Meslay-Du-Maine
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Châteaur GONTIER JUBLAINS SAULGES ÉVRON
BILAN touristique 2019 LASSAY-LES- CHÂTEAUX MAYENNE JUBLAINS ÉVRON SAINTE-SUZANNE LAVAL SAULGES COSSÉ- LE-VIVIEN CHÂTEAU- GONTIER La fréquentation touristique 2019 en Mayenne Deux bons mois estivaux (juin et août) et une bonne fin d’année ont permis de rattraper une première partie d’année difficile, dû aux conditions climatiques difficiles notamment. Une bonne fin d’année a permis à l’hôtellerie d’avoir un bilan 2019 supérieur à celui de 2018 (+2%). L’hôtellerie, de plus en plus tournée vers la clientèle affaire, marque de moins en moins la saison estivale et tend à lisser son activité de manière constante sur l’ensemble de l’année. Les gîtes et meublés marquent le pas cette année alors que les chambres d’hôtes constatent elles une baisse entre 2018 et 2019. Les campings ont pu stabiliser leur nombre de nuitées cette année (+0,1%), et ce malgré 3 mois de la saison très impactés par la météo (mai, août et septembre), très en deçà de ses standards habituels (-18, -4 et -5%). Les sites culturels et de loisirs ont connu une année similaire, voir à la hausse, par rapport à 2018, suivant ainsi la tendance régionale. Le changement notable de cette saison en Mayenne est à pointer sur l’augmentation de la part de public individuel, +8 points à 72% des publics accueillis. Sommaire • la fiche d’identité de la Mayenne p.4 • l’itinérance en mayenne p.6-7 • LES secteurS d’activité Hôtellerie p.8-11 Hôtellerie de plein air p.12-15 Meublés de tourisme p.16-17 Lieux de visite, sites de loisirs et événements p.18-19 3 Fiche d’identité de la Mayenne CHIFFRES -

DDFIP Présentation Du Dispositif
Exonération de CFE pour les professions libérales de santé DDFIP Présentation du dispositif Les professions libérales exerçant une activité médicale peuvent, sous conditions, bénéficier d'une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE). La cotisation foncière des entreprises (CFE) est l'une des 2 composantes de la contribution économique et territoriale (CET). C'est une taxe professionnelle basée uniquement sur les biens soumis à la taxe foncière. Elle est due par les professionnels exerçant à titre habituel une activité non salariée au 1er janvier de l'année d'imposition. Conditions d'attribution A qui s’adresse le dispositif ? Entreprises éligibles Sont concernés par l'exonération : les infirmiers et infirmières, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sage-femme, les orthophonistes, les orthoptistes les manipulateurs d'électroradiologie médical et techniciens de laboratoire médical, les audioprothésistes, prothésistes, orthésistes pour l'appareillages des personnes handicapées, les opticiens -lunetiers les diététiciens, les vétérinaires investis du mandat sanitaire dès lors que ce mandat sanitaire concerne au moins 500 bovins de plus de 2 ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins. Critères d’éligibilité A compter de l'année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant -

Saint Loup Du Dorat Rondes Et Rectangulaires, Commodes, Lits, Horloges, 06.03.66.92.59 Tables De Nuit Et De Toilette, Malles
ULLETIN B MUNICIPAL DE LA VILLE 2018 Saint Loup du Dorat www.saintloupdudorat.fr P a g e | 2 Antiquités - Brocante Sylvie GILLET Monsieur LARDEUX Coiffeuse à domicile ACHÈTE A DOMICILE. Contact au 06.73.25.06.07 Les Allais Tous meubles anciens : buffets, armoires, tables 53290 Saint Loup du Dorat rondes et rectangulaires, commodes, lits, horloges, 06.03.66.92.59 tables de nuit et de toilette, malles. DÉBARRAS CAVES, GRENIERS ET MAISONS APRÈS SUCCESSION OU DÉMÉNAGEMENT Paiement comptant - discrétion assurée Jérôme LAMBERT Entreprise de maçonnerie Les Angevinières 53290 Saint Loup du Dorat Tél. : 06.17.62.44.01 AGRIDUO Au service des éleveurs agriculteurs AGRIDUO vous propose des produits pour vos animaux et vos cultures. Groupe AGRI-NEGOCE AGRIDUO - Rue des Chênes 53290 Saint Loup du Dorat CAP’PAYSAGE Tél : 02.43.07.54.14 Entreprise de conseils et réalisations d’aménagement et d’entretien dans le domaine du paysage. Olivier CLÉMENT Lieu-dit La Foupraie SAINT LOUP DU DORAT 02 53 68 00 60 Les écuries du Loup PONEY CLUB - CENTRE EQUESTRE - PENSIONS - BALLADES Gaëlle BONNAUDET La Bouchardière Eric ESNAULT 53290 Saint Loup du dorat Entreprise de ravalement de façade Tél : 02.43.06.10.51 11, rue Principale Mobile : 06.42.05.90.92 53290 Saint Loup du Dorat Site : http://www.ecuriesduloup.fr 02.43.07.69.58 P a g e | 3 LE ROND-POINT Restaurant ouvrier et routier, de cuisine traditionnelle propose une formule le midi et le soir avec buffet entrées, plat, fromage, dessert, café, 1/4 de vin ou de cidre. -

Arrêté Zonage Régional Médecins
ARRETE N° ARS-PDL/DOSA/681/2020 relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE DES PAYS DE LA LOIRE Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 632-6 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-4 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-14-1 et L.162-32-1 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1511-8 ; Vu le code général des impôts, notamment son article 151 ter; Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 158 ; Vu le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 modifié fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains ; Vu le décret n° 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l’offre est particulièrement élevé ; Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination du directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire - M. COIPLET (Jean-Jacques) Vu l'arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux dispositions applicables à la détermination des zones prévues à l'article L.1434-7 du code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie signée le 25 août 2016 ; Vu l'arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. -
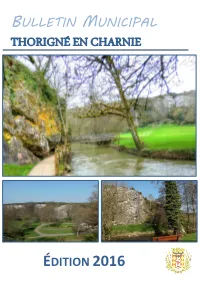
Thorignéencharnie
BULLETIN MUNICIPAL THORIGNÉ EN CHARNIE ÉDITION 2016 Le mot du Maire Nous voilà déjà au crépuscule de cette année 2017. 2016 s’achève avec son lot de bons et moins bons souvenirs. Dans les nouvelles les plus agréables, L’accord des subventions qui nous sont allouées pour la réalisation du projet salle multiculturelle avec adjonction d’une salle dite de cantine ; L’arrivée du haut-débit pour espérer voir les habitants mieux connectés. Dans le domaine des inquiétudes disons, Les réformes de la Loi NOTRe qui engagent des révisions importantes sur le mode de fonctionnement de nos collectivités. Beaucoup de dossiers seront administrés par les Communautés de Communes (ex : compétences urbanisme, eau, assainissement voire mutualisation du personnel). Beaucoup de maire se posent la question : « Quel sera le pouvoir décisionnel de nos conseils municipaux ? » Autres soucis, Notre modèle de RPI pourrait être remis en cause par l’inspection académique en raison de la faiblesse de nos effectifs, nous veillerons à défendre la valeur de l’enseignement à l’intérieur de notre territoire. En 2017, vous allez être sollicité pour choisir le renouvellement de la présidence de la République, suivra l’élection des membres de l’Assemblée Nationale, je vous encourage à participer à ce mouvement démocratique qui vous est offert. L’agriculture a vécu une année difficile. Tout d’abord par un climat peu favorable à la qualité et aux rendements. Les prix des céréales, du lait et de la viande bovine et porcine qui conduisent à des inquiétudes dans nos campagnes. Sommes-nous dans une crise structurelle, nous pouvons craindre une remise en cause du modèle de notre agriculture, faisons confiance à la profession pour s’adapter et ceci dans le respect de chacun. -

Barrage De La Voisinière
SYNDICAT DU BASSIN DE LA VAIGE Code ouvrage VAIGSIT019 Commune de Saint Loup du Dorat / Bouessay Parc d’activités du Laurier 29 avenue Louis Bréguet 85180 LE CHATEAU D’OLONNE Tél : 02 51 32 40 75 Fax : 02 51 32 48 03 Email : [email protected] _____________________________________________________________________________________________Hydro concept 2016 Dossier d'autorisation et de déclaration d’intérêt général de travaux sur les ouvrages du bassin de la Vaige Vannage et chaussée de Virefolet 2 _____________________________________________________________________________________________Hydro concept 2016 SOMMAIRE I - Carte de situation.................................................................................................... 5 II - Etat initial du site .................................................................................................... 6 Description ...................................................................................................... 6 Les éléments en présence ................................................................................ 6 Renseignements descriptifs ............................................................................... 6 Règlement d’eau et usages ................................................................................. 8 Règlement d'eau ............................................................................................. 8 Gestion de l’ouvrage ......................................................................................... 8 Classement -

Bassins D'alimentation Des Captages Prioritaires Dans Le Département De La Mayenne
Bassins d'alimentation des captages prioritaires dans le département de la Mayenne MANCHE ORNE n. LIGNIERES o! r i La May ORGERES A ' L e RENNES-EN nne FOUGEROLLES GRENOUILLES !. LA PALLU LANDIVY DU-PLESSIS THUBOEUF L SAINT a SAINT NEUILLY F DESERTINES CALAIS-DU u JULIEN-DU SAINTE LE-VENDIN t LE HOUSSEAU COUPTRAIN DESERT a SOUCE TERROUX i MARIE e SAINT-AUBIN BRETIGNOLLES MADRE L SAINT PRE-EN LA DOREE a DU-BOIS VIEUVY FOSSE LESBOIS COUESMES AIGNAN-DE PAIL-SAINT " LOUVAIN V SAINT-MARS VAUCE a COUPTRAIN SAMSON re PONTMAIN SUR-LA n n n CHEVAIGNE CHAMPFREMONT o h FUTAIE e LASSAY-LES SAINT-CYR t SAINT SAINT LEVARE HERCE GORRON DU-MAINE RAVIGNY r . CHATEAUX a ! LE PAS AMBRIERES EN-PAIL S ELLIER-DU BERTHEVIN-LA BOULAY e LES-VALLEES JAVRON-LES L MAINE TANNIERE CHANTRIGNE LES-IFS CHARCHIGNE CHAPELLES COLOMBIERS BRECE CARELLES L SAINT VILLEPAIL MONTAUDIN DU-PLESSIS a SAINT-LOUP LE HORPS C MONTREUIL SAINT-PIERRE o MARS-SUR LA HAIE l DU-GAST ne m COLMONT POULAY 'Ais DES-NIDS " on TRAVERSAINE L LE RIBAY CRENNES-SUR t L SAINT LE HAM FRAUBEE ' LARCHAMP OISSEAU GESVRES Ornette DENIS-DE SAINT CHAMPEON GASTINES FRAIMBAULT L CHATILLON AVERTON ' E DE-PRIERES LOUPFOUGERES VILLAINES r SUR-COLMONT LA PELLERINE n HARDANGES é PARIGNE LA-JUHEL e Le M . MARCILLE erde ! SUR-BRAYE LA CHAPELLE rea ERNEE LA-VILLE u SAINT SAINT MAYENNE AU-RIBOUL SAINT-AUBIN VAUTORTE PIERRE-DES GEORGES ARON DU-DESERT BUTTAVENT ron COURCITE LANDES SAINT L'A SAINT MONTENAY BAUDELLE CHAMPGENETEUX LA BAZOGE GRAZAY MARS-DU MONTPINCON TRANS DESERT PLACE MOULAY CONTEST La Va udelle SAINT GERMAIN-DE -

Enedis Prend De La Hauteur Pour Assurer La Maintenance Des Lignes Électriques Aériennes En Survolant Différentes Communes De La Mayenne
Communiqué de presse 2021 Enedis prend de la hauteur pour assurer la maintenance des lignes électriques aériennes en survolant différentes communes de la Mayenne La distribution de l’électricité est un service public qui relève des compétences des collectivités locales. Celles-ci sont propriétaires du réseau de distribution et en confient la gestion à Enedis dans le cadre d’une délégation de service public. Enedis est chargée d’assurer l’exploitation du réseau, d’entretenir et développer les infrastructures. Pour maintenir la qualité de l’alimentation à un niveau élevé, Enedis réalise des investissements pour développer, moderniser, automatiser et sécuriser les lignes, notamment face aux aléas climatiques. C’est pourquoi, afin de surveiller les lignes électriques aériennes de moyenne tension, nous avons mis en place, un survol de plusieurs communes de la Mayenne par hélicoptère. Ces survols se déroulent chaque année et ont pour objectif de détecter et localiser les équipements présentant des défaillances ou des signes d’usure qui justifient leur remplacement (poteaux endommagés, isolateurs cassés, lignes avec des brins coupés, supports déformés) et d’analyser la végétation de part et d’autre des supports afin d’établir des plans d’élagage. C’est donc une collecte d’information importante, qui permet à Enedis de réaliser un diagnostic précis de points de fragilité pour cibler ensuite les opérations de maintenance et d’élagage à entreprendre et ainsi éviter d’éventuelles pannes électriques Cette année, le survol des lignes en Mayenne aura lieu entre le 10 au 28 mai 2021. Ces vols seront réalisés à très basse altitude pour la réalisation de diagnostic des réseaux électriques de la commune. -

Bulletin Municipal 2017
BULLETIN MUNICIPAL 2017 p.3 LE MOT DU MAIRE p.4 p.8 RENSEIGNEMENTS DEMARCHES PRATIQUES ADMINISTRATIVES p.14 p.17 SERVICES ETAT CIVIL COMMUNAUX p.19 p.23 VIE ACTUALITES MUNICIPALE p.27 p.31 VIE VIE ECOLIERE ASSOCIATIVE ommaire p.34 p.45 PRESSE AGENDA S p.46 p.52 PUBLICITE COM2COM Page | 2 LE MOT DU MAIRE Chers amis, En ce début d’année 2018, permettez-moi de vous souhaiter mes meilleurs vœux, qu’ils se réalisent dans la sérénité familiale et professionnelle avec les carburants des bâtisseurs de l’organisation de notre vie sociale : l’optimisme et la patience. L’équipe municipale porte toujours une grande attention à la vie communale pour que, les uns et les autres, vous puissiez vivre avec plaisir dans notre commune rurale. Cette ruralité, nous y sommes tous, à des degrés divers, très attachés, à la condition évidemment, d’y trouver suffisamment de vitalité. Je pense que nos efforts en la matière sont récompensés : La dernière rentrée scolaire a vu l’ouverture d’une troisième classe. Cette situation est le reflet de notre engagement orienté vers l’accueil de nouvelles familles tant au niveau du parc locatif local que dans la réalisation de projet personnel de construction d’un pavillon individuel. Le lotissement des Noyers devrait accueillir plusieurs pavillons dans les mois à venir. Au cours de cette nouvelle année, vous allez découvrir un nouvel interlocuteur de la gestion de l’eau et de l’assainissement. Depuis le 1er janvier 2018, le transfert de compétences « Eau » et « Assainissement » s’est effectué en direction de la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez. -

Procès-Verbal Du Conseil Municipal Du 25 Février 2016
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FÉVRIER 2016 L'an deux mil seize, le vingt-cinq février à vingt heures trente, les membres du conseil municipal se sont réunis à l’Hôtel de Ville de MESLAY-DU-MAINE, sous la présidence de Madame Noëlle LAUNAY, Maire Présents : Mme LAUNAY, Maire, M. POULAIN, M. BORDIER, Mme GAUTIER, M. BOULAY, Mme TAUNAIS, Adjoints, M. GASCOIN, Mme CHEVALIER, Mme MOREAU, Mme BRUNEAU, Mme PICHEREAU, M. BIDAUD, Mme BOURDAIS, M. BOUTIN, Mme BERTHELOT, M. MOULIN, M. ABAFOUR, Mme JARDIN Conseillers municipaux. Absent(s) ayant donné pouvoir : M. GOUAS à Mme LAUNAY Absent(s) : M. BRAULT, M VEILLÉ, Mme MONNERET Il a été procédé, conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) à la nomination d'un secrétaire parmi les membres du conseil : M. BORDIER, a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées. ORDRE DU JOUR : Approbation du compte-rendu du 21 janvier 2015 Décisions du Maire Délibérations du Conseil municipal Administration générale Validation de l’agenda d’accessibilité programmée Budget finances Indemnités allouées au Comptable public Remise de majoration et d’intérêt de retard sur la taxe d’urbanisme Participation financière au fonds de solidarité logement pour les factures d’eau Tarifs communaux – modification 2016-01 Prix de vente des terrains du lotissement de l’Allée de l’Epeautre Subventions et participations à des personnes morales de droit privé et public. Personnel et services Dispositif argent de poche Modification du tableau des emplois et des -

BOUESSAY Bulletin Municipal
BOUESSAY Bulletin municipal Décembre 2020 N°62 Une nouvelle année va s’achever particulièrement chargée en émotion au vu de la crise sanitaire que nous avons traversée et traver- sons. Toutes vies sociales et familiales sont quasiment inexistantes. La vie associative est en mode léthargique, merci aux différents membres des associations qui font preuve d’imagination et de persévérance pour continuer leurs missions, nous allons vers des jours meilleurs. Nous sa- vons malheureusement que nous allons devoir vivre avec, pour plusieurs mois encore. Le respect des gestes barrières est la mesure la plus effi- cace pour contrer ce virus, ne nous relâchons pas ! Restons vigilants ! La propagation du virus reste et restera importante. Je sais pouvoir compter sur votre sens des responsabilités individuelles pour vous protéger et sur- tout, les personnes les plus fragiles. Après un arrêt de l’école le 13 Mars, nous avons pu ouvrir suite au confinement, le 18 Mai, et tenions à cette ouverture même si les condi- tions d’accueil étaient difficiles et contraignantes. Nous avons persisté dans l’intérêt des enfants et des familles. L’année 2021 devrait voir la finalité du PLUIH (plan local d’urbanisme habitat) qui a été un long travail et les différents raccordements de la fibre devraient se terminer. Un nouveau conseil communautaire a vu le jour suite aux élections municipales, sous la présidence de Daniel Chevalier. Ce dernier veut une implication des maires de toutes nos communes sous forme de vice prési- dence ou vice présidence déléguée. Il m’a confié comme délégation la commission environnement, ce qui prouve que notre commune est reconnue et a sa place. -

DREAL Pays De La Loire Mission Énergie Et Changement Climatique Mis À Jour Le 15 /04 /2013 ETAT DES ZONES DE DEVELOPPEMENT DE L'eolien (ZDE) AUTORISEES
DREAL Pays de la Loire Mission énergie et changement climatique mis à jour le 15 /04 /2013 ETAT DES ZONES DE DEVELOPPEMENT DE L'EOLIEN (ZDE) AUTORISEES Collectivité(s) proposante(s) Caractéritiques de la ZDE (puissance en MW) Arrêté préfectoral Nom(s) Dept Nom des communes concernées Min Max Date Observations Froidfond et La Garnache 85 Froidfond-La Garnache 6 40 02 -août-06 CC du Canton de Montrevault et du Saint Quentin en Mauges et Le Pin en 49 10 30 04-oct-07 Centre Mauges Mauges Le Bernard et Longeville sur Mer 85 Le Bernard et Longeville sur Mer 3 25 08 -févr-08 Coëx, Saint Maixent sur Vie, Saint CC Atlancia 85 10 30 08 -févr-08 Révérend Chemillé, Cossé d'Anjou, Mélay, CC Région de Chemillé 49 6 60 24-sept-08 "Plateau de chemillé" Valanjou Chanzeaux, Chemillé, Jallais, la CC Région de Chemillé, du Centre 49 Chapelle Rousselin, Saint Georges des 6 57 11-janv-11 "itinéraire de l'A87 " Mauges et commune de Trémentines Gardes, Trémentines, Valanjou Lassay-les-Châteaux, Le Horps, Montreuil-Poulay, Chantrigné, Champéon, Charchigné, la Chapelle-au- CC Le Horps-Lassay, des Avaloirs et Riboul, Hardanges, Le Ribay, Le Ham, 10-jun-11 de Villaines-la-Juhel et commune de 53 Javron-les-Chapelles, Crennes-sur- 0 115 31-juil-09 "synclinal de Pail" Chantrigné Fraubée, Villepail, Saint-Cyr-en-Pail, 15-oct-08 Pré-en-Pail, Saint-Aignan-de-Couptrain , Chevaigné-du-Maine, Saint-Calais-du- désert Champgenéteux, Hambers, Bais, Trans , CC de Villaines-la-Juhel et de Bais 53 Courcité, Saint Thomas-de-Courceriers , 0 70 15-oct-08 "du Teil à Mont Méard" Saint