Histoire Anecdotique De La Fronde
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Archives De La Famille Ferry
Archives départementales des Vosges 40 J Archives de la famille Ferry (1813-1981) Répertoire numérique détaillé établi par Mélanie GLESS stagiaire, licence Gestion de l’information et du Document pour les Organisations à Mulhouse avec la collaboration de Benoît MARTIN attaché de conservation sous la direction d’Isabelle CHAVE , conservatrice du patrimoine, directrice des Archives départementales des Vosges Épinal, 2005/2006 INTRODUCTION ________________________________________________________________________________ Historique du fonds Les archives de la famille Ferry sont entrées aux Archives départementales des Vosges en 1985 par voie extraordinaire. Elles ont été rassemblées par Hélène Ferry, épouse d’Abel, - lui-même neveu de Jules Ferry -, qui en a fait don pour une grande partie à sa fille Fresnette Pisani-Ferry. Cette dernière, dans son testament olographe du 8 février 1978, légua au musée des Ferry à Saint-Dié-des- Vosges « toutes les archives classées par sa mère ». Cependant, deux codicilles vinrent bouleverser leurs destinées en 1981 et 1982. En 1981, elle annula les précédentes dispositions au bénéfice de la bibliothèque municipale de Saint-Dié et fixa des conditions de conservation, de classement et d'accessibilité du fonds, dont le contrôle fut délégué au directeur du Centre national de la recherche scientifique. Le non respect de ces conditions avéré, elles furent léguées aux Archives de France en 1982, qui confirma, en 1985, la conservation physique du fonds aux Archives départementales des Vosges. Initialement conservé au chalet des Ferry à Saint-Dié, le fonds a donc été successivement conservé à la bibliothèque municipale de Saint-Dié, puis aux Archives départementales des Vosges, à Épinal. La correspondance de Jean Pisani-Ferry, exécuteur testamentaire de sa mère, Fresnette, et d’Odile Jurbert, directrice des Archives départementales des Vosges, en 1985, laisse à penser qu’une partie du fonds était toujours conservée dans une propriété de la famille Ferry à cette date. -

LA GUERRE ET LES GRANDS BATIMENTS L’Homme Prime La Fonction, Voire Les Fonctions, Car Les Ministres Cumulent Souvent Plusieurs Attributions
MINISTERE DE LA DEFENSE ETAT-MAJOR DE L’ARMEE DE TERRE SERVICE HISTORIQUE LA GUERRE ET LES GRANDS BATIMENTS INDEX DE LA CORRESPONDANCE EXPEDIEE PAR FRANÇOIS-MICHEL LE TELLIER MARQUIS DE LOUVOIS SECRETAIRE D’ETAT DE LA GUERRE ET SURINTENDANT DES BATIMENTS DU ROI 1683-1691 SOUS-SERIE A1 696-1033 par Thierry SARMANT Archiviste-paléographe Docteur de l’université de Paris-I-Sorbonne Conservateur au Service historique de l’armée de Terre et Mathieu STOLL Archiviste-paléographe Conservateur stagiaire des bibliothèques Préface d’André CORVISIER Professeur émérite à l’université de Paris-Sorbonne Château de Vincennes 1999 Louvois plus haut que lui ne voyait que son maître. Dans le sein des grandeurs, des biens et des plaisirs, Un trait fatal et prompt borne enfin ses désirs Et ne lui laisse pas le temps de se connaître. Hélas, aux grands emplois à quoi sert de courir ? Pour veiller sur soi-même, heureux qui s’en délivre ! Qui n’a pas le temps de bien vivre Trouve malaisément le temps de bien mourir. Charles Perrault Épitaphe de Louvois, 1691 PREFACE Dans la mémoire collective des Français et même de leurs voi- sins, le nom de Louvois est resté lié aux guerres de Louis XIV. Il apparaissait déjà tel aux courtisans ses contemporains, qui, dans l’Esther de Racine, crurent le reconnaître sous les traits d’Aman, le mauvais ministre d’Assuérus. L’historiographie ne l’a pas ménagé. Évoquant les dragonnades et l’incendie du Palatinat, Ernest Lavisse, dans son manuel d’enseignement primaire qui a formé le jugement de tant de générations, n’hésite pas à écrire que c’était « un méchant homme ». -

La Poste D'autrefoi S
LA POSTE 1 - CHARTE DE 1442. DE MERELLESSART (Guillaume), seigneur de la Souleresse et Catherine GOURRANDE, D’AUTREFOI sa femme reconnaissant avoir vendu à Pierre Briant une mine de froment annuelle. 30 Janvier 1442. Acte passée S devant l’Official de POITIERS et en la Cour de MIREBEAU (86) ; signé Bouteau. (C. Cabinet d’Hozier) – 250/ 300 € LA POSTE 2 – CHARTE DU 18 Octobre 1447 – Pièce adressée à Pierre YSABEAU, Prêtre par Philibert de Marcassin D’AUTREFOI Prieur du Monastère de Notre-Dame de LA CHARITÉ SUR LOIRE, de l’Ordre de Cluny. Texte en latin - Cabinet S d’Hozier. 200/ 250 € Photo 15 LA POSTE 3 – (SEL & GABELLE – 1542) - Arrêt de la Chambres des Comptes de PARIS, contre Joseph DORET, avocat à D’AUTREFOI CHÂTEAUDUN (28), au profit de François ALAMANT Seigneur du CHASTELLET, contrôleur général des S Greniers à Sel du royaume, au sujet d’amendes et de restitutions de Gabelles, 16 septembre 1542 – « Extrait des registres des Commissaires commis par le Roi sur la Réformation et fait des Greniers à Sel. » - Parchemin (54 x 51) – 200/ 250 € LA POSTE 4 – Henri 1er, Seigneur de DAMVILLE, puis Duc de MONTMORENCY, Maréchal de France en 1566 D’AUTREFOI (Chantilly/ Oise 1534 – Agde 1614) – S Lettre signée « Henry Duc de MONTMORENCY » à LYON le 18 août 1600 – adressé à M. de la Mure Notre Bailli à Roze en Reynie – Il parle de son nepveu (neveu) et de Mr de VENTADOUR et d’une somme à donner - 1p in-4° - 300/ 400 € LA POSTE 5 – FAUCONNERIE. 1567 - Quittance de Nicolas VONC dit Andrenelle Gentilhomme de la Fauconnerie, pour D’AUTREFOI ses appointements de son état de Gentilhomme de Fauconnerie pour les quartiers de janvier février et mars - S Fait et passé en 1567 - Parchemin (19 x 14) – 150/ 200 € LA POSTE 6 - (SEINE-MARITIME). -

Collection D'autographes, De Dessins Et De Portraits De Personnages Célèbres, Français Et Étrangers, Du Xvie Au Xixe Siècle, Formée Par Alexandre Bixio
BnF Archives et manuscrits Collection d'autographes, de dessins et de portraits de personnages célèbres, français et étrangers, du XVIe au XIXe siècle, formée par Alexandre Bixio. XVIe-XIXe siècle. Cote : NAF 22734-22741 Collection d'autographes, de dessins et de portraits de personnages célèbres, français et étrangers, du XVIe au XIXe siècle, formée par Alexandre Bixio. XVIe-XIXe siècle. Papier.Huit volumes, montés in-fol.Demi-reliure. Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits Document en français. Présentation du contenu Un inventaire détaillé de cette collection a été publié par Léon Dorez dans le Bulletin d'histoire du Comité des travaux historiques (1916), p. 276 et suiv : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5787089t/f284.image. Informations sur les modalités d’entrée Don de Mmes Rouen-Bixio et Depret-Bixio, 1916 (D 5005) I. A - B Cote : NAF 22734 Réserver I. A - B 250 f. Ce document est conservé sur un site distant. Conditions d'accès Un délai est nécessaire pour la communication de ce document. En savoir plus. Documents de substitution Il existe une version numérisée de ce document. Numérisation effectuée à partir d'un document original : NAF 22734. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b100272996 Lettre de Mehmet-Emin Aali-Pacha division : F. 1 Lettre de Mehmet-Emin Aali-Pacha 1856 ? Portrait de Mehmet-Emin Aali-Pacha division : F. 2 Portrait de Mehmet-Emin Aali-Pacha Dessin à la plume et encre brune ; 170 x 113 mm. Présentation du contenu Attribué à Nadar par Léon Dorez. 01/10/2021 https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc4092h Page 1 / 238 BnF Archives et manuscrits Lettre d'Abd el Kader au général Bugeaud division : F. -

Histoire Généalogique Des Familles Nobles Du Nom De La Porte
This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible. https://books.google.com A propos de ce livre Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne. Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression “appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public. Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains. Consignes d’utilisation Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. -

Télécharger L'inventaire En
Châtelet de Paris. Y//197-Y//200. Insinuations (14 août 1659 - 11 mars 1662) Inventaire analytique Par É. Campardon, Ch. Samaran, M.-A. Fleury et G. Vilar Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine XIXe siècle 1 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_005836 Cet instrument de recherche a été encodé en 2010 par l'entreprise diadeis dans le cadre du chantier de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales sur la base d'une DTD conforme à la DTD EAD (encoded archival description) et créée par le service de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales 2 Archives nationales (France) INTRODUCTION Référence Y//197-Y//200 Niveau de description fonds Intitulé Châtelet de Paris. Insinuations Date(s) extrême(s) 14 août 1659 - 11 mars 1662 Localisation physique Paris 3 Archives nationales (France) Inventaire analytique Y//197 Insinuations. Y//197 Dates des insinuations : 14 août 1659 - 10 avril 1660 fol. 3 Marie Guillochon, veuve d'Antoine Hiret, commissaire examinateur en la prévôté royale de Tours, y demeurant, actuellement logée à Paris, rue Traversière, paroisse Saint-Roch : donations aux couvents et hôpitaux de la Charité Notre-Dame fondés à la Roquette, près Paris, d'une rente de 6 livres 12 fols tournois. Notice n° 3024 Date de l'acte : 7 août 1659 fol. 3 V° Pierre Mary, marchand et tonnelier, demeurant à Puiseaux en Gâtinais, et Marguerite Géault, sa femme : donation mutuelle. Notice n° 3025 Date de l'acte : 9 août 1659 fol. 4 V° Anne Le Mercier, femme de Thibault Nicau, grand prévôt du régiment des gardes Suisses du Roi, résidant à Saint-Denis en France : donation à Reine Nicau, fille d'un premier lit de son mari, de la propriété d'une maison à Saint-Denis en France, rue Compoise autrement dite de Lestrée. -

Le Soleil Comme La Mort
Université Rennes 2 Centre de Recherches Historiques de l'Ouest Le soleil comme la mort. Le manuscrit du capucin Balthazar de Bellême, 1603-1667 Volume 2 Catherine PICHOT Mémoire de Master 2 d'Histoire sous la direction de Georges PROVOST 2016 Table des matières Annexe 1 : Ephéméride annoté.............................................................................................................5 Annexe 2 : Le Thrésor de Pierre Guillebaud......................................................................................34 Annexe 3 : Les citations latines..........................................................................................................41 Annexe 4 : Prière à Marie...................................................................................................................44 Annexe 5 : Table des illustrations du volume 1..................................................................................46 Annexe 6 : Table des cartes, tableaux et graphiques du vol. 1...........................................................48 Annexe 7 : illustrations du manuscrit.................................................................................................49 7-1 « Grand, admirable et lugubre miroir de l'inconstance humaine »..........................................49 7-2 « Miseremini Mei ».................................................................................................................50 7-3 Portement de croix...................................................................................................................51 -

Collection Georges De Morand (Xiiie-Xxe Siècles)
Collection Georges de Morand (XIIIe-XXe siècles). Inventaire analytique (AB/XIX/3410-AB/XIX/3461, AB/XIX/3535). Auteur inconnu. Revu et corrigé pour l'édition électronique par Th. Guilpin, chargé d'études documentaires. Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine XXe siècle 1 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_003586 Cet instrument de recherche a été encodé en 2010 par l'entreprise diadeis dans le cadre du chantier de dématérialisation des instruments de recherche des Archives nationales sur la base d'une DTD conforme à la DTD EAD (encoded archival description) et créée par le service de dématérialisation des instruments de recherche des Archives nationales. 2 Archives nationales (France) INTRODUCTION Référence AB/XIX/3410-AB/XIX/3461, AB/XIX/3535 Niveau de description fonds Intitulé Collection Georges de Morand. Date(s) extrême(s) XIIIe-XXe siècles Nom du producteur • Cabinet des généalogistes de l’ordre de Malte (XVIIIe siècle-XIXe siècle) • Morant, Georges de (1878-1961 ; comte) • Saint-Allais, Nicolas Viton de (1773-1842) • Collège héraldique de France (1841-XXe siècle) Importance matérielle et support Localisation physique Pierrefitte-sur-Seine Conditions d'accès Communication libre, sous réserve du règlement en vigueur dans la salle de lecture des Archives nationales. Conditions d'utilisation Reproduction autorisée, selon les modalités en vigueur aux Archives nationales. DESCRIPTION Présentation du contenu La collection de Morand, entré par achat aux Archives nationales, est la suite logique des collection d’Hozier, Chérin et Saint-Allais (AB/XIX/3261-AB/XIX/3294). En effet, Georges de Morand, qui dirigeait la publication de l' Annuaire de la noblesse Française, avait racheté une partie des archives qui composaient le cabinet de généalogiste de Magny aux successeurs de celui-ci. -

François-Xavier Ortoli
Fonds inventory François-Xavier Ortoli Firenze November 2012 François-Xavier Ortoli Sommaire FXO François-Xavier Ortoli _____________________________________________ 6 FXO.01 De la jeunesse aux premières expériences professionnelles ___ 7 FXO.01.01 Jeunesse et études ______________________________________________________ 7 FXO.01.02 Inspecteur général des Finances _________________________________________ 8 FXO.01.03 Cabinet Buron, DREE, DG Marché intérieur ______________________________ 9 FXO.02 Du SGCI aux fonctions de ministre ______________________________ 10 FXO.02.01 SGCI et cabinet Pompidou ______________________________________________ 10 FXO.02.02 Commissaire général du Plan ___________________________________________ 11 FXO.02.03 Ministre: Equipement et logement; Education nationale ________________ 13 FXO.03 Ministre des Finances ____________________________________________ 13 FXO.03.01 Discours et interventions _______________________________________________ 14 FXO.03.02 Crise du franc ___________________________________________________________ 15 FXO.03.03 Chronos et affaires diverses ____________________________________________ 16 FXO.04 Ministre du Développement industriel et scientifique __________ 19 FXO.04.01 Discours et communiqués _______________________________________________ 19 FXO.04.02 Chrono et affaires de personnel _________________________________________ 21 FXO.04.03 Affaires sectorielles et déplacements ___________________________________ 23 FXO.04.04 Négociations pétrolières avec l'Algérie __________________________________ -
Lettres & Manuscrits Autographes
LETTRES & MANUSCRITS AUTOGRAPHES DESSINS - AQUARELLES - PHOTOGRAPHIES JEUDI 8 JUILLET 2021 AUTOGRAPHES - DESSINS - PHOTOGRAPHIES - DESSINS AUTOGRAPHES INFORMATIONS ET SERVICES POUR CETTE VENTE SELARL AGUTTES & PERRINE commissaire-priseur judiciaire RESPONSABLE DE LA VENTE SOPHIE PERRINE [email protected] EXPERT POUR CETTE VENTE THIERRY BODIN Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres d’Art Tél.: +33 (0)1 45 48 25 31 [email protected] RENSEIGNEMENTS & RETRAIT DES ACHATS Uniquement sur rendez-vous MAUD VIGNON Tél.: +33 (0) 1 47 45 91 59 [email protected] Assistée de Henri Lafaye [email protected] FACTURATION ACHETEURS Tél. : +33 (0)1 41 92 06 41 [email protected] ORDRE D’ACHAT [email protected] RELATIONS PRESSE SÉBASTIEN FERNANDES Tél. : +33 (0)1 47 45 93 05 [email protected] 42 LETTRES & MANUSCRITS AUTOGRAPHES DESSINS - AQUARELLES - PHOTOGRAPHIES APRÈS LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ ARISTOPHIL JEUDI 8 JUILLET 2021, 14H30 NEUILLY-SUR-SEINE EXPOSITION PUBLIQUE NEUILLY-SUR-SEINE VENDREDI 2 JUILLET : 10H - 13H ET 14H - 17H DU LUNDI 5 AU MERCREDI 7 JUILLET : 10H - 13H ET 14H - 18H JEUDI 8 JUILLET : 10H - 12H CATALOGUE COMPLET ET RÉSULTATS VISIBLES SUR WWW.COLLECTIONS-ARISTOPHIL.COM ENCHÉRISSEZ EN LIVE SUR SELARL AGUTTES & PERRINE - COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE Neuilly-sur-Seine • Paris • Lyon • Aix-en-Provence • Bruxelles Suivez-nous | aguttes.com/newsletter | 1 LES COLLECTIONS ARISTOPHIL EN QUELQUES MOTS Importance C’est aujourd’hui la plus belle collection de manuscrits et autographes au monde compte tenu de la rareté et des origines illustres des œuvres qui la composent. Nombre Plus de 130 000 œuvres constituent le fonds Aristophil. L’ensemble de la collection a été trié, inventorié, authentifié, classé et conservé dans des conditions optimales, en ligne avec les normes de la BNF. -
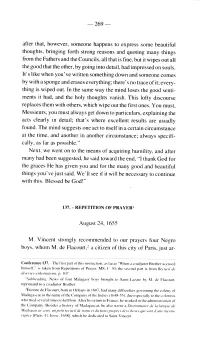
After That, However, Someone Happens to Express Some Beautiful Thoughts, Bringing Forth Strong Reasons and Quoting Many Things F
— 269 — after that, however, someone happens to express some beautiful thoughts, bringing forth strong reasons and quoting many things from the Fathers and the Councils, all that is fine, but it wipes out all the good that the other, by going into detail, had impressed on souls. It's like when you’ve written something down and someone comes by with a sponge and erases everything; there’s no trace of it; every thing is wiped out. In the same way the mind loses the good senti ments it had, and the holy thoughts vanish. This lofty discourse replaces them with others, which wipe out the first ones. You must. Messieurs, you must always get down to particulars, explaining the acts clearly in detail; that’s where excellent results are usually found. The mind suggests one act to itself in a certain circumstance at the time, and another in another circumstance; always specifi cally, as far as possible.” Next, we went on to the means of acquiring humility, and after many had been suggested, he said toward the end, “I thank God for the graces He has given you and for the many good and beautiful things you’ve just said. We'll see if it will be necessary to continue with this. Blessed be God!” 137. - REPETITION OF PRAYER1 August 24, 1655 M. Vincent strongly recommended to our prayers four Negro boys, whom M. de Flacourt,2 a citizen of this city of Paris, just ar- Conference 137. - The first part o f this instruction, as far as “When a coadjutor Brother accused himself." is taken from Repetitions o f Prayer. -

Pièces Isolées, Collections Et Papiers D'érudits. Tome 4
Pièces isolées, collections et papiers d'érudits. Tome 4. Inventaire général de la sous-série AB/XIX (AB/XIX/2690-AB/XIX/3255). Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 1942-2014 1 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_003577 Cet instrument de recherche a été encodé par l'entreprise diadeis dans le cadre du chantier de dématérialisation des instruments de recherche des Archives nationales sur la base d'une DTD conforme à la DTD EAD (encoded archival description) et créée par le service de dématérialisation des instruments de recherche des Archives nationales. 2 Archives nationales (France) INTRODUCTION Référence AB/XIX/2690-AB/XIX/3255 Niveau de description sous-série organique Intitulé Pièces isolées, collections et papiers d'érudits. Tome 4. Localisation physique Pierrefitte-sur-Seine DESCRIPTION Présentation du contenu La sous-série AB/XIX est créé en 1856 à l'occasion de la réorganisation du secrétariat des Archives nationales, devenues Archives de l'Empire, avec pour vocation de recueillir tous les documents entrés par voie extraordinaire, c'est à dire en dehors des versements des administrations publiques. L'empereur Napoléon III honore lui-même la nouvelle série de quelques dons. En 1858 sont données les archives de François de Neufchâteau. Pour la première fois entrent aux Archives nationales l'ensemble des papiers d'un homme politique, mélangeant papiers de fonctions et papiers personnels. En 1949, à l'occasion de l'établissement d'un service des archives économiques et privées, sont créées de nouvelles séries : AP (pour les archives des familles et des personnes célèbres) ; AQ (pour les archives d'entreprises) ; AR (pour les archives de presse) et AS (pour les archives d'associations).