BILAN SCIENTIFIQUE HAUTE-VIENNE 2 0 1 1 Tableau
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
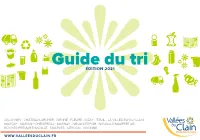
Guide Du Tri ÉDITION 2021
Guide du tri ÉDITION 2021 ASLONNES . CHÂTEAU-LARCHER . DIENNÉ . FLEURÉ . GIZAY . ITEUIL . LA VILLEDIEU-DU-CLAIN . MARÇAY . MARIGNY-CHÉMEREAU . MARNAY . NIEUIL-L’ESPOIR . NOUAILLÉ-MAUPERTUIS . ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ . SMARVES . VERNON . VIVONNE WWW.VALLEESDUCLAIN.FR Le sommaire M. Beaujaneau, Président de la Communauté de P 3 _____ ZÉRO DÉCHET Communes des Vallées du Clain Le guide du tri 2021 des Vallées du Clain vous donne toutes les clés P 4 _____ LE B.A. BA DU BAC pour mieux trier et réduire vos déchets au quotidien. Vous y trouverez les consignes de tri détaillées et les informations pratiques pour trier, P 5 _____ LES JOURS DE COLLECTE chez vous, dans les bornes et dans les déchèteries. Notre geste de tri reste indispensable pour protéger notre environne- P 6-7 ___ LE TRI À LA MAISON ment. Mais au vu des quantités très importantes de déchets produits, et des coûts en hausse pour les traiter, réduire nos déchets devient un P 8-9 ____ LE TRI DANS LES BORNES véritable enjeu ! Simple à mettre en place au quotidien, réduire ses dé- chets, c’est tout simplement éviter de les produire. Le meilleur déchet est celui que l’on ne fait pas ! P 10-11 ___ LE TRI EN DÉCHÈTERIE La Communauté de communes des Vallées du Clain qui a la com- P 12-13 __ LA VALORISATION DES DÉCHETS pétence « gestion et traitement des déchets » conduit une politique environnementale ambitieuse. Elle dotera bientôt le territoire d’une nouvelle déchèterie plus performante avec de nouvelles filières de re- P 14-15 __ LES INFOS PRATIQUES cyclage pour valoriser un maximum de déchets. -

Info Pratique Itinéraire
PAYS DE LIMOGES EN HAUTE-VIENNE Paris Paris Info pratique A 20 Accès : à 25 min de Limoges. Emprunter la RN141 en direction de Veyrac Saint-Junien. Suivre la sortie n°64 pour Oradour-sur- 6 D 9 N Glane puis la RD9. 141 Limoges Départ : place de la mairie. A 20 Durée Longueur BalisageNiveau Dénivelé Toulouse 5 h 30 22 km jaune difficile Continuité 5 d'itinéraire Changement Mauvaise de direction Les pratiques possibles direction circuits d'Oradour-sur-Glane Itinéraire 4 1 De la place de la mairie, se diriger vers l'église, puis tourner à gauche et passer devant le pont colombier. Au carrefour, prendre la route à droite puis juste après le cimetière tourner à gauche. Suivre ce large chemin pendant 2 km. 7 Le Pont colombier, du XIIème siècle est le seul en Europe à être construit sur une rivière, le Glanet. De plan rectangulaire recouvert 10 d'un toit à croupes en tuiles creuses, il présente 2 niveaux : le 1er, faisant office de pont couvert servait d'accès au verger seigneurial variante 3 des chatelains de Veyrac, le 2ème niveau, accessible de l'intérieur par une échelle, était dévolu aux pigeons. 1 2 Arrivé sur la route, la suivre à droite sur 150m puis tourner de suite à 8 9 gauche. Continuer sur cette petite route en direction de Plounty. A la croix de la Peyruche, suivre à droite la piste forestière. 3 Au croisement en 'T', continuer tout droit jusqu'à la Chatrusse. Prendre la route à droite jusqu'à la RD28. Veyrac Variante pour le circuit du Petit Colombier : tourner à gauche, suivre Place de la mairie la piste jusqu'à la route. -

Partie 3 : Etude D’Impact
SAS REVIPLAST 3 rue Jean Mermoz, Parc OCEALIM, 87 270 COUZEIX Tél. : 05 55 09 77 80 / Fax : 05 55 09 81 31 Email : [email protected] REVIPLAST Partie 3 : Etude d’impact Couzeix – Parc OCEALIM (87) Date : janvier 17 Société d’Action et de Veille Environnementale ESTER Technopole Immeuble Antarès - BP 56 959 22 rue Atlantis - 87 069 Limoges Cedex T. +33 (0)5 55 35 01 38 E. [email protected] www.ecosave.fr Partie 3 : Etude d’impact Couzeix – Parc OCEALIM (87) SOMMAIRE I. RAPPEL DU CONTEXTE DE L’ETUDE D’IMPACT ......................................................................... 1 I.1 METHODOLOGIE ........................................................................................................... 1 I.2 CONTEXTE ................................................................................................................... 2 I.2.1 LOCALISATION DU SITE D’EXPLOITATION .................................................................... 2 I.2.2 OBJET DE LA DEMANDE .......................................................................................... 4 II. ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX ............................................................................... 5 II.1 PAYSAGE ET TOPOGRAPHIE ............................................................................................. 5 II.1.1 LE PARC OCEALIM ............................................................................................... 5 II.1.2 LA ZONE D’ETUDES ............................................................................................... -

Surprenante Haute-Vienne ! 31 Programmes Concoctés Par Haute-Vienne Tourisme
Surprenante Haute-Vienne ! 31 programmes concoctés par Haute-Vienne Tourisme Brochure groupes 2018 PAYS-BAS / ANGLETERRE / ENGLAND NETHERLAND PARIS ALLEMAGNE / GERMANY POITIERS LIMOGES LYON BORDEAUX TOULOUSE MARSEILLE ESPAGNE / SPAIN A 2h de Limoges Le Futuroscope Train Paris : 3 h St-Sulpice- Les Vergers Toulouse : 3 h de l’Aumaillerie les-Feuilles Bordeaux : 2 h Château de Dompierre-les-Eglises Avion Magnac-Laval Aéroport International Limoges Bellegarde Le Dorat Bellac Châteauponsac Nouic Bessines-sur- Château du Fraisse Gartempe St-Pardoux Espace Mortemart Suzanne Valadon A 1h45 de Limoges Lac de Cité Internationale de Montrol- Saint-Pardoux la tapisserie Aubusson A 2h45 de Limoges Senard Saint Sylvestre Jabreilles La Cité du Vin de Bordeaux les Bordes Ambazac Oradour-sur-Glane Saint-Junien Feeriland Veyrac St-Léonard de Noblat Rochechouart Cognac la Forêt Aixe-sur-Vienne Saint Auvent Peyrat- Parc Zoo Centre Internationnal du Reynou le-Château d’Art et du Paysage Les Salles Solignac Limousine Nedde Lavauguyon Park Eymoutiers Château de Brie Saint Mathieu Cussac Nexon Mont Rilhac Lastours Gargan Châlus St Hilaire les Places Pierre-Buère Saint-Germain- Bussière-Galant Saint-Gilles- Vicq-sur-Breuilh les-Belles Musée et Jardins les-Forêts Cécile Sabourdy N21 PÉRIGUEUX Le Chalard TOULOUSE BIS Château de Bonneval Coussac-Bonneval Saint-Yrieix- A 1h30 de Limoges la-Perche LASCAUX de Limoges Montignac A 1h Collonges-la-Rouge Document non contractuel. Cette brochure a été éditée Mise en pages et impression : Atelier Graphique - Limoges avec -

L'accompagnement De Vos Territoires
L’accompagnement de vos territoires RELATION ADHÉRENTS ARCHITECTURE/PAYSAGE/URBANISME SERVICES NUMÉRIQUES SERVICE JURIDIQUE/AMF86/FORMATION DES ÉLUS Architecte Julien Secheresse AJSA -Photographe : Maud Piderit, Focalpix adriers - amberre - anche - angles-sur-l’anglin - angliers - antigny - an- tran - arcay - archigny - aslonnes - asnieres-sur-blour - asnois - aulnay - availles limouzine - availles-en-chatellerault - avan- ton - ayron - basses - beaumont saint cyr - bellefonds - berrie - ber- the- gon - beruges - bethines - beuxes - biard - bignoux - blanzay - boivre-la-vallee - bonnes - bonneuil-matours - bouresse - bourg-archambault - bournand - brigueil-le-chantre - brion - brux - buxerolles - buxeuil - ceaux-en-loudun - celle-l’evescault - cenon- sur-vienne - cernay - chabournay - chalais - chalandray - champagne- le-sec - champagne-saint-hilaire - champigny en rochereau - champniers - charroux - chasseneuil-du-poitou - chatain - chateau-garnier - chateau-larcher - chatellerault - chaunay - chauvigny - chenevelles - cherves - chire-en-montreuil - chouppes - cisse - civaux - civray - cloue - colombiers - valence-en-poitou - cou- lombiers - coulonges - coussay - coussay-les-bois - craon - croutelle - cuhon - cur- cay-sur-dive - curzay sur vonne - dange-saint-romain - derce - dienne - dissay - doussay - fleix - fleure - fontaine-le-comte - frozes - gencay - genouille - gizay - glenouze - gouex - guesnes - haims - ingrandes - iteuil - jardres - jaunay-marigny - jazeneuil - jouhet - journet - jousse - la bussiere - la chapelle viviers -

La Gazette Feytiacoise N°19
La Gazette Feytiacoise n°19 Date de sortie : 28 janvier 2010 Championnat Division Honneur ème Saison 2009-2010 14 journée L.L.LIGUGE - C.S.FEYTIAT Les matchs du Week-end Les matchs du 12 Décembre Samedi 30 janvier 2010 Samedi 23 janvier 2010 Buxerolles Es - Laleu La Rochelle Fc - 19H00 Lubersac Auvezere Cf 3 – 1 Angouleme Chte Fc Aixe S/vienne As - Brive Esa – 20H00 Brive Esa 1 – 0 Liguge Ll Angouleme Chte Fc - Limoges Fc – 20H00 Laleu La Rochelle Fc 1 – 1 Feytiat Cs Liguge Ll - Feytiat Cs – 20H00 Royan Vaux Afc 0 – 1 Chauray Fc Chauvigny Us - Chatellerault So 2 – 20H00 Limoges Fc 2 – 0 Aixe S/vienne As Lubersac Auvezere Cf - Royan Vaux Afc – 20H00 Dimanche 24 janvier 2010 Dimanche 31 janvier 2010 Cozes As 1 – 2 Chauvigny Us Chauray Fc - Cozes As – 15H00 Chatellerault So 2 1 – 1 Buxerolles Es CLASSEMENT Pl Clubs Pts J G N P B P BC Diff 1 Liguge Ll 41 12 9 2 1 26 12 +14 2 Brive Esa 39 13 8 2 3 19 15 +4 3 Limoges Fc 37 13 7 3 3 23 11 +12 4 Royan Vaux Afc 33 13 6 2 5 15 13 +2 5 Laleu La Rochelle Fc 31 11 6 2 3 14 10 +4 GRAND LOTO du 6 Angouleme Chte Fc 31 13 5 3 5 17 18 -1 7 Chauray Fc 28 12 5 1 6 23 25 -2 C.S.FEYTIAT 8 Aixe/Vienne As 28 12 4 4 4 10 12 -2 Samedi 6 Février 9 Chauvigny Us 27 12 4 3 5 15 16 -1 10 Lubersac Auvezere C 26 11 5 1 5 16 14 +2 11 Cozes As f 23 13 3 1 9 13 25 -12 Salle G.BRASSENS 12 Chatellerault So 2 23 12 3 2 7 8 16 -8 13 Feytiat Cs 22 12 2 4 6 11 16 -5 A 20H 14 Buxerolles Es 18 11 1 4 6 12 19 -7 Flash FM partenaire du CSF 89.9 Mhz en Haute-Vienne et en direct sur www.flashfm.fr 1ère radio locale de la région. -

Foires Et Marchés HAUTE VIENNE
Fairs and markets In Haute-Vienne Markets M T W Th F S Su AIXE-SUR-VIENNE – Place René Gillet ● AIXE-SUR-VIENNE – Place Aymard Fayard (around the church) ● AMBAZAC ● BELLAC ● BESSINES-SUR-GARTEMPE ● ● BEAUMONT-DU-LAC (only in july and august) ● BERSAC-SUR-RIVALIER ● ● BLOND ● BUJALEUF ● BUSSIERE-POITEVINE (VAL D’OIR ET GARTEMPE) ● ● CHALUS (except the Friday that follows the fair day) ● CHAMPAGNAC-LA-RIVIERE ● CHATEAU-CHERVIX (4 p.m. to 7 p.m.) ● CHATEAUNEUF-LA-FORET ( March to October - from 4 p.m.) ● CHATEAUPONSAC ● CHEISSOUX (10 a.m. to 12:30 p.m.) ● COGNAC-LA-FORÊT ● CONDAT-SUR-VIENNE ● COUSSAC-BONNEVAL (10 a.m. to 12 p.m.) ● COUZEIX (16h à 19h30) ● CUSSAC ● DOMPS ( only on the2nd Tuesday of the month) ● EYMOUTIERS ● FEYTIAT ● FLAVIGNAC ● ISLE ● ● JANAILHAC ( only on the2nd Sunday of the month) ● LAURIERE ● LE DORAT ● LE VIGEN ● LE PALAIS SUR VIENNE ● LINARDS ● LIMOGES Beaubreuil ● LIMOGES Place Marceau ● LIMOGES Place des Carmes ● LIMOGES Place des Bancs ● ● LIMOGES Les Halles Centrales (6 a.m. to 1 p.m.) – covered market ● ● ● ● ● ● LIMOGES Les Halles Carnot – covered market ● ● ● ● ● ● LIMOGES – Landouge (parking Intermarché) ● MAGNAC-BOURG (only on the2nd Saturday of the month) ● MAGNAC-LAVAL ● MEUZAC ● M T W Th F S Su MORTEMART (only in July and August) ● NANTIAT ● ● NEDDE ● NEXON ● NOUIC ● ORADOUR-SUR-GLANE ● ORADOUR-SUR-VAYRES ● ● PANAZOL ● PEYRAT-LE-CHATEAU ● ● PIERRE-BUFFIERE ● RANCON ● RILHAC-LASTOURS (only on the 3rd Sunday of the month) ● RILHAC-RANCON ● ROCHECHOUART ● ● SAINT-GERMAIN-LES-BELLES (only on the last Saturday -

Liste Partenaires TL 2020-2021 Caf.Fr
COMPT CODE PARTENAIRES TICKETS LOISIRS CONTACT ADRESSE VILLE NATURE ACTIVITES ADRESSE POSTAL MAIRIE DE CHATEAUNEUF LA FORET Place du 8 mai 1945 87130 CHATEUNEUF LA FORET ECOLE DE MUSIQUE COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE VIENNE 24 avenue Wilson 87700 AIXE SUR VIENNE adhésions et sorties ALSH ados BOISSEUIL FOOTBALL CLUB Mairie 87220 BOISSEUIL FOOTBALL CERCLE JUDO BOISSEUIL Mairie le bourg 87220 BOISSEUIL JUDO CSB JUDO RUE DES VIEUX BLATS 87300 BELLAC JUDO SHOTO KARATE CLUB 1 rue des pensées 87700 AIXE SUR VIENNE KARATE TENNIS CLUB DU VAL DE VIENNE 1 allée du tennis 87200 CHAILLAC SUR VIENNE TENNIS DE TABLE TENNIS CLUB COMPREIGNAC - THOURON Chez Madame GALLIO 12 impasse St Christophe 87100 LIMOGES TENNIS MAIRIE D'AUREIL LE BOURG 87220 AUREIL MUSIQUE ET DANSE ASSOCIATION GYM ET DANSE 23 rue Victor Hugo 87700 AIXE SUR VIENNE DANSE ECOLE DE BOWLING DE LIMOGES FEYTIAT Mme LUDWIG Sandra 20 boulevard du mas bouyol 87000 LIMOGES BOWLING ASSOCIATION GRAINES DE RUE 1 RUE G. PHILIPPE 87250 BESSINES SUR GARTEMPE ACTIVITES ARTISTIQUES ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE JEAN 2 allée du Muret 87240 AMBAZAC UNSS MOULIN ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE JEAN 3 avenue René Regaudie 87130 CHATEAUNEUF LA FORET ACTIVITES SPORTIVES MONNET CLUB SPORTS LOISIRS CHAMBERET Mme Lydie RUBY VTT COURSE A PIED 2 Moussanas 87130 CHATEAUNEUF LA FORET CHATEAUNEUF MONTEIL CYCLOCROSS SARL LES HAUTS DE BLOND La bachellerie 87300 BLOND EQUITATION AMICALE DESJEUNES ET LAIQUES 4 place de la Mairie 87150 CHAMPAGNAC LA RIVIERE DANSE Collège FOYER SOCIO EDUCATIF Place Allende Pierre 87230 CHALUS ADHESIONS FOYER Desproges CLUB AIXOIS DE BILLARD route du puy panard 87700 AIXE SUR VIENNE BILLARD Chez M. -

Avis Methaniseur La Ribiere
PREFET DE LA HAUTE-VIENNE PREFET DE L’INDRE AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE relative à une demande d’autorisation unique pour le projet « Unité de méthanisation Centrale Biogaz de la Ribière » située sur la commune de Limoges présentée par la Société Centrale Biogaz de la Ribière et la demande de valorisation agricole des digestats issus du processus de méthanisation dans 14 communes de la Haute-Vienne et 31 communes de l’Indre La SARL Centrale Biogaz de la Ribière, dont le siège social se situe 45 impasse du Petit Pont – 76230 ISNEAUVILLE, a déposé un dossier de demande d’autorisation unique le 28 février 2017, complété les 14 mars 2017, 11 juillet 2017 et 18 décembre 2017, en vue d’obtenir une autorisation unique pour l’exploitation de l’unité de méthanisation Centrale Biogaz de la Ribière sur les parcelles n° 324 et n° 302 de la section HO de la commune de Limoges. La demande comprend également une étude préalable à la valorisation agricole des digestats issus du processus de méthanisation sur 5 859 ha répartis sur 14 communes de la Haute-Vienne (LIMOGES, BOISSEUIL , CONDAT SUR VIENNE, EYJEAUX, LE VIGEN, NIEUL, PANAZOL, PEYRILHAC, SAINT GENCE, SAINT GENEST SUR ROSELLE, SAINT HILAIRE BONNEVAL, SAINT JUST LE MARTEL, SAINT PAUL, SOLIGNAC) et 31 communes de l’Indre (AIZE, BAUDRES, BRION, CHÂTEAUROUX, CHOUDAY, COINGS , CONDE, DEOLS, GEHEE, GUILLY, ISSOUDUN, LA CHAMPENOISE, LA CHAPELLE SAINT LAURIAN, LANGE, LEVROUX, LINIEZ, MENETROLS SOUS VATAN, MONTIERCHAUME, MOULINS SUR CEPHONS, NEUVY PAILLOUX, SAINT AUBIN, SAINT FLORENTIN, SAINT GEORGES SUR ARNON, SAINT MAUR, SAINT PIERRE DE LAMPS, SAINT VALENTIN, SAINTE FAUSTE, SEGRY, THIZAY, VICQ SUR NAHON, VILLEDIEU SUR INDRE). -

08-Association Couzeix En Mouvement
Couzeix le 26 Juin 2019 Le Président à Monsieur le Commissaire Enquêteur, Objet : Enquête publique relative au projet de mise à 2 fois 2 voies de la RN147 sur le territoire de la commune de COUZEIX et de NIEUL 27 mai -27 juin 2019. Monsieur le Commissaire, Habitants de Couzeix nous suivons ce projet depuis son origine en 2003. Dans le cadre de l’association COUZEIX EN MOUVEMENT nous avons contribué à apporter nos remarques et propositions à la concertation réalisée du 16 novembre au 19 décembre 2016 et aux différentes étapes du projet qui ont suivi. Il est difficile de réagir sur la totalité du contenu au vu de l’énorme documentation mise à disposition du public. Mais force est de constater que notre point de vue largement évoqué dans le dossier de concertation n’a pas été pris en compte. Nous n’avons retenu que les éléments les plus marquants de cette enquête et soumettons à votre réflexion un questionnement qui nous l’espérons apportera un éclairage propre à approfondir les éléments de ce dossier. Il est nécessaire de revenir tout d’abord à l’origine sur la motivation du projet qui consistait à rapprocher le raccordement de la nouvelle route 147 au niveau de la D2000 et des centres d’intérêts de la ville de Limoges soit au plus près de l’A20 donc à l’est. La communauté de communes AGD étant de son côté plus favorable au tracé ouest (futur Magenta) parce qu’il devait permettre de desservir en principe la zone d’Activités OCEALIM 1. -

Connaitre Le Risque Radon Associé À Votre Commune Département De La
Connaitre le risque radon associé à votre commune EXTRAIT de l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français. En application des articles L.1333-22 du code de la santé publique et L.125-5 du code de l'environnement, les communes sont réparties entre les trois zones à potentiel radon définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique conformément à la liste ci-après. Cette liste est arrêtée par référence aux délimitations administratives, issues du code officiel géographique de l'Institut national de la statistique et des études économiques, en vigueur à la date du 1er janvier 2016. Département de la Corrèze Tout le département en zone 1 sauf : Zone 2 : Les communes de Beaulieu-sur-Dordogne, Beyssenac, Chanac-les-Mines, Chartrier-Ferrière, Chasteaux, Concèze, Confolent-Port-Dieu, Courteix, Curemonte, Estivals, Ladignac-sur-Rondelles, Laguenne, Lapleau, Les Angles-sur-Corrèze, Lubersac, Marc-la-Tour, Naves, Nespouls, Saint-Éloy-les- Tuileries, Saint-Étienne-aux-Clos, Saint-Hilaire-Peyroux, Saint-Salvadour, Saint-Sornin-Lavolps, Seilhac, Tulle. Zone 3 : Les communes de Affieux, Aix, Albignac, Albussac, Allassac, Alleyrat, Altillac, Ambrugeat, Argentat, Aubazines, Auriac, Ayen, Bar, Bassignac-le-Bas, Bassignac-le-Haut, Beaumont, Bellechassagne, Benayes, Beynat, Beyssac, Bonnefond, Bort-les-Orgues, Brignac-la-Plaine, Brive-la-Gaillarde, Brivezac, Bugeat, Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, Chabrignac, Chamberet, Chamboulive, Chameyrat, Champagnac- la-Noaille, Champagnac-la-Prune, Chanteix, -

Vienne2 Liste Des Communes Rattachées À Chaque Centre De Mise
Centre de mise à disposition CIVRAY Centre d’intervention du SDIS Place du 8 mai 1945 86 400 CIVRAY - MAGNE - AVAILLES LIMOUSINE - MAUPREVOIR - BLANZAY - MOUTERRE SUR BLOURDE - CHAMPAGNE SAINT HILAIRE - PAYROUX - CHATEAU-GARNIER - PRESSAC - CHARROUX - ROMAGNE - CHAUNAY - SAINT GAUDENT - CIVRAY - SAINT MAURICE LA - COUHE CLOUERE - GENCAY - SAVIGNE - JOUSSE - SOMMIERE-DU-CLAIN - L’ISLE JOURDAIN - USSON -DU -POITOU - LIZANT Centre de mise à disposition MONTMORILLON Centre d’intervention du SDIS 58 rue des Clavières 86 500 MONTMORILLON - LUSSAC LES CHATEAUX - ADRIERS - MONTMORILLON - BETHINES - PERSAC - BONNES - SAINT GERMAIN - BRIGUEIL LE CHANTRE - SAINT SAVIN - CIVAUX - SILLARS - CHAUVIGNY - VALDIVIENNE - LATHUS - VERRIERES - LA TRIMOUILLE - LE VIGEANT Centre de mise à disposition LOUDUN Centre d’intervention du SDIS 3 Avenue de Ouagadougou 86 200 LOUDUN - COUSSAY LES BOIS - MONT SUR GUESNES - LES TROIS MOUTIERS - SAINT JEAN DE SAUVES - LOUDUN - SAINT LEGER DE MONTBRILLAIS - MONCONTOUR 1 Centre de mise à disposition de CHÂTELLERAULT Centre d’intervention du SDIS 14 rue Raymond Pitet 86 100 CHÂTELLRAULT - ANGLES-SUR-L’ANGLIN - LENCLOÎTRE - ARCHIGNY - LESIGNY - AVAILLES en CHÂTELLERAULT - LES ORMES - BEAUMONT - NAINTRE - BONNEUIL-MATOURS - PLEUMARTIN - BUXEUIL - SAINT GERVAIS LES TROIS CLOCHERS - CENON-SUR-VIENNE - SAINT PIERRE DE MAILLE - CHÂTELLERAULT - SCORBE-CLAIRVAUX - CHENECHE - SOSSAY - DANGE SAINT ROMAIN - TARGE - DISSAY - THURE - INGRANDES - USSEAU - LA ROCHE POSAY - VICQ SUR GARTEMPE - LA PUYE - VOUNEUIL SUR VIENNE Centre de mise