L'animation À L'onf, Histoire D'une Idée
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
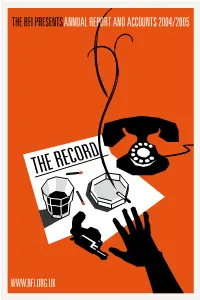
Annual Report and Accounts 2004/2005
THE BFI PRESENTSANNUAL REPORT AND ACCOUNTS 2004/2005 WWW.BFI.ORG.UK The bfi annual report 2004-2005 2 The British Film Institute at a glance 4 Director’s foreword 9 The bfi’s cultural commitment 13 Governors’ report 13 – 20 Reaching out (13) What you saw (13) Big screen, little screen (14) bfi online (14) Working with our partners (15) Where you saw it (16) Big, bigger, biggest (16) Accessibility (18) Festivals (19) Looking forward: Aims for 2005–2006 Reaching out 22 – 25 Looking after the past to enrich the future (24) Consciousness raising (25) Looking forward: Aims for 2005–2006 Film and TV heritage 26 – 27 Archive Spectacular The Mitchell & Kenyon Collection 28 – 31 Lifelong learning (30) Best practice (30) bfi National Library (30) Sight & Sound (31) bfi Publishing (31) Looking forward: Aims for 2005–2006 Lifelong learning 32 – 35 About the bfi (33) Summary of legal objectives (33) Partnerships and collaborations 36 – 42 How the bfi is governed (37) Governors (37/38) Methods of appointment (39) Organisational structure (40) Statement of Governors’ responsibilities (41) bfi Executive (42) Risk management statement 43 – 54 Financial review (44) Statement of financial activities (45) Consolidated and charity balance sheets (46) Consolidated cash flow statement (47) Reference details (52) Independent auditors’ report 55 – 74 Appendices The bfi annual report 2004-2005 The bfi annual report 2004-2005 The British Film Institute at a glance What we do How we did: The British Film .4 million Up 46% People saw a film distributed Visits to -

Short Film Programme
SHORT FILM PROGRAMME If you’d like to see some of the incredible short films produced in Canada, please check out our description of the Short Film Programme on page 50, and contact us for advice and assistance. IM Indigenous-made films (written, directed or produced by Indigenous artists) Films produced by the National Film Board of Canada NFB CLASSIC ANIMATIONS BEGONE DULL CARE LA FAIM / HUNGER THE STREET Norman McLaren, Evelyn Lambart Peter Foldès 1973 11 min. Caroline Leaf 1976 10 min. 1949 8 min. Rapidly dissolving images form a An award-winning adaptation of a An innovative experimental film satire of self-indulgence in a world story by Canadian author Mordecai consisting of abstract shapes and plagued by hunger. This Oscar- Richler about how families deal with colours shifting in sync with jazz nominated film was among the first older relatives, and the emotions COSMIC ZOOM music performed by the Oscar to use computer animation. surrounding a grandmother’s death. Peterson Trio. THE LOG DRIVER’S WALTZ THE SWEATER THE BIG SNIT John Weldon 1979 3 min. Sheldon Cohen 1980 10 min. Richard Condie 1985 10 min. The McGarrigle sisters sing along to Iconic author Roch Carrier narrates A wonderfully wacky look at two the tale of a young girl who loves to a mortifying boyhood experience conflicts — global nuclear war and a dance and chooses to marry a log in this animated adaptation of his domestic quarrel — and how each is driver over more well-to-do suitors. beloved book The Hockey Sweater. resolved. Nominated for an Oscar. -
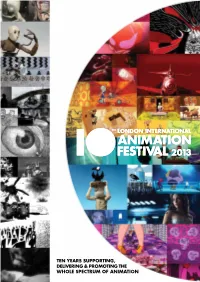
Ten Years Supporting, Delivering & Promoting the Whole Spectrum of Animation
TEN YEARS SUPPORTING, DELIVERING & PROMOTING THE WHOLE SPECTRUM OF ANIMATION Directors Message Wow – we made it to our 10th anniversary!! Who would have thought it? From very humble beginnings – our first festival in 2004 screened at the now-defunct Rupert Street Cinema in Piccadilly – to LIAF 2013, 10 days at 3 different venues. We have survived - sort of. Over 10 years we’ve received more than 12,000 entries, screened more than 2,500 films, and had some of the most talented animators in the world come and hang out with us. And we’ve had a ball on the way. It’s time to blow our own trumpet. As well as being the largest festival of it’s kind in the UK in terms of films and programmes screened, we have a substantial touring component and we run satellite events all year-round. We’ve screened at festivals, cinemas, theatres and colleges all around the world and in the UK and hopefully we have spread the word that animation is a valid artform that is only limited by the animator’s imagination. In short, our maxim is that in animation anything can happen. Long may this be. There are far too may people to thank here (hopefully you know who you are) but the guidance and immense work-rate of my co-Director Malcolm Turner has to be acknowledged. Way back when in our ground zero - actually in the year 1999 - I still vividly recall that very first meeting Malcolm and I had with our then-colleague Susi Allender in the back garden of our Melbourne flat. -

Senior 1 Art. Interim Guide. INSTITUTION Manitoba Dept
DOCUMENT RESUME ED 375 054 SO 024 441 AUTHOR Hartley, Michael, Ed. TITLE Senior 1 Art. Interim Guide. INSTITUTION Manitoba Dept. of Education and Training, Winnipeg. REPORT NO ISBN-0-7711-1162-2 PUB DATE 93 NOTE 201p.; Photographs might not produce well. AVAILABLE FROMManitoba Dept. of Education and Training, Winnipeg, Manitoba, Canada. PUB TYPE Guides Classroom Use Teaching Guides (For Teacher)(052) EDRS PRICE MF01/PC09 Plus Postage. DESCRIPTORS *Art Activities; Art Appreciation; Art Criticism; *Art Education; Course Content; Curriculum Guides; Foreign Countries; Grade 9; High Schools; *Secondary School Curriculum IDENTIFIERS Manitoba ABSTRACT This Manitoba, Canada curriculum guide presents an art program that effectively bridges Canadian junior and senior high school art levels. Content areas include media and techniques, history and culture, criticism and appreciation, and design. Four core units present fundamental art knowledge through themes based on self and environmental exploration. Media and techniques used include drawing, collage, sculpture and ceramics. Four secondary units are enrichment oriented. Maskmaking expands on self-exploration by examining different faces humans present to establish identity and communication. Mass media introduces students to concepts of advertisement communication. Differences between need and want are explored. Landscape is studied as interpretations of environment as seen, remembered, or imagined. Investigation of the future allows for exploration of various scenarios with a wide variety of materials. The teaching method employed is problem solving/inquiry. Idea journals and portfolios are identified and used as evaluation tools. Appendices and bibliographies are included. (MM) ********************************************************************** Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made from the original document. *********************************************************************** 1993 Senior I Art U S. -
![Arxiv:1908.09083V2 [Cs.CL] 8 Oct 2020 Existing Supervised Approaches Suffer from Two Sig- Get Reviews fluctuates a Lot](https://docslib.b-cdn.net/cover/6588/arxiv-1908-09083v2-cs-cl-8-oct-2020-existing-supervised-approaches-suffer-from-two-sig-get-reviews-uctuates-a-lot-616588.webp)
Arxiv:1908.09083V2 [Cs.CL] 8 Oct 2020 Existing Supervised Approaches Suffer from Two Sig- Get Reviews fluctuates a Lot
Multi-view Story Characterization from Movie Plot Synopses and Reviews Sudipta Kar|, Gustavo Aguilar|, Mirella Lapata♠, Thamar Solorio| | University of Houston ♠ ILCC, University of Edinburgh fskar3, [email protected], [email protected], [email protected] Abstract Plot Synopsis In late summer 1945, guests are gathered for the wedding reception of Don Vito Corleone's daughter Connie (Talia Shire) and Carlo Rizzi This paper considers the problem of charac- (Gianni Russo). ... ... The film ends with Clemenza and new ca- terizing stories by inferring properties such as poregimes Rocco Lampone and Al Neri arriving and paying their re- spects to Michael. Clemenza kisses Michael's hand and greets him as theme and style using written synopses and "Don Corleone." As Kay watches, the office door is closed." reviews of movies. We experiment with a Review multi-label dataset of movie synopses and a Even if the viewer does not like mafia type of movies, he or she will tagset representing various attributes of sto- watch the entire film ... ... Its about family, loyalty, greed, relationships, and real life. This is a great mix, and the artistic style make the film ries (e.g., genre, type of events). Our pro- memorable. posed multi-view model encodes the synopses violence action murder atmospheric and reviews using hierarchical attention and revenge mafia family loyalty shows improvement over methods that only greed relationship artistic use synopses. Finally, we demonstrate how can we take advantage of such a model to ex- Figure 1: Example snippets from plot synopsis and review of tract a complementary set of story-attributes The Godfather and tags that can be generated from these. -

MIAF13 88Pp V4:Layout 1
13TH MELBOURNE INTERNATIONAL ANIMATION FESTIVAL 1 DIRECTOR’S MESSAGE Malcolm TURNER DIRECTOR: Melbourne International Animation Festival I have a beautiful god-daughter, Alex. I’m lucky to know her. That her My embrace of the ‘new’ – the DCP – couldn’t have started more Mum and Dad would nominate me to play this kind of role in her life fittingly than with the conversion of the legendary Alex Stitt film, GRENDEL is both a privilege for me and, considering my more or less comprehen- GRENDEL GRENDEL. Through a Pozible crowdfunding campaign that sively spectacular lack of preparedness for the gig, something approaching was supported by many true lovers of Australian film we were able to a reckless dereliction of duty on their part. finance the transfer of an unused 35mm print to this digital format. When I am in Australia I am bogged down with the festival and, Meeting and getting to know Alex and Paddy Stitt has been one of the when I’m overseas, I’m getting ready to get bogged down with the festival great delights of this festival cycle. Being able to utilise MIAF as a vehicle – once off the plane, I quite literally hit the tarmac running. It’s a lifestyle to preserve a digital copy of Alex’s first animated feature is about as I love and it makes MIAF possible but skipping out on taking the good as it gets for a festival like MIAF. The openness, generosity and opportunity to be just a liiiiiittle bit more involved in her life is one of the forbearance they have shown throughout this little adventure is here small number of regrets I suspect will settle on me when life’s fog begins acknowledged and gratefully tributed. -

Ecological Consequences Artificial Night Lighting
Rich Longcore ECOLOGY Advance praise for Ecological Consequences of Artificial Night Lighting E c Ecological Consequences “As a kid, I spent many a night under streetlamps looking for toads and bugs, or o l simply watching the bats. The two dozen experts who wrote this text still do. This o of isis aa definitive,definitive, readable,readable, comprehensivecomprehensive reviewreview ofof howhow artificialartificial nightnight lightinglighting affectsaffects g animals and plants. The reader learns about possible and definite effects of i animals and plants. The reader learns about possible and definite effects of c Artificial Night Lighting photopollution, illustrated with important examples of how to mitigate these effects a on species ranging from sea turtles to moths. Each section is introduced by a l delightful vignette that sends you rushing back to your own nighttime adventures, C be they chasing fireflies or grabbing frogs.” o n —JOHN M. MARZLUFF,, DenmanDenman ProfessorProfessor ofof SustainableSustainable ResourceResource Sciences,Sciences, s College of Forest Resources, University of Washington e q “This book is that rare phenomenon, one that provides us with a unique, relevant, and u seminal contribution to our knowledge, examining the physiological, behavioral, e n reproductive, community,community, and other ecological effectseffects of light pollution. It will c enhance our ability to mitigate this ominous envirenvironmentalonmental alteration thrthroughough mormoree e conscious and effective design of the built environment.” -

ASIFA 50 on 50” (Aka “ASIFA 51 on 51”) – the Contest
“ASIFA 50 on 50” (aka “ASIFA 51 on 51”) – the contest th inspired by the 50 anniversary of International Animated Film Association (Association Internationale du Film d’Animation – ASIFA) This year, a significant group of artists, producers, festival directors, animation critics and viewers can th celebrate the 50 anniversary of the creation of the International Animated Film Association (Association Internationale du Film d’Animation – ASIFA), an organization founded by Norman Mc Laren and other exceptional creators in order to unite animation artists from all around the world. th The head of the Association chose 2010 to be the year in which the 50 anniversary is celebrated. As people responsible for the International Etiuda&Anima Film Festival, which is the oldest Polish festival devoted to film education and international animation, we have decided to hold a competition together with ASIFA Poland. The international contest called “ASIFA 50 on 50” focuses on creating a list of 50 best animated shorts created during the 50 years that the Association has been active. The idea was welcomed by the ASIFA and honorary Patronage was provided by the Association President, Mr Nelson Shin from Korea, and Mr Raoul Servais from Belgium, the Honorary President of the celebration. The story is worth remembering. In the 1984, the ASIFA Hollywood decided to celebrate the Los Angeles Olympics together with the American Academy of Motion Picture Arts and Sciences and conducted the famous “Champions of Animation” poll. The idea first occurred to the late Fini Littlejohn, an ASIFA Hollywood member, designer and illustrator working for the Disney Studios. -

Showing Our Shorts
(J1UWUe (Ju1de • GREG KLYMKIW music industry support program and represents the efforts of a Winnipeg band called The Cheer. The video has already been screened on Much Music and will be touring non-theatrically as a Showing our warm-up short to Greg Hanec's music-oriented feature Tunes A Plenty . Schizophrenic Cinema Dept. : M. B. Duggan's 23-minute drama Mike The Movie, is currently in post-production. The $60,000,00 pic takes a realistic look at the surrealistic life of a young shorts schizophrenic. Duggan, a social-worker-turned-filmmaker, spent a few pre-production weeks acquainting the cast with the ins and outs of schizophrenia and the social programmes presiding over oon Cat Meets Fish Called Wanda Dept. : With three major awards from Zagreb, Winnipeg them. The film will be released in January. animator Cordell Barker's seven-minute The Cat Came Back is warming-up the crowds nationally for the new MGM release of A Fish Called Wanda. Over three years in the making, Barker's film was produced through The National Film Board and boasts a coproducing credit from Oscar-nominated Richard Condie. Audience-reaction at Winnipeg's Polo Park CinemaT has been extremely positive. Theatre management reports that guffaws and applause are tie .ftJ-a~ee ftJ-~ btJ-tJ-i.f Nt common occurrences during the seven minutes preceding the John Cleese comedy that Cat has been paired with. Kudos are certainly in order for Famous Players for bringing back alittle showmanship into their presentation byprogr amming ashort that not only provides alittle something extra for the moviegoers' six-and-a-half bucks, but more-than-adequately warms-up the audience for the lunacy f/L~· Ttl.· II/OE() that follows in A Fish Called WalIda . -

Eric Carle Museum of Picture Book Art • Neil Gaiman • Zena Sutherland • Ezra Jack Keats
Children the journal of the Association for Library Service to Children Libraries & Volume 1 Number 1 Spring 2003 ISSN 1542-9806 Eric Carle Museum of Picture Book Art • Neil Gaiman • Zena Sutherland • Ezra Jack Keats NON-PROFIT ORG. U.S. POSTAGE PAID BIRMINGHAM, AL PERMIT NO. 3020 spring03-CAL-final.qxd 05/09/2003 3:57 PM Page 1 Table Contentsl ofVolume 1, Number 1 Spring 2003 Notes and Letters 36 That Big Old Gold Sticker 2 Editor’s Note Children Talk about the Newbery Award Sharon Korbeck Kathleen T. Horning 2 Executive Director’s Note 41 The Critic’s Craft Malore I. Brown In Memory of Zena Sutherland 3 Letters to the Editor Sharon Korbeck 4 ALSC President’s Message Barbara Genco Departments 42 Book Reviews Features 44 Photo Gallery 5 Get the Picture? 2003 Midwinter Meeting Photos The Dynamic Marriage of Picture-Book Text and Images 45 ALSC News John Warren Stewig ALA Midwinter Meeting Awards Announcements 10 From Page to Plaster Notable Lists Eric Carle’s Museum of Picture Book ALA Annual Conference Schedule Art Brings the Power of Pictures Up Close and Personal 16 Call for Referees Sharon Korbeck 58 Index to Advertisers 59 Author Guidelines 13 A Snowy Day 60 Celebrating Forty Years of Keats’s The Last Word Masterpiece Megan Lynn Isaac 17 Joyful Noise A Study of Children’s Music at the Baldwin Library for Historical Children’s Literature Jane Marino 26 Raising the Bar © 1973 Maurice Sendak Coraline Soars, and Neil Gaiman page 10 Couldn’t Be More Pleased Maggie Thompson 31 Weaving the Golden String Recalling a Joyful Ninety Years at the Toronto Public Library Margaret Crawford Maloney spring03-CAL-final.qxd 05/09/2003 3:57 PM Page 2 Editor’s Note Notes from a “Freelance Librarian” Sharon Korbeck I consider myself a “freelance librarian.” Duly employed as a professional journalist, yet degreed in library sci- ence, I relish the opportunity to embrace both worlds. -

11Th Annual Victoria Independent Film & Video Festival Programme Guide
Cedarhill’s newest Espresso Bar & Italian Deli offers fantastic lunches, starring grilled panini sandwiches and superb espresso drinks and coffee! A selection of fine European deli items, including gourmet cheeses, meats, sausage, soups, pastries and breads are ready for you to take home to your table. For the health conscious, we have a full range of high-protien and vegetarian items. We’re located next to Fairways on Cedarhill X-Road at Shelbourne, so stop in soon and taste the the sweet life! Present this ad and buy one coffee drink get another FREE! Espresso Bar Italian Deli 250.381.8482 3667B Shelbourne Street ~ www.ladolcevitadeli.com TABLE OF CONTENTS tickets & membership info festival personnel February 4–13, 2005 (Staff , Board of Directors, Jurors) windows around town 808 View Street messages of welcome Victoria, BC, Canada & sponsors v8w 1k2 feature fi lms [email protected] Screening Venues Gala CAC 1 Community Arts Council Gallery check the website Canadian 6G-1001 Douglas (Sussex Building) for changes & updates World Perspective Capitol 6 2 Famous Players Capitol 6 www.vifvf.com 805 Yates Next Wave Cinecenta 3 Cinecenta Midnight Madness Student Union Building, UVic Documentary Hermann’s 4 Hermann’s Jazz Club 753 View other Venues shorts Odeon 5 Odeon Cineplex Th eatre special events 780 Yates Laurel Point Inn 9 680 Montreal One 6 One Lounge Reef Restaurant 10 533 Yates Tribute to Bill Plympton 1318 Broad Solstice Café 11 529 Pandora Sips ‘n Cinema Star 7 Star Cinema Temple 12 525 Fort 9842 3rd St (Sidney) Godzilla -
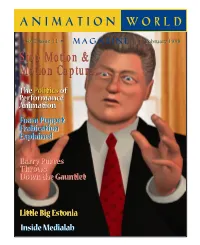
Stop Motion & Motion Capture Stop Motion
VolVol 22 IssueIssue 1111 February 1998 Stop Motion & Motion Capture The Politics of Performance Animation FoamFoam PuppetPuppet FrabicationFrabication ExplainedExplained BarryBarry Purves Purves ThrowsThrows DownDown thethe GauntletGauntlet Little Big Estonia InsideInside MedialabMedialab Table of Contents February, 1998 Vol. 2, No. 11 4 Editor’s Notebook Animation and its many changing faces... 5 Letters: [email protected] STOP-MOTION & MOTION-CAPTURE 6 Who’s Data Is That Anyway? Gregory Peter Panos, founding co-director of the Performance Animation Society, describes a new fron- tier of dilemmas, the politics of performance animation. 9 Boldly Throwing Down the Gauntlet In our premier issue, acclaimed stop-motion animator Barry J.C. Purves shared his sentiments on the coming of the computer. Now Barry’s back to share his thoughts on the last two years that have been both exhilarating and disappointing for him. 14 A Conversation With... In a small, quiet cafe, motion-capture pioneer Chris Walker and outrageous stop-motion animator Corky Quakenbush got together for lunch and discovered that even though their techniques may appear to be night and day, they actually have a lot in common. 21 At Last, Foam Puppet Fabrication Explained! How does one build an armature from scratch and end up with a professional foam puppet? Tom Brierton is here to take us through the steps and offer advice. 27 Little Big Estonia:The Nukufilm Studio On the 40th anniversary of Estonia’s Nukufilm, Heikki Jokinen went for a visit to profile the puppet ani- mation studio and their place in the post-Soviet world. 31 Wallace & Gromit Spur Worldwide Licensing Activity Karen Raugust takes a look at the marketing machine behind everyone’s favorite clay characters, Wallace & Gromit.