Les Travailleurs De La Mer
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Low Water Men
LOW WATER MEN A novel by William Gasston The British Channel Islands lie in the Bay of St Malo, just south of the Cherbourg peninsula closer to France than England. In 1940 the Germans invaded the islands and thus began five years of purgatory for the local population. 1 First published in February 2018 by William Gasston Cover, page design and overall production by William Gasston Copywright William Gasston All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without prior permission of William Gasston. Disclaimer Low Water Men is a work of fiction which has been based on historical fact. Except for some historical wartime leaders, the characters are all figments of the author's imagination . Any similarity with any living person is coincidental. Acknowledgements Many thanks must go to the Jersey Evening Post for their permission in being able to reproduce the text of the orders of the German High Command during the Occupation. I am deeply indebted to Peter and Verity Cruickshank of Jersey who have been a major source of information, their family and friends being low water fisherfolk since long before the war. Thanks also to my good friend Phil Greaves of Lambley, Nottingham, England who undertook the edit and encouraged me to push on. Website Whatever you think about the pros and cons of the internet, it is probably( up to now!) the major game changer of the twenty first century. It disseminates information and opinions faster than a speeding bullet. I have set up www.lowwatermen.com so that any reader, who has been kind enough to peruse and enjoy my story, could access information regarding the Channel Islands and the German Occupation. -

2015 Jersey AGM Minutes
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING Date : 3rd December 2015 Time : 17:45hrs Location : Rothwell - 17 La Motte St., St.Helier, Jersey JE2 4SY 1.0 Present : Darren Sowney DS Jersey Chairman Dave Powell DP Jersey Secretary Allan Liddle AL Jersey Treasurer Leigh Turpin LT Committee Member Sam Boleat SB Committee Member Rob O’Brien ROB Committee Member Andrew Morvan AM Committee Member Joe Seabrook JS Committee Member Peter Hull PH Non-Committee Member Maurice Dubras MD Non-Committee Member Apologies : Richard Sutton Committee Member Johnston Duncan Non-Committee Member Matthew Warner Non-Committee Member Richard Willmot-Chadwick Non-Committee Member Item Description Action 2.0 Approval of Previous Minutes 2.1 The meeting notes from the 11th December 2014 AGM were amended slightly Note then agreed as a true and accurate record, updated minuets on web site. Proposed: DP Seconded: DS 3.0 Matters Arising 3.1 Potential extra lecture could be added to 2016 schedule – JE N3 project Note already confirmed also MD – Pierre Hoursefall, is local retired engineer who was integral in the development of the concord. He is 76 now. 3.2 Proposed lectures for 2015 is attached in Appendix D Note 3.3 The proposal submitted by Guernsey to the IET requesting extra funding to Note hold engineering forums was signed off, ROB will be discussing further with Gur 3.4 Member are looking to try and get engineering organization over to the islands ROB to provide support and guidance to existing engineers and school highlighting the courses that student need to peruse -

English Channel
PUB. 191 SAILING DIRECTIONS (ENROUTE) ★ ENGLISH CHANNEL ★ Prepared and published by the NATIONAL GEOSPATIAL-INTELLIGENCE AGENCY Bethesda, Maryland © COPYRIGHT 2006 BY THE UNITED STATES GOVERNMENT NO COPYRIGHT CLAIMED UNDER TITLE 17 U.S.C. 2006 TWELFTH EDITION For sale by the Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office Internet: http://bookstore.gpo.gov Phone: toll free (866) 512-1800; DC area (202) 512-1800 Fax: (202) 512-2250 Mail Stop: SSOP, Washington, DC 20402-0001 Preface 0.0 Pub. 191, Sailing Directions (Enroute) English Channel, 0.0 Courses.—Courses are true, and are expressed in the same Twelfth Edition, 2006, is issued for use in conjunction with manner as bearings. The directives “steer” and “make good” a Pub. 140, Sailing Directions (Planning Guide) North Atlantic course mean, without exception, to proceed from a point of Ocean, Baltic Sea, North Sea, and the Mediterranean Sea. origin along a track having the identical meridianal angle as the Companion volumes are Pubs. 192, 193, 194, and 195. designated course. Vessels following the directives must allow for every influence tending to cause deviation from such track, 0.0 This publication has been corrected to 9 September 2006, and navigate so that the designated course is continuously including Notice to Mariners No. 36 of 2006. being made good. 0.0 Currents.—Current directions are the true directions toward Explanatory Remarks which currents set. 0.0 Dangers.—As a rule outer dangers are fully described, but 0.0 Sailing Directions are published by the National Geospatial- inner dangers which are well-charted are, for the most part, Intelligence Agency (NGA), under the authority of Department omitted. -

Guernsey Post & Go Faststamps Esel Powered by Royal Mail Postandgochecklist
Guernsey Post & Go Faststamps Esel Powered by Royal Mail PostandgoCheckList Guernsey - Lighthouses - FS 3 GG Designer: Robin Carter Images printed digitally by International Security Printers (Cartor), service indicator and datastring printed thermally at point of sale. Perfs: 14 x 14½ (simulated) Stamp Size: 56mm x 25mm Date Issued Machine Date Values Image / Overprint Remarks (or EKD) Type No. Location Code Pres P Mint FDC 15-Feb-17 RM Ser.II B002 Guernsey - GY Letter up to 100g Sark Lighthouse Issued on GP FDC GY Large up to 100g Castle Breakwater L. Issued in Presentation Pack UK Letter up to 100g Les Hanois Lighthouse Overprint: None UK Large up to 100g Brehon Tower L. Datastring: B2GG17 B002-1969-002 EUR Letter up to 20g Alderney Lighthouse ROW Letter up to 20g Casquets Lighthouse 15-Feb-17 RM Ser.II GG01 Spring Stampex 2017 - GY Letter up to 100g Sark Lighthouse Collectors Strip GY Large up to 100g Castle Breakwater L. Only issued at Spring Stampex 2017 UK Letter up to 100g Les Hanois Lighthouse 15 to 18-Feb-17 UK Large up to 100g Brehon Tower L. Overprint: None EUR Letter up to 20g Alderney Lighthouse Datastring: B2GB17 GG01 ROW Letter up to 20g Casquets Lighthouse 15-Feb-17 RM Ser.II GG01 Spring Stampex 2017 - GY Letter up to 100g Sark Lighthouse Only issued at Spring Stampex 2017 GY Letter up to 100g Castle Breakwater L. 15 to 18-Feb-17 GY Letter up to 100g Les Hanois Lighthouse Overprint: None GY Letter up to 100g Brehon Tower L. Datastring: B2GB17 GG01 GY Letter up to 100g Alderney Lighthouse GY Letter up to 100g Casquets Lighthouse 15-Feb-17 RM Ser.II GG01 Spring Stampex 2017 - GY Large up to 100g Sark Lighthouse Only issued at Spring Stampex 2017 GY Large up to 100g Castle Breakwater L. -
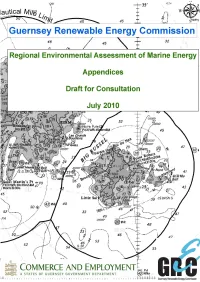
Appendix C of The
A1 Appendices Appendix A – List of Authors Appendix B – Glossary of Terms Appendix C – Tidal Resource Mapping for the Territorial Waters of Guernsey Appendix D – REA Assessment Process Appendix E – Pre-feasibility Technical Report Appendix F-1 – Benthic Ecology - Definitions of habitat sensitivities following Marlin guidelines Appendix F-2 – Benthic Ecology - Significance Assessment Criteria following Marlin and JNCC guidelines Appendix G – Marine Mammal Species Data Appendix H – Locations of designated fishery areas Appendix I – Historic wrecks around Guernsey, Sark and Herm Appendix J – Coastal sites and monuments on Guernsey, Sark and Herm Appendix K – Environmental Action Plan (EAP) Appendix L – Regional Monitoring Plan (RMP) A2 Appendix A – List of Authors Chapter Number Subject Author 4 Geology and Sediment Transition David Tappin 5 Marine Processes Chris Green 6 Water Quality Peter Barnes 7 Benthic Ecology Mel Broadhurst 8 Pelagic Ecology Annie Linley & Karine Laffont 9 Birds Jamie Hooper 10 Marine Mammals Martin Gavet 11 Commercial Fisheries David Wilkinson 12 Peter Perrio, Len Le Page, Peter Recreational Fishing Barnes 13 Marine and Coastal Historic Philip de Jersey, Tanya Walls & Environment Christopher Hughes 14 Cables Pipelines and Onshore Grid Steve Morris Connections 15 Shipping and Navigation Rob Barton 16 Tourism and Recreation Peter Barnes 17 Noise Peter Barnes 18 Air Quality Peter Barnes 19 Landscape and Seascape Character Chris Green A1 A2 Appendix B – Glossary of Terms General C & E – Commerce & Employment Department -
Guernsey 326 Turkish Empire
326 BRITISH OFFICES ABROAD — MOROCCO — TURKISH EMPIRE — GUERNSEY Wmk. 259 604 A130 10p royal blue .45 .30 Great Britain Nos. 131, 134 Re-engraved 605 A130 11p violet brown .60 .40 Surcharged 1 Perf. 14 606 A131 1sh brown .30 .30 37 A80 /2p yel grn (’12) .20 .20 543 A104 2sh6p yellow grn 5.75 5.75 607 A132 1sh3p dark green .60 .40 38 A81 1p scarlet (’12) .25 .25 544 A104 5sh dull red 6.25 6.25 608 A131 1sh6p dark blue .85 .50 545 A105 10sh ultra 32.50 32.50 Great Britain No. 148 Surcharged Nos. 531-545 (15) 51.90 51.90 Engr. Perf. 11x12 Great Britain Nos. 276 to 279 609 A133 2sh6p dark brown 2.00 1.25 Overprinted Type “a” 610 A133 5sh crimson 3.25 2.75 1 611 A133 10sh ultramarine 6.50 5.25 Perf. 14 /2x14 Nos. 592-611 (20) 17.65 13.70 1949, Oct. 10 Wmk. 251 f 1 Centenary of British P.O. in Tangier. 546 A117 2 /2p bright ultra .20 .20 Nos. 609-611 are found with hyphen omitted 547 A118 3p bright violet .25 .20 1906 Wmk. 30 (one stamp in sheet of 40). 1 548 A119 6p red violet .30 .30 British stamps overprinted “Tangier” were 13 A66(f) 1pi on 2 /2p ultra 3.50 .20 o 549 A120 1sh brown .60 .60 14 A71(f) 2pi on 5p lil & ultra 10.00 1.75 discontinued Apr. 30, 1957. 1 Nos. 546-549 (4) 1.35 1.30 Nos. -
Those Boats Which Left the Exe Late Afternoon on Friday 25 May
Whitsun Cruise to Brittany 2007 Those boats which left the Exe late afternoon on Friday 25 May enjoyed a cracking sail to Dartmouth to join a total of 15 Club boats planning to cruise the Channel Islands and the Rose Coast of North Brittany. Unfortunately these winds were harbingers of stormy conditions which were to prevail for the next few days and kept the fleet tied to the Upper Ferry pontoon entertaining themselves by eating, drinking, reading, chatting and playing bridge to a background of overworked Eberspachers and drumming rain! It’s not often Force 10 features in a shipping forecast in late May! The highlight has to be the “bring-a-plate-and-bottle” supper chez Melanie and Jonathan (Avocet) at their home in Dartmouth – a generous invitation which they may have regretted as the mountain of dripping Mustos and welly boots grew! Mercifully, Tuesday brought a weather window but it proved too late and promised to be too brief for those with only a week. Five boats, Ashanta, Pickle, Riviera Magic, Termeric and ZigZag, took advantage and made a 4am start having an uneventful passage south about Les Hanois to slide over the sill before the next predicted strong south easterly arrived that night. Erin and Trintella of Avon had already crossed early Saturday. No one begrudged Wednesday in St Peter Port as the wind blew accompanied by yet more rain. Thursday promised decreasing winds and we departed at 0800 for Lézardrieux while Erin headed for Herm and Alderney before returning cross Channel. A foul tide and head winds made for a wet and uncomfortable passage down the Russell but once clear of the Guernsey coast the seas settled. -

Des Origines À 1939
1 BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE DE L’HISTOIRE MARITIME DU BAILLIAGE DE GUERNESEY (des origines à 1939) Sources manchoises SHD Cherbourg, 1 P 2, Amirauté de Cherbourg, Contrebande avec les îles Anglo-Normandes. Mémoires, theses Nicolas AUBRY, « L’espace insulaire guernesiais », M. Sieper et R. Hérin (dir), mémoire de maîtrise, Caen, Université de Caen-Normandie, 1996, 205 p1. Sources imprimées [An.], « A Channel crossing, 1830 », John-Quentin Le Pelley (éd.), The review of the Guernsey society, vol. XXX, n° 1, 1974, p. 16-19. [An.], An act (Passed 12th March 1805), for making further provision for the effectual performance of quarantine, and also an order in council, dated 5th april 1805, Georges Eyre – Andrew Strahan, Londres, 1805, 86 p. + index et appendix. [An.], Articles prayed for, by the States of Guernsey, for the improvement of the Trade of that Island, and alluded to in their humble Petition to HIS MAJESTY, of the 14th June 1820, as being incorporated with the articles before prayed for by the Merchants and other Inhabitants of the said Island, s. éd., s.l., 5 p. Versailles, 28 Juin 1778, Arrêt du conseil d’état concernant les bâtiments anglais détenus dans les ports du royaume, en vertu des ordres de Sa MaJesté ; et les navires pris par les corsaires des iles de Jersey et de Guernesey, Paris , Imprimerie royale, 1778, 3 p. Billets d’État, Saint-Pierre-Port, États de Guernesey, 1812-2014, 178 vol. Correspondance, etc., 7 septembre 1912-28 Juillet 1915, au suJet de la législation projetée de la Marchande des Îles de la Manche, Jersey, Comité des Havres et Chaussées, 1915, 87 p. -

Regional Environmental Assessment Appendices
Appendices Appendix A – List of Authors Appendix B – Glossary of Terms Appendix C – Tidal Resource Mapping for the Territorial Waters of Guernsey Appendix D – REA Assessment Process Appendix E – Pre-feasibility Technical Report Appendix F-1 – Benthic Ecology - Definitions of habitat sensitivities following Marlin guidelines Appendix F-2 – Benthic Ecology - Significance Assessment Criteria following Marlin and JNCC guidelines Appendix G – Marine Mammal Species Data Appendix H – Locations of designated fishery areas Appendix I – Historic wrecks around Guernsey, Sark and Herm Appendix J – Coastal sites and monuments on Guernsey, Sark and Herm Appendix K – Locations of Diffusion Tubes in Guernsey Appendix L – Environmental Action Plan (EAP) Appendix M – Regional Monitoring Plan (RMP) Appendix A – List of Authors Chapter Number Subject Author 4 Geology and Sediment Transition David Tappin 5 Marine Processes Chris Green 6 Water Quality Peter Barnes 7 Benthic Ecology Mel Broadhurst 8 Pelagic Ecology Annie Linley & Karine Laffont 9 Birds Jamie Hooper 10 Marine Mammals Martin Gavet 11 Commercial Fisheries David Wilkinson 12 Peter Perrio, Len Le Page, Peter Recreational Fishing Barnes 13 Marine and Coastal Historic Philip de Jersey, Tanya Walls & Environment Christopher Hughes 14 Cables Pipelines and Onshore Grid Steve Morris Connections 15 Shipping and Navigation Rob Barton 16 Tourism and Recreation Peter Barnes 17 Noise Peter Barnes 18 Air Quality Peter Barnes 19 Landscape and Seascape Character Chris Green A1 A2 Appendix B – Glossary of Terms -

Seasearch Survey of Guernsey
Seasearch Survey of Guernsey June 2018 A report to La Société Guernesiaise and the States of Guernsey by Charlotte Bolton National Seasearch Co-ordinator Seasearch Survey of Guernsey, June 2018 1 Seasearch Seasearch is a volunteer underwater survey project for recreational divers and snorkelers to record observations of marine habitats and the life they support. The information gathered is used to increase our knowledge of the marine environment and contribute towards its conservation. Seasearch is a partnership between the Marine Conservation Society (MCS), The Wildlife Trusts, statutory nature conservation bodies and others, co-ordinated nationally by MCS and co-ordinated and delivered locally in England by Wildlife Trust and MCS local co-ordinators. Financial support for the programme comes mainly from the Marine Conservation Society and the programme is also receiving (or has received in the recent past) financial support from Natural England, Scottish Natural Heritage, Natural Resources Wales and The Crown Estate. Volunteers can participate in training courses and this report describes one of many surveys organized during the diving season. For more information visit www.seasearch.org.uk The objectives of the Seasearch programme are: • To gather information on seabed habitats and associated marine wildlife in Britain and Ireland through the participation of volunteer recreational divers and snorkellers • To encourage the participation of volunteer recreational divers and snorkelers in marine conservation through gathering data, particularly for areas where little data exists or where there is a conservation need • To provide training in recording skills to enable volunteers to participate and contribute data to Seasearch • To make quality assured Seasearch data available to partner organisations and the general public • To raise public awareness of the diversity of marine life and habitats in Britain and Ireland through the dissemination of information gathered and the identification of issues arising from it. -

Festival Guide
TH 25th March – 10 MAY 2016 FESTIVAL GUIDE VISITCHANNELISLANDS.COM DISCOVER WELCOME TRAVEL ALDERNEY TO THE 2016 AROUND &OUR ISLANDS CHANNEL Getting around the Channel Islands couldn’t be easier. Regular boat or air travel means you could explore ISLANDS all of our beautiful islands even 15 mins / 1 hour 25 mins during a short stay. HERITAGE 20 mins FESTIVAL! HERM GUERNSEY 50 mins st peter port SARK 20 mins / from 1 to 2 hours For full details on travel times and prices go to: 55 mins AIRLINES aurigny.com blueislands.com flybe.com FERRIES condorferries.co.uk This year we honour the Islands’ timeless coach tours and boat trips to an insider’s guide traveltrident.com relationship with the sea, and this Festival guide of the best exhibitions and concerts, enjoy the sarkshippingcompany.com is packed full of hundreds of events taking place many events and activities taking place at manche-iles-express.com JERSEY across Guernsey, Jersey and the Bailiwick isles heritage sites around the Islands, throughout of Alderney, Sark and Herm, each of which have the Festival. For boat charter trips search: their own unique story to tell. ‘Boat trips’ on The Channel Islands past is woven into its visitguernsey.com From Roman wrecks to famous seafarers, present and we hope you enjoy the wonderful & jersey.com st HELIER tales of our Ice Age past to great shipwrecks, programme of events on offer as we celebrate our maritime heritage spans centuries. our group of small islands with a big history! Some scheduled services may be seasonal, Find out what is taking place where. -

English Channel
PUB. 191 SAILING DIRECTIONS (ENROUTE) ★ ENGLISH CHANNEL ★ Prepared and published by the NATIONAL GEOSPATIAL-INTELLIGENCE AGENCY Bethesda, Maryland © COPYRIGHT 2007 BY THE UNITED STATES GOVERNMENT NO COPYRIGHT CLAIMED UNDER TITLE 17 U.S.C. 2007 THIRTEENTH EDITION For sale by the Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office Internet: http://bookstore.gpo.gov Phone: toll free (866) 512-1800; DC area (202) 512-1800 Fax: (202) 512-2250 Mail Stop: SSOP, Washington, DC 20402-0001 Preface 0.0 Pub. 191, Sailing Directions (Enroute) English Channel, 0.0NGA Maritime Domain Website Thirteenth Edition, 2007, is issued for use in conjunction with http://www.nga.mil/portal/site/maritime Pub. 140, Sailing Directions (Planning Guide) North Atlantic 0.0 Ocean, Baltic Sea, North Sea, and the Mediterranean Sea. 0.0 Courses.—Courses are true, and are expressed in the same Companion volumes are Pubs. 192, 193, 194, and 195. manner as bearings. The directives “steer” and “make good” a 0.0 Digital Nautical Chart 20 provides electronic chart coverage course mean, without exception, to proceed from a point of for the area covered by this publication. origin along a track having the identical meridianal angle as the 0.0 This publication has been corrected to 1 September 2007, designated course. Vessels following the directives must allow including Notice to Mariners No. 36 of 2007. for every influence tending to cause deviation from such track, and navigate so that the designated course is continuously Explanatory Remarks being made good. 0.0 Currents.—Current directions are the true directions toward 0.0 Sailing Directions are published by the National Geospatial- which currents set.