Andelu Relatés Ici
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fiche Parcours
Randonnée Pierre LINA Organisée par le Club Cyclo -Tourisme de Marly-le-Roi 90 Km 70 Km 50 Km Localités / Direction Km Localités / Direction Km Localités / Direction Km MARLY-LE-ROI (Gymnase) 0 MARLY-LE-ROI (Gymnase) 0 MARLY-LE-ROI (Gymnase) 0 Stade de la forêt D7 2 Stade de la forêt D7 2 Stade de la forêt D7 2 Entrée Bailly (au feu à Dr) ➔ 5 Entrée Bailly (au feu à Dr) ➔ 5 Entrée Bailly (au feu à Dr) ➔ 5 Noisy-le-Roi (Gare) 7 Noisy-le-Roi (Gare) 7 Noisy-le-Roi (Gare) 7 Noisy -le-Roi (Rd pt D161) Noisy -le-Roi (Rd pt D161) Noisy -le-Roi (Rd pt D161) Rennemoulin D161 9 Rennemoulin D161 9 Rennemoulin D161 9 Villepreux de Maule D161/D97 12 Villepreux de Maule D161/D97 12 Villepreux de Maule D161 / D97 12 Chavenay D74 15 Chavenay D74 15 Chavenay D74 15 Cuvette de Chavenay STOP 17 Cuvette de Chavenay STOP 17 Cuvette de Chavenay STOP 17 Rd Point Grignon (INRA)➔D119 19 Rd Point Grignon (INRA)➔D119 19 Rd Point Grignon (INRA) ➔ D119 19 Vol à voile 20 Vol à voile 20 Rd Point Vol à Voile ➔ 20 Beynes (STOP) D191 24 Beynes (STOP) D191 24 Thiverval-Grignon ➔ 21 Villiers-St-Frédéric ➔ 28 Villiers-St-Frédéric ➔ 28 Val des 4 pignons 22 Neauphle-le-Vieux D42 30 Neauphle-le-Vieux D42 30 Crespières 26 Vicq La Bardelle ➔ 33 Vicq La Bardelle ➔ 33 Boulemont 28 Auteuil-le-Roi 35 Auteuil-le-Roi 35 HERBEVILLE (Ravitaillement) 30 AUTOUILLET (Ravitaillement) 38 AUTOUILLET (Ravitaillement) 38 Villiers-le-Mahieu (Entrée) 40 (Ravitaillement) (Ravitaillement) Boulaincourt ➔Chemin neuf 42 Garancières ➔D42 46 Orgerus ➔D130 51 Osmoy 54 Le Moutier ➔ 55 Flexanville -

Projet D'aménagement Et De Développement Durable De La
Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune d’Herbeville Plan Local D’Urbanisme Approuvé par délibération du Conseil Municipal En date du 14 mars 2019 Vu pour être annexé à la Délibération du Conseil Municipal débattu en Juillet 2016 1 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable s’organise autour de sept grands axes Le présent document constitue l’une des pièces principales du Plan Local d’Urbanisme. Son contenu est régi par l’article L151-5 du Code de l’Urbanisme. Il est destiné à faire l’articulation entre d’une part, le diagnostic territorial présenté dans la première partie du rapport de présentation, et d’autre part, le zonage et le règlement du Plan Local d’Urbanisme. Il sera accompagné d’un document complémentaire qui présentera, s’il y a lieu, les orientations d’aménagements particulières relatives à certains secteurs du territoire. Il définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble du territoire communal. Ces orientations reflètent la vision globale déterminée par l’équipe municipale pour conduire et orienter l’évolution de la commune dans les années à venir. Elles doivent répondre entre autre aux objectifs de développement durable, tels qu’ils sont définis par l’article L101-2 du Code de l’Urbanisme. Le contenu du Projet d’Aménagement et de Développement Durable a été établi sur les bases suivantes : ⚫ Le diagnostic territorial à la fois socio-économique et environnemental d’Herbeville. ⚫ La vision à long terme de ce que désire la commune pour son territoire. ⚫ La réflexion de la commune d’Herbeville à une échelle plus large dans une logique intercommunale. -

Aubergenville Andelu Les Mureaux Aubergenville
CIRCONSCRIPTION COMMUNE SECTEUR AUBERGENVILLE ANDELU LES MUREAUX AUBERGENVILLE AUBERGENVILLE LES MUREAUX AUBERGENVILLE AULNAY SUR MAULDRE LES MUREAUX AUBERGENVILLE BAZEMONT LES MUREAUX AUBERGENVILLE BOUAFLE LES MUREAUX AUBERGENVILLE CHAPET LES MUREAUX AUBERGENVILLE ECQUEVILLY LES MUREAUX AUBERGENVILLE EPONE LES MUREAUX AUBERGENVILLE FLINS SUR SEINE LES MUREAUX AUBERGENVILLE HERBEVILLE LES MUREAUX AUBERGENVILLE JUMEAUVILLE LES MUREAUX AUBERGENVILLE LA FALAISE LES MUREAUX AUBERGENVILLE LES ALLUETS LE ROI LES MUREAUX AUBERGENVILLE MAREIL SUR MAULDRE LES MUREAUX AUBERGENVILLE MAULE LES MUREAUX AUBERGENVILLE MEZIERES SUR SEINE LES MUREAUX AUBERGENVILLE MONTAINVILLE LES MUREAUX AUBERGENVILLE NEZEL LES MUREAUX BEYNES AUTEUIL RAMBOUILLET BEYNES AUTOUILLET RAMBOUILLET BEYNES BAZAINVILLE RAMBOUILLET BEYNES BEHOUST RAMBOUILLET BEYNES BEYNES RAMBOUILLET BEYNES BOISSETS RAMBOUILLET BEYNES BOISSY SANS AVOIR RAMBOUILLET BEYNES CIVRY LA FORET RAMBOUILLET BEYNES COURGENT RAMBOUILLET BEYNES FLEXANVILLE RAMBOUILLET BEYNES GARANCIERES RAMBOUILLET BEYNES GOUPILLERES RAMBOUILLET BEYNES GRESSEY RAMBOUILLET BEYNES HOUDAN RAMBOUILLET BEYNES JOUARS PONTCHARTRAIN RAMBOUILLET BEYNES LA QUEUE LES YVELINES RAMBOUILLET BEYNES MARCQ RAMBOUILLET BEYNES MAULETTE RAMBOUILLET BEYNES NEAUPHLE LE CHATEAU RAMBOUILLET BEYNES NEAUPHLE LE VIEUX RAMBOUILLET BEYNES ORGERUS RAMBOUILLET BEYNES ORVILLIERS RAMBOUILLET BEYNES OSMOY RAMBOUILLET BEYNES PRUNAY EN YVELINES RAMBOUILLET BEYNES RICHEBOURG RAMBOUILLET BEYNES SAULX MARCHAIS RAMBOUILLET BEYNES SEPTEUIL RAMBOUILLET BEYNES ST GERMAIN -

The Academic Structures of Boston, London and Paris: a Comparison Report Prepared for CNRS
The academic structures of Boston, London and Paris: a comparison Report prepared for CNRS CLIENT: Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) DATE: October 2016 [email protected] - www.sirisacademic.com 2 THE ACADEMIC STRUCTURES OF BOSTON, LONDON AND PARIS: A COMPARISON October 2016 Submitted to: Centre Nationnal de la Recherche Scientifique By SIRIS Academic Av. Francesc Cambó, 17 08003 Barcelona Spain Tel. +34 93 624 02 28 [email protected] www.sirisacademic.com For more information and comments about this report, please contact us at [email protected] 3 EXECUTIVE SUMMARY ..................................................................................................................................... 6 KEY RECOMMENDATIONS ................................................................................................................................ 8 LINKS TO THE INTERACTIVE VISUALISATIONS PRESENTED IN THIS REPORT .................................................... 12 Rankings overview ..................................................................................................................................................... 12 Maps of science ......................................................................................................................................................... 12 Visualisation of ranking’s qualitative vs. quantitative criteria ................................................................................... 12 Visualisations of ranking’s qualitative criteria vs. -

Printemps 2019
Le point sur... Printemps 2019 Printemps 2019 - n°11 Retrouvez toutes les infos de la CCGM, votre agenda culturel et sportif sur notre site internet LES 12 PRINCIPES DE LES SORTIES www.cc-gallymauldre.fr Facebook : Communauté-de-communes- auld et M re ly al LA PERMACULTURE G FESTIVAL GallyMauldre-1003015576434015 GeM emploi D’HUMOUR SELON DAVID HOLMGREN, DE THÉÂTRE L’UN DES FONDATEURS : Proposé par le Théâtre LA LETTRE DE GALLY MAULDRE de l’Alambic : Andelu, Bazemont, Chavenay, Crespières, Davron, Feucherolles, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Maule, Montainville, Saint-Nom-la-Bretèche À la base la permaculture est une approche Le 04 Mai - 1er Juin et globale qui repose sur une éthique : prendre soin Le salon 22 juin, lieux restants de tous les à confirmer des humains, prendre soin de la terre et trouver emplois sa juste part ou sa juste place. 2020 MARSMARS 20192019 Complexe Les 2 Scènes, Maule Concernant le fait de prendre soin de la terre, 13h30 - 17h30 il existe 12 principes clefs parmi lesquels on peut énoncer les 4 suivants : CDI, CDD, stage, alternance, formations, jobs d’été Auchan, Bilstein Group, Bricorama, Culligan, JC Decaux, Invie, Renault, RATP, Sarp / Veolia, Société Générale, • Collecter et stocker l’énergie SDIS / Pompiers des Yvelines, TDF / Yvelines fibre, Zoo de Thoiry, Police Nationale, Armée de l’Air, • Utiliser et valoriser les services et Armée de Terre, Conseil Départemental des Yvelines, ... (Liste non exhaustive) les ressources renouvelables GeM Emploi présente une initiative communale et intercommunale, en partenariat -

Livret De Bienvenue
Livret de Bienvenue Commune de Saulx-Marchais Sommaire •Horaires •Coordonnées La Mairie •Contacts •Plan de la commune •Ecole •Centre d'Accueil Périscolaire •Cantine Enfance / Scolaire •Nouvelles Activités Périscolaires •Crèches •RIPAM •Collège •Lignes de Bus Transports •Gares SNCF Entreprises Associations •Calendrier •Déchetterie Collecte des déchets •Collecte du verre •Collecte des textiles Urbanisme •Ce qu'il faut savoir Vie en communauté •Arrêtés Préfectoraux & Municipaux La Mairie Horaires Ouverture du Lundi de 14h à 19h00 Mardi au Vendredi de 14h à 17h30. Samedi de 10h à 12h (1er et 3ème Samedi de chaque mois) Coordonnées Mairie de Saulx-Marchais Rue de la Mairie 78650 Saulx-Marchais Tél : 01 34 87 45 18 / Fax : 01 30 88 50 84 E-mail : [email protected] Site : www.saulx-marchais.fr Contacts Maire : Jacques Chaumette Secrétaire : Carole Gilbert Adjointe Administrative : Nathalie Ramos Adjoints : Yann Sévérini (Travaux) Lucette Petit (Enfance/Scolaire) Marilyne Gamblin (Communication) Muriel Dupeux (Urbanisme) Nom des habitants : « Marcasalucéens » 3 4 5 Enfance / Scolaire Ecole École Primaire de SAULX-MARCHAIS Rue de la Mairie 01.34.87.57.74 Directrice : Madame Lisette LAURANT Classes : 5 classes réparties sur 8 niveaux, de la maternelle au CM2. Enseignants Maternelle Mme Johanna DE LEON Mme Aurélie LEROY Primaire Mme Lisette LAURANT Mme Corinne DECOUARD Mme Catherine BARLET ATSEM Mme Fabienne GROSSREITHER Mme Christine DEVILLERS Horaires Semaine de 5 jours - Tous les jours matin : 8h30 - 11h30 - Lundi, mardi, jeudi, vendredi après-midi : 13h15 - 15h30 6 Inscriptions Pour les nouveaux arrivants, s'inscrire en mairie. Se munir d'un justificatif de domicile, du livret de famille et du carnet de santé. -

N° Parcours Mantois Mercredi Matin
Parcours Mantois mercredi matin - Km au Départ du Club 1er et 3eme mercredi : Club et Stade; 2eme mercredi : Club et Bas Etang la Ville, N° (4eme mercredi + 5 Km Club et Carrefour Royal par Lycée Horticole) 1 Forêt-Chavenay-Thiverval-Crespières-(Herbeville)-Croix Marie-Les Alluets-Forêt 60-(65) Gare St Nom-Forêt-Orgeval-Montamets-Morainvilliers-Les Alluets-(Crespières- 60-(65) 2 Flambertins)-Forêt 3 Forêt-Les Alluets-Morainvilliers-(Les Alluets-Crespières- Les Flambertins)-Forêt 60-(65) Val Martin-Flambertins-Crespières-Croix Marie- Les Alluets-(Montamets-Les Alluets)- 60-(65) 4 Forêt Rennemoulin-Chavenay-Thiverval-Crespières-Herbeville-Les Alluets-(Morainvilliers-Les 65- (75) 5 Alluets)-Forêt Val Martin-Feucherolles-Crespières-Croix Marie- Les Alluets-Montamets-Les Alluets- 65 Km 6 Forêt 7 Val Martin-Les Alluets-Cabanne d'Herbeville-Crespières-Thiverval-Rennemoulin 65 Km 8 Val Martin-Les Alluets-Cabanne d'Herbeville-Mareil sur Mauldre-Thiverval-Rennemoulin 65 Km Rennemoulin-Chavenay-Villiers-(Vicq-Saulx)-Beynes-La Maladrerie-Les Flambertins- 65-(70) 9 Forêt Val Martin-Les Alluets-Bazemont-Vaux de Huguenots-Nézel-Maule-Herbeville-Les 70 Km 10 Alluets-Forêt Val Martin-Les Alluets-Cabanne d'Herbeville-Maule-(Jumeauville)-Andelu-Montainville- 70-(75) 11 Les Flambertins-Forêt Val Martin-Les Alluets-Cabanne d'Herbeville-Maule-Andelu-Thoiry-Marcq-Beynes- 75 Km 13 Rennemoulin Forêt-St Nom-Chavenay-St Germain la Grange-Beynes-Marcq-Andelu-Jumeauville-Beulle 75 Km 14 (ou Herbeville)-Les Alluets-Forêt Val Martin-Les Alluets-Bazemont-Vaux de Huguenots-Nézel-Maule-Jumeauville-Andelu- -
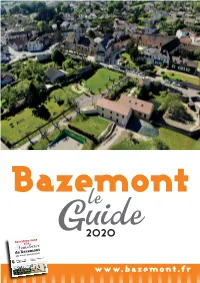
GUIDE PRATIQUE BAZEMONT 2019-2020-SITE.Pdf
Bazemont le Inscrivez-vous à la Guide2020 Newsletter de Bazemont sur www.bazemont.fr www.bazemont.fr www.elie-paysage.fr ESPACES VERTS PAYSAGERS CRÉATION ET PLANTATION D’ARBRES «ADULTES» Terrassement n Préparation du sol et plantations n Aménagement d’allées diverses n Pose de bordures et clôtures n Assainissement ou drainage n Pose de gazon de placage ENTRETIEN Entretien de gazon et massifs n Traitement phytosanitaire n Taille des haies et arbustes ÉLAGAGE Abattage et dessouchage n Soins des arbres n Taille de formation, architecturée, de grands arbres Plus de 30 ans d’expérience Portable : 06 08 65 12 66 6bis, rue de Maule 78580 Bazemont Tél.: 01 30 90 65 33 - Fax : 01 30 90 62 41 Mail : [email protected] Aux Alluets-le-Roi Une entreprise familiale depuis 1982 Shetlands, double poneys, chevaux Du cours particulier au cours collectif Du loisir à la compétition Animations diverses, anniversaires Stages pendant les vacances scolaires Équitation scolaire Pension boxe À 5 minutes, venez nous rendre visite ROUTE DE CRESPIÈRES - 78580 LES ALLUETS-LE-ROI Tél.: 01 39 75 95 52 PC-CE LES ALLUETS LE ROI www.poneyclub-centreequestre-alluets.com 2 l’édito www.bazemont.fr a parution de ce guide pratique l’aide de la région Île de France s’y attelle. Vous coïncide avec la dernière ligne droite trouverez dans ce guide pratique les informations de notre mandat qui a vu notre village et adresses utiles qui vous aideront dans votre se transformer tout en conservant son vie quotidienne. Il vient en complément du caractère rural. -

EAJE CD78 20201207Complet.Pdf
LesLes EtablissementsEtablissements d'Accueild'Accueil desdes JeunesJeunes EnfantsEnfants Edition : 21 décembre 2020 27 EURE Gommecourt Moisson Lainville- Notre- Limetz-Villez 95 Dame- en-Vexin Mousseaux- Jambville de-la-Mer Montalet- VAL-D'OISE Freneuse sur-Seine Drocourt Bennecourt !2 1 le- Blaru ! Saint- Sailly Bois Méricourt Martin-la- Garenne Fontenay- Oinville-sur- Bonnières- Gaillon- Follainville- Saint-Père Brueil- Montcient Chaufour- sur-Seine Rolleboise sur- La Villeneuve- Dennemont en-Vexin Tessancourt- lès- !1 Montcientsur-Aubette Bonnières !2 Guernes en-Chevrie Hardricourt Évecquemont Seine Aval Mézy- Meulan Vaux-sur-Seine 1 1 Mantes-la-Jolie Guitrancourt sur-Seine !! !1 Conflans- Lommoye Rosny- 1 1 7 7 Limay Juziers !2 Ste-Honorine sur-Seine !!!! Triel- Maurecourt Cravent Gargenville Les Mureaux 2 1 !1!3!3 sur-Seine !1!1!3!5 !! Buchelay Andrésy Issou !1!1!3!5 Verneuil- Saint- 1 1 Flins- !3!2 1 Perdreauville !! Mantes- sur-Seine ! Illiers-la- Jouy- sur- Chanteloup- Boissy- la-Ville Seine 2 3 Saint- Ville Mauvoisin Magnanville Porcheville !! les-Vignes Mauvoisin !1!1!5!2 !2 Bouafle Achères Illiers-le- Fontenay- !2 Chapet !1!2 Vernouillet !2 Bois Mauvoisin Aubergenville !1 Bréval Ménerville Auffreville- Mézières- 1 1 Maisons- 1 3 1 !! !1 Soindres Brasseuil sur-Seine Épône !!! Médan Boucle Laffitte !1!1 !2 Carrières- 4 6 1 Breuil- Guerville Nézel !!! Le Tertre- Favrieux Ecquevilly sous-Poissy de Seine Saint-Denis Vert Bois- La !1 Villennes- Sartrouville Robert !1!1 !1!1!3!4 Neauphlette Falaise sur-Seine !21!10 Flacourt 1 1 1 -

Feuille D'automne 2020 !
GROUPEMENT PAROISSIAL Horaires du secrétariat DE MONTFORT L’AMAURY Du lundi au vendredi : 9h-12h 3, rue de la Treille Le samedi : 10h-12h 78490 MONTFORT L’AMAURY Sacrement de Réconciliation* tél : 01 34 86 01 43 Le samedi : Montfort : 10h-12h au presbytère [email protected] Permanence des prêtres http://montfort-catholique-yvelines.fr Le samedi de 10h à 12h (*hors vacances scolaires) Feuille d’Automne 2020 ! MESSES DOMINICALES MESSES DE SEMAINE Périodicité Mardi : 18h30 Montfort Mercredi : 9h Montfort Thoiry : 1er et 3ème dimanches Jeudi : 18h30 Montfort Garancières : 2ème et 4ème dimanches Vendredi : 9h Montfort La Queue : 5ème dimanche NOUVEAU Les dates et horaires de messes et d’agenda contenus dans cette feuille paroissiale restent conditionnés à la situation sanitaire. PRIONS POUR NOS DÉFUNTS Nous vous invitons à consulter régulièrement le site de la paroisse Chers amis, http://montfort-catholique-yvelines.fr qui est tenu à jour. Comme chaque année, nous vous convions, si vous le souhaitez, à une célébration au cours de laquelle nous ferons mémoire de nos défunts en témoignant de la MESSES DOMINICALES miséricorde de Dieu pour chacun et du soutien de la com- munauté chrétienne. La crise sanitaire inédite que nous traversons a considérablement boulever- Sam 31 oct 18h30 La Queue sé nos vies et nos repères. Certains d’entre vous ont été particulièrement touchés. A la douleur de la perte d’un de vos proches est venue s’ajouter la Toussaint douleur de ne pas avoir pu l’accompagner lors d’une célébration religieuse à 9h30 Thoiry l’église entourés de vos familles et de vos amis. -

Communes CPTS Yvelines
CPTS Yvelines Mai 2021 CPTS en fonctionnement Communes Adresses contacts Bailly, Bois-d’Arcy, Bougival, Buc, Châteaufort, Fontenay-le-Fleury, Jouy-en-Josas, La Celle Saint-Cloud, Le Chesnay- CPTS Grand Versailles Rocquencourt, Les Loges-en-Josas, Noisy-le-Roi, Rennemoulin, Saint-Cyr-l’Ecole, Saint-Nom-la-Bretèche, Toussus-le-Noble, [email protected] Vélizy-Villacoublay, Versailles, Viroflay Aubergenville, Bouafle, Chapet, Ecquevilly, Evecquemont, Flins-sur-Seine, Gaillon-sur-Montcient, Hardricourt, Jambville, CPTS Val-de-Seine Lainville-en-Vexin, Les Mureaux, Meulan-les-Yvelines, Mézy-sur-Seine, Montalet-le-Bois, Oinville-sur-Montcient, [email protected] Tessancourt-sur-Aubette, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Vernouillet, Verneuil-sur-Seine CPTS en fonctionnement CPTS en projets Communes préfiguratrices Adresses contacts Arnouville-les-Mantes, Auffreville-Brasseuil, Bennecourt, Blaru, Boinville-en-Mantois, Boissy-Mauvoisin, Bonnières-sur- Seine, Breuil-Bois-Robert, Bréval, Brueil-en-Vexin, Buchelay, Chaufour-lès-Bonnières, Cravent, Dammartin-en-Serve, Drocourt, Epône, Favrieux, Flacourt, Follainville-Dennemont, Fontenay-Mauvoisin, Fontenay-Saint-Père, Freneuse, Gargenville, Gommecourt, Guernes, Guerville, Guitrancourt, Hargeville, Issou, Jeufosse, Jouy-Mauvoisin, Juziers, La CPTS 78 Nord [email protected] Villeneuve-en-Chevrie, Le Tertre-Saint-Denis, Limay, Limetz-Villez, Lommoye, Longnes, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Ménerville, Méricourt, Mézières-sur-Seine, Moisson, Mousseaux-sur-Seine, Neauphlette, -

Liste Des Communes 78 Et Arrondissements
Communes des Yvelines et arrondissements Arrondissement de Versailles : Préfecture des Yvelines 1 rue Jean Houdon - 78010 Versailles cedex Arrondissement de Saint Germain en Laye : Sous-Préfecture de Saint-Germain-en-Laye 1 rue du Panorama - 78105 Saint-Germain-en-Laye Cedex Arrondissement de Mantes-la-Jolie : Sous-Préfecture de Mantes-la-Jolie 18-20 rue de Lorraine - 78201 MANTES-LA-JOLIE cedex Arrondissement de Rambouillet : Sous-Préfecture de Rambouillet 82 rue du Général de Gaulle - 78514 Rambouillet cedex COMMUNES ARRONDISSEMENT ABLIS Rambouillet ACHERES Saint-Germain-en-Laye ADAINVILLE Mantes-la-Jolie AIGREMONT Saint-Germain-en-Laye ALLAINVILLE Rambouillet ALLUETS LE ROI (LES) Saint-Germain-en-Laye ANDELU Mantes-la-Jolie ANDRESY Saint-Germain-en-Laye ARNOUVILLE LES MANTES Mantes-la-Jolie AUBERGENVILLE Mantes-la-Jolie AUFFARGIS Rambouillet AUFFREVILLE BRASSEUIL Mantes-la-Jolie AULNAY SUR MAULDRE Mantes-la-Jolie AUTEUIL LE ROI Rambouillet AUTOUILLET Rambouillet BAILLY Saint-Germain-en-Laye BAZAINVILLE Mantes-la-Jolie BAZEMONT Mantes-la-Jolie BAZOCHES SUR GUYONNE Rambouillet BEHOUST Rambouillet BENNECOURT Mantes-la-Jolie BEYNES Rambouillet BLARU Mantes-la-Jolie BOINVILLE EN MANTOIS Mantes-la-Jolie BOINVILLE LE GAILLARD Rambouillet BOINVILLIERS Mantes-la-Jolie BOIS D'ARCY Versailles BOISSETS Mantes-la-Jolie BOISSIERE ECOLE (LA) Rambouillet BOISSY MAUVOISIN Mantes-la-Jolie BOISSY SANS AVOIR Rambouillet BONNELLES Rambouillet BONNIERES SUR SEINE Mantes-la-Jolie BOUAFLE Mantes-la-Jolie BOUGIVAL Saint-Germain-en-Laye BOURDONNE Mantes-la-Jolie