Universite Abou Bekr Belkaid Tlemcen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Transfert Des Nitrates Du Bassin Versant De La Tafna (Nord-Ouest De L'algérie) Vers La Mer Méditerranée
En vue de l'obtention du DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ DE TOULOUSE Délivré par : Institut National Polytechnique de Toulouse (Toulouse INP) Discipline ou spécialité : Ecologie Fonctionnelle Présentée et soutenue par : M. AMIN ZETTAM le dimanche 6 mai 2018 Titre : Transfert des nitrates du bassin versant de la Tafna (Nord-Ouest de l'Algérie) vers la mer Méditerranée. Approche couplant mesures, modélisation et changement d'échelle vers les grands bassins versants Nord africains. Ecole doctorale : Sciences de l'Univers de l'Environnement et de l'Espace (SDUEE) Unité de recherche : Laboratoire Ecologie Fonctionnelle et Environnement (ECOLAB) Directeur(s) de Thèse : MME SABINE SAUVAGE MME AMINA TALEB Rapporteurs : M. DIDIER ORANGE, IRD MONTPELLIER M. DJILALI YEBDRI, UNIV SCIENCES ET TECHNOLOGIE D'ORAN Membre(s) du jury : Mme NOURIA BELAIDI, UNIVERSITE DE TLEMCEN, Président M. JOSE-MIGUEL SANCHEZ-PEREZ, CNRS TOULOUSE, Membre I A mes parents A ma famille A mes Amis A Tlemcen A Toulouse A mon Pays (EL Djazair) II Remerciements Un seul nom sur la première page de ce travail, ne veut pas dire pour autant, travail d’une seule personne. Cette thèse est un fruit d’une collaboration, et j’ai le grand plaisir à remercier ici tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce modeste travail : Mes encadreurs Taleb Amina du laboratoire LECGEN de l‘université de Tlemcen, Tout au long de ce travail, elle a su m‘apporter un soutien constant, une disponibilité, une écoute, une confiance et des conseils précieux et avisés à la hauteur de ses compétences. Sauvage Sabine et Sánchez Pérez José Miguel du laboratoire ECOLAB CNRS de Toulouse- France pour avoir bien voulu m‘encadrer, pour leurs aides, leurs conseils et tout simplement leurs qualités scientifiques bien fermes, et pour avoir su me guider durant la réalisation de ce travail. -

L'agriculture, Nouveau Créneau Pour Les Jeunes
L’Algérie profonde / Actualités L’Algérie profonde L’agriculture, nouveau créneau pour les jeunes “C’est vers les centres de formation professionnelle et l’université que les efforts vont être dorénavant déployés afin d’encourager les jeunes diplômés à mettre en place leurs propres entreprises dans la démarche de les accompagner à créer de la richesse et de l’emploi.” Grâce au dispositif de l’Ansej, de nombreux jeunes de la wilaya de Tlemcen ont manifesté leur intérêt pour le secteur de l’agriculture comme en témoignent les 169 dossiers financés en 2013 par les banques publiques, soit plus du double par rapport à 2012. Pour la première fois, l’activité agricole (élevages ovin, bovin et avicole, apiculture, poules pondeuses, distribution de matériel agricole) occupe le haut du pavé, ce qui n’était pas le cas les années précédentes, car les jeunes promoteurs étaient attirés particulièrement par le secteur des transports, créneau actuellement saturé. Le secteur de l’industrie et de l’artisanat vient en seconde position avec 122 dossiers acceptés alors que les prestations de services n’ont enregistré que 24 projets définitifs acceptés. En 2013, de nombreux projets ont été financés à travers les 53 communes de la wilaya générant de nouveaux emplois dont le taux pour les femmes demeure cependant faible (5%) par rapport au nombre de diplômés. Selon Bahif Mohamed, directeur de l’Ansej, “c’est vers les centres de formation professionnelle et l’université que les efforts vont être dorénavant déployés afin d’encourager les jeunes diplômés à mettre en place leurs propres entreprises dans la démarche de les accompagner à créer de la richesse et de l’emploi”. -

Ressources En Eau Et Urbanisation Cas Du Groupement Urbain Tlemcen
République Algérienne Démocratique et Populaire Ministére de l’enseignement supérieur Et de la recherche scientifique Faculté de technologie Département de l’hydraulique Mémoire De magister en hydraulique Option : Mobilisation et protection des ressources en eau RESSOURCES EN EAU ET URBANISATION CAS DU GROUPEMENT URBAIN TLEMCEN Présenté par : SMAIL FOUZIA SOUTENU DEVANT LE J URY Président : Benmansour A. Professeur Uni .Tlemcen Encadreur : Adjim F. Professeure Uni .Tlemcen Examinateur : Megnounif A. M.C.A Uni .Tlemcen Examinateur : Chiboub F.A. Professeur Uni .Tlemcen Invité d’Honneur : Rouissat B. M. A .A. Uni. Tlemcen Dédicaces Je dédie ce travail à la mémoire de ma mère et de mon père pour tout ce qu’ils ont fait pour moi. Merci A mon cher mari pour ces encouragements et sa patience. Aux êtres les plus chères, mes enfants : Farah et Manel A mes frères et sœurs je leurs souhaite une vie pleine de bonheur… A ma belle mère, mes beaux frères et belles sœurs A mes amies et mes voisines; qui ont toujours cru en moi ; ce qui m’a donné confiance pour élaborer ce travail et m’a permis de me surpasser. REMERCIEMENT Je remercie tout d’abord mon encadreur, Pr.Adjim F. pour tous ses encouragements et sa patience, c’est grâce à Dieu puis à elle que j’ai pu continuer mes recherches et pu terminer ce mémoire. Mon choix s’est porté sur Mr Rouissat comme invité d’honneur pour enrichir le débat, grace à son expérience pratique et théorique et sa compétence dans le domaine. Grâce à lui j’ai pu réaliser une étude professionnelle. -
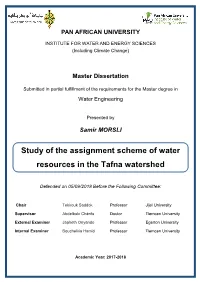
MT-Samir MORSLI.Pdf (4.618Mb)
PAN AFRICAN UNIVERSITY INSTITUTE FOR WATER AND ENERGY SCIENCES (Including Climate Change) Master Dissertation Submitted in partial fulfillment of the requirements for the Master degree in Water Engineering Presented by Samir MORSLI Study of the assignment scheme of water resources in the Tafna watershed Defended on 05/09/2018 Before the Following Committee: Chair Tekkouk Saddok Professor Jijel University Supervisor Abdelbaki Chérifa Doctor Tlemcen University External Examiner Japheth Onyando Professor Egerton University Internal Examiner Bouchelkia Hamid Professor Tlemcen University Academic Year: 2017-2018 Study of the assignment scheme of water resources in the Tafna watershed Declaration I SAMIR MORSLI, hereby declare that this thesis represents my personal work, realized to the best of my knowledge. I also declare that all information, material and results from other works presented here, have been fully cited and referenced in accordance with the academic rules andethics Signed Date 31/07/2018 SAMIR MORSLI This thesis has been submitted for examination with our approval as the University supervisor. Signature Date31/07/2018 Prof. ABDELBAKI CHERIFA Study of the assignment scheme of water resources in the Tafna watershed Dedication It is with the help of all powerful that I come to term of this modest work that I dedicate: To those who have cared for me since my birth to make me a person full of love for science and knowledge; my dear parents who have been able to give me happiness, Who knew how to guide my steps towards a safe future, who have never stopped encouraging me to undertake these studies and achieve this goal. -

Entre Corruption Et Mauvaise Gestion
L’Algérie profonde / Ouest Gouvernance locale à Tlemcen Entre corruption et mauvaise gestion Des élus et des emplo yés des APC de la wilaya de Tlemc en sont impliq ués dans des scand ales. © D.R. 13 maires sur les 53 que compte la wilaya de Tlemcen, ainsi que plusieurs élus communaux, sont poursuivis en justice. La corruption et les affaires liées à la dilapidation et au détournement de l’argent public est devenu un phénomène qui semble battre des records durant ce mandat électoral de 2012 à 2017, lequel est qualifié par les observateurs comme étant le pire mandat électoral depuis l’indépendance du pays. Selon un bilan officiel dressé en 2015 par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, 300 P/APC et 1400 élus locaux ont été poursuivis en justice dont 540 condamnés à différentes peines. Ce bilan s’est aggravé depuis, avec de nouvelles affaires où sont incriminés des élus locaux. La wilaya de Tlemcen, au même titre que Mostaganem et Tiaret, arrive en 2e position en nombre d’élus poursuivis en justice après celle d’Oran qui semble battre ce sinistre record. Le dernier scandale qui a éclaté dans la wilaya de Tlemcen est relatif à la dilapidation de deniers publics, et dans lequel le P/APC et une vingtaine d’employés et élus locaux sont impliqués. Cette affaire, qui suit son cours, est traitée par la brigade économique et financière de la Sûreté de wilaya, et dans laquelle le P/APC a été mis sous contrôle judiciaire. Selon nos sources, actuellement 13 P/APC sur les 53 que comptent la wilaya, et plusieurs membres communaux sont poursuivis en justice. -

Télécharger Article
مجلة هيرودوت للعلوم اﻹنسانية و اﻻجتماعية المجلد5/ العدد 1 )2021(....ص -22 111 Les concepts de l’occupation du sol en Algérie tude d’Anthropologie sociale dans la Trara oriental Land use concepts in Algeria: Study of social anthropology in the Eastern Trara Benslimane Abdennour * Faculté de droit et sciences politiques, Spécialité : Anthropologie- Université de Saida, Algérie. [email protected] تاريخ القبول: 32/23/0303 تاريخ اﻻستﻻم: 02/30/0302 تاريخ النشر: 0302/30/03 Résumé : Notre recherche a pour but d’analyser des concepts de l’occupation du sol qui en découlent dans la région de la Trara oriental. On a constaté qu’il y avait deux types de droits : Droit traditionnelle qui a vécu dans la période précoloniale et a été basé sur plusieurs sources comme (la décision du conseil et la présence de confrérie …),et le Droit coutumier qui a apparait bien dans la période coloniale et qui a été basé sur le système ancestrale et qui a pris le mode d’une légitimité auquel les individus ont recours pour revendiquer leurs droits d’appropriation du sol , cette dernière a causé des conflits entre les paysans au sujet de l’occupation des terroirs et qui demeure jusqu’à nos jours dans les régions montagnardes. Mots clés : concepts - occupation- sol- anthropologie-Algérie. Abstract: Our research aims to analyze concepts of land use resulting from this in the trara region. It was found that there were two types of rights: traditional law that lived in the pre- colonial period and was based on several sources such as (the council's decision and the presence of the confrerie ..), and customary law that It has appeared well in the colonial period and has been based on the ancestral system and has taken the mode of a legitimacy that individuals use to claim their rights of land appropriation. -

Chapitre I Généralité Sur Le Bassin Versant De La Tafna
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة اﻟﺘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻌــــــﻠﻴـــــــــﻢ اﻟﻌــــــــــــــــــــــــــــــﺎﱄ واﻟﺒــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺤﺚ اﻟﻌــــــــــــــــــــﻠــــــﻤــــــــــــﻲ Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ﺟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻣﻌﺔ أﰊ ﺑــﻜــــــــــــﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎﻳﺪ– ﺗـــــــﻠﻤﺴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎن – Université Aboubakr Belkaïd– Tlemcen – Faculté de TECHNOLOGIE MEMOIRE Présenté pour l’obtention du diplôme de MASTER En : Hydraulique Spécialité : Hydraulique urbaine Par : Chaib Draa Tani Meriem Acteurs de l’eau et leurs interactions dans la gestion de l’eau au niveau du bassin versant Tafna Soutenu publiquement, le / 06 / 2019, devant le jury composé de : M CHERIF Z. M A. (A) Univ. Tlemcen Président M MEGNOUNIF A. Professeur Univ. Tlemcen Encadreur Mme BOUKLI HACENE CH. M C. (A) Univ. Tlemcen Co-encadreur M BESSEDIK M. M C. (B) Univ. Tlemcen Examinateur Melle FANDI W. M A. (A) Univ. Tlemcen Examinatrice Année Universitaire 2018-2019 REMERCIMENTS Ce mémoire n’aurait pas été possibles sans l’intervention, conscientes, d’un grand nombre de personnes que je souhaite remercier dans cette modeste page. Je tiens d’abord à remercier très chaleureusement mes parents et toute ma famille. Je tiens aussi à remercier du fond de mon cœur Madame Boukli Hacene Cherifa et Monsieur Megnounif Abdeslam, qui m’ont permis de bénéficier de leur encadrement. Les conseils qu’ils m’ont prodigués, la patience, la confiance qu’ils ont témoignée ont été déterminants dans la réalisation de mon travail. Mes remerciements s’étendent également à Mr Cherif Zinedine président du jury, Mr Bessedik Madani et Melle Fandi Wassila examinateurs qui ont bien accepté de juger mon travail. Mes remerciements vont aussi à tous mes enseignants du Département d’Hydraulique. -

Plan Développement Réseau Transport Gaz Du GR TG 2017 -2027 En Date
Plan de développement du Réseau de Transportdu Gaz 2014-2024 N°901- PDG/2017 N°480- DOSG/2017 CA N°03/2017 - N°021/CA/2017 Mai 2017 Plan de développement du Réseau de Transport du Gaz 2017-2027 Sommaire INTRODUCTION I. SYNTHESE DU PLAN DE DEVELOPPEMENT I.1. Synthèse physique des ouvrages I.2. Synthèse de la valorisation de l’ensemble des ouvrages II. PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES RESEAUX GAZ II.1. Ouvrages mis en gaz en 201 6 II.2. Ouvrages alimentant la Wilaya de Tamanrasset et Djanet II.3. Ouvrages Infrastructurels liés à l’approvisionnement en gaz nature l II.4. Ouvrages liés au Gazoduc Rocade Est -Ouest (GREO) II.5. Ouvrages liés à la Production d’Electricité II.6. Ouvrages liés aux Raccordement de la C lientèle Industrielle Nouvelle II.7. Ouvrages liés aux Distributions Publiques du gaz II .8. Ouvrages gaz à réhabiliter II. 9. Ouvrages à inspecter II. 10 . Plan Infrastructure II.1 1. Dotation par équipement du Centre National de surveillance II.12 . Prévisions d’acquisition d'équipements pour les besoins d'exploitation II.13 .Travaux de déviation des gazoducs Haute Pression II.1 4. Ouvrages en idée de projet non décidés III. BILAN 2005 – 201 6 ET PERSPECTIVES 201 7 -202 7 III.1. Evolution du transit sur la période 2005 -2026 III.2. Historique et perspectives de développement du ré seau sur la période 2005 – 202 7 ANNEXES Annexe 1 : Ouvrages mis en gaz en 201 6 Annexe 2 : Distributions Publiques gaz en cours de réalisation Annexe 3 : Distributions Publiques gaz non entamées Annexe 4 : Renforcements de la capacité des postes DP gaz Annexe 5 : Point de situation sur le RAR au 30/04/2017 Annexe 6 : Fibre optique sur gazoducs REFERENCE Page 2 Plan de développement du Réseau de Transport du Gaz 2017-2027 INTRODUCTION : Ce document a pour objet de donner le programme de développement du réseau du transport de gaz naturel par canalisations de la Société Algérienne de Gestion du Réseau de Transport du Gaz (GRTG) sur la période 2017-2027. -

Genetics and Biodiversity Journal
Genetics and Biodiversity Journal Journal homepage: http://ojs.univ-tlemcen.dz/index.php/GABJ Original Research Paper General characteristics of goat milk cheese (Feta) in the region of Tlemcen, Algeria Djebli I. Ameur Ameur A. Gaouar SBS Laboratory of Physiopathology and Biochemical of Nutrition (PpBioNut), Department of Biology, University of Tlemcen, Algeria *Corresponding Author: Dr. Abdelkader Ameur Ameur, University of Tlemcen. Email: [email protected] Article history; Received: 12 February 2020; Revised: 25 March 2020; Accepted: 19 May 2020 Abstract Goat milk, whose production is starting to develop in Algeria in recent years, has a number of advantages that even allow it to substitute cow's milk. It is a source of health benefits for humans; it contains more vitamins with a significant cheese yield than cow's milk. Our present study aims to study physicochemical, microbiological and for the first time trials of a fresh cheese (Feta) made from locally selected goat's milk in the region of Tlemcen and its 10 regions namely: Ouled Mimoun, Terny, Sebdou, Ain El houte, Remchi, Bensakrane, Maghnia, Sabra, Nedroma and Zenata. 27 goats from the local population were used for this study. The physicochemical quality (fat, density, conductivity, defatted dry extract, temperature, protein, mineral salts and lactose) of the milk sampled was measured using a LACTOSCAN Milk-Analyzer. Four flora (total germ, fecal coliform, Staphylococcus aureus and salmonella) were chosen to test the microbiological quality of the milk. The results obtained show that the good physicochemical quality of milk studied in all regions except the two regions of Nedroma and Maghnia showing a high fat content. -

Region Centre
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES Commission ad-hoc chargée de l'organisation des élections des Conseils nationaux de l'Ordre national des Experts comptables, de la Chambre nationale des Commissaires aux comptes et de l'Organisation nationale des Comptables agréés (Décret n° 11-28 du 27/01/2011) LISTE DES PROFESSIONNELS DE LA COMPTABILITE EN EXERCICE REGION CENTRE EXPERTS COMPTABLES AGREMENT ORD NOMS ET PRENOMS ADRESSE WILAYA N° DATE 1 ABBED ABDELMAJID 01-11-99 14 AVE DU 1ER NOVEMBRE ALGER 2 ABDELAZIZ SEGHIR 60 143 BD KRIM BELKACEM ALGER 3 ABDOUS HOCINE 025/92 08-08-92 48 DES FRERES MADANI ALGER 4 ABED MOHAMED 713 08 RUE FADHAL AEK BEO ALGER 5 ACG 2516 BT B N° 195 MOHAMADIA ALGER 6 ACHOUCHE KHALED 62 CITE SIGNA COOP GARIDI RABAH REGHAIA ALGER 7 ADANE MED AHMED 2 CITE DNC BT A6 SAID HAMDINE ALGER 8 AHNOU RACHID 614/87 CITE MOHAMED BOUDIAF N,V BT08 TIZIOUZOU 9 AHRIZ OUAHID-EDDINE 1335 40 AV AHMED GHERMOUL ALGER 10 AIT ABDELKADER NOUREDDINE 1073 CITE 1406 LOGT BT A 26 N°8 BOUMERDES 11 AIT KACI ALI LAHCENE 26 LOT G N°36 OUED ROUMANE EL ACHOUR ALGER 12 AIT MESBAH NOUREDDINE 2744 LOT EL BINA VILLA N° 30 DELLY BRAHIM ALGER 13 AIT SALEM HAMID 62 CITE 20 AOUT BT C2 N°04 TIZI OUZOU 14 ALLAL FODIL 2293 CITE DES ANNASSERS BT 805 KOUBA ALGER Page 1 de 71 15 AMER EL KHEDDOUD MOHAMED 2788 CITE 1ER MAI BT N° 10 OULED YAICH BLIDA 16 AMEZIANI LOUNES 28 BT A GROUPE PLACE 1ER MAI ALGER 17 AMMOUR AHMED 104/92 FERME SAINTE ALSA ROUTE DU STADE TIPAZA 18 AMS AUDIT SARL 58 RUE DIDOUCHE MOURAD ALGER 19 AOUANE HADI 14 8 RUE -

Ms.Hyd.Aboubekr+Baba Ahmed.Pdf
Remerciement En guise de reconnaissance, nous tenons à témoigner nos sincères remerciements et notre gratitude la plus distinguée à notre encadreur, madame BOUKLI HACEN CHERIFA, pour son orientation, sa confiance, sa patience, sa qualité humaine, ses connaissances et son optimisme, qui ont constitués un apport considérable sans lequel ce travail n’aurait pas pu être mené au bon port. Nos remerciements s’étendent également à monsieur BESSEDIK. M pour l’honneur qu’il nous a fait en président notre jury, Nos vifs remerciements vont également aux membres du jury pour l’intérêt qu’ils ont porté à notre travail en acceptant de l’examiner. Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à tous les professeurs qui nous ont enseigné et qui par leurs compétences nous ont soutenu dans la poursuite de nos études. Enfin, on remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail. En particulier à : - Monsieur MEHIAOUI Djamel ingénieur en chef dans l’ETRHB - Monsieur KRID Walid ingénieur dans la DRE Tlemcen i Dédicaces Je dédie ce mémoire a : Ma mère, qui a œuvré pour ma réussite, de par son amour, son soutien, tous les sacrifices consentis et ses précieux conseils, pour toute son assistance et sa présence dans ma vie, reçois à travers ce travail aussi modeste soit-il, l'expression de mes sentiments et de mon éternelle gratitude. Mon père, qui peut être fier et trouver ici le résultat de longues années de sacrifices et de privations pour m'aider à avancer dans la vie. Puisse Dieu faire en sorte que ce travail porte son fruit ; Merci pour les valeurs nobles, l'éducation et le soutient permanent venu de toi. -

Médecins Généralistes
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière Direction de la Santé et de la Population de la Wilaya de : Tlemcen Médecins Généralistes Nom Prénom Adresse Commune Téléphone SENOUSSAOUI TEWFIK Boutrak Ain Fetah AIN FETAH (043)-20-90-52 GHALEM ABDELMALEK Sis, n° 02 Route de carrières Ain Fezza Tlemcen AIN FEZZA (043)-26-43-45 TERKI HASSAINE ZAKARIA Village Oucheba commune de Aîn-Fezza AIN FEZZA (057)-69-82-88 GHALEM KHALED Ain Mekrouf Ain Nehala AIN NEHALA (043)-22-21-98 BOUKLI HACENE MOHAMED TEWFIK Ain Tellout AIN TALLOUT (043)-20-38-16 EL HACI ABDERRAHMANE Citée Salem route Sidi Belabbes Ain Tellout AIN TALLOUT OUISSI RAHILA Cité nouvelle, Aîn-Tallout AIN TALLOUT ABOURA DJAOUAD Ain Youcef AIN YOUCEF Lotissement " EL OUKHOUA " commune de Aîn- BENADLA ABDERRAHMANE AIN YOUCEF (043)-24-11-73 Youcef BELKHOUCHE ABDELKRIM Rue NOURINE Abdelkader n° 03 Aïn-Youcef AIN YOUCEF BOUYAKOUB OTHMANE LOTF-ALLAH N° 02 Dar El-Aîdouni AIN-DOUZ 0555-50-17-76 BEMRAH SIDI-MOHAMMED Lieu dit Boutrak AIN-FETTAH 0552-23-91-53 BENHADJI-SERRADJ SIHAM Local n° 02, rez de chaussée Aïn-Ghoraba 0550-33-90-87 DIB ZOUBIR Chelaïda Commune de Amieur AMIEUR (079)-00-74-47 BENOSMANE GHOUTI El-Azail AZAILS SEBAA NESRINE Ecole Chafaî Boumédiène Tleta AZAILS 0560-25-79-78 KHEDIM ABDELGHANI Bab El Assa BAB EL ASSA (043)-22-12-27 BOUSHABA MIMOUNA Zouia commune de Beni-Boussaïd BENI BOUSSAID BOUGHOMD RACHID Zouia Daïra de Beni-Boussaïd BENI BOUSSAID (062)-61-79-57 KEBIR BOUMEDIENE Lotissement communal n° 07 Beni Mester BENI MESTER (043)-26-31-04 BENYELLES