Bilan Scientifique 2 0 0 8 Aquitaine
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Liste Des Villes Et Villages Du Département De La Gironde
Liste des villes et villages du département de la Gironde Communes du département de la Gironde en A Abzac Aillas Ambarès-et-Lagrave Ambès Andernos-les-Bains Anglade Arbanats Arbis Arcachon Arcins Arès Arsac Artigues-près-Bordeaux Arveyres Asques Aubiac Aubie-et-Espessas Audenge Auriolles Auros Avensan Ayguemorte-les-Graves Communes du département de la Gironde en B Bagas Baigneaux Balizac Barie Baron Barsac Bassanne Bassens Baurech Bayas Bayon-sur-Gironde Bazas Beautiran Bégadan Bègles Béguey Belin-Béliet Bellebat Bellefond Belvès-de-Castillon Bernos-Beaulac Berson Berthez Beychac-et-Caillau Bieujac Biganos Birac Blaignac Blaignan Blanquefort Blasimon Blaye Blésignac Bommes Bonnetan Bonzac Bordeaux Bossugan Bouliac Bourdelles Bourg Bourideys Brach Branne Brannens Braud-et-Saint-Louis Brouqueyran Bruges Budos Communes du département de la Gironde en C Cabanac-et-Villagrains Cabara Cadarsac Cadaujac Cadillac Cadillac-en-Fronsadais Camarsac Cambes Camblanes-et-Meynac Camiac-et-Saint-Denis Camiran Camps-sur-l'Isle Campugnan Canéjan Cantenac Cantois Capian Caplong Captieux Carbon-Blanc Carcans Cardan Carignan-de-Bordeaux Cars Cartelègue Casseuil Castelmoron-d'Albret Castelnau-de-Médoc Castelviel Castets-en-Dorthe Castillon-de-Castets Castillon-la-Bataille Castres-Gironde Caudrot Caumont Cauvignac Cavignac Cazalis Cazats Cazaugitat Cénac Cenon Cérons Cessac Cestas Cézac Chamadelle Cissac-Médoc Civrac-de-Blaye Civrac-en-Médoc Civrac-sur-Dordogne Cleyrac Coimères Coirac Comps Coubeyrac Couquèques Courpiac Cours-de-Monségur Cours-les-Bains Coutras -
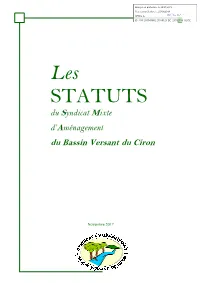
Statuts GEMAPI V4
Les STATUTS du Syndicat Mixte d’ Aménagement du Bassin Versant du Ciron Novembre 2017 PREAMBULE Historique ● Par arrêté préfectoral du 13 mai 1968 a été créé, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Ciron regroupant les communes du département de la Gironde désignées ci-après : Barsac, Bernos-Beaulac, Bommes, Budos, Cudos, Escaudes, Giscos, Goualade, Lartigue, Léogeats, Lerm-et-Musset, Lucmau, Noaillan, Pompéjac, Préchac, Preignac, Pujols-sur- Ciron, Saint-Michel-de-Castelnau, Sauternes, Uzeste, Villandraut. ● Par arrêté préfectoral du 6 Octobre 1999, les communes désignées ci-après ont été autorisées à quitter le syndicat : Escaudes, Giscos, Goualade, Lartigue, Lerm-et-Musset, Saint-Michel-de-Castelnau. ● Par arrêté préfectoral du 13 mars 2003, la commune de Cudos se retire du Syndicat et le Syndicat Intercommunal se transforme en Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin Versant du Ciron. Le Syndicat associe les membres suivants : Les communes de Barsac, Bernos-Beaulac, Budos, Preignac, Pujols-sur-Ciron, la Communauté de communes du Pays de Langon (représentant les communes de Bommes, Léogeats, Sauternes) et la Communauté de communes du Canton de Villandraut (représentant les communes de Lucmau, Noaillan, Pompéjac, Préchac, Uzeste, Villandraut). ● Par arrêté préfectoral du 1er juillet 2008, le Syndicat associe les membres suivants : Les communautés de Communes du Canton de Podensac, du Pays de Langon, du Canton de Villandraut, du Bazadais, Captieux-Grignols, du Pays de Roquefort et les communes de Balizac, Saint Léger de Balson, d’Allons , Pinderes, Saumejan, Bousses, Losse et Lubbon. ● Par arrêté préfectoral du 18 mars 2014, le Syndicat associe les membres suivants : Les communautés de Communes du Canton de Podensac, du Sud Gironde, du Bazadais, des Landes d’Armagnac, et les communes d’Allons, Pindères, Saumejan, Bousses. -

Session on Post-Accident
Your logo here Main results from the French panel of Blayais Post-accident (D9.71) session Mélanie MAÎTRE, Pascal CROÜAIL, Eymeric LAFRANQUE, Thierry SCHNEIDER (CEPN) Sylvie CHARRON, Véronique LEROYER (IRSN) TERRITORIES Final Workshop 12-14 November 2019, Aix-en-Provence This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant agreement No 662287. Quick reminders about WP3 Your logo here ▌ FIRST STEPS Ref. Ares(2018)542785 - 30/01/2018 This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant ► agreement No 662287. Feedback analysis (post-Chernobyl, post-Fukushima) allowing to: EJP-CONCERT • European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Identify uncertainties and local concerns at stake in contaminated Research H2020 – 662287 D 9.65 – Decision processes/pathways TERRITORIES: Synthesis report of CONCERT sub-subtask 9.3.3.1 territories ; Lead Authors: Jérôme Guillevic (IRSN, France), Pascal Croüail, Mélanie Maître, Thierry Schneider (CEPN, France) • Develop a typology of uncertainties (deliverable D.9.65): With contributions from: Stéphane Baudé, Gilles Hériard Dubreuil (Mutadis, France), Tanja Perko, Bieke Abelshausen, Catrinel Turcanu (SCK•CEN, Belgium), Jelena Mrdakovic Popic, Lavrans Skuterud (NRPA, Norway), Danyl Perez, Roser Sala (CIEMAT, Spain), Andrei Goronovski, Rein Koch, Alan Tkaczyk (UT, Estonia) radiological characterization and impact assessment, zoning of affected Reviewer(s): CONCERT coordination team areas, feasibility and effectiveness of the remediation options, health consequences, socio-economic and financial aspects, quality of life in www.concert- the territories, social distrust. h2020.eu/en/Publications ▌ INTERACTIONS WITH STAKEHOLDERS ► Organization of panels, case studies, serious games: collect stakeholders' expectations and concerns to better consider the uncertainties in the management of contaminated territories. -

17 Au 24 Août 2019
e 1742 au 24 août 2019 hestejada de las arts LA RÉOLE ESCAUDES LUCMAU POMPEJAC UZESTE UZESTE MUSICAL UZESTE 1 e 42dédiée à : Agnès Varda (cinéaste) Rosina de Pèira (voix d’Occitanie) Norbert Letheule (écrivain) Marcel Azzola (musicien) João Gilberto (musicien) Philippe Médiavilla (responsable syndical CGT et membre actif d’Uzeste musical) la manifestivité poïélitique d’Occitanie océanique HESTEJADA DE LA ARTS d’uzeste musical samedi 17 LA RÉOLE.......................................... p. 9 visages villages des arts à l’œuvre dimanche 18 ESCAUDES................................. p. 11 lundi 19 LUCMAU............................................ p. 12 mardi 20 POMPÉJAC................................... p. 15 ÉDITO ............................................................................................. p. 3 & pendant l’ hestejada à UZESTE.......... p. 16 LE SWING DES ŒUVRIERS ..................... p. 4 mercredi 21 ............................................................ p. 21 Alain Delmas jeudi 22 ........................................................................ p. 27 LA RENCONTRE, L’ART REND CONTRE...TOUT CONTRE ....................... p. 19 vendredi 23 .............................................................. p. 31 Bernard Lubat samedi 24 ................................................................... p. 35 ROUGE SCOLAIRE ....................................... p. 26 Collectif des enseignants engagés Tarifs .............................................................................. p. 39 de Nouvelle Aquitaine -

C99 Official Journal
Official Journal C 99 of the European Union Volume 63 English edition Information and Notices 26 March 2020 Contents II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 99/01 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9701 — Infravia/Iliad/Iliad 73) (1) . 1 2020/C 99/02 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9646 — Macquarie/Aberdeen/Pentacom/JV) (1) . 2 2020/C 99/03 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9680 — La Voix du Nord/SIM/Mediacontact/Roof Media) (1) . 3 2020/C 99/04 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9749 — Glencore Energy UK/Ørsted LNG Business) (1) . 4 IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 99/05 Euro exchange rates — 25 March 2020 . 5 2020/C 99/06 Summary of European Commission Decisions on authorisations for the placing on the market for the use and/or for use of substances listed in Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (Published pursuant to Article 64(9) of Regulation (EC) No 1907/2006) (1) . 6 EN (1) Text with EEA relevance. V Announcements PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY European Commission 2020/C 99/07 Prior notification of a concentration (Case M.9769 — VW Group/Munich RE Group/JV) Candidate case for simplified procedure (1) . 7 OTHER ACTS European Commission 2020/C 99/08 Publication of a communication of approval of a standard amendment to a product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 . -

Commune Et Mairie D'escaudes
LE PETIT JOURNAL d’Escaudes 2020 Septembre 17 Le changement n’est pas seulement nécessaire à la vie, il est la vie. Et, par conséquent, vivre c’est s’adapter. Alvin Toffler N° Très bonne lecture LE MOT DU MAIRE Dans un contexte exceptionnel, le 15 mars dernier, vous avez donné votre confiance à l’équipe municipale que je vous proposais. Je tiens à vous remercier de votre soutien et de ce qui me semble une reconnaissance du travail accompli depuis 2014 ; je suis, par ailleurs, convaincu que cette équipe en partie renouvelée, rajeunie, et représentant les diffé- rents quartiers d’Escaudes sera attachée au développement de la commune dans le respect de son environne- ment, de son caractère rural et du bien-être de ses habitants. Le contexte sanitaire particulier, cette période d’angoisse et de stress, ont exigé l’annulation des événements qui marquaient, dans notre commune, la période estivale et festive. Nos associations ont le soutien du Conseil Muni- cipal afin qu’elles puissent continuer à travailler pour nous offrir de belles manifestations en 2021 ! Un sujet beaucoup moins léger me préoccupe, ce sont les incivilités constatées : aux abords des conteneurs à ordures par le dépôt de déchets de toutes sortes, je suis bien conscient que ce ne sont pas les Escaudais les seuls responsables et je demande à chacun d’entre vous d’être vigilant sur ce point car il en va de la propreté de la commune, par l’entrepôt d’épaves de voitures ou de matériaux dans les domaines privés, n’oublions pas que ces problèmes sont régis le code de l'environnement (art. -

Page 1 Sur 4
CONSEIL MUNICIPAL D’ESCAUDES COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 11 mars 2020 Présents : M. TULARS Bernard, Mmes Patricia DE FREITAS, Marie-Ange CHANCELLÉ, FERRAND Françoise, MM. DANFLOUS Jean-Louis, BENTEJAC Francis, ROUCHET Alain, RIOLLOT Yves, DAUDET Bernard. Absent excusé : M. Philippe MONNIER Secrétaire de séance : M. TULARS Bernard Convocation du 5 mars 2020. La réunion débute à 18h10. I. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 15 JANVIER 2020 Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. II. DELIBERATIONS ET INFORMATIONS 1- VENTE DU PYLONE DE TELECOMMUNICATION DU PETIT LEBE DEL110320-02 Ce pylône a été rétrocédé par le Département à la commune d’Escaudes qui assume l’entretien du terrain communal (parcelle B722) sur lequel il est implanté et assure ce pylône contre les dégradations qui pourraient lui arriver. La Sté TDF, intéressée par cette structure, fait une offre d’achat de 20 000€ (pylône et terrain). Une fois cédé la commune sera dégagée de ses responsabilités et libérée de tout entretien. Après délibération le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, cette vente et autorise le maire à signer tout document lié à cette transaction. 2- BOITE AUX LETTRES ACCA Le courrier de l’ACCA arrive dans la boîte aux lettres de la mairie qui n’est ouverte que 2 jours par semaine pour plus de souplesse dans la réception de ce courrier l’ACCA, par l’intermédiaire de son président, demande la possibilité d’implanter une boîte personnelle à côté de celle de la mairie. Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 3- REMPLACEMENT DE L’ARMOIRE FRIGORIFIQUE DU RESTAURANT Suite à de nombreuses pannes subies au cours des derniers mois cet appareil, vital pour le bon fonctionnement de l’établissement, est dorénavant hors service. -

Communes a Dominante Forestiere En Gironde
COMMUNES A DOMINANTE FORESTIERE EN GIRONDE AILLAS GUJAN-MESTRAS ORIGNE ANDERNOS-LES-BAINS HOSTENS PESSAC ARBANATS HOURTIN PETIT-PALAIS-ET-CORNEMPS ARCACHON ILLATS POMPEJAC ARES LA BREDE PORCHERES ARSAC LA TESTE-DE-BUCH PORTETS AUBIAC LABESCAU PRECHAC AUDENGE LACANAU PUYNORMAND AUROS LADOS QUEYRAC AVENSAN LAGORCE REIGNAC AYGUEMORTE-LES-GRAVES LANDIRAS ROAILLAN BALIZAC LANTON SAINT-ANTOINE-SUR-L'ISLE BAYAS LAPOUYADE SAINT-AUBIN-DE-BLAYE BAZAS LARTIGUE SAINT-AUBIN-DE-MEDOC BELIN-BELIET LARUSCADE SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE BERNOS-BEAULAC LAVAZAN SAINT-CHRISTOPHE-DE-DOUBLE BIGANOS LE BARP SAINTE-HELENE BIRAC LE FIEU SAINT-GERMAIN-D'ESTEUIL BOURIDEYS LE NIZAN SAINT-JEAN-D'ILLAC BRACH LE PIAN-MEDOC SAINT-LAURENT-MEDOC BUDOS LE PORGE SAINT-LEGER-DE-BALSON CABANAC-ET-VILLAGRAINS LE TAILLAN-MEDOC SAINT-MAGNE CADAUJAC LE TEICH SAINT-MEDARD-D'EYRANS CAMPUGNAN LE TEMPLE SAINT-MEDARD-EN-JALLES CANEJAN LE TUZAN SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU CAPTIEUX LE VERDON-SUR-MER SAINT-MICHEL-DE-RIEUFRET CARCANS LEGE-CAP-FERRET SAINT-MORILLON CARTELEGUE LEOGEATS SAINT-SAUVEUR CASTELNAU-DE-MEDOC LEOGNAN SAINT-SAUVEUR-DE-PUYNORMAND CASTRES-GIRONDE LERM-ET-MUSSET SAINT-SAVIN CAUVIGNAC LES EGLISOTTES-ET-CHALAURES SAINT-SELVE CAZALIS LESPARRE-MEDOC SAINT-SYMPHORIEN CERONS LIGNAN-DE-BAZAS SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC CESTAS LISTRAC-MEDOC SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC CHAMADELLE LOUCHATS SALAUNES CISSAC-MEDOC LUCMAU SALLES COIMERES LUGOS SAUCATS COURS-LES-BAINS MACAU SAUGON CUDOS MARANSIN SAUMOS CUSSAC-FORT-MEDOC MARCHEPRIME SAUTERNES DONNEZAC MARCILLAC SAUVIAC ESCAUDES MARGAUX-CANTENAC SAVIGNAC ETAULIERS MARIMBAULT SENDETS FARGUES MARIONS SILLAS FRANCS MARTIGNAS-SUR-JALLE SOULAC-SUR-MER GAILLAN-EN-MEDOC MARTILLAC TAYAC GENERAC MASSEILLES TIZAC-DE-LAPOUYADE GISCOS MAZERES UZESTE GOUALADE MERIGNAC VENDAYS-MONTALIVET GRADIGNAN MIOS VENSAC GRAYAN-ET-L'HOPITAL MOULIS-EN-MEDOC VERTHEUIL GRIGNOLS NAUJAC-SUR-MER VILLANDRAUT GUILLOS NOAILLAN VIRELADE. -

La Halte SRGV En Sud Gironde
GRAND PROJET FERROVIAIRE DU SUD-OUEST GPSO Bordeaux-Toulouse Bordeaux-Espagne Aménagement d’une halte SRGV en sud Gironde Bilan de la concertation publique menée du 10 octobre au 5 novembre 2011 Mai 2012 SOMMAIRE INTRODUCTION ……………………………………...2 4. Les modalités de la concertation………………6 4.1. La phase de préparation et de définition des modalités ANNEXES (sur DVD joint) 4.2. La phase de concertation du 10 octobre au 5 novembre 2011 1. GPSO, le Grand Projet ferroviaire du Sud- • Décision du Président de RFF du 6 octobre 2011 d’engager la Ouest………………………………………………...2 concertation préalable et son annexe présentant les modalités de 5. Le bilan quantitatif de la concertation ………..7 1.1. Deux lignes nouvelles Bordeaux-Espagne et Bordeaux- cette concertation. Toulouse 5.1. La fréquentation du site internet gpso.fr • Mail du 7 octobre et courrier du 10 octobre 2011 aux communes, 5.2. Les retombées média 1.2. Un projet au service des territoires accompagnés de la décision du Président de RFF d’engager la concertation 2. GPSO et la concertation………………………….3 6. Les observations recueillies…………………….8 • Courrier du 11 juillet 2011 sollicitant l’avis des collectivités sur les modalités de la concertation 2.1. Une démarche continue de concertation et d’études 2.2. De nombreux acteurs associés à la démarche de concertation • Courrier du 28 juillet 2011 prolongeant le délai de délibération des 2.3. Le cadrage réglementaire de la concertation sur le projet 7. Les perspectives…………...................................8 communes d’aménagement d’une halte SRGV en sud Gironde • Délibération de la commune de Captieux 2.4. -

Les 6 Arrondissements Et Les 33 Cantons De La Gironde
LES 6 ARRONDISSEMENTS ET LES 33 CANTONS DE LA GIRONDE ARRONDISSEMENT D’ARCACHON Canton du Nord-Gironde : 43 703 hab. Canton de La Brède : 40 933 hab. 17 communes et 4 cantons Aubie-et-Espessas Ayguemorte-les-Graves Cavignac Beautiran Canton d’Andernos-les-Bains : Cézac Cabanac-et-Villagrains 49 712 hab. Civrac-de-Blaye Cadaujac Cubnezais Castres-Gironde Andernos-les-Bains Cubzac-les-Ponts Isle-Saint-Georges Arès Donnezac La Brède Audenge Gauriaguet Léognan Biganos Générac Martillac Lanton Saint-Médard-d’Eyrans Lège Cap-Ferret Laruscade Marcenais Saint-Morillon Marsas Saint-Selve Canton de Gujan-Mestras : 41 214 hab. Peujard Saucats Gujan-Mestras Saint-André-de-Cubzac Le Teich Saint-Christoly-de-Blaye Canton de la Presqu’ile : 37 806 hab. Marcheprime Saint-Gervais Ambares-et-Lagrave Mios Saint-Girons-d’Aiguevives Ambès Saint-Laurent-d’Arce Beychac-et-Cailleau Canton de La Teste-de-Buch : 36 360 hab. Saint-Mariens Carbon-Blanc Arcachon Saint-Savin Sainte-Eulalie La Teste-de-Buch Saint-Vivien-de-Blaye Saint-Loubès Saint-Yzan-de-Soudiac Saint-Louis-de-Montferrand Canton des Landes des Graves : 18 874 hab. Saugon Saint-Sulpice-et-Cameyrac Virsac Belin-Beliet Saint-Vincent-de-Paul Le Barp Canton de l’Entre-deux-Mers : 4 715 hab. Lugos ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX Saint-Magne Blésignac Salles 82 communes et 21 cantons Haux La Sauve-Majeure Canton de Bordeaux : 246 586 hab. Le Tourne ARRONDISSEMENT DE BLAYE Bordeaux Saint-Léon Tabanac 63 communes et 2 cantons Canton de Cenon : 44 130 hab. Canton de Lormont : 42 071 hab. Canton de l’Estuaire : 44 412 hab. -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2020
Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 33 GIRONDE INSEE - décembre 2019 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 33 - GIRONDE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 33-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 33-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 33-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 33-3 INSEE - décembre 2019 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la -

Carte Des Circonscriptions Législatives
E N - D L LE PIAN-MEDOC PAREMPUYRE ASQUES AMBARES-ET -LAGRAVE BLANQUEFORT ST- LOUBES LE TAILLAN- MEDOC BASSENS LE VERDON-SUR-MER STE- EULALIE CARBON- BLANC SOULAC-SUR-MER BRUGES EYSINES TALAIS MONTUSSA LORMONT YVRAC N A L SAINT-VIVIEN- IL LE BOUSCAT A H DE-MEDOC E L ARTIGUES- GRAYAN-ET-L'HOPITAL BORDEAUX PRES-BX JAU-DIGNAC- POMPIGNAC ET-LOIRAC CENON VENSAC TRESSES VALEYRAC MERIGNAC SALLEBO FLOIRAC BEGADAN ST-CHRISTOLY- QUEYRAC FARGUES- MEDOC VENDAYS-MONTALIVET CIVRAC- ST-HILAIRE EN-MEDOC COUQUEQUES TALENCE BOULIAC BON ST-YZANS- DE-MEDOC CARIGNAN-DE-BX BLAIGNAN PRIGNAC PLEINE-SELVE GAILLAN-EN-MEDOC PESSAC BEGLES ORDONNAC ST-CIERS-SUR SAINT-PALAIS -GIRONDE LIGNAN-DE-BX ST-SEURIN- LESPARRE- DE-CADOURNE LATRESNE MEDOC NAUJAC-SUR-MER VAL DE LIVENNE CENAC SADIRAC ST-AUBIN-DE-BLAYE GRADIGNAN VILLENAVE- VERTHEUIL D'ORNON BRAUD-ET- ST-GERMAIN- ST-ESTEPHE CESTAS SAINT-LOUIS CANEJAN CAMBLANES-ET-MEYNAC D'ESTEUIL CISSAC-MEDOC DONNEZAC REIGNAC ETAULIERS QUINSAC ST-CAPRAIS- CADAUJAC CAMBES DE-BX PAUILLAC ANGLADE UE ST-SAUVEUR EG EYRANS EL N HOURTIN T A ST-ANDRONY AR N C G SAUGON U SAINT- P FOURS M SAVIN A ST-GENES-DE- MAZION C GENERAC ST-JULIEN- BLAYE ST-SEURIN- BEYCHEVELLE DE-CURSAC ST-GIRONS- ST-YZAN-DE- ST-PAUL D'AIGUEVIVES ST-LAURENT-MEDOC ST-MARTIN- SOUDIAC LACAUSSADE ST-CHRISTOLY- CARS CUSSAC- DE-BLAYE BLAYE ST-MARIENS LARUSCADE FORT-MEDOC BERSON CIVRAC-DE ST-VIVIEN- -BLAYE CARCANS PLASSAC DE-BLAYE LAPOUYADE LAMARQUE TEUILLAC CHAMADELLE ST-CIERS-DE ST- CAVIGNAC -CANESSE TROJAN ARCINS VILLENEUVE MOMBRIER PUGNAC CEZAC MARANSIN LES EGLISOTTES-ET-