L'exemple Du Rhin Supérieur
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
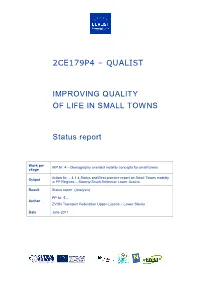
2Ce179p4 – Qualist Improving Quality of Life in Small
2CE179P4 – QUALIST IMPROVING QUALITY OF LIFE IN SMALL TOWNS Status report Work pa- WP Nr. 4 – Demography oriented mobility concepts for small towns ckage Action Nr. – 4.1.4 Status and Best practice report on Small Towns mobility Output in PP Regions – Saxony/South Bohemia/ Lower Austria Result Status report (Analysis) PP Nr. 5 – Author ZVON Transport Federation Upper-Lusatia – Lower Silesia Date June 2011 Status and best practice report on Small Towns mobility in PP regions- Saxony/ South Bohemia/Lower Austria Preliminary remarks This “Small Towns Mobility Status Report in the PP-regions” grew out of two sub-reports: - Small towns mobility status Report (data collection, analysis of regional small towns mobility status reports, development of report for all RR regions incl. Best best practices) Responsible: Saxony Ministry of Economic Affairs, Labour and Transport - Mobility Report (Status and Best practice report on Small towns in the PP regions) Responsible: Transport Federation Upper-Lusatia – Lower- Silesia (ZVON) The editorial process was carried out by the consulting engineers - LUB Consulting GmbH, Dresden - ISUP Ingenieurbüro für Systemberatung und Planung GmbH, Dresden 2CE179P4 - QUALIST Status and best practice report on Small Towns mobility in PP regions- Saxony/ South Bohemia/Lower Austria Index 1 Introduction................................................................................ 1 2 Brief description of study area.................................................... 2 2.1 Saxon Vogtland .................................................................. -

Moving Wachau, © Robert Herbst
REFRESHINGLY moving Road map of Lower Austria, with tips for visitors WWW.LOWER-AUSTRIA.INFO Mostviertel, © Robert Herbst Mostviertel, Welcome! “With this map, we want to direct you to the most beautiful corners of Lower Austria. As you will see, Austria‘s largest federal state presents itself as a land of diversity, with a wide variety of landscapes for refreshing outdoor adventures, great cultural heritage, world-class wines and regional specialities. All that’s left to say is: I wish you a lovely stay, and hope that your time in Lower Austria will be unforgettable!” JOHANNA MIKL-LEITNER Lower Austrian Governor © NLK/Filzwieser “Here you will find inspiration for your next visit to, or stay in, Lower Austria. Exciting excursion destinations, varied cycling and mountain biking routes, and countless hiking trails await you. This map also includes lots of tips for that perfect stay in Lower Austria. Have fun exploring!” JOCHEN DANNINGER Lower Austrian Minister of Economics, Tourism and Sports © Philipp Monihart Wachau, © Robert Herbst Wachau, LOWER AUSTRIA 2 national parks in numbers Donau-Auen and Thaya Valley. 1 20 Vienna Woods nature parks years old is the age of the Biosphere Reserve. in all regions. Venus of Willendorf, the 29,500 world’s most famous figurine. fortresses, castles 70 and ruins are open to visitors. 93 centers for alpine abbeys and monasteries have “Natur im Garten” show gardens 9 adventure featuring 15 shaped the province and ranging from castle and monastic summer and winter its culture for centuries, gardens steeped in history sports. Melk Abbey being one to sweeping landscape gardens. -

Cycling Along Europes Rivers Ebook Free Download
CYCLING ALONG EUROPES RIVERS PDF, EPUB, EBOOK Michael Lyon | 338 pages | 29 Aug 2012 | Esterbauer GmbH | 9780615691893 | English | United States Cycling Along Europes Rivers PDF Book I also met up with friends and spent time in cities such as Besancon, Vienna, Budapest and Belgrade along the way, so spent budget on tourist attractions, drinking, and dining out. IJsselmeer near Genemuiden. Your title:. Ural in Oral. Where: Basque Country, Spain. Perfect for cycling in Europe! A wonderful bike and boat cycling holiday from Camargue through the sensory delights of Provence to Avignon. However, spurring you along the mile trail are views of Grossglockner Mountain, the Hohe Tauern National Park, Lake Zell reflecting the surrounding landscape, and the dramatic Krimml waterfall, one of the highest in Europe. Volga near Yuryevets. While the crest of the Caucasus Mountains is the geographical border with Asia in the south, Georgia , and to a lesser extent Armenia and Azerbaijan , are politically and culturally often associated with Europe; rivers in these countries are therefore included. Just make sure to be discrete: find a secluded spot, wait until dusk to set up camp and be gone by early morning. The roads usually had beautiful scenery, too. Not to be confused with the hiking route of the same name, this mile km bike path starts in Salzburg, Austria, winds through the Alps, and ends on the Mediterranean coast in Grado, Italy. Feefo is an independent customer research specialist which generates genuine customer feedback and ratings in relation to the services we provide. Grade 2. I am planning a race and there are strict rules regarding the use of tunnels to avoid penalties. -
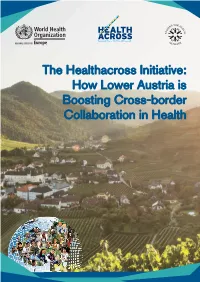
How Lower Austria Is Boosting Cross-Border Collaboration in Health
The Healthacross Initiative: How Lower Austria is Boosting Cross-border Collaboration in Health The Healthacross Initiative: How Lower Austria is Boosting Cross-border Collaboration in Health Abstract Cross-border collaboration in the field of health care can involve a transfer, movement or exchange of individuals, services or resources. It can comprise the sharing of health services, providers and expertise, as well as the provision of disease prevention, health promotion, curative and rehabilitative health services. This report tells the story of the cross-border collaboration in the field of health between Lower Austria and Czechia, and the beginning of collaboration with Slovakia. It focuses on the gradual provision of outpatient care and the exchange of medical expertise taking place in three border regions; documents the first large- scale effort to develop cross-border cooperation on health care between a long-standing and new European Union Member States; and provides information on how and why cross-border care started, mechanisms used to put it in place, key stakeholders and the lessons learned, including challenges and enabling factors. Keywords: International Cooperation Health Services Accessibility Delivery of Health Care Austria Czech Republic Address requests about publications of the WHO Regional Office for Europe to: Publications WHO Regional Office for Europe United Nations City, Marmorvej 51 DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark Alternatively, complete an online request form for documentation, health information, or for permission to quote or translate, on the Regional Office website (http://www.euro.who.int/pubrequest). ISBN 978 92 890 5375 4 © World Health Organization 2018 All rights reserved. The Regional Office for Europe of the World Health Organization welcomes requests for permission to reproduce or translate its publications, in part or in full. -

Pavlov Hills: Botanical Excursion Guide
Pavlov Hills: Botanical Excursion Guide Ji ří Danihelka, Vít Grulich & Milan Chytrý Introduction The Pavlov Hills (in Czech Pavlovské vrchy, Pálava) is a range of limestone hills in southern Moravia situated between the Dyje River (in German Thaya) and the Czech-Austrian border near the town of Mikulov. Its northernmost point is located about 30 km south of the southern margin of the city of Brno. The area is 11 km long and 2 to 3 km wide. The altitudinal difference between the Dyje River in Pavlov (165 m) and the top of D ěvín Hill (554 m) is 389 m. The northernmost hilltop with the ruin of the 14th century castle D ěvi čky (= Dív čí hrady, Maidenstein) stands out above the village of Pavlov. Southwards, the highest Děvín Hill (554 m) follows, which is separated in the south by the narrow gorge Pavlov Hills called Sout ěska from Kotelná Hill (462 m). Růžový vrch Hill, with another castle ruin on the top, and Stolová hora Hill (459 m), with a prominent plateau, form the central part of the range. Turold Hill (385 m) and Svatý kope ček Hill (363 m), the latter with a church on its top, surround the town of Mikulov from the north and 17th International Workshop European Vegetation Survey, Brno, 1–5 May 2008 161 the east, respectively. The southernmost Šibeni čník Hill (238 m) is situated south of the town near the border with Austria. Schweinbarther Berg, Höhlenstein, and Falkenstein Hills in the adjacent part of Lower Austria belong to the same range. -

Huchen in the Czech Republic: a Review
Arch. Pol. Fish. (2013) 21: 143-154 DOI 10.2478/aopf-2013-0011 RESEARCH ARTICLE Huchen in the Czech Republic: A review Lubomír Hanel, Stanislav Lusk, Jan Andreska Received – 01 April 2013/Accepted – 11 July 2013. Published online: 30 September 2013; ©Inland Fisheries Institute in Olsztyn, Poland Citation: Hanel L., Lusk S., Andreska J. 2013 – Huchen in the Czech Republic: A review – Arch. Pol. Fish. 21: 143-154. Abstract. This paper focuses on the historical and present Introduction occurrence of huchen, Hucho hucho (L.), in the Czech Republic. The last autochthonous huchen specimens caught in Moravia at the end of the nineteenth century are Huchen, or Danube salmon, Hucho hucho (L.), origi- discussed, as are huchen stocking and and success rates in nally occurred in the Danube River basin in Europe. the Czech Republic from the late nineteenth century to the Huchen was introduced locally in some other Euro- present, catches of trophy-sized recreational angling catches pean headwaters (Holèík et al. 1988, Kottelat and of huchen, and the results of measures taken to re-introduce Freyhof 2007). Its current distribution in the Danube the species to traditional areas of occurrence and to introduce it to new ones. The occurrence of huchen at drainage basin is highly fragmented, and natural present is confirmed in some sections of the Labe, Oder, and huchen reproduction has been heavily restricted by Morava river basins within the Czech Republic, and all of habitat alterations. Human impact, including water these populations are sustained through stocking material pollution, waterway redirection, overfishing, and obtained through artificial reproduction. -

Book of Abstracts
Masaryk University 17th International Workshop European Vegetation Survey Using phytosociological data to address ecological questions 1-5 May 2008 Masaryk University, Brno, Czech Republic Abstracts and Excursion Guides Edited by Milan Chytrý Excursion Guides by Ji ří Danihelka, Milan Chytrý, Jan Role ček and Vít Grulich Brno 2008 Programme Committee Milan Chytrý (Brno, CZ) Ladislav Mucina (Stellenbosch, ZA) Sandro Pignatti (Rome, IT) John S. Rodwell (Lancaster, UK) Joop H. J. Schaminée (Wageningen, NL) Lubomír Tichý (Brno, CZ) Local Organizers Iva Adamová Stanislav N ěmejc Jana Božková Zdenka Otýpková Magdaléna Chytrá Barbora Pelánková Milan Chytrý Karla Pet řívaldská Ji ří Danihelka Jan Role ček Markéta Fránková Ji ří Rozehnal Michal Hájek Marcela R ůži čková Eva Hettenbergerová Lucia Sekulová Lucie Jarošová Deana Simonová Št ěpánka Králová Lubomír Tichý Ching-Feng (Woody) Li Irena Veselá Zde ňka Lososová Marie Vymazalová Kristina Merunková David Zelený Lydie Navrátilová Organized and sponsored by Faculty of Science, Masaryk University, Brno (Vegetation Science Group, Mire Ecology Group and Department of Botany and Zoology) Faculty of Education, Masaryk University, Brno (Department of Biology) Secretariat Št ěpánka Králová, Department of Botany and Zoology, Masaryk University Kotlá řská 2, CZ-611 37 Brno, Czech Republic, e-mail: [email protected] http://botzool.sci.muni.cz/EVS/ © Masaryk University, Brno, 2008 ISBN 978-80-210-4585-9 Contents Abstracts ............................................................................................................... -

Internet, Capitalism, and Peripheral Development in the Waldviertel
New Proposals: Journal of Marxism and Interdisciplinary Inquiry Vol. 7, No. 2 (March 2015) Pp. 74-100 Internet, Capitalism, and Peripheral Development in the Waldviertel Christian Fuchs University of Westminster ABSTRACT: The Waldviertel (“Forest Quarter”) is a region in northern Austria that is structurally weak. It represents an inner periphery and inner colony of Austrian and European capitalism. This article analyses the political economy of the Internet in the Waldviertel. The Waldviertel is confronted with high rates of exploitation within the context of an imperialist division of labour, with transfer of value, unequal exchange, low wages, the exodus of the textile industry, high unemployment, depopulation of the countryside, a dismantling of public infrastructure, and a declining population. This analysis makes clear that the reality of the Waldviertel as inner periphery of the capitalist centres shapes communication in the region. Access to computers, the Internet and broadband is worse in the Waldviertel than in other regions. Internet and mobile speeds tend to be slower, making the region less attractive to information workers. There are also signs of an alternative economy in the Waldviertel that call imperialism into question. In the area of the information economy there is potential for founding socialist co-operatives for hardware, software, and social media that call the capitalist information society into question and struggle for alternatives. KEYWORDS: regional development; capitalism; political economy of the Internet; Austria; Waldviertel; inner colonies; periphery; inner periphery; imperialism Introduction grew up in the small Austrian city of Waidhofen of my schoolmates have returned to Waidhofen or an der Thaya, and went to school there. -

Sensitive Transport Development Along the Central European Green
Attila Lüttmerding Ádám Bodor Peter Leischner Boris Madjeric Neven Trenc Annett Zeigerer Matthias Gather Sensitive Transport Development Development Transport Sensitive along the Belt Green European Central Berichte des Instituts Verkehr und Raum Band 2 (2008) Sensitive Transport Development along the Central European Green Belt Public transport, hike trails and bike paths Objectives, criteria, analysis and best practice examples (INTERREG IIIB – CADSES) Attila Lüttmerding Ádám Bodor (Hungarian Cyclist Club, PP10) Peter Leischner (Radplan, Germany) Boris Madjeric (Tourist Association of Pitomača, Croatia) Neven Trenc (Croatian State Institute for Nature Protection, PP 17) Annett Zeigerer Matthias Gather April 2008 Institut Verkehr und Raum – Transport and Spatial Planning Institute Fachhochschule Erfurt – University of Applied Science Altonaer Straße 25 D-99085 Erfurt Telefon: +49 (361) 6700 758 Telefax: +49 (361) 6700 757 E-Mail: [email protected] Internet: www.verkehr-und-raum.de Contents 1 Introduction ................................................................................................................... 1 2 Introduction of the Region ............................................................................................ 1 3 Population and accessibility of the Green Belt (Annett Zeigerer) ................................. 2 4 Sensitive transport development .................................................................................. 4 4.1 Sensitive transport development as part of Ecotourism .............................................. -

Huchen in the Czech Republic: a Review
Arch. Pol. Fish. (2013) 21: 143-154 DOI 10.2478/aopf-2013-0011 RESEARCH ARTICLE Huchen in the Czech Republic: A review Lubomír Hanel, Stanislav Lusk, Jan Andreska Received – 01 April 2013/Accepted – 11 July 2013. Published online: 30 September 2013; ©Inland Fisheries Institute in Olsztyn, Poland Citation: Hanel L., Lusk S., Andreska J. 2013 – Huchen in the Czech Republic: A review – Arch. Pol. Fish. 21: 143-154. Abstract. This paper focuses on the historical and present Introduction occurrence of huchen, Hucho hucho (L.), in the Czech Republic. The last autochthonous huchen specimens caught in Moravia at the end of the nineteenth century are Huchen, or Danube salmon, Hucho hucho (L.), origi- discussed, as are huchen stocking and and success rates in nally occurred in the Danube River basin in Europe. the Czech Republic from the late nineteenth century to the Huchen was introduced locally in some other Euro- present, catches of trophy-sized recreational angling catches pean headwaters (Holèík et al. 1988, Kottelat and of huchen, and the results of measures taken to re-introduce Freyhof 2007). Its current distribution in the Danube the species to traditional areas of occurrence and to introduce it to new ones. The occurrence of huchen at drainage basin is highly fragmented, and natural present is confirmed in some sections of the Labe, Oder, and huchen reproduction has been heavily restricted by Morava river basins within the Czech Republic, and all of habitat alterations. Human impact, including water these populations are sustained through stocking material pollution, waterway redirection, overfishing, and obtained through artificial reproduction. -

Moving Austria. ÖBB Is the Most Important Mobility Provider in Local and Regional Transport and Makes Austria a Little Greener with Every Passenger Kilometre
Moving ÖBB compact 2018/19 compact ÖBB Austria. Facts & Figures ÖBB. Austrian Federal Railways Climate protection. ÖBB saves 1.1 million tonnes of CO2 per year by rail freight traffic and 2.4 million tonnes CO2 by rail pas- senger transport. This amounts to a total of 3.5 million tonnes of 35 CO . In order to bind 2 PLO. t this quantity, a forest the size of Vorarlberg would have to be planted. 1124 mil. t of CO2 emissions saved through ÖBB’s rail transport FOREWORD 3 FACTS & FIGURES FOREWORD Green ÖBB. It’s no news to us that we make an important contribution to climate protection in Austria every day. There is no longer any doubt that human activity is causing climate change, so our mobility services are now more modern and more important than ever. 9GRQYGTGFQWTƓTUVVTCKPUGNGEVTKECNN[QXGTCJWPFTGF[GCTU ago. Today, more than 90 percent of all our passenger trains run on electricity. And in 2018 we continued to improve our climate protection performance. Since mid-2018, our trains have been powered exclusively by electricity from renewable sources. And since mid-2019, electricity exclusively from renewable energy is also used in all our operating facilities CPFQHƓEGU This has massively improved our carbon footprint once CICKP9GCTGOCMKPICUKIPKƓECPVEQPVTKDWVKQPVQGPCDNKPI Austria to achieve its climate targets. And ÖBB is constantly working to improve the services on offer in order to move even more people on rails: to work, to school, and in their leisure time. Find out more about how we do this in what is now the 7th edition of this folder. -
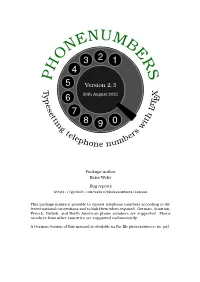
Typesetting Telephone Numbers with Latex
ENUMB N E O 3 2 1 R H 4 S P 5 Version 2.3 T y 20th August 2021 X p 6 E e T s A L e 7 t h t t in 8 0 i g 9 w te rs lep be hone num Package author Keno Wehr Bug reports https://github.com/wehro/phonenumbers/issues This package makes it possible to typeset telephone numbers according to dif- ferent national conventions and to link them when required. German, Austrian, French, British, and North American phone numbers are supported. Phone numbers from other countries are supported rudimentarily. A German version of this manual is available in the file phonenumbers-de.pdf. Contents 1 Quick Start 4 1.1 Germany ................................. 4 1.2 Austria ................................... 4 1.3 France ................................... 5 1.4 United Kingdom ............................. 5 1.5 North America .............................. 6 1.6 Other Countries ............................. 6 2 General Principles 7 2.1 Basic Ideas of the Package ....................... 7 2.2 Commands ................................ 7 2.3 Linking of Phone Numbers ....................... 8 2.4 Options .................................. 9 2.5 Invalid Numbers ............................. 11 2.6 Licence .................................. 11 3 German Phone Numbers 12 3.1 Structure of the Numbers ........................ 12 3.2 Options .................................. 13 3.3 Invalid Numbers ............................. 14 4 Austrian Phone Numbers 16 4.1 Structure of the Numbers ........................ 16 4.2 Options .................................. 17 4.3 Invalid Numbers ............................. 18 5 French Phone Numbers 20 5.1 Scope ................................... 20 5.2 Structure of the Numbers ........................ 20 5.3 Options .................................. 22 5.4 Invalid Numbers ............................. 23 6 British Phone Numbers 24 6.1 Scope ................................... 24 6.2 Structure of the Numbers .......................