Ethno Thierry 2003 432.Pdf Pdf 1 Mo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Departement De Saone-Et-Loire Nombre D'emplacements D'affichage Electoral Arrondissement De Charolles
DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE NOMBRE D'EMPLACEMENTS D'AFFICHAGE ELECTORAL ARRONDISSEMENT D'AUTUN CANTON COMMUNES ADRESSE Bureau de vote groupe scolaire du Clos-Jovet : façade - CANTON D'AUTUN-NORD AUTUN 13 de l'école Av. République, mur gymnase rue Rolin Av. République, entrée quai gare Rue de la Barre - rue des Gailles : terrain ville situé au croisement de ces deux deux Rue du 11 novembre 18, près voie ferrée BV groupe scolaire Parc St-Andoche : mur de clôture de la caserne pompiers, jouxtant celui du groupe scolaire (St Pantaléon) BV du groupe scolaire Victor-Hugo : mur de l'école Mairie annexe, mur cimetière, parallèle à l'avenue de (St Pantaléon) la République (St Pantaléon) Rue Pierre et Marie Curie: prieuré St Martin (St Pantaléon) Route d'Arnay-le-Duc, à la hauteur du n° 24 Route d'Arnay-le-Duc, à la hauteur de l'ancienne (St Pantaléon) gare de l'Orme Rue Antoine Clément : prés de la Place Général (St Pantaléon) Brosset Quartier St-Pierre, angle rues de Bourgogne et de (St Pantaléon) Moirans DRACY-ST-LOUP 1 Place de la mairie MONTHELON 1 le bourg ST-FORGEOT 1 le bourg TAVERNAY 1 le bourg 17 BV hôtel de ville : mur de l'Hotel de ville, côté rue - CANTON D'AUTUN-SUD AUTUN 6 Guérin Rue H. Dunant, muret de la maison verte Rue Victor Terret (à proximité tennis) Place d'Hallencourt, arrière Palais Justice Couhard : sur parking près cabine téléphonique Bureau vote de Fragny, mur du préau de la salle "La communale" ANTULLY 1 le bourg, place de la mairie AUXY 2 parking face au terrain de sports D298 CD 278 " la petite auberge" (21 route -
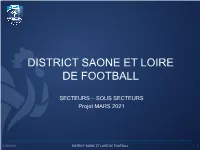
Comite Direction 27/11/2020
DISTRICT SAONE ET LOIRE DE FOOTBALL SECTEURS – SOUS SECTEURS Projet MARS 2021 01/05/2021 DISTRICT SAÔNE ET LOIRE DE FOOTBALL 1 LA SAONE ET LOIRE : EN CHIFFRES Avec une population estimée de 548 000 habitants au 1er janvier 2020, la Saône-et- Loire est le département le plus peuplé de la région Bourgogne-Franche-Comté. Mais la dynamique démographique n'est plus au rendez-vous ; sa population est en baisse depuis 2013 Superficie de 8 574,7 km ² (18 % de la superficie de la Bourgogne Franche Comté) 01/05/2021 DISTRICT SAÔNE ET LOIRE DE FOOTBALL 2 LE DISTRICT : EN CHIFFRES 146 CLUBS 16 998 LICENCIES Base 2020 2021 19 ELUS 6 SALARIES 01/05/2021 DISTRICT SAÔNE ET LOIRE DE FOOTBALL 3 LE DISTRICT : 5 SECTEURS Méthode : Un découpage en se basant sur les arrondissements (source CD71). 5 arrondissements. On intègre AUTUN 1 et 2 dans un secteur tout en se gardant la possibilité de traiter via la sous sectorisation cette partie « isolée » de notre District. Et une sous sectorisation par CANTONS afin de coller au plus près à la politique du territoire. Un sous secteur, un (ou quelques) canton (s), un interlocuteur « politique », une dynamique de territoire. 01/05/2021 DISTRICT SAÔNE ET LOIRE DE FOOTBALL 4 LES 5 ARRONDISSEMENTS 01/05/2021 DISTRICT SAÔNE ET LOIRE DE FOOTBALL 5 LES 25 CANTONS 01/05/2021 DISTRICT SAÔNE ET LOIRE DE FOOTBALL 6 LE DISTRICT : 5 SECTEURS Il faut donner un nom à chaque secteur, associer une Secteur 1: Grand Charolais couleur. Secteur 2: Autunois et CUCM Secteur 3: Mâconnais 1 secteur = deux élus du CD 10 personnes Secteur 4: Chalonnais En charge de trouver un Secteur 5: Bresse 71 réfèrent pour chaque sous secteur (canton). -

Mise En Page 1 03/03/2017 15:55 Page1
GUIDE 2017 BAT_Mise en page 1 03/03/2017 15:55 Page1 Culture ou nature ? les deux c’est mieux ! Entre Autun, Ville d’Art et d’Histoire et Morvan, forêts et mystères... Tourist guide Tourist www.autun-tourisme.com Culture or nature? Why not both! From Autun, City of Art and History to Morvan, land of forests and myths… GB GUIDE 2017 BAT_Mise en page 1 03/03/2017 15:55 Page2 Cathédrale Saint-Lazare - Autun Direction ANOST Saulieu ANTULLY Vézelay AUTUN AUXY CChhissey-iissseyy-- BARNAY en-Morvanen-Morrvvvaan BROYE Direction CHARBONNAT Dijon CHISSEY-EN-MORVAN BarnayBarnay Cussy-en-Cussyy--en- COLLONGE-LA-MADELEINE MorvanMorrvvvaan Lucenay-Lucenayy-- CORDESSE AnostAnnost l'Évêquel'Évvêêque CRÉOT SommantSomo mant IgornayIgornay CURGY ReclesneRec CordesseCordesse CUSSY-EN-MORVAN Direction Chateau-Chinon LaLa Petite-Petittee- DETTEY NeverNeversrss VerrièreVVeerrière SSaintSaSaint-Léger Lé Dracy-D ar ccyyy-- dudu-Bois B Roussillon-Roussillon- TTaTavernayavv rna DRACY-SAINT-LOUP en-Morvanen-Morrvvvaan Saint-LoupSaintt--Loup Sully EPERTULLY La Celle-C elle - en-Morvanen-Morrvvvaan Saint-ForgeotSaSSaint-Fa FoForgo ggeoteoeotot EPINAC Haut Folin Epinacpiinn GLUX-EN-GLENNE CCurgyurgy IGORNAY LA BOULAYE Glux-en- MMonthelononthelon SaisyS isyy Glenne LaLa Grande- MorletM ett EpertullyEpertullyrtrtully LA CELLE-EN-MORVAN VVeVerrièreerrrr rèi e AuxyAuxxyy Collonge-laoonge-lala DirectionDirection LA CHAPELLE-SOUS-UCHON Madeleine Beaune TintryiT nttrrryy LA GRANDE-VERRIÈRE BibracteBibracacte AutunAutun Saint-Gervaisiss LAIZY sur-Couchessu heses Saint-Léger--Léger-er -

AD71 Répertoire Des Revues
RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DE LA SÉRIE REV TITRES DE REVUES ET AUTRES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES (HORS TITRES DE PRESSE) Mise à jour : janvier 2021 Archives départementales de Saône-et-Loire, 21/01/2021 1 REV 1/1-27 L’Histoire. 1981 à nos jours 1 n° 30 - 42 1981 - février 1982 mq. n° 41 2 n° 43 - 54 mars 1982 - mars 1983 mq. n° 50 3 n° 55 - 66 avril 1983 - avril 1984 4 n° 67 - 79 mai 1984 - juin 1985 5 n° 80 - 93 juillet 1985 - octobre 1986 6 n° 94 - 107 septembre 1986 - janvier 1988 7 n° 108 - 120 février 1988 - mars 1989 8 n° 121 - 135 avril 1989 - août 1990 9 n° 136 - 151 septembre 1990 - janvier 1992 plus index général 1978 - 1991 mq. n° 144, 148 10 n° 152 - 167 février 1992 - juin 1993 mq. n° 158 11 n° 168 - 183 juillet 1993 - décembre 1994 12 n° 184 - 199 janvier 1995 - mai 1996 13 n° 200 - 216 juin 1996 - décembre 1997 14 n° 217 - 232 janvier 1998 - mai 1998 15 n° 233 - 248 juin 1999 - novembre 2000 mq. 240, 245 16 n° 249 - 263 décembre 2000 - mars 2002 mq. 259 17 n° 264 - 279 avril 2002 - septembre 2003 mq. n° 269 18 n° 280 - 293 octobre 2003 - décembre 2004 plus index général 1978 - 2003 19 n° 294 - 317 janvier 2005 - février 2007 20 n° 318 - 337 janvier 2007 - décembre 2008 mq. n° 324, 327 21 n° 338 - 354 janvier 2009 - juin 2010 mq. n° 348 22 n° 355 - 370 juillet 2010 - décembre 2011 mq. n° 362 23 n° 371 - 400 janvier 2012 - décembre 2013 mq. -

Bureau De La Communication Interministérielle Et De La Représentation De L'état
COMMUNIQUE DE PRESSE MÂCON, le 16 octobre 2020 COVID-19 : le taux d’incidence franchit la barre des 200/100 000 en Saône-et- !ire - "!int de situati!n en Saône-et- !ire Comme au plan national, la dégradation des indicateurs sanitaires s’accélère nettement en Sa ne! et!"oire depuis di# $ours% &u 16 octobre, selon l’agence régionale de santé, '( personnes atteintes du )irus Co)id!19 sont *ospitalisées dans les * pitau# et clini+ues de Sa ne!et!"oire ,soit - .6 personnes *ospitalisées en une semaine/% ' patients sont pris en c*arge en réanimation ,soit - 2 personnes en une semaine/% 22( personnes sont décédées en milieu *ospitalier des suites de la Co)id!1' ,soit 0 personnes décédées en une semaine/% "a circulation du )irus s’accro1t rapidement au sein de la population 2 le tau# d’incidence a +uasiment triplé en sept $ours pour s’établir 3 2164100 000 *abitants% "e tau# d’incidence pour les personnes 5gées de plus de 66 ans conna1t le m7me r8t*me et atteint 2.04100 000% "e tau# d’incidence cumulé pour les +uatre principales agglomérations de Sa ne!et!"oire ,M5con, C*alon! sur!Sa ne, "e Creusot, Montceau!les!Mines/ se situe désormais 3 plus de 2624100 000% - #tat d’ur$ence sanitaire : c!ns%&uences en Saône-et- !ire 9ar décret du 1( octobre 2020, le 9remier ministre a décrété l’état d:urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire 3 compter du samedi 1( !ct!bre 2020 ) 00h00% "a Sa ne!et!"oire n’est toute;ois pas concernée par le cou)re ;eu établi dans plusieurs départements et métropoles de <rance% =ans l’ensemble des départements, plusieurs -

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS D’AUTUN Comité Directeur
2017 2018 AUTUN SPORTS INDIVIDUELS SPORTS COLLECTIFS SPORTS SANTÉ Office SPORTS COMPÉTITION Municipal SPORTS LOISIRS des Sports 2, rue Nicéphore Nièpce - 71400 Autun tél. +33 (0)3 85 86 60 00 - www.dim.fr OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS D’AUTUN Comité Directeur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Jean-François ALUZE 03 85 54 33 64 Préau - 71190 BROYE 06 76 66 73 42 [email protected] 2 Alain COULON 03 85 52 40 48 34, rue du Vieux St Denis - 71400 CURGY [email protected] 3 Marie-Jeanne GIEN 06 76 63 04 27 13, gde rue Chauchien - 71400 AUTUN [email protected] 4 Pierre LATOUCHE 06 74 19 35 38 22, rue Maurice Ravel - 71400 AUTUN [email protected] 5 Manue LIOCHON 03 85 54 24 66 Magny - 71400 La-CELLE-en-MORVAN [email protected] 6 Hubert LOBREAU 03 85 52 73 01 Hôtel de Ville - 71400 AUTUN 06 80 65 25 86 [email protected] 7 Gérard METAIS 03 85 52 33 93 29, rue du Parc des Drémeaux - 71400 AUTUN 06 71 98 98 30 [email protected] 8 Gilles PASQUELIN 03 85 52 54 43 6, rue Moirans - 71400 AUTUN [email protected] 9 Pascal POMAREL 03 85 52 79 65 Hôtel de Ville - 71400 AUTUN [email protected] 10 Christian RENIER 06 81 78 91 37 6, impasse des Carilloux - 71400 AUTUN [email protected] 11 Rémi STRASBERG 03 85 52 67 40 10, rue Talleyrand - 71400 AUTUN [email protected] 12 Gérard VERDIER 03 85 52 65 32 30, rue du Champ Develay - 71400 CURGY [email protected] 13 Georges VERNAY 03 85 52 39 19 3, allée de la Liberté - 71400 AUTUN 06 80 38 06 11 [email protected] 2, avenue Charles de Gaulle - 71400 AUTUN 3 SOMMAIRE et Index des Sports Comité Directeur .............................................................................................................................................p. -

Mise En Page 1
Culture ou nature ? les deux c’est mieux ! Entre Autun, Ville d’Art et d’Histoire et Morvan, forêts et mystères... Tourist guide Tourist www.autun-tourisme.com Culture or nature? Why not both! From Autun, City of Art and History to Morvan, land of forests and myths… GB Cathédrale Saint-Lazare - Autun ANOST Direction ANTULLY Saulieu/Vézelaylieuieu AUTUN AUXY Chissey-CChhiissseyy-- BARNAY enen-Morvan--MMorrvvvaan BRION Direction BROYE DiDijonijonjon CHARBONNAT BarnBarnayaayy CHISSEY EN MORVAN CCuCussy-en-usssyyy--enn- MoMorvanrrvvan Lucenay-Lucenayy-- COLLONGE LA MADELEINE AnostAnost ll'ÉvêqueÉ' vêque CORDESSE COUCHES SommSommantant IIgIgornayg ro naayy CREOT ReclesneRec CCoCordesseorrddesse CURGY Direction Chateau-Chinon LLaa PPetite-ettiittee- CUSSY EN MORVAN Nevers VVeVerrièreerrriièrree Saint-LégerSaint-Léger DETTEY DDracy-rraacyy-- ddudu-BoisBoi Roussillon-Roussiilllon- Tavernayv SSaint-Loupaintt--Loup DRACY LES COUCHES en-Morvanen-Morrvvvaan Sully DRACY SAINT LOUP La CCeCelle-el -el en-Men-Morvanorrvvan Saint-ForgeotSaS oorgegeoteoto EPERTULLY HautHaH Folin EpinacEp EPINAC CCuCurgyurrggy ETANG SUR ARROUX IGORNAY SSaisyisy StSt-Prixt Prix MMonthelononth ole n LA BOULAYE LaLa Grande-Grraande- MMorletett EpertullyEp LA CELLE EN MORVAN VerrièreVVeerrriièrree AAuxyuxxyy Collonge-lallonge-lalolla Direction LA CHAPELLE SOUS UCHON MaMadeleine Beaune AutunAuttuun TintryiT ntryry LA COMELLE BibrBibracteacacte Saint-Gervaiss LA GRANDE VERRIERE sur-sursur-Couchesur-Couches ess LA PETITE VERRIERE Saint-Léger-geger-- Saint- sous-BeuvrayB vr y Brionio -

15 Sutherland
Lamartine, Louis-Napoléon and the Left 135 Lamartine, Louis-Napoléon and the Left: Rural Voting in the Mâconnais, 1848–49 D.M.G. Sutherland The election of Louis-Napoleon Bonaparte on December 10, 1848 looms over the nineteenth century. As is well known, the election of the nephew stunned contemporaries who saw it as a consequence of political illiteracy. Marx was only the most well-known commentator who expressed his disdain for the deplorables: December 10, 1848 was the day of the peasant insurrection. Only from this day does the February of the French peasants date. The symbol that expressed their entry into the revolutionary movement, clumsily cunning, knavishly naive, doltishly sublime, a calculated superstition, a pathetic burlesque, a cleverly stupid anachronism, a world historical piece of buffoonery and an undecipherable hieroglyphic for the understanding of the civilized – this symbol bore the unmistakable features of the class that represents barbarism within civilization. The republic had announced itself to this class with the tax collector; it announced itself to the republic with the emperor [...] With banners, with beat of drums and blare of trumpets, they marched to the polling booths shouting: plus d’impôts, à bas les riches, à bas la république, vive l’Empereur [...] Behind the emperor was hidden the peasant war. The republic that they voted down was the republic of the rich.1 Beneath the contempt, Marx was asserting that peasant politics was anti-fiscal and hostile to the rich. Robert Tombs concurred that the election was a peasant revolt against the whole political class and the notables. -
ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION Vom 7. März 2000 Zur Aufstellung
2000D0339 — DE — 16.03.2001 — 001.001 — 1 Dieses Dokument ist lediglich eine Dokumentationsquelle, für deren Richtigkeit die Organe der Gemeinschaften keine Gewähr übernehmen " B ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION vom 7. März 2000 zur Aufstellung des Verzeichnisses der in Frankreich unter Ziel 2 der Strukturfonds fallenden Gebiete im Zeitraum 2000—2006 (Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(2000) 553) (Nur der französische Text ist verbindlich) (2000/339/EG) (ABl. L 123 vom 24.5.2000, S. 1) Geändert durch: Amtsblatt Nr. Seite Datum "M1 Entscheidung 2001/202/EG der Kommission vom 21. Februar 2001 L 78 42 16.3.2001 2000D0339 — DE — 16.03.2001 — 001.001 — 2 !B ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION vom 7. März 2000 zur Aufstellung des Verzeichnisses der in Frankreich unter Ziel 2 der Strukturfonds fallenden Gebiete im Zeitraum 2000—2006 (Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(2000) 553) (Nur der französische Text ist verbindlich) (2000/339/EG) DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen Bestimmungen über die Strukturfonds (1), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 4 Unterabsatz 1, nach Anhörung des Ausschusses für die Entwicklung und Umstellung der Regionen, des Ausschusses für Agrarstrukturen und die Entwicklung des ländlichen Raums und des Ausschusses für Fischerei und Aquakultur, in Erwägung nachstehender Gründe: (1) Gemäß Artikel 1 Unterabsatz 1 Ziffer 2 der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 wird im Rahmen von Ziel 2 der Strukturfonds die wirtschaftliche und soziale Umstellung der Gebiete mit Struktur- problemen unterstützt. (2) Gemäß Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Verordnung (EG) Nr. -
Risques De Rupture De Barrages
Zds͘ϱ Z/^Yh^ZhWdhZZZ'^ ;ƐĞůŽŶůΖǀĂůƵĂƚŝŽŶWƌĠůŝŵŝŶĂŝƌĞĚĞƐZŝƐƋƵĞƐ/ŶŽŶĚĂƚŝŽŶĚƵs>ŽŝƌĞƌĞƚĂŐŶĞͿ a a ^h>>z^h>>z ^h>>z^h>>z W/EW/E d/EdZzad/EdZz aEdh>>zEdh>>z D^sZ^D^sZ^ dE'Ͳ^hZͲZZKhydE'Ͳ^hZͲZZKhy DZD'EDZD'E ^/EdͲ^ZE/EͲhͲK/^^/EdͲ^ZE/EͲhͲK/^a >Zh^Kd>Zh^Kd>Zh^Kd>Zh/>>Zh/>>Zh/> a a dKZzdKZz a ^/EdͲh^^/EdͲh^a >Ez>Ez DKEdhͲ>^ͲD/E^DKEdhͲ>^ͲD/E^ Ϭ ϭϬŬŵ /ZzͲ>ͲEK>/ZzͲ>ͲEK> 'E>Z'E>Z W>/E'^W>/E'^ aZZ'>^^ŽƵ;ăůΖĞdžĐĞƉƚŝŽŶĚƵDĂƌƚŝŶĞƚ͕ĐůĂƐƐĠͿ WZzͲ>ͲDKE/>WZzͲ>ͲDKE/> dE'KEZEWZhEZZ'>^^ KDDhEKEZEWZhEZ/^YhΗZhWdhZZZ'Η;ϭϴͿ ;^ĞůŽŶůĞƐZDͿ WZ/DdZh^' KhZ^Ζh ^ŽƵƌĐĞƐ͗Z>ĞŶƚƌĞĞƚZDϮϭ͕ϱϴ͕ϳϭͲƵƚĞƵƌ͗^ƚĞǀĞDh>>ZͲϮϬϭϮ EEy^ EEyϱ͘ϭ͗>^^/&/d/KE^ZZ'^d^/'h^ EEyϱ͘Ϯ͗ZZdZWKZdEd^hZ>^D^hZ^WZ^Zsd/KE>Z^^KhZEh EWZ/K͛d/'E^>WZdDEd>^KEd>K/Z EEyϭ >^^/&/d/KE^ZZ'^d^/'h^ >ĞĚĠĐƌĞƚĚƵϭϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϬϳƚƌĂŝƚĞĚĞĨĂĕŽŶĂŶĂůŽŐƵĞƚŽƵƐůĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐĚĞŵġŵĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ͕ƋƵĞůƋƵĞƐŽŝĞŶƚůĞƵƌ ǀŽĐĂƚŝŽŶŽƵůĞƵƌƌĠŐŝŵĞũƵƌŝĚŝƋƵĞ;ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŽƵĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶͿ͘>ĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐŚLJĚƌĂƵůŝƋƵĞƐƐŽŶƚƐĠƉĂƌĠƐĞŶĚĞƵdžĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ͗ ďĂƌƌĂŐĞƐĞƚĚŝŐƵĞƐ͘ ĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐƐŽŶƚƌĠƉĂƌƚŝƐĞŶƋƵĂƚƌĞĐůĂƐƐĞƐ͕͕͗Ğƚ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ͗ŚĂƵƚĞƵƌĚĞůΖŽƵǀƌĂŐĞ͕ ǀŽůƵŵĞĚĞůĂƌĞƚĞŶƵĞ͕ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĚĞůĂnjŽŶĞƉƌŽƚĠŐĠĞ͘>ĞWdKh,ĂƉƵďůŝĠƵŶĞŶŽƚĞůĞϭϱũƵŝůůĞƚϮϬϬϴƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞŵŝĞƵdž ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞĐĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ WKhZ>^ZZ'^ , с ŚĂƵƚĞƵƌ ĚĞ ůΖŽƵǀƌĂŐĞ ĞdžƉƌŝŵĠĞ ĞŶ ŵğƚƌĞƐ Ğƚ ĚĠĨŝŶŝĞ ĐŽŵŵĞ ůĂ ƉůƵƐ ŐƌĂŶĚĞ ŚĂƵƚĞƵƌ ŵĞƐƵƌĠĞ ǀĞƌƚŝĐĂůĞŵĞŶƚ ĞŶƚƌĞ ůĞ ƐŽŵŵĞƚ ĚĞ ůΖŽƵǀƌĂŐĞ Ğƚ ůĞ ƚĞƌƌĂŝŶŶĂƚƵƌĞů;dEͿăůΖĂƉůŽŵďĚĞĐĞƐŽŵŵĞƚ͘ sс ǀŽůƵŵĞ ƌĞƚĞŶƵ ĞdžƉƌŝŵĠ ĞŶ ŵŝůůŝŽŶƐ ĚĞ ŵğƚƌĞƐ ĐƵďĞƐĞƚĚĠĨŝŶŝĐŽŵŵĞůĞǀŽůƵŵĞƋƵŝĞƐƚƌĞƚĞŶƵƉĂƌůĞ ďĂƌƌĂŐĞăůĂĐŽƚĞĚĞƌĞƚĞŶƵĞŶŽƌŵĂůĞ;ZEͿ͘KŶƉĞƵƚ ŶŽƚĞƌ ƋƵ͛ĞŶ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ůĞ ǀŽůƵŵĞ s ă ƉƌĞŶĚƌĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞĞƐƚůĞǀŽůƵŵĞƌĞƚĞŶƵƉĂƌůĞďĂƌƌĂŐĞ͘ -

Limites Administratives De Saône-Et-Loire
Limites administratives de Saône-et-Loire + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + CHISSEY EN-MORVAN CUSSY EN-MORVAN LUCENAY BARNAY L'ÉVÊQUE ANOST IGORNAY SOMMANT LA PETITE RECLESNE VERRIÈRE CORDESSE ST-LÉGER Autun-1 DU-BOIS ROUSSILLON EN-MORVAN DRACY-ST-LOUP LA CELLE TAVERNAY EN-MORVAN ST-FORGEOT ÉPINAC CURGY SULLY POURLANS PALLEAU CLUX-VILLENEUVE ST-PRIX LA GRANDE VERRIÈRE SAISY ÉCUELLES ST-GERVAIS MONT-LÈS N MONTHELO MORLET EN-VALLIÈRE ST-MARTIN SEURRE LONGEPIERRE AUTUN EN-GÂTINOIS ÉPERTULLY ST-LOUP COLLONGE CHARNAY NAVILLY GÉANGES LÈS-CHALON LAYS-SUR FRETTERANS AUXY LA-MADELEINE BRAGNY CHANGE LE-DOUBS TINTRY ST-GERVAIS DEZIZE-LÈS SUR-SAÔNE SUR-COUCHES MARANGES ALLEREY SAUNIÈRES FRONTENARD CRÉOT SUR-SAÔNE PARIS CHAUDENAY DEMIGNY L'HÔPITAL REMIGNY ST-LÉGER BRION PONTOUX CHARETTE LAIZY ST-MARTIN LES BORDES S/S-BEUVRAY VARENNES DE-COMMUNE SAMPIGNY SERMESSE AUTHUMES Gergy VERDUN-SUR PIERRE ST-SERNIN LÈS-MARANGES CHAGNY LE-DOUBS DE-BRESSE DRACY-LÈS DU-PLAIN CHEILLY BOUZERON ST-ÉMILAND R COUCHES LÈS-MARANGES MOUTHIE ANTULLY VERJUX EN-BRESSE BROYE CHASSEY GERGY CIEL TOUTENANT ST-MAURICE ST-GILLES LE-CAMP RULLY LESSARD ST-BONNET LÈS-COUCHES LE-NATIONAL LA COMELLE EN-BRESSE DENNEVY CHAMILLY BELLEVESVRE MESVRES COUCHES ST-DIDIER LA CHAPELLE VIREY ST-MAURICE ÉTANG FONTAINES EN-BRESSE ST-SAUVEUR Chagny E TORPES BEAUVERNOIS SUR-ARROUX -

DECISÃO DA COMISSÃO De 7 De Março De 2000 Que Estabelece a Lista Das Zonas Abrangidas Pelo Objectivo N.O 2 Dos Fundos Estrutu
2000D0339 — PT — 16.03.2001 — 001.001 — 1 Este documento constitui um instrumento de documentação e não vincula as instituições " B DECISÃO DA COMISSÃO de 7 de Março de 2000 que estabelece a lista das zonas abrangidas pelo objectivo n.o 2 dos Fundos estruturais para o período 2000-2006, em França [notificada com o número C (2000) 553] (Apenas faz fé o texto em língua francesa) (2000/339/CE) (JO L 123 de 24.5.2000, p. 1) Alterada por: Jornal Oficial n.o página data "M1 Decisão 2001/202/CE da Comissão de 21 de Fevereiro de 2001 L 78 42 16.3.2001 2000D0339 — PT — 16.03.2001 — 001.001 — 2 !B DECISÃO DA COMISSÃO de 7 de Março de 2000 que estabelece a lista das zonas abrangidas pelo objectivo n.o 2 dos Fundos estruturais para o período 2000-2006, em França [notificada com o número C (2000) 553] (Apenas faz fé o texto em língua francesa) (2000/339/CE) A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1260/1999 do Conselho, de 21 de Junho de 1999, que estabelece disposições gerais sobre os Fundos estruturais (1), e, nomeadamente, o n.o 4, primeiro parágrafo, do seu artigo 4.o, Após consulta do Comité para o Desenvolvimento e a Reconversão das Regiões, do Comité das Estruturas Agrícolas e do Desenvolvimento Rural e do Comité do Sector da Pesca e da Aquicultura, Considerando o seguinte: (1) O primeiro parágrafo, ponto 2, do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 dispõe que o objectivo n.o 2 dos Fundos estruturais tem por objectivo o apoio à reconversão económica e social das zonas com dificuldades estruturais.