Figures Mobiles: Une Anthropologie Du Smartphone
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Idevice Repair Course
0 iDevice Repair Course CLEVELAND IDEVICE REPAIR (IPHONE, IPAD AND IPOD) INSTITUTE OF LESSONS 9061C THROUGH 9070C ELECTRONICS 1 Study Guide to accompany The Unauthorized Guide to iPhone, iPad, and iPod Repair: A DIY Guide to Extending the Life of Your iDevices! By Timothy L. Warner ISBN: 0789750732 ISBN 13: 9780789750730 iPhone, iPad & iPod Repair Course $125 Study at home and learn to fix iDevices like iPhones, iPads and iPods. This self-paced certificate course includes a tool kit, study guide, text book and instructor support. It will prepare students with no iPhone repair experience for careers in the rapidly growing cell phone repair field. Learn at home to fix iPhones and other iDevices and start your own business. Call 1-800-321-2155 or enroll online today. This study guide contains excerpts from the book The Unauthorized Guide to iPhone, iPad, and iPod Repair – A DIY Guide to Extending the Life of Your iDevices! by Timothy Warner © Copyright 2014 Cleveland Institute of Electronics All Rights Reserved / Printed in the United States of America FIRST EDITION / First Printing / December 2014 2 Table of Contents Chat with Your Instructor ................................................................................................................ 3 Chapter 1 – Why Do it Yourself? ..................................................................................................... 4 iDevice Repair Lesson 9061C Examination .................................................................................. 5 Chapter 2 – The Tools of -

Iphone 6 Plus Screen Assembly Replacement Guide Iphone 6+
iPhone 6+ Product Installation Best Practices iPhone 6 Plus Screen Assembly Replacement Guide iPhone 6+ ©2014 iCracked, Inc. All rights reserved. iOS, all Apple product names, and Apple logos are trademark property of Apple, Inc. The content of this document is for iCracked Inc. suggested best practices for product use and installation. Users of this document are not permitted to copy, sell, reproduce, distribute, or otherwise share this content, either in part or as a whole, with others. Misuse of the content will be viewed as a violation of any license, employment agreement, or independent affiliate relationship with iCracked. iPhone 6+ ESD SAFETY! iCracked likes to stay on the safe side of repairs, and by using ESD (Electrostatic Discharge) safe tools and equipment, you can be sure to avoid static damage to your mobile device. ESD damage is difficult to diagnose as its effect isn’t usually immediately apparent, but sensitive sections of the logic board can, nevertheless, get weakened by static, and in turn become non-functional over time. While installing an iCracked touch screen digitizer or an LCD screen, doing a repair with ESD safety in mind can save the long-term circuitry and functionality of the device. iPhone 6+ RECOMMENDED TOOLS AND PARTS Tools Required: Parts Needed: ESD safe nylon spudger Replacement display assembly ESD safe #00 Phillips screwdriver iPhone Pentalobe screwdriver Optional: iSesamo opening tool Suction cup iSclack opening tool ESD safe tweezers Hair dryer or heat gun iPhone 6+ WARNING! TAKE every possible care to NOT damage the home button/biometric scanner cable. The Biometric scanner is locked to its original iPhone, meaning this CANNOT be replaced. -

(Sevilla) Unit 5, Circular Economy and Industrial Leadership
EUROPEAN COMMISSION JOINT RESEARCH CENTRE Directorate B, Growth and Innovation (Sevilla) Unit 5, Circular Economy and Industrial Leadership 1 2 Guide for the Assessment of Material Efficiency: application to smartphones Author(s): JRC – B.5 Date: 19 April 2018 Summary: Improving the material efficiency of products has the potential of bringing added value to the environment and to the economy, by saving resources and avoiding production of waste. However, improved design of products needs to be assisted by appropriate assessment methods. In this context, the Joint Research Centre Directorate B, Circular Economy & Industrial Leadership unit (JRC B.5), has been prepared a methodological guide for the assessment of material efficiency of products (GAME). The methodology is based on the analysis of technical and functional aspects of products, as well as on the definition of life cycle scenarios of assessment targeting environmental and economic impacts, and adheres on practical targets: ñ To identify key material efficiency aspects of products; ñ To propose of tangible improvement measures. This report describe the application of the methodology to the assessment of material efficiency aspects for smartphones, with the aim of compiling a list of possible actions for improving their performance with respect aspects as durability, reparability, upgradability, use of materials and recyclability. This draft report is structured in the following chapters: 1. Product group definition and characterisation (including: scoping, legislation and testing methods of interest, relevant information on market, user behaviour and product); 2. Identification of hot-spots for material efficiency (based on product- specific information and life cycle considerations); 3. Technical analysis and assessment of material efficiency aspects (e.g. -
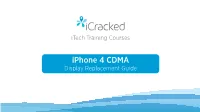
Iphone 4 CDMA Display Replacement Guide Iphone 4 CDMA
iTech Training Courses iPhone 4 CDMA Display Replacement Guide iPhone 4 CDMA ©2014 iCracked, Inc. All rights reserved. iOS, all Apple product names, and Apple logos are trademark property of Apple, Inc. The content of this training is for iTech training within iCracked, Inc. Users of this training program are not permitted to copy, sell, reproduce, distribute, or otherwise share this content, either in part or as a whole, with others. Misuse of the content of this training will be viewed as a violation of any license or employment agreement with iCracked. iPhone 4 CDMA ESD SAFETY! iCracked likes to stay on the safe side of repairs, and by using ESD (Electrostatic Discharge) safe tools and equipment, you can be sure to avoid static damage to your mobile device. ESD damage is difficult to diagnose as its effect isn’t usually immediately apparent, but sensitive sections of the logic board can nevertheless get weakened by static, and in turn become non-functional over time. Whether you are replacing a touch screen digitizer or an LCD screen, doing your repair with ESD safety in mind can save the long-term circuitry and functionality of your device. iPhone 4 CDMA EYE SAFETY! It is important that you understand that Safety glasses should be worn when working on any iOS device. Eye injuries are very common. Every day an estimated 1,000 people suffer an eye injury at work. Approximately 10% of these injuries are severe enough to require days away from work to recover. While the financial cost of these injuries are substantial, no dollar figure can adequately reflect the personal toll these incidents take on the injured employee. -
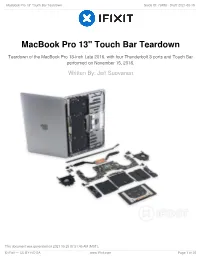
Macbook Pro 13" Touch Bar Teardown Guide ID: 73480 - Draft: 2021-05-19
MacBook Pro 13" Touch Bar Teardown Guide ID: 73480 - Draft: 2021-05-19 MacBook Pro 13" Touch Bar Teardown Teardown of the MacBook Pro 13-inch Late 2016, with four Thunderbolt 3 ports and Touch Bar performed on November 15, 2016. Written By: Jeff Suovanen This document was generated on 2021-05-25 07:51:45 AM (MST). © iFixit — CC BY-NC-SA www.iFixit.com Page 1 of 25 MacBook Pro 13" Touch Bar Teardown Guide ID: 73480 - Draft: 2021-05-19 INTRODUCTION Two weeks ago, we tore down the new entry-level 13" MacBook Pro to discover it was thinner, lighter, faster, and (sad face) less repairable than most any other pro-level laptop. Today, we turn our tools on its Touch Bar-equipped launch mate. Will this machine surprise us with some upgrade- friendly features, or will it be as disposable as the box it comes in? There's only one way to find out: it's teardown time! Follow along on Facebook, Instagram, or Twitter to keep in touch with the latest and greatest hardware teardowns and repair news! [video: https://www.youtube.com/watch?v=lBzDGjRge1A] TOOLS: 64 Bit Driver Kit (1) iOpener (1) Nylon Tipped Tweezers (1) Plastic Cards (1) iFixit Opening Picks set of 6 (1) Spudger (1) This document was generated on 2021-05-25 07:51:45 AM (MST). © iFixit — CC BY-NC-SA www.iFixit.com Page 2 of 25 MacBook Pro 13" Touch Bar Teardown Guide ID: 73480 - Draft: 2021-05-19 Step 1 — MacBook Pro 13" Touch Bar Teardown Today's million-dollar question: Is this a scaled-up version of the 13-inch "Escape Edition," or a scaled-down version of the 15-inch Touch Bar unit? Here's -

(Sevilla) Unit 5, Circular Economy and Industrial Leadership
EUROPEAN COMMISSION JOINT RESEARCH CENTRE Directorate B, Growth and Innovation (Sevilla) Unit 5, Circular Economy and Industrial Leadership 1 Guidance for the Assessment of Material Efficiency: Application to smartphones 2 – v 2 Author(s): Mauro Cordella, Felice Alfieri, Javier Sanfélix Date: 6 May 2019 (JRC – B.5) Summary: Improving the material efficiency of products has the potential of bringing added value to the environment and to the economy, by saving resources and avoiding production of waste. However, improved design of products needs to be assisted by appropriate assessment methods. In this context, the Joint Research Centre Directorate B, Circular Economy & Industrial Leadership unit (JRC B.5), has prepared a methodological guide for the assessment of material efficiency of products (GAME). The methodology is based on the analysis of technical and functional aspects of products, as well as on the definition of life cycle assessment scenarios targeting environmental and economic impacts, aiming at two practical targets: To identify key material efficiency aspects of products; To propose tangible improvement measures. This report describe the application of the methodology to the assessment of material efficiency aspects for smartphones, with the aim of compiling a list of possible actions for improving their performance with respect aspects as durability, reparability, upgradability, use of materials and recyclability. The report is structured in the following chapters: 1. Product group definition and characterisation (including: scoping, legislation and testing methods of interest, relevant information on market, user behaviour and products); 2. Identification of hot-spots for material efficiency (based on product- specific information and life cycle considerations); 3. Technical analysis and assessment of material efficiency aspects (e.g. -

Application to Smartphones
Guidance for the Assessment of Material Efficiency: Application to Smartphones Final report for Task 2 of the AA N. 070201/2015/SI2.719458/ENV.A.1 Mauro Cordella, Felice Alfieri, Javier Sanfelix (European Commission, Joint Research Centre, Seville, Spain) 2020 EUR 30068 EN This publication is a Technical report by the Joint Research Centre (JRC), the European Commission’s science and knowledge service. It aims to provide evidence-based scientific support to the European policymaking process. The scientific output expressed does not imply a policy position of the European Commission. Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for the use that might be made of this publication. For information on the methodology and quality underlying the data used in this publication for which the source is neither Eurostat nor other Commission services, users should contact the referenced source. The designations employed and the presentation of material on the maps do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the European Union concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Contact information Name: Mauro Cordella Address: Joint Research Centre, Edificio Expo. c/ Inca Garcilaso, 3. E-41092 Seville (Spain) Email: [email protected] Tel.: +34 954 488 424 EU Science Hub https://ec.europa.eu/jrc JRC116106 EUR 30068 EN PDF ISBN 978-92-76-15411-2 ISSN 1831-9424 doi:10.2760/037522 Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020 © European Union 2020 The reuse policy of the European Commission is implemented by the Commission Decision 2011/833/EU of 12 December 2011 on the reuse of Commission documents (OJ L 330, 14.12.2011, p.