L'évolution De La Structure De Gouvernance Pétrolière Russe. Une
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
In1vesting in Offshore
f&fI. BAKER HUGHY flawless execution is essential to maximizing your asset value-as Roger helps ensure flawless execution in well as your return on investment. That's why it's crucial to work with our pressure pumping field services, from a knowledgeable partner you can rely on. hydraulic fracturing to cementing. Visit us online to discover how he and his team can Baker Hughes combines the right people with the right technologies provide you reliable zonal isolation and to achieve the highest possible efficiency at your wellsite. And we're efficient access to your reserves. committed to identifying and implementing best practio~s, so we can improve our performance-and yours-2417. That's hoVi we've been Find out more at earning your trust for more than 100 years. ~. \', www.bakerhughes.com (H~ © 20\ 1BakEr Hughes Incorporal~d. All Righll Re\~l\'ed. 31746 Em ll!J ADVERTISI NG SALES US Sales 11'1ike 1I-10ss, (713) 963-6221, mi!ccm@pcnnwelL com. }..lark Cf.llcs, (713) 963·6237, rnarkg@pennwdl. com Sian Tel'T}; (713) 963-6203, slam@pennwell. Penn Well, Houston office Penn Well, Tulsa office com. I'>1arlenc Breedlove, (713) 963·6293, marleneb@ 1455 West Loop South, Suite 400, HO\Jston, TX 1421 S. Sheridan Rd., Tulsa, OK 74112 pennwE:1l.com. Roy Markum. (713) 963-6220, roym@ 77027 PO Box 1260, Tulsa, OK 74101 pcnnwdl.com. Telephone 713.621.9nO/Fax 713.963.6285/ Telephone 918.835.31611 Fax 918.832.9290 Web sile W'Nw.ogjorlline.com PresentationJEquipment Editor Jim Stilwell, Australia I New Zealand Editor Bob Tippee, [email protected] [email protected] -
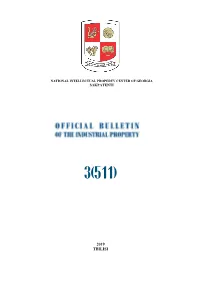
2019 Tbilisi
NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY CENTER OF GEORGIA SAKPATENTI 3(511) 2019 TBILISI INID CODES FOR IDENTIFICATION OF BIBLIOGRAPHIC DATA LIST OF CODES, IN ALPHABETIC SEQUENCE, AND THE CORRESPONDING (SHORT) NAMES OF STATES, OTHER ENTITIES AND INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (WIPO STANDARD ST.3) INVENTIONS, UTILITY MODELS (10) Number of publication for application, which has been examined (54) Title of the invention AD Andorra for the Arab States of the Gulf (GCC) NE Niger (11) Number of patent and kind of document (57) Abstract AE United Arab Emirates GD Grenada NG Nigeria (21) Serial number of application (60) Number of examined patent document granted by foreign patent office, date from which patent AF Afghanistan GG Guernsey NI Nicaragua (22) Date of filing of the application has effect and country code (62) Number of the earlier application and in case of divided application, date of filing an AG Antigua and Barbuda GH Ghana NL Netherlands (23) Date of exhibition or the date of the earlier filing and the number of application, if any application AI Anguilla GI Gibraltar NO Norway (24) Date from which patent may have effect (71) Name, surname and address of applicant (country code) AL Albania GT Guatemala NP Nepal (31) Number of priority application (72) Name, surname of inventor (country code) AM Armenia GW Guinea- Bissau NR Nauru (32) Date of filing of priority application (73) Name, surname and address of patent owner (country code) AN Netherlands Antilles GY Guyana NZ New Zealand (33) Code of the country or regional organization allotting -

Pacific Protection Activities Expanded
[email protected] | www.spillcontrol.org ISSUE 701 | 9 SEPTEMBER 2019 ISCO & THE ISCO NEWSLETTER INTERNATIONAL NEWS The International Spill Control Organization, a CLICK ON THE BANNERS BELOW FOR MORE INFO ON THE EVENTS FEATURED not-for profit organization dedicated to raising worldwide preparedness and co-operation in response to oil and chemical spills, promoting technical development and professional competency, and to providing a focus for making the knowledge and experience of spill control professionals available to Intergovernmental, Governmental, NGO’s and interested groups and individuals ISCO holds consultative status at the International Maritime Organisation and observer Status at International Oil Pollution Compensation Funds ISCO COMMITTEE & COUNCIL PACIFIC PROTECTION ACTIVITIES ISCO is managed by an EXECUTIVE EXPANDED Directors • Mr David Usher, President (USA) • Mr Matthew Sommerville , Secretary (UK) • Mr John McMurtrie, VP and Editor (UK) • Ms Mary Ann Dalgleish, VP M’ship (USA) Members • Mr Li Guobin (China) • M. Jean Claude Sainlos (France) • Mr Kerem Kemerli (Turkey) • Mr Marc Shaye (USA) • Mr Dan Sheehan (USA) • Captain Bill Boyle (UK) • Lord Peter Simon Rickaby (UK) Assisted by COUNCIL (National Representatives) • Mr John Wardrop (Australia) • Mr Osman Tarzumanov (Azerbaijan) • TBA (Brazil) • Dr Merv Fingas (Canada) • Captain Davy T. S. Lau (China) • Mr Darko Domovic (Croatia) • Eng. Ashraf Sabet (Egypt) • Mr Torbjorn Hedrenius (Estonia) A key IMO-supported international centre responsible for co-ordinating efforts -

An Analysis of the Licensing and Fiscal Policies Crystol Energy
The US Gulf of Mexico Policy Initiatives: An Analysis of the Licensing and Fiscal Policies Crystol Energy 06 August 2018 Table of Contents List of Figures ............................................................................................................................ 4 List of Tables ............................................................................................................................. 6 List of Boxes .............................................................................................................................. 7 Abbreviations List ....................................................................................................................... 8 Units and Currencies.................................................................................................................11 Executive Summary ..................................................................................................................12 1. Introduction ........................................................................................................................22 2. US Gulf of Mexico Overview ..............................................................................................24 3. Licensing Policy .................................................................................................................30 3.1. Allocation Method .......................................................................................................31 3.1. Restrictions .................................................................................................................34 -

Ceraweek 2013 Agenda at a Glance
Monday, March 4 9:00 am - 6:30 pm Pre-Conference Summits and Workshops | See conference details for questions on eligibility Monetizing Gas and Coal for Petrochemicals – Briefing and Workshop Thirst for Growth: Outlook for Gas and Power in the Middle East and North Africa – Multiclient Study Workshop Solving the Tangram: China Regional Gas, Power, and Coal Market Outlooks – Multiclient Study Workshop The New Map of Global Gas – Luncheon Briefing Africa Energy Summit Operational Excellence Summit The Tiger Re-Emerges: Southeast Asia Gas, Coal and Power Market Opportunities – Multiclient Study Workshop Onshore Oil and Gas Environmental Dialogue Luncheon Workshop: Launching The Manufacturing Renaissance* Luncheon Workshop** Unconventional Resources – Finding the Rational Middle Dialogue** 3:00 pm - 6:00 pm Conference Opening | IHS CERAWeek Global View Insights 2013 | open to all CERAWeek participants Presentations by leading IHS experts providing forward-looking insights on energy markets—as well as on cross-industry emerging global trends. Atul Arya, (Chairman) Senior Vice President, Energy Insight 3:00 PM – 4:30 PM Energy Market Outlook: What will be the Surprises in 2013 – and Beyond? James Burkhard, Vice President and Head of Oil Market Research & Scenarios Michael Stoppard, Managing Director, Global Gas Lawrence Makovich, Vice President and Senior Advisor for Global Power Thane Gustafson, Senior Director, Russian and Caspian Energy Xizhou Zhou, Director, China Energy John Larson, Vice President Economic and Public Sector Consulting 4:30 -

Natural Resources: Status and Trends Towards a Regional Development Agenda in Latin America and the Caribbean
Natural resources: status and trends towards a regional development agenda in Latin America and the Caribbean Contribution of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean to the Community of Latin American and Caribbean States Natural resources: status and trends towards a regional development agenda in Latin America and the Caribbean Contribution of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean to the Community of Latin American and Caribbean States This document was prepared by Hugo Altomonte, Chief of the Natural Resources and Infrastructure Division of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), and Jean Acquatella, Andrés Arroyo, Caridad Canales and Andrei Jouravlev, Economic Affairs Officers with the Division’s Natural Resources and Energy Unit. Arturo Prieto Matte and Víctor Zúñiga, consultants, also collaborated in this work. The authors wish to express thanks to Jeannette Lardé and René Salgado, Research Assistants with the Natural Resources and Infrastructure Division. LC/L.3748 • December 2013 © United Nations • Printed in Santiago, Chile 2013-808 3 CONTENTS Introduction .........................................................................................................................................................................................7 A. Natural resources governance and long-term structural change in Latin American economies .................................... 10 B. Responses of the mining, oil and gas sector to the 2000-2012 price cycle ................................................................... -

ISO 14001 Certified Companies in Hong Kong Under Alphabetical
THE DIRECTORY OF ISO 14001 CERTIFIED COMPANIES IN HONG KONG (A total of 939 ISO 14001 Certificates as at December 2015) Experience Sharing on EAC ISO 14000 by Accreditation No. Company Name Scope Cert body Implementing Code Industrial Sectors scheme ISO14001 1 3M Hong Kong 29 Wholesale & Retail Main office: Provision of logistics services for wholesale and retail trade of 3m products. UKAS Bureau Veritas Certification Limited Trade; Repairs of Motor Provision of packaging design, customer services and suppliers quality management for Hong Kong Limited Vehicles, Motorcycles industrial products (excludes abrasive system division, industrial adhesive and tape & Personal & division, energy markets and 3m dyneon), consumer and office products, electro & Household Goods communication products (excludes electronic markets materials division and electronic solutions division), health care products, display & graphics products (excludes optical system division), safety, security and protection products (exclude new business venture – scotchgard B2B, visibility & insulation solutions, corrosion protection products division). Innovation centre: Provision of technical services for industrial products (excludes abrasive system division, industrial adhesive and tapes division, energy markets and 3m dyneon), consumer and office products, electro & communication products (excludes electronic markets materials division and electronic solutions division), health care products, display & graphics products (excludes optical system division), safety, security and protection products (exclude new business venture – scotchgard B2B, visibility & insulation solutions, corrosion protection products division).Distribution centre: Provision of logistics services for wholesale and retail trade of 3m products 2 A.S. Watson Industries 3 Food Products, Design and manufacture of distilled water and beverages Nil Hong Kong Quality - A Division of Beverages & Tobacco Assurance Agency A.S.Watson Group (Hong Kong) Ltd. -
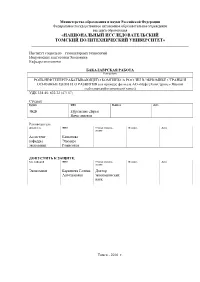
TPU193185.Pdf
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» _____________________________________________________________________________________ Институт социально – гуманитарных технологий Направление подготовки Экономика Кафедра экономики БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА Тема работы РОЛЬ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА РОССИИ В ЭКНОМИКЕ СТРАНЫ И ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ЕГО РАЗВИТИЯ (на примере филиала АО «НефтеХимСервис» Яйский нефтеперерабатывающий завод) УДК 338.45: 622.32 (47+57) Студент Группа ФИО Подпись Дата 3Б2Б Ефременко Дарья Вячеславовна Руководитель Должность ФИО Ученая степень, Подпись Дата звание Ассистент Кашапова кафедры Эльмира экономики Рамисовна ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ: Зав. кафедрой ФИО Ученая степень, Подпись Дата звание Экономики Барышева Галина Доктор Анзельмовна экономических наук Томск - 2016 г. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ООП ДЛЯ БАКАЛАВРОВ Требования ФГОС, Код Результат обучения критериев и/или результата (выпускник должен быть готов) заинтересованных сторон Универсальные компетенции Р1 Осуществлять коммуникации в профессиональной среде Требования ФГОС (ОК- и в обществе в целом, в том числе на иностранном языке, 14; ПК-9; 11) разрабатывать документацию, презентовать и защищать результаты комплексной экономической деятельности. Р2 Эффективно работать индивидуально, в качестве члена Требования ФГОС (ПК- команды, состоящей из специалистов различных 11; ОК-1,7,8) направлений и квалификаций, -

Effective Strategy for Growth 2012 Annual Report
JSC GAZPROMJSC NEFT EFFECTIVE STRATEGY FOR GROWTH JSC GAZPROM NEFT Russian Federation, 190000, St. Petersburg, Ul. Pochtamtskaya, 3-5 Tel.: +7 (812) 363-31-52 Tel.: 8 (800) 700-31-52 (free call in Russia) www.gazprom-neſt.ru ANNUAL REPORT 2012 2012 ANNUAL REPORT Gazprom Neft Group 2012 aNNUAL report Contents 50 128 Key Performance Indicators ����������������������������������������������������2 Innovation ������������������������������������������������������������������������������������ 94 Innovation in Exploration & Production ��������������������������������������������������� 95 Addresses ��������������������������������������������������������������������������������������������4 Innovation in Petroleum Refining & Petrochemical processing �����������������������������������������������������������������������101 Key Events ��������������������������������������������������������������������������������������8 Investment Activities ������������������������������������������������������������102 Company Profile ������������������������������������������������������������������������ 12 Mission ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 Management’s Discussion and Analysis ����������������������� 104 Company History ����������������������������������������������������������������������������������������������� 13 Definitions and Conversions �����������������������������������������������������������������������104 Gazprom Neft Structure ���������������������������������������������������������������������������������� -
Public Information Plan Coordinator, OLP, Plans Section (GM 235D )
UNITED STATES GOVERNMENT May 19, 2021 MEMORANDUM To: Public Information From: Plan Coordinator, OLP, Plans Section (GM 235D) Subject: Public Information copy of plan Control # - S-8044 Type - Supplemental Development Operations Coordinations Document Lease(s) - OCS-G08852 Block - 764 Mississippi Canyon Area Operator - Shell Offshore Inc. Description - Subsea Wells; MC 764, 004, 005, 006, KE001, KE002 and 8-Alt Rig Type - Not Found Attached is a copy of the subject plan. It has been deemed submitted as of this date and is under review for approval. Nawaz Khasraw Plan Coordinator Shell Offshore Inc. P. O. Box 61933 New Orleans, LA 70161-1933 United States of America Tel +1 504 425 4652 Fax +1 504 425 8076 Email [email protected] PUBLIC INFORMATION COPY March 17, 2021 Ms. Michelle Picou, Section Chief Bureau of Ocean Energy Management Office of Field Operations 1201 Elmwood Park Boulevard New Orleans, LA 70123-2394 Attn: Plans Section – GM 235D SUBJECT: Supplemental Development Operations Coordination Document Mississippi Canyon (MC) Block 764, OCS-G 8862 Mars Unit Contract No. 754393002 Offshore Louisiana Dear Ms. Picou: In compliance with 30 CFR 550.221 and NTLs 2008-G04, 2009-G27, 2015-N01 and BOEM 2020-G01, giving Development Plan guidelines, Shell Offshore Inc. (Shell) requests your approval of this Supplemental Development Operations Coordination Document (DOCD) to add new subsea wells to an existing manifold in MC 764 and the installation of a new flowline, umbilical, flying leads and jumpers. The cost recovery fee is attached to the proprietary copy of the plan. Should you have any questions or require additional information, please contact me. -

Chemicals & Plastics Newsletter
OCTOBER 2019 CHEMICALS & PLASTICS NEWSLETTER IN THIS ISSUE PNC’s Chemicals & Plastics Newsletter focuses on relevant market news and trends, Recent Headlines 1 lending and bond market activity and public trading data, along with merger and acquisition movement to keep you informed. In this issue, we highlight the third quarter Pricing and Volume Update 2 2019 market activity and provide insight into the trends that defi ned the quarter. Third Quarter Lending We hope that you fi nd the newsletter to be a useful tool for your day-to-day activities and Bond Market Activity 5 and we are always interested in learning how we can enhance our report. Please feel Public Trading Data 6 free to contact us with any suggestions or customized requests. Segment Performance 7 Third Quarter 2019 Transactions 8 RECENT HEADLINES PNC’s Chemicals & Plastics Experience 21 Clariant:1 Just 10 months after taking the job, and less than a year after Clariant and SABIC announced the signing of a Memorandum of Understanding on a “signifi cant collaboration opportunity,” Clariant’s CEO has stepped down and the joint venture between the two chemical companies has been suspended. While Ernesto Occhiello stepped down as CEO, apparently for personal reasons, current market FOR MORE INFORMATION conditions were cited as the reason behind the stalled talks regarding the intended combination of Clariant’s high-performance materials with parts of SABIC’s specialties business. Contact PNC’s Chemicals & Plastics Group: In addition to putting off talks of a joint venture, Clariant has decided to divest its entire Ben Whiting masterbatches business, instead of just its standard masterbatches, as previously announced. -

Intelligence Report: Business Shifts in the Global Catalytic Process Industries 2019-2025
The Eighteenth Biennial Edition INTELLIGENCE REPORT: BUSINESS SHIFTS IN THE GLOBAL CATALYTIC PROCESS INDUSTRIES 2019-2025 STUDY PRESENTATION (Completed May 2020) THE CATALYST GROUP RESOURCES, INC. ● Gwynedd Office Park ● P.O. Box 680 ● Spring House, PA 19477 – USA –Phone: +1-215-628-4447 ● Fax: +1-215-628-2267 ● www.catalystgrp.com ● [email protected] INTELLIGENCE REPORT BUSINESS SHIFTS IN THE GLOBAL CATALYTIC PROCESS INDUSTRIES 2019-2025 …Leading-edge Analyses and Guidance for Opportunity Identification and Strategic Investment… Clients in the catalyst and catalytic process industries are facing unprecedented times! The current “medical crisis” from COVID- 19 is being followed by a “financial crisis” in which TCGR anticipates a U-shaped recession lasting to at least the 4QTR, 2020 and perhaps into the 1st QTR 2021. The net result of the global pandemic, the oil price/demand crisis, and the recent US-China trade disputes is a level of uncertainty not seen in generations. Nonetheless, the catalyst and licensing industries are resilient and responsive, continuing to serve a breadth of dynamic and high value-added applications. In this report, between 2019-2025, the overall industry is forecast to grow at +2.8% annually, with some segments flat or declining (e.g., liquid fuels) while others grow more substantially (e.g., syngas-derived chemicals). As it has in the past, catalysis will drive the progress and innovation across society, producing over $15 trillion annually, from gasoline to aspirin. It is therefore of vital strategic importance to your business development, opportunity identification and planning for success. TCGR has completed the 18th edition of our biennial update, “The Intelligence Report: Business Shifts in the Global Catalytic Process Industries, 2019-2025.” Considered the industry “gold standard,” TCGR’s report goes beyond statistics and benchmarks to provide competitive insight and analysis vital to end users in the refining, petrochemical/chemical, polymer, specialty/fine chemicals and environmental markets.