Tribunal Administratif D'amiens
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Atlas Hydrogéologique Numérique De L'oise
Atlas hydrogéologique numérique de l’Oise Phase 2 : Notice Rapport d’avancement BRGM/RP-59757-FR Juin 2011 Atlas hydrogéologique numérique de l’Oise Phase 2 : Notice Rapport d’avancement BRGM/RP-59757-FR Juin 2011 Étude réalisée dans le cadre des projets de Service public du BRGM 2011 10EAUI56 V. Bault et R. Follet Vérificateur : Approbateur : Nom : J.J. Seguin Nom : D. Maton Date: 11/07/2011 Date : 12/07/2011 Signature : Signature : En l’absence de signature, notamment pour les rapports diffusés en version numérique, l’original signé est disponible aux Archives du BRGM. Le système de management de la qualité du BRGM est certifié AFAQ ISO 9001:2008. Mots clés : atlas, hydrogéologie, hydrologie, eau souterraine, eau superficielle, nappe, aquifère, bilan hydrologique, paramètres hydrodynamiques, données climatiques, piézométrie, SIG, Oise, Picardie. En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante : Bault V. et Follet R. (2011) – Atlas hydrogéologique numérique de l’Oise. Phase 2 : Notice. Rapport d’avancement. BRGM/RP-59757-FR, 168 p., 22 ill., 11 tab. © BRGM, 2011, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l’autorisation expresse du BRGM. Atlas hydrogéologique numérique de l’Oise. Phase 2 : Notice. Synthèse Constatant que le support et le contenu de l’atlas hydrogéologique du département de l’Oise, publié en 1987, ne répondaient plus aux besoins actuels d’informations et de consultation de ces données, le BRGM a proposé au Conseil Général de l’Oise et aux Agences de l’eau Seine-Normandie et Artois-Picardie de réaliser un atlas hydrogéologique départemental numérique pour le département de l’Oise. -

Relais Assistantes Maternelles Est Un Service D’Information Sur Les Différents Modes D’Accueil Pour Maison De L’Ensemble Du Territoire
Comment nous contacter ? Le Rdu BeauvaisisAM Maison de la petite enfance Le RAM du Beauvaisis RELAIS ASSISTANTES MAISON DE LA PETITE ENFANCE 20 avenue des écoles Lundi, mardi, jeudi et vendredi : MATERNELLES 8H45-12H & 13H30-16H30 (sur rendez-vous) Pas de rendez-vous le mercredi ✆ 03 44 79 39 09 de la Communauté d’agglomération du Beauvaisis Autres Points Accueil RAM : AUNEUIL BRESLES Centre Social La Canopée 20 avenue de la Libération 318 rue des Aulnes Sur rendez vous au 06 61 41 23 29 Sur rendez vous au 07 62 17 95 18 CRÈVECOEUR-LE-GRAND BEAUVAIS, QUARTIER ST JEAN Salle du Crépicordium MJA - 2 rue Berlioz rue du Presbytère Sur rendez vous au 07 62 17 95 24 Sur rendez vous au 07 62 17 95 20 GOINCOURT MILLY-SUR-THÉRAIN Où nous trouver ? Mairie - 12 rue Jean Jaurès Mairie - Rue de Dieppe 20 avenue des écoles 60000 Beauvais Sur rendez vous au 07 62 17 95 18 Sur rendez vous au 07 62 17 95 20 03 44 79 39 09 [email protected] Crévecoeur-le-Grand Crévecoeur-le-Grand 4 animatrices à votre disposition Le Relais Assistantes Maternelles est un service d’information sur les différents modes d’accueil pour Maison de l’ensemble du territoire. la Petite Enfance Lieu d’écoute et d’accompagnement à destination des Le Saulchoy parents employeurs, des professionnels de l’accueil Point d’accueil RAM individuel, ce service est ouvert à tous, gratuit, et Crèvecœur-le-Grand animé par 4 professionnelles petite enfance. Rotangy Secteur rose Francastel Emilie DUBOC Parents, Auchy-la-Montagne ✆ 07 62 17 95 20 le RAM vous propose : Lachaussée-du-Bois-d'Écu -

Création De La ZAC Saint-Mathurin À ALLONNE (60)
Création de la ZAC Saint-Mathurin à ALLONNE (60) Compléments à l’étude d’impact apportés suite aux recommandations de l’Autorité Environnementale Juin 2016 A84615/B Approuvé par délibération du conseil communautaire de l’agglomération du Beauvaisis en date du 8 décembre 2016 Dossier présenté par : Communauté d’agglomération du Beauvaisis 48 rue Desgroux BP 90508 60005 BEAUVAIX Cedex Antea Group – Direction Régionale Nord Est Pôle Aménagement du Territoire Synergie Park – 5 Avenue Louis Néel 59620 LEZENNES Tél. : 03.20.43.25.55 1 Création de la ZAC Saint-Mathurin à ALLONNE (60) Compléments à l’étude d’impact apportés suite aux recommandations de l’Autorité Environnementale A84615/B 4.3.1. Infrastructures et transports ........................................................................................ 71 4.3.2. Environnement sonore ................................................................................................. 72 4.3.3. Ressources énergétiques .............................................................................................. 74 Sommaire 5. Compatibilité du projet avec les plans et programmes .................................................... 75 5.1. Les périmètres de protection de captage ............................................................................ 75 5.2. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ............................ 75 1. Préambule.........................................................................................................................5 -
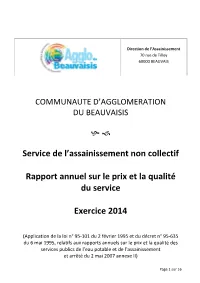
Rapp2014 Spanc Vdef
Direction de l’Assainissement 70 rue de Tilloy 60000 BEAUVAIS COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS h f Service de l’assainissement non collectif Rapport annuel sur le prix et la qualité du service Exercice 2014 (Application de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et du décret n° 95-635 du 6 mai 1995, relatifs aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement et arrêté du 2 mai 2007 annexe II) Page 1 sur 16 SOMMAIRE 1 PRESENTATION GENERALE DU SERVICE ........................................................................................ 3 1.1 Données générales ................................................................................................................. 3 1.2 Nature du service assuré ........................................................................................................ 4 1.3 Mode de gestion ..................................................................................................................... 4 1.4 Description et consistance du service .................................................................................... 4 1.5 Usagers du service d’assainissement non collectif ................................................................ 5 2 FAITS MARQUANTS ET ORIENTATIONS DU SERVICE..................................................................... 6 2.1 Faits marquants de l’exercice 2014 ........................................................................................ 6 2.1.1 les contrôles sur l’année 2014 ........................................................................................ -

Des Zones D'activités
TIO EDI N 2019 ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées Mai 2019 LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS CAB 2 ATLAS des zones d’activités du territoire de l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées / Mai 2019 INTRODUCTION Cet atlas fait parti du recensement de toutes les zones d’activités du territoire de l’Agence d’Urbanisme Oise-les-Vallées, c’est-à-dire les zones qui sont spécifiquement dédiées à l’accueil d’entreprises et ceci quel qu’en soit le type, l’activité et la taille. Il est bien entendu que ces zones n’ont pas le monopole de l’économie sur le territoire. En effet, de très nombreuses entreprises sont éparpillées dans les villes et les villages, notamment dans le secteur tertiaire. Néanmoins, ces zones d’activités sont capables d’accueillir de nombreuses entreprises, et en particulier celles industrielles et logistiques, qui ne pourraient pas s’installer en ville à cause des contraintes qui leur sont associées : besoin de larges parcelles, flux de camions, nuisances sonores, pollution, etc. Ainsi, l’attractivité économique d’un territoire passe par la disponibilité de ce foncier précieux et incite donc à sa rationalisation et à sa valorisation. La question de la reconversion des anciens sites industriels en friches occupe également une place centrale dans l’ensemble du département de l’Oise et en particulier la vallée de l’Oise où l’industrie a été développée depuis le XIXème siècle. Si ces sites constituent souvent un potentiel fabuleux du fait de leur grande taille et de leur localisation souvent très favorable, leur mobilisation n’est pas aisée car elle implique au préalable d’importants investissements en matière de dépollution et de nettoyage des sites. -

Carte-Oise-Velo-2018-2.Pdf
M1 M11 M4 Rotterdam 18 D6 ROYAUME-UNI 32 51 GAREGARE T.G.V.T.G.V. A 3131 A29 2 PAYS-BAS LE TRÉPOR D211 16 HAUTEHAUTE PPICARDIEICARDIE Londres Hornoy- AMIENS AMIENS L' M4 A29 5252 T AMIENS Omignon Saint- A29 D1029 D116 AMIENS 53 LILLE le-Bourg LILLE A29 Anvers D 6 CALAIS 17 M5 M25 M20 Bruges www.oise-a-velo.com920 D9 ALBER CALAIS, Quentin CALAIS ABBEVILLE, D138 D934 D141 Breteuil ABBEVILLE, D5 42 PÉRONNE,CAMBRAI Douvres E17 T AMIENS D A26 1 ABBEVILLE, D935 D337 D79 54 A3 Calais E40 1 vélorouteA28 - voie verte départementale : La Trans’Oise Boves BRUXELLES, TUNNEL D1015 D38 Noyon D3 A27 SOUS LA 6 D210 A31 2 MANCHE E15 Bruxelles - CALAIS, LONDRES Portsmouth D18 D7 Gerberoy A38 BELGIQUESAINT D1 E402 Lille 2 itinéraires européens : L’Avenue verte London - Paris et La Scandibérique (EV3) A16 D28 28 km D930 6 D1001 Rosières- Plymouth QUENTIN 24 km A1 D316 Luce D920 La en-Santerre 24 km D4 nche 27 circuits cyclotouristiques,9 11 randonnées permanentes, 13 voies de circulation douce, 4 vélopromenades Chaulnes a 1111 3 M 13 D28 ROUEN 25 km Amiens LAON, 9 D2 BEAUVAIS E402 e REIMS A2 CLERMONT 26 km E44 m D103 Cherbourg m COMPIÈGNE o E17 029 S Plus de 100 départs de circuits VTT / VTC D1 22 km Le Havre A29 A16 E46 Basse Forêt d'Eu D18 D934 a E15 28 km 1 Rouen SOMME L Laon E46 5 km REIMS Aéroport de D1901 Caen E46 Beauvais Beauvais-Tillé Reims Nouveau Carnets de route en français et en anglais (rubrique voies vertes) Saint-Lô D930 E46 D321 D928 Poix-de- 80 Crépy- E50 La Selle 10 A28 D28 Chaumont- Creil en-Valois Aéroport de Picardie D138 Bois Moreuil -

Les Féeries De Noël DU 30 NOVEMBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019
LE MAGAZINE DU BEAUVAISIS N° 48 | DÉCEMBRE | 2018 notre territoire BEAUVAIS Les Féeries de Noël DU 30 NOVEMBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019 SANTÉ P.14 Création d’un pôle santé à Bresles LE MAGAZINE DU BEAUVAISIS N° 48 | DÉCEMBRE | 2018 notre territoire w Sommaire VIE DU 03 SANTÉ 14 Décembre BEAUVAISIS SPORT 15 scintillant ÉCONOMIE 05 et chaleureux ENVIRONNEMENT 16 Quel plaisir de surprendre les grands yeux CADRE DE VIE / 06 émerveillés des enfants ! Beauvais et le DÉCHETS CULTURE Beauvaisis vont de nouveau briller de ces 17 mille lumières qui nous invitent à vivre avec exaltation cette période enchantée des fêtes de fin d’année. LE BEAUVAISIS 07 AGENDA 19 Avec ce nouveau numéro de votre magazine Beauvaisis Notre Territoire, découvrez EN IMAGES le programme complet des Féeries de Noël qui baigneront notre ville préfecture dans une ambiance douce, festive et joyeuse dès le 30 novembre. LIBRE 24 VIE MUNICIPALE 10 EXPRESSION Sous le feu chaleureux des illuminations, vous pourrez goûter à de nombreux DE BEAUVAIS plaisirs et apprécier de réjouissantes animations de rue, dont la Grande Parade du 22 décembre, programmée en nocturne pour la première fois. INFOS PRATIQUES 25 La féerie se répandra sur l’ensemble de notre agglomération, à l’image de la ÉDUCATION 12 commune Saint-Martin-le-Nœud animée d’une bienfaisante effervescence pour organiser son grand marché de Noël les 8 et 9 décembre ; un événement que nous avons reconnu d’intérêt communautaire pour son attachement, depuis plus SOLIDARITÉ 13 de 30 ans, à valoriser les savoir-faire et les talents de nos artisans. -

Ligne 35 Ligne 35 Méru > Ste Geneviève > Beauvais Beauvais
Horaires valables à partir du 31 Août 2015 Méru > Ste Geneviève > Beauvais Code 10057 10068 10054 10067 10069 10070 10071 11547 10072 10073 10056 10055 10074 10058 11559 11502 10059 11503 10060 Jours de circulation L à V L à S L à V L à S L à V L à V L à V S V V MeS L à V Me S L à V L à V L à V L à V L à S L à S Jours scolaires n n n n n n n n n n n n n n Ligne 35 Jours non scolaires n n n n n n Niveau PTA B A B Renvois à consulter tad (2) (2) tad tad (1) MÉRU LP Lavoisier 18:00 MÉRU Gare SNCF 6:55 7:00 7:45 12:00 12:00 13:50 13:20 18:05 18:05 18:35 18:35 19:05 19:05 MÉRU Eglise Saint Lucien 6:57 7:02 | 12:02 12:02 13:52 13:22 18:07 18:07 18:37 18:37 19:07 C ANDEVILLE Octroi 7:01 7:06 | 12:06 12:06 13:56 13:26 18:11 18:11 18:45 18:43 19:11 C ANDEVILLE Parking Orsol 7:02 7:07 | 12:07 12:07 13:57 13:27 18:12 18:12 18:48 18:46 19:12 C ANDEVILLE Rue du Bois 7:03 7:08 | 12:08 12:08 13:58 13:28 | | | | 19:13 C ANDEVILLE Angleterre 7:04 7:09 | 12:09 12:09 13:59 13:29 | | | | 19:14 C MORTEFONTAINE EN THELLE Centre | 6:50 | | | | C C C C | | MORTEFONTAINE EN THELLE Route de LABOISSIERE | 6:52 | | | | C C 18:55 18:55 | | LABOISSIÈRE EN THELLE Eglise 7:10 | 7:15 7:15 | 14:05 13:35 18:24 18:24 19:20 C LABOISSIÈRE EN THELLE Rue Madame 7:11 | 7:16 7:17 | 14:06 13:36 18:25 18:25 19:21 C SAINTE GENEVIÈVE Le Petit Fercourt 7:15 | 7:19 7:20 | 14:10 13:40 18:28 18:28 19:24 C SAINTE GENEVIÈVE Collège Léonard de VINCI | | | | | 8:27 8:31 | | | | | | SAINTE GENEVIÈVE Mairie 6:50 7:20 6:58 7:24 7:24 | 8:28 8:32 13:21 13:21 14:15 13:45 18:33 18:33 19:29 C SAINTE -

Lettre Circulaire N° 2007-125
PARIS, le 05/11/2007 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N° 2007-125 OBJET : Modification du champ d'application du Versement Transport (art L. 2333-64 du Code Général des Collectivités Territoriales) TEXTE A ANNOTER : Lettre circulaire n° 2007-061 du 28 mars 2007 - Augmentation du taux versement transport à 0,60% (ancien taux à 0,40%) sur 25 communes à compter du 1er janvier 2008; - Maintien du taux versement transport à 0,60 % sur les communes de BEAUVAIS, ALLONNE et TILLE. - Suppression de l'identifiant 9306007. Par délibération en date du 14 décembre 2004, la Communauté d’Agglomération du BEAUVAISIS (identifiant n° 9306006 – 9306007) a décidé de moduler le versement transport sur 5 ans pour 28 communes. De ce fait, à compter du 1er janvier 2008, le versement transport est fixé au taux de : - 0,60% (ancien taux 0,40%) sur les communes de AUX MARAIS, BONLIER, FONTAINE-SAINT-LUCIEN, FOUQUENIES, FROCOURT, GOINCOURT, GUIGNECOURT, HERCHIES, JUVIGNIES, LE MONT-SAINT-ADRIEN, MAISONCELLE-SAINT-PIERRE, MILLY-SUR-THERAIN, NIVILLERS, PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS, RAINVILLERS, ROCHY-CONDE, SAINT GERMAIN-LA-POTERIE, SAINT LEGER-EN-BRAY, SAINT MARTIN-LE-NŒUD, SAINT PAUL, SAVIGNIES, THERDONNE, TROISSEREUX, VERDEREL-LES-SAUQUEUSES et WARLUIS. - 0,60% (taux inchangé) sur les communes de BEAUVAIS, ALLONNE et TILLE. 1 Toutes les communes étant assujetties au même taux, nous décidons de supprimer l'identifiant n°9306007 et de basculer les 28 communes sur l'identifiant n°9306006. Les informations relatives au champ d’application, au recouvrement et reversement du versement transport sont regroupées dans le tableau ci-joint. -

Mrb Warluis Rapport Ce
0 Enquête publique présentée par la Direction Départementale des Territoires de l’Oise Demande d’autorisation environnementale d’exploiter une carrière de sablons sur le territoire de la commune de Warluis par la société Matériaux recyclés du Beauvaisis Enquête du 15 mai au 15 juin 2018 sur une période de 32 jours Prescrite par arrêté de Monsieur le Préfet de l’Oise en date du 11 avril 2018 Rapport du commissaire enquêteur Juin 2018 Ordonnance n° E18000044/80 du 2 mars 2018 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif d’Amiens Etabli par Sabine GAMBS-DEGROOTE Demande d’autorisation d’ouverture d’une carrière de sablons à Warluis par la société M.R.B. Enquête n° E18000044/80 1 I. Projet soumis à enquête L’enquête concerne la demande d’autorisation de la société Matériaux Recyclés du Beauvaisis (M.R.B.) d’exploiter une carrière de sablons au lieu-dit »La Vallée » sur le territoire de la commune de Warluis à 5 kilomètres au Nord-Ouest de Beauvais. La zone compte déjà plusieurs carrières autorisées en cours d’exploitation, fin d’exploitation ou en exploitation future. Les zones constructibles à urbaniser ou urbanisées les plus proches se situent sur la commune d’Allonne à environ 925 mètres du site d’exploitation projeté. La société M.R.B., qui a son siège social à Beauvais, a pour vocation l’exploitation, le stockage, le transit, le recyclage, la transformation, la commercialisation de granulats artificiels ou de matériaux inertes issus du BTP et l’exploitation de gisements de matériaux naturels destinés aux chantiers de travaux publics. -

Notre Territoire
LE MAGAZINE DU BEAUVAISIS N° 49 | JANVIER | 2019 notre territoire Beauvais CHAUSSE SES PATINS VIE MUNICIPALE P.16 Les assises du cœur de ville #AGGLO LE MAGAZINE DU BEAUVAISIS N° 49 | JANVIER | 2019 VIE DU BEAUVAISIS BUDGET 2019 BUDGET 2019 notre territoire Pas d’augmentation w des taux d’imposition Sommaire Le conseil communautaire un taux de 25,40% en matière de cotisation Concernant ce dernier point, 100% de l’encours est foncière des entreprises. classé en « 1A » sur la grille de Gissler, soit la cotation a adopté, le 10 décembre la plus sécurisée. dernier, le budget primitif 2019 En dehors de la non-augmentation de la fiscalité Le ratio de désendettement de la Communauté VIE DU 03 SANTÉ 26 intercommunale, (que ce soit pour les ménages ou pour d’Agglomération du Beauvaisis ressort à 4 ans soit un Remettre l’humain au BEAUVAISIS et validé la non augmentation les entreprises), les grandes orientations qui ont guidé peu moins que la moyenne des villes de même strate cœur de notre société ENVIRONNEMENT 27 des taux d’imposition sur le l’élaboration du budget primitif 2019 sont : (4,74 ans). ÉCONOMIE 06 territoire de l’agglomération. la non-augmentation des tarifs aux usagers ; Le budget primitif 2019 s’élève à 99 449 132 euros, 2019 commence déjà et laisse derrière elle une année la maîtrise des dépenses de gestion ; répartis entre dépenses de fonctionnement (75 232 337 SPORT millions d’euros) et investissement (24 216 795 euros). particulièrement chargée qui nous aura permis de consolider l’harmonie territoriale 28 Conformément aux propositions retenues dans le une stabilisation des subventions aux La cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur de notre Agglomération, passée en seulement douze mois de 31 à 53 communes. -

Laissez-Vous Conter La Céramique
Laissez-vous conter Beauvais « Ville d’art et d’histoire »… Ce document a été conçu Villes et Pays d’art et d’histoire … en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère de la Culture sous la direction de Marie Ansar, animatrice de l’architecture Beauvais Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes de Beauvais et du patrimoine, service Ville d’art et d’histoire de la Ville de et vous donne des clefs de lecture pour comprendre l’échelle d’une Beauvais place, le développement de la ville au fil de ses quartiers. Le guide Textes : Sylvain Pinta, attaché de conservation - MUDO - est à votre écoute. N’hésitez pas à lui poser vos questions. Musée de l’Oise Contributions et remerciements : Lauriane Miellé, céramologue Le service Ville d’art et d’histoire - Service Archéologique Municipal de Beauvais et Jean Cartier, coordonne et met en œuvre les initiatives de Beauvais « Ville d’art président du GRECB et d’histoire ». Il propose toute l’année des animations pour les Photographies : Archives départementales de l’Oise (ADO), Beauvaisiens et les scolaires, et se tient à votre disposition pour Groupe de recherches et d’études sur la céramique du Beauvaisis tout projet. (GRECB), Direction de la communication - Ville de Beauvais Si vous êtes en groupe (BVS), École d’art du Beauvaisis (EAB), Service Archéologique - Beauvais vous propose des visites toute l’année sur réservation. Ville de Beauvais (SAM) - Service Ville d’art et d’histoire - Ville de Des brochures conçues à votre attention peuvent vous être Beauvais (VAH), MUDO - Musée de l’Oise (MUDO), Réunion envoyées sur demande.