Création De La ZAC Saint-Mathurin À ALLONNE (60)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

16 Listecce-Beauvais.Pdf
COMMISSION CONSULTATIVE DE L'ENVIRONNEMENT AÉRODROME DE BEAUVAIS-TILLÉ Mise à jour : 11 juin 2013 COLLÈGE DES PROFESSIONS AÉRONAUTIQUES PERSONNEL DE L'AÉRODROME Aéroport de Beauvais 1 M. Jean-Claude VIDAL Délégué CFE-CGC 60000 TILLÉ Titulaire Aéroport de Beauvais 2 Mme Shafika BOULARES Déléguée CGT 60000 TILLÉ Titulaire 73 rue Louis Barthou 60260 LAMORLAYE Aéroport de Beauvais 3 M. Olivier BOIS Délégué CFDT 60000 TILLÉ Titulaire Aéroport de Beauvais 4 M. Frédéric MARTENS Délégué SNCTA 60000 TILLÉ Titulaire Aéroport de Beauvais 5 M. Fabien GRAU Délégué CFE CGC 60000 TILLÉ Suppléant Aéroport de Beauvais 6 M. Rafik SENOUCI Délégué CGT 60000 TILLÉ Suppléant Aéroport de Beauvais 7 M. Jean-Pierre MAULER Délégué CFDT 60000 TILLÉ Suppléant Délégué SNCTA Aéroport de Beauvais 8 Mme Aude PRAUD 60000 TILLÉ Suppléant SAGEB 9 M. Emmanuel COMBAT Directeur Aéroport de Beauvais-Tillé Titulaire SAGEB 60000 TILLÉ Aéroport de Beauvais-Tillé 10 M. Florent MITELET Directeur de SAGEB Suppléant l'environnement - SAGEB 60000 TILLÉ COMPAGNIES AÉRIENNES 11 M. Dirk STREMES Ryanair Titulaire 12 M. Vincent LECOMPTE Wizzair Titulaire 13 M. Frédéric LEMERY Ryanair Suppléant 14 M. Denis LAFARGUE Wizzair Suppléant AÉROCLUB Délégué de l'aéroclub du Aéroclub du Beauvaisis 15 M. Alexis ZAGULAJEW Beauvaisis Aéroport de Beauvais-Tillé - BP Titulaire 30755 60007 BEAUVAIS Président de l'aéroclub du Aéroclub du Beauvaisis 16 M. André CRUCIFIX Beauvaisis Aéroport de Beauvais-Tillé - BP Suppléant 30755 60007 BEAUVAIS COLLÈGE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS N° Nom Fonction Adresse Coordonnées Qualité Présidente de la Communauté d'Agglomération 1 Mme Caroline CAYEUX Communauté du Beauvaisis Titulaire d'Agglomération du 48, rue Desgroux - BP 90508 Beauvaisis 60005 BEAUVAIS cedex Mairie de Tillé 2 M. -

Rapport Plu Frocourt Definitif
Rapport de l’enquête publique relative à L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de FROCOURT (60) Durée de l’enquête : du lundi 7 janvier 2019 au samedi 9 février 2019 inclus soit 34 jours consécutifs ---------------------- Décision n°E18000115/80 du 12/07/2018 Commissaire enquêteur : Madame Jacqueline LECLERE Enquête publique du 7 janvier 2019 au 9 février 2019 Jacqueline Leclère Décision n°180000115/80 SOMMAIRE DU RAPPORT A- Généralités 1. Présentation de la commune pages 2 à 4 2. Procédure 2-1. Démarches préalables page 5 2-1-1. Avec le Commissaire Enquêteur page 6 2-2. Cadre juridique page 6 à 7 3. Etude du dossier de l’enquête page 7 4. Les objectifs du Plan Local d’Urbanisme page 8 5. Le PADD pages 8 à 11 6. Les Orientations d’aménagement et de programmation page 11 7. Un emplacement réservé page 11 8. La concertation page 12 9. Les zones inscrites au PLU pages 12 à 13 10. Les données sanitaires à prendre en compte page 13 11. Les contraintes artificielles page 14 12. Les servitudes de protection des monuments historiques classés et inscrits page 14 13. Les contraintes environnementales et écologiques pages 14 à 15 14. Les remarques et observations des Personnes Publiques Associées pages 15 à 18 15. Les remarques de l’Autorité Environnementale pages 18 à 19 16. Les commentaires du commissaire enquêteur page 20 B– Organisation et déroulement de l’enquête 1. Modalités de l’enquête page 20 2. Information effective du public page 21 3. Déroulement des permanences page 21 4. -

Atlas Hydrogéologique Numérique De L'oise
Atlas hydrogéologique numérique de l’Oise Phase 2 : Notice Rapport d’avancement BRGM/RP-59757-FR Juin 2011 Atlas hydrogéologique numérique de l’Oise Phase 2 : Notice Rapport d’avancement BRGM/RP-59757-FR Juin 2011 Étude réalisée dans le cadre des projets de Service public du BRGM 2011 10EAUI56 V. Bault et R. Follet Vérificateur : Approbateur : Nom : J.J. Seguin Nom : D. Maton Date: 11/07/2011 Date : 12/07/2011 Signature : Signature : En l’absence de signature, notamment pour les rapports diffusés en version numérique, l’original signé est disponible aux Archives du BRGM. Le système de management de la qualité du BRGM est certifié AFAQ ISO 9001:2008. Mots clés : atlas, hydrogéologie, hydrologie, eau souterraine, eau superficielle, nappe, aquifère, bilan hydrologique, paramètres hydrodynamiques, données climatiques, piézométrie, SIG, Oise, Picardie. En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante : Bault V. et Follet R. (2011) – Atlas hydrogéologique numérique de l’Oise. Phase 2 : Notice. Rapport d’avancement. BRGM/RP-59757-FR, 168 p., 22 ill., 11 tab. © BRGM, 2011, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l’autorisation expresse du BRGM. Atlas hydrogéologique numérique de l’Oise. Phase 2 : Notice. Synthèse Constatant que le support et le contenu de l’atlas hydrogéologique du département de l’Oise, publié en 1987, ne répondaient plus aux besoins actuels d’informations et de consultation de ces données, le BRGM a proposé au Conseil Général de l’Oise et aux Agences de l’eau Seine-Normandie et Artois-Picardie de réaliser un atlas hydrogéologique départemental numérique pour le département de l’Oise. -

Relais Assistantes Maternelles Est Un Service D’Information Sur Les Différents Modes D’Accueil Pour Maison De L’Ensemble Du Territoire
Comment nous contacter ? Le Rdu BeauvaisisAM Maison de la petite enfance Le RAM du Beauvaisis RELAIS ASSISTANTES MAISON DE LA PETITE ENFANCE 20 avenue des écoles Lundi, mardi, jeudi et vendredi : MATERNELLES 8H45-12H & 13H30-16H30 (sur rendez-vous) Pas de rendez-vous le mercredi ✆ 03 44 79 39 09 de la Communauté d’agglomération du Beauvaisis Autres Points Accueil RAM : AUNEUIL BRESLES Centre Social La Canopée 20 avenue de la Libération 318 rue des Aulnes Sur rendez vous au 06 61 41 23 29 Sur rendez vous au 07 62 17 95 18 CRÈVECOEUR-LE-GRAND BEAUVAIS, QUARTIER ST JEAN Salle du Crépicordium MJA - 2 rue Berlioz rue du Presbytère Sur rendez vous au 07 62 17 95 24 Sur rendez vous au 07 62 17 95 20 GOINCOURT MILLY-SUR-THÉRAIN Où nous trouver ? Mairie - 12 rue Jean Jaurès Mairie - Rue de Dieppe 20 avenue des écoles 60000 Beauvais Sur rendez vous au 07 62 17 95 18 Sur rendez vous au 07 62 17 95 20 03 44 79 39 09 [email protected] Crévecoeur-le-Grand Crévecoeur-le-Grand 4 animatrices à votre disposition Le Relais Assistantes Maternelles est un service d’information sur les différents modes d’accueil pour Maison de l’ensemble du territoire. la Petite Enfance Lieu d’écoute et d’accompagnement à destination des Le Saulchoy parents employeurs, des professionnels de l’accueil Point d’accueil RAM individuel, ce service est ouvert à tous, gratuit, et Crèvecœur-le-Grand animé par 4 professionnelles petite enfance. Rotangy Secteur rose Francastel Emilie DUBOC Parents, Auchy-la-Montagne ✆ 07 62 17 95 20 le RAM vous propose : Lachaussée-du-Bois-d'Écu -

Beauvaisis En Toute Confidence
LE MAG LE MAG Beauvaisis N°2 En toute confidence VOUS INVITE À AIMER ... Beauvais<Oise<Hauts-de-France RENCONTREZ DÉAMBULEZ DANS FAITES LE PLEIN NOS PASSIONNÉS LES JARDINS PRENEZ DE DE SENSATIONS LA HAUTEUR de A B L’Offi ce ET S OUT IQ U Tourisme E ! Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller, vous aiguiller, vous proposer des excursions, des visites guidées. Venez nous rendre visite au 1, rue Beauregard 60000 BEAUVAIS, Laurie, Stéphane et Laurie vous accueillent D’octobre à avril : le lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. D’avril à octobre : le lundi de 14h à 18h, du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h et les dimanches et jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 17h30. Accueillants et disponibles, ils sauront vous faire profiter de leurs conseils éclairés, vous livrer leurs bons plans, en un mot vous accompagner pour réussir votre séjour. N’hésitez pas à nous contacter Dans notre espace d’accueil, profitez de différents services : 03 44 15 30 30 WIFI gratuit ou [email protected] Spot de rechargement smartphones / tablettes Un espace boutique qui présente des produits locaux, C’est avec plaisir que nous vous ferons des ouvrages sur la région, des guides thématiques, découvrir le patrimoine et les activités des objets souvenirs, des créations artisanales…. de Beauvais et sa région. Retrouvez-nous sur www.visitbeauvais.fr Des outils numériques pour vous accompagner dans votre parcours de découverte du territoire. -

Bonne En Beauvaisis
N28 | SEPTEMBRE 2011 MAGINFOS LE MAGAZINE DES HABITANTS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS Bonne ////// DOSSIER PAGE L'enseignement 06 supérieur Rentrée en Beauvaisis en Beauvaisis ////// COMMUNE PAGE Découvrez 09 Maisoncelle- Saint-Pierre ////// ENTRETIENS DU BEAUVAISIS PAGE L'Agglomération, 11 trait d'union entre le rural et l'urbain #02 SOMMAIRE /// ÉDITO ACTUS #03 //////// ÉDITO //////// EMPLOI BONNE Suivi renforcé sur #09 MAISONCELLE-SAINT-PIERRE RENTRÉE ! les chantiers d'insertion our remobiliser les publics exclus durable- ment du marché de l'emploi, les chantiers d'insertion sont des outils efficaces. Il en existe trois dans le Beauvaisis : deux chan- tiers "Bâtiment nature" et "Espaces natu- 01 ACTUS Prels" portés par l'Agglomération du Beauvaisis et un 03 I Chantiers d'insertion autre de rénovation de l'Ecospace porté par la Ville 04 I Transports : Les nouveautés de la rentrée Les premiers jours de septembre sonnent la fin des de Beauvais. 05 I Extension des réseaux d'assainissement vacances et annoncent la rentrée des classes pour Les deux collectivités et leurs trois partenaires opéra- tous les enfants du Beauvaisis. C'est l'occasion de tionnels – la Maison de l'Emploi et de la Formation leur souhaiter une bonne année scolaire. du Pays du Grand Beauvaisis, l'association "Réussir 05 ÉCONOMIE Demain, ces écoliers pourront poursuivre leurs avec le PLIE du Beauvaisis" et le Centre Communal études au cœur du territoire : l'enseignement d'Action Sociale de la Ville de Beauvais - ont signé 06 I L'Enseignement supérieur en Beauvaisis une convention pour renforcer l'accompagnement 07 I Pépinière : TCC reprend son envol supérieur propose une large palette de des salariés de ces chantiers le 5 juillet dernier. -

Horaires Et Trajet De La Ligne T1 De Bus Sur Une Carte
Horaires et plan de la ligne T1 de bus T1 Auteuil Voir En Format Web La ligne T1 de bus (Auteuil) a 2 itinéraires. Pour les jours de la semaine, les heures de service sont: (1) Auteuil: 11:15 - 17:30 (2) Hôtel de Ville Beauvais: 08:15 - 14:30 Utilisez l'application Moovit pour trouver la station de la ligne T1 de bus la plus proche et savoir quand la prochaine ligne T1 de bus arrive. Direction: Auteuil Horaires de la ligne T1 de bus 12 arrêts Horaires de l'Itinéraire Auteuil: VOIR LES HORAIRES DE LA LIGNE lundi Pas opérationnel mardi Pas opérationnel Hôtel de Ville - Quai B Rue Malherbe, Beauvais mercredi Pas opérationnel Centre Commercial jeudi Pas opérationnel 47 Rue Juliette Névouet, Goincourt vendredi Pas opérationnel Place samedi 11:15 - 17:30 13 Rue Jean Jaurès, Goincourt dimanche Pas opérationnel Place 78 Grande Rue d'aux Marais, Aux Marais Mairie 19 Rue de la Poste, Rainvillers Informations de la ligne T1 de bus Direction: Auteuil St-Léger Rond-Point Arrêts: 12 Grande Rue, Saint-Leger-En-Bray Durée du Trajet: 60 min Récapitulatif de la ligne: Hôtel de Ville - Quai B, Saint-Léger Place Centre Commercial, Place, Place, Mairie, St-Léger 1 Rue du Placeau, Saint-Léger-en-Bray Rond-Point, Saint-Léger Place, Saint-Martin Le Nœud École, Frocourt École, Les Vivrots, Berneuil-En-Bray, Saint-Martin Le Nœud École Auteuil École Frocourt École 9 bis Rue de Beauvais, Frocourt Les Vivrots 2 Impasse des Croisettes les VIvrots, Berneuil-En-Bray Berneuil-En-Bray 2 Route de Beauvais, Berneuil-En-Bray Auteuil École 35 quater Rue de Gournay, Auteuil -

Senots Valdampierre Beauvais Senots Beauva
Ligne Ligne Service covoiturage 17 Senots u Valdampierre17 Beauvais u Beauvais u Valdampierre u Senots Ligne INFORMATIONS VOYAGEURS Le « PASS Oise Mobilité » est un titre de transport R17 17 R30 31 32 33A R33A 33E Tarifs unique utilisable sur Course n° 11718 10418 10422 10423 Course n° 10408 10409 10412 10411 10413 l’ensemble des réseaux SENOTS 35 35B 35C 35R2 38 R38 R38B 40 17 de transport de l’Oise. R40 41 41C 43 43B 43C 43DL 44/45m Me L m Me L m Me L m Me VOYAGES OCCASIONNELS FRESNE LÉGUILLON BEAUVAIS Période scolaire J V J V J V S L m J V Période scolaire L m J V Me Me L m J V J V Cette nouvelle solution est GRATUITE ! Billet unitaire ....................................... 1 € FLEURY Vacances scolaires Vacances scolaires Me Du 13/01 au SAINT MARTIN LE NŒUD Carnet de 10 trajets ................................ 10 € FRESNE LÉGUILLONSimpliez vos déplacements 15/03/2020 • TAD FROCOURT http://www.covoiturage-oise.fr/inscription-covoiturage.html SENOTSoise-mobilite.fr COMMUNE ARRÊT COMMUNE ARRÊT VOYAGES RÉGULIERS • SENOTS 0 970 150 150 BEAUVAIS Abonnement mensuel jeune (- de 26 ans , +65 ans, CMI, Coup de FRESNE LÉGUILLON | | Pouce, abonnement mensuel train)........................... 10 € FRESNEAUX MONTCHEVREUIL BERNEUIL EN BRAY Senots FLEURY SAINT MARTIN LE NŒUD .............................. FRESNE LÉGUILLON FROCOURT X X X X X FRESNE LÉGUILLON Abonnement mensuel 30 € CENTRE DE BEAUVAIS FLEURY FRESNEAUX MONTCHEVREUIL SENOTS X Abonnement annuel scolaire (1 A/R par jour) ....... gratuit AUTEUIL FRESNEAUX MONTCHEVREUIL Pour s’inscrire télécharger le formulaire sur oise-mobilite.fr BEAUMONT LES NONAINS BERNEUIL EN BRAY FRESNEAUX MONTCHEVREUIL RESSONS L’ABBAYE POUILLY Pour être en règle, il faut VALIDER son titre de transport ! BEAUMONT LES NONAINS VALDAMPIERRE FRESNEAUX MONTCHEVREUIL AUTEUIL ATTENTION : 1. -

Rapport De Présentation Dossier De Création De La ZAC Boulenger À
Zone d'aménagement concerté Boulenger Rapport de présentation Approuvé par délibération du conseil communautaire de l’agglomération du Beauvaisis en date du RAPPORT DE PRESENTATION Dossier de création de la ZAC Boulenger à Auneuil PROJET DE DOSSIER DE CREATION DE ZAC 1/47 Zone d'aménagement concerté Boulenger Rapport de présentation Dossier de création de ZAC élaboré sous la Maîtrise d’Ouvrage de la: Communauté d’agglomération du Beauvaisis Direction de l’aménagement et de l’urbanisme 48 rue Desgroux 60000 BEAUVAIS Tel : 03.44.15.68.65 Fax : 03.44.15.68.01 PROJET DE DOSSIER DE CREATION DE ZAC 2/47 Zone d'aménagement concerté Boulenger Rapport de présentation SOMMAIRE 1. OBJET ET JUSTIFICATION DE L’OPERATION 6 2. DESCRIPTION DE L’ETAT DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 16 2.1. L’environnement du site 17 2.2. Le site lui-même 19 3. PARTI PRIS D’AMENAGEMENT ET PROGRAMME GLOBAL PREVISIONNEL 35 DES CONSTRUCTIONS 3.1. Le parti d'aménagement 35 3.2. Programme global prévisionnel des constructions. 42 4. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 44 4.1. Choix du projet au regard des dispositions d'urbanisme 44 4.2. Choix du projet au regard de son insertion dans l'environnement naturel et urbain 45 5. REGIME DE LA ZAC AU REGARD DE LA TAXE D'AMENAGEMENT 46 PROJET DE DOSSIER DE CREATION DE ZAC 3/47 Zone d'aménagement concerté Boulenger Rapport de présentation PREAMBULE Le présent dossier porte sur l’aménagement de la ZAC Boulenger sur la commune d’Auneuil dans l'Oise, et plus particulièrement au sud de l’agglomération du Beauvaisis. -

Navettes St Esprit Ligne STESPRIT
Horaires valables à partir du 3 septembre 2013 navettes St Esprit Code 11393 11402 11405 11399 11396 11387 11381 11384 11372 11390 11369 11375 11378 Jours de circulation S S S S S L à V L à V L à V L à V L à V L à V L à V L à V Jours scolaires Ligne STESPRITJours non scolaires Niveau PTA Renvois à consulter FRESNOY EN THELLE Eglise 7:10 MORANGLES Centre 7:16 CROUY EN THELLE centre 6:45 7:22 ERCUIS centre 6:50 7:05 | NEUILLY EN THELLE Hotel de Ville 6:54 | 7:28 NEUILLY EN THELLE route de cavillon 6:55 | 7:30 DIEUDONNÉ Centre | | 7:35 FOULANGUES Foulangues | | 7:05 | CIRES LÈS MELLO Le Tillet | | 7:10 | CIRES LÈS MELLO mairie | 6:55 | 7:16 | CIRES LÈS MELLO gare sncf | 6:57 | 7:19 | BALAGNY SUR THÉRAIN stade | | | 7:28 | MOUY place de l'eglise | 7:07 | 7:34 | HONDAINVILLE Centre-MONUMENT AUX MORTS | 7:14 | 7:40 | CHAUMONT EN VEXIN Le Grand Cerf | | 6:57 | | | 7:15 CHAUMONT EN VEXIN Rue Roger BLONDEAU | | 6:59 | | | 7:17 BACHIVILLERS D115 | | | | | | 7:27 LE MESNIL THÉRIBUS Abribus | | 7:14 | | | 7:32 JOUY SOUS THELLE pharmacie | | 7:15 | | | 7:33 LA HOUSSOYE Mairie | | 7:22 | | | 7:40 AUNEUIL Place de la Folie | | 7:29 | | | 7:47 BERNEUIL EN BRAY Centre (Vaux) | | 7:36 | | | 7:54 SAINT MARTIN LE NOEUD Centre | | 7:40 | | | 7:58 BORNEL Centre 6:30 | | | 7:05 | | | | FOSSEUSE Centre 6:35 | | | 7:08 | | | | AMBLAINVILLE Cimetière 6:41 | | | | | | | | AMBLAINVILLE Place 6:43 | | | | | | | | 7:26 MÉRU gendarmerie | | | | | | | | | 7:31 MÉRU dde | | | | | | | | | 7:33 MÉRU Eglise Saint Lucien 6:46 | | | | | | | | 7:35 MÉRU Faurecia 6:47 | | -
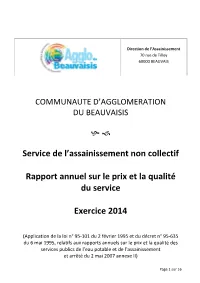
Rapp2014 Spanc Vdef
Direction de l’Assainissement 70 rue de Tilloy 60000 BEAUVAIS COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS h f Service de l’assainissement non collectif Rapport annuel sur le prix et la qualité du service Exercice 2014 (Application de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et du décret n° 95-635 du 6 mai 1995, relatifs aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement et arrêté du 2 mai 2007 annexe II) Page 1 sur 16 SOMMAIRE 1 PRESENTATION GENERALE DU SERVICE ........................................................................................ 3 1.1 Données générales ................................................................................................................. 3 1.2 Nature du service assuré ........................................................................................................ 4 1.3 Mode de gestion ..................................................................................................................... 4 1.4 Description et consistance du service .................................................................................... 4 1.5 Usagers du service d’assainissement non collectif ................................................................ 5 2 FAITS MARQUANTS ET ORIENTATIONS DU SERVICE..................................................................... 6 2.1 Faits marquants de l’exercice 2014 ........................................................................................ 6 2.1.1 les contrôles sur l’année 2014 ........................................................................................ -

Des Ateliers
Des animatrices à votre disposition Le Maison de la Petite Enfance Rdu BeauvaisisAM Le Saulchoy Point d’accueil RAM Crèvecœur-le-Grand RELAIS ASSISTANTES Rotangy Secteur rose Francastel MATERNELLES Emilie DUBOC Auchy-la-Montagne ✆ 07 62 17 95 20 Lachaussée-du-Bois-d'Écu de la Communauté d’Agglomération Luchy Maulers du Beauvaisis Secteur orange Muidorge Lidwine FERNANDEZ Juvignies Maisoncelle Saint DE CASTRO Pierre Milly-sur Fontaine ✆ 06 61 41 23 29 Saint Thérain Verderel-lès Lucien Sauqueuse Lafraye PROGRAMME Herchies Troissereux Guignecourt Haudivillers Pierrefitte Velennes en-Beauvaisis Bonlier Fouquenies Savignies Notre-Dame Tillé du Thil DES ATELIERS Le Mont Nivillers Fouquerolles Le Fay Saint Saint-Lucien Saint Saint Rémérangles Adrien Saint-Just Quentin Germain-la des Marais Argentine Poterie Saint Beauvais Marissel Laversines Litz AVRIL À JUILLET 2020 Paul Goincourt Centre-Ville Therdonne Saint-Jean La Rue Voisinlieu Bresles Aux Saint Rainvillers Marais Rochy Pierre Saint Allonne Condé Saint Martin Léger le-Nœud en-Bray Warluis Bailleul La Neuville Frocourt sur-Thérain en-Hez Auneuil Berneuil Hermes en-Bray Où nous trouver ? Auteuil Secteur vert 20 avenue des écoles - 60000 Beauvais Secteur bleu Charlotte LAMBLIN 03 44 79 39 09 [email protected] Cathy LURAND ✆ 07 62 17 95 24 ✆ 07 62 17 95 18 Crévecoeur-le-Grand Programme des ateliers d’avril à juillet 2020 AVRIL MAI JUIN JUILLET Therdonne Lun. 11 Milly-sur-Thérain Lun. 1er Bresles Mar. 2 Bresles Jeu. 2 et Auneuil Mar. 12 Voisinlieu Bresles Mer. 3 Bresles Jeu. 4 Ven. 3 Allonne Mer. 13 Troissereux et Therdonne Saint-Jean et Le Bailleul-sur- Lun.