Revuedecologie 2016 71 1 59.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Further Insect and Other Invertebrate Records from Glasgow Botanic
The Glasgow Naturalist (online 2021) Volume 27, Part 3 https://doi.org/10.37208/tgn27321 Ephemerellidae: *Serratella ignita (blue-winged olive), found occasionally. Further insect and other Heptageniidae: *Heptagenia sulphurea (yellow may dun), common (in moth trap). *Rhithrogena invertebrate records from Glasgow semicolorata was added in 2020. Botanic Gardens, Scotland Leptophlebiidae: *Habrophlebia fusca (ditch dun). *Serratella ignita (blue-winged olive), found R.B. Weddle occasionally in the moth trap. Ecdyonurus sp. 89 Novar Drive, Glasgow G12 9SS Odonata (dragonflies and damselflies) Coenagrionidae: Coenagrion puella (azure damselfly), E-mail: [email protected] one record by the old pond outside the Kibble Palace in 2011. Pyrrhosoma nymphula (large red damselfly), found by the new pond outside the Kibble Palace by Glasgow Countryside Rangers in 2017 during a Royal ABSTRACT Society for the Protection of Birds (RSPB) Bioblitz. This paper is one of a series providing an account of the current status of the animals, plants and other organisms Dermaptera (earwigs) in Glasgow Botanic Gardens, Scotland. It lists mainly Anisolabididae: Euborellia annulipes (ring-legged invertebrates that have been found in the Gardens over earwig), a non-native recorded in the Euing Range the past 20 years in addition to those reported in other found by E.G. Hancock in 2009, the first record for articles in the series. The vast majority of these additions Glasgow. are insects, though some records of horsehair worms Forficulidae: *Forficula auricularia (common earwig), (Nematomorpha), earthworms (Annelida: first record 2011 at the disused Kirklee Station, also Lumbricidae), millipedes (Diplopoda) and centipedes found subsequently in the moth trap. (Chilopoda) are included. -

Xylobionte Käfergemeinschaften (Insecta: Coleoptera)
©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.zobodat.at Carinthia II n 205./125. Jahrgang n Seiten 439–502 n Klagenfurt 2015 439 Xylobionte Käfergemeinschaften (Insecta: Coleoptera) im Bergsturzgebiet des Dobratsch (Schütt, Kärnten) Von Sandra AURENHAMMER, Christian KOMPOscH, Erwin HOLZER, Carolus HOLZscHUH & Werner E. HOLZINGER Zusammenfassung Schlüsselwörter Die Schütt an der Südflanke des Dobratsch (Villacher Alpe, Gailtaler Alpen, Villacher Alpe, Kärnten, Österreich) stellt mit einer Ausdehnung von 24 km² eines der größten dealpi Totholzkäfer, nen Bergsturzgebiete der Ostalpen dar und ist österreichweit ein Zentrum der Biodi Arteninventar, versität. Auf Basis umfassender aktueller Freilanderhebungen und unter Einbeziehung Biodiversität, diverser historischer Datenquellen wurde ein Arteninventar xylobionter Käfer erstellt. Collection Herrmann, Die aktuellen Kartierungen erfolgten schwerpunktmäßig in der Vegetations Buprestis splendens, periode 2012 in den Natura2000gebieten AT2112000 „Villacher Alpe (Dobratsch)“ Gnathotrichus und AT2120000 „Schüttgraschelitzen“ mit 15 Kroneneklektoren (Kreuzfensterfallen), materiarius, Besammeln durch Handfang, Klopfschirm, Kescher und Bodensieb sowie durch das Acanthocinus Eintragen von Totholz. henschi, In Summe wurden in der Schütt 536 Käferspezies – darunter 320 xylobionte – Kiefernblockwald, aus 65 Familien nachgewiesen. Das entspricht knapp einem Fünftel des heimischen Urwaldreliktarten, Artenspektrums an Totholzkäfern. Im Zuge der aktuellen Freilanderhebungen -
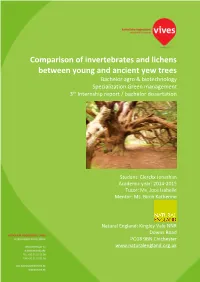
Comparison of Invertebrates and Lichens Between Young and Ancient
Comparison of invertebrates and lichens between young and ancient yew trees Bachelor agro & biotechnology Specialization Green management 3th Internship report / bachelor dissertation Student: Clerckx Jonathan Academic year: 2014-2015 Tutor: Ms. Joos Isabelle Mentor: Ms. Birch Katherine Natural England: Kingley Vale NNR Downs Road PO18 9BN Chichester www.naturalengland.org.uk Comparison of invertebrates and lichens between young and ancient yew trees. Natural England: Kingley Vale NNR Foreword My dissertation project and internship took place in an ancient yew woodland reserve called Kingley Vale National Nature Reserve. Kingley Vale NNR is managed by Natural England. My dissertation deals with the biodiversity in these woodlands. During my stay in England I learned many things about the different aspects of nature conservation in England. First of all I want to thank Katherine Birch (manager of Kingley Vale NNR) for giving guidance through my dissertation project and for creating lots of interesting days during my internship. I want to thank my tutor Isabelle Joos for suggesting Kingley Vale NNR and guiding me during the year. I thank my uncle Guido Bonamie for lending me his microscope and invertebrate books and for helping me with some identifications of invertebrates. I thank Lies Vandercoilden for eliminating my spelling and grammar faults. Thanks to all the people helping with identifications of invertebrates: Guido Bonamie, Jon Webb, Matthew Shepherd, Bryan Goethals. And thanks to the people that reacted on my posts on the Facebook page: Lichens connecting people! I want to thank Catherine Slade and her husband Nigel for being the perfect hosts of my accommodation in England. -

Mechanism and Field Potential Against Hylobius Abietis Larvae
Interactions of entomopathogenic fungi and other control agents: mechanism and field potential against Hylobius abietis larvae A thesis submitted to the National University of Ireland, Maynooth for the degree of Doctor of Philosophy by Louise Mc Namara B.Sc. Supervisor Co-Supervisor Head of Department Dr. Christine Griffin Dr. Kevin Kavanagh Dr. Paul Moynagh Behavioural Ecology & Biocontrol Medical Mycology Unit Dept. of Biology Dept. of Biology Dept. of Biology Maynooth University Maynooth University Maynooth University County Kildare County Kildare County Kildare May 2016 DECLARATION This thesis has not been submitted in whole or part to this or any other university for any degree, and is the original work of the author except where otherwise stated. Signed: ______________ Date: ______________ II Acknowledgements I would like to firstly thank my supervisors, Dr. Christine Griffin and Dr. Kevin Kavanagh, for all their support and guidance throughout my PhD. I was very lucky to have two incredibly supportive supervisors, who were so generous with their time and help, and I am extremely grateful to have had the opportunity to work in both your research groups. Thank you to the Department of Agriculture, Food and the Marine, for funding my research project as part of the MCOP project, which was funded by the Irish government under the National Development Plan 2007-2013. I have had the opportunity to work with some many great people throughout my project. To Dr. James Carolan, thank you for your extensive help with proteomics and for helping me tackle Qexactive from the very start, I couldn’t even try to guess how many hours you spent helping me work through that data. -

Oregon Invasive Species Action Plan
Oregon Invasive Species Action Plan June 2005 Martin Nugent, Chair Wildlife Diversity Coordinator Oregon Department of Fish & Wildlife PO Box 59 Portland, OR 97207 (503) 872-5260 x5346 FAX: (503) 872-5269 [email protected] Kev Alexanian Dan Hilburn Sam Chan Bill Reynolds Suzanne Cudd Eric Schwamberger Risa Demasi Mark Systma Chris Guntermann Mandy Tu Randy Henry 7/15/05 Table of Contents Chapter 1........................................................................................................................3 Introduction ..................................................................................................................................... 3 What’s Going On?........................................................................................................................................ 3 Oregon Examples......................................................................................................................................... 5 Goal............................................................................................................................................................... 6 Invasive Species Council................................................................................................................. 6 Statute ........................................................................................................................................................... 6 Functions ..................................................................................................................................................... -

EDF Energy Sizewell C New Nuclear Power Station
EDF Energy Sizewell C New Nuclear Power Station: Terrestrial and Freshwater Ecology, and Ornithology Invertebrate Survey Report 2007-2010 Draft Report June 2012 AMEC Environment & Infrastructure UK Limited Disclaimer This report has been prepared in a working draft form and has not been finalised or formally reviewed. As such it should be taken as an indication only of the material and conclusions that will form the final report. Any calculations or findings presented here may be changed or altered and should not be taken to reflect AMEC’s opinions or conclusions. Copyright and Non-Disclosure Notice The contents and layout of this report are subject to copyright owned by AMEC (©AMEC Environment and Infrastructure UK Limited 2012) save to the extent that copyright has been legally assigned by us to another party or is used by AMEC under licence. To the extent that we own the copyright in this report, it may not be copied or used without our prior written agreement for any purpose other than the purpose indicated in this report. The methodology (if any) contained in this report is provided to you in confidence and must not be disclosed or copied to third parties without the prior written agreement of AMEC. Disclosure of that information may constitute an actionable breach of confidence or may otherwise prejudice our commercial interests. Any third party who obtains access to this report by any means will, in any event, be subject to the Third Party Disclaimer set out below. Third Party Disclaimer Any disclosure of this report to a third party is subject to this disclaimer. -

Ecology, Survey and Management of Forest Insects GTR-NE-311 33 Every Year in Late March They Were Moved Under the Projection of Crowns of Other Birch Trees
The Population and Seasonal Dynamics of Weevils Developing in the Soil of Birch Stands E. Kula Institute of Forest Ecology, Faculty of Forestry and Wood Technology, Zemědělská 3, 613 00 Brno, Czech Republic, e-mail: [email protected] Abstract Curculionidae developing in the soil of birch stands in an air-polluted region were classified using the method of soil photoeclectors on the basis of their population dynamics (1986 – 2000) and phenology of their emergence from where they developed. In the course of 15 years we saw two evident culminations in the population density of Polydrusus undatus, while the population density of the other species – Polydrusus (Metallites) impar, Phyllobius arborator, P. argentatus, P. calcaratus, Rhinomias forticornis and Strophosoma capitatum culminated only once. We derived the sum of effective temperatures, which characterise the start of activity of a wide range of weevils. Based on the phenology of emerging from where they developed, the dominant species were those weevil species that are active in the spring. Key words: Curculionidae, weevils, photoeclectors, population and seasonal dynamics, birch stands, Betula pendula Roth Introduction The Curculionidae, the most abundant family of beetles in the Czech Republic (900), are generally found among the phytophagous fauna of birch stands (Betula pendula Roth) (Kula 1990/1991). Their harmful effect in the study region has not yet made itself felt to such an extent as the willow leaf beetle, mottled umber moth and winter moth, miners of the genus Eriocrania or the case-bearers (Kula 1988a, 1988b, 1989, 1990a, 1990b, 1995, 1998, 2000; Kula and Vaca 1995). Despite this, they include a number of species whose gradation potential is well known so we cannot exclude the impact of their heavy feeding and clear eating (e.g. -

Wild Plants and Their Associated Insects in The
Abstract Campobasso, G., E. Colonnelli, L. Knutson, G. Copies of this publication may be purchased from Terragitti, and M. Cristofaro, eds. 1999. Wild the National Technical Information Service, 5285 Plants and Their Associated Insects in the Port Royal Road, Springfield, VA 22161; telephone Palearctic Region, Primarily Europe and the Middle (703) 605–6000. East. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service, ARS–147, 249 pp. The United States Department of Agriculture (USDA) prohibits discrimination in all its programs This book compiles information on palearctic and activities on the basis of race, color, national insects that were collected or reared from 166 origin, gender, religion, age, disability, political species of plants of Eurasian origin. The insect beliefs, sexual orientation, and marital or family species are listed taxonomically and by host plant. status. (Not all prohibited bases apply to all The host plant list includes data on rearing, feeding, programs.) Persons with disabilities who require and other insect-plant associations. A third list alternative means for communication of program includes parasites of the insect species. information (Braille, large print, audiotape, etc.) should contact USDA’s TARGET Center at Information on the insects was obtained during the 202–720–2600 (voice and TDD). course of studies on biological control of weeds by staff of the Biological Control of Weeds To file a complaint of discrimination, write USDA, Laboratory-Europe, Rome, Italy, and European Director, Office of Civil Rights, Room 326–W, Biological Control Laboratory, Montpellier, Whitten Building, 14th and Independence Avenue, France, from 1959 through 1995. Included are the SW, Washington, DC 20250–9410 or call data presented by Pemberton and Hoover (1980) 202–720–5964 (voice or TDD). -

New Arthropod Herbivores on Trees and Shrubs in Iceland and Changes in Pest Dynamics: a Review
ICEL. AGRIC. SCI. 26 (2013), 69-84 Review article New arthropod herbivores on trees and shrubs in Iceland and changes in pest dynamics: A review GudmunduR HalldóRsson1, BjaRni d. siGuRdsson2, BRynja HRafnkelsdóttiR2,3, edda s. oddsdóttiR3, ólafuR eGGeRtsson3 and eRlinG ólafsson4 1 Soil Conservation Service of Iceland, Gunnarsholt, IS-851 Hella, Iceland. [email protected] (corresponding author) 2 Agricultural University of Iceland, Hvanneyri, IS-311 Borgarnes, Iceland. [email protected] 3 Icelandic Forest Research, Mogilsa, IS-116 Reykjavik, Iceland. [email protected]; [email protected]; [email protected] 4 Icelandic Institute of Natural History, Urriðaholtsstræti 6-8, IS-212 Garðabær, Iceland. [email protected] ABSTRACT This paper is a review of the history of the introduction of arthropod herbivore species to Iceland since the beginning of the 20th century. A total of 27 new arthropod herbivore species on trees and shrubs have become established in Iceland during this period. One of the introduced pest species, the pine woolly aphid, has been considered to be the major cause of the almost total eradication of the introduced Scots pine in Iceland. The rate of introduction was found to be highest during warm periods. Outbreaks of pests in birch woodlands were also found to be most severe during warm periods. Other pest species have shown changes in outbreak patterns since 1990. The consequences of these findings for isolated native forest ecosystems and a growing forest resource in Iceland are discussed. Keywords: Birch woodland, climate change, insect outbreaks, introduced species, native forest ecosystems YFIRLIT Nýjar tegundir liðfætlna á trjám og runnum á Íslandi Í þessari grein er rakin landnámssaga nýrra liðdýrategunda sem lifa á trjám og runnum á Íslandi. -

The Arthropod Fauna of Oak (Quercus Spp., Fagaceae) Canopies in Norway
diversity Article The Arthropod Fauna of Oak (Quercus spp., Fagaceae) Canopies in Norway Karl H. Thunes 1,*, Geir E. E. Søli 2, Csaba Thuróczy 3, Arne Fjellberg 4, Stefan Olberg 5, Steffen Roth 6, Carl-C. Coulianos 7, R. Henry L. Disney 8, Josef Starý 9, G. (Bert) Vierbergen 10, Terje Jonassen 11, Johannes Anonby 12, Arne Köhler 13, Frank Menzel 13 , Ryszard Szadziewski 14, Elisabeth Stur 15 , Wolfgang Adaschkiewitz 16, Kjell M. Olsen 5, Torstein Kvamme 1, Anders Endrestøl 17, Sigitas Podenas 18, Sverre Kobro 1, Lars O. Hansen 2, Gunnar M. Kvifte 19, Jean-Paul Haenni 20 and Louis Boumans 2 1 Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO), Department Invertebrate Pests and Weeds in Forestry, Agriculture and Horticulture, P.O. Box 115, NO-1431 Ås, Norway; [email protected] (T.K.); [email protected] (S.K.) 2 Natural History Museum, University of Oslo, P.O. Box 1172 Blindern, NO-0318 Oslo, Norway; [email protected] (G.E.E.S.); [email protected] (L.O.H.); [email protected] (L.B.) 3 Malomarok, u. 27, HU-9730 Köszeg, Hungary; [email protected] 4 Mågerøveien 168, NO-3145 Tjøme, Norway; [email protected] 5 Biofokus, Gaustadalléen 21, NO-0349 Oslo, Norway; [email protected] (S.O.); [email protected] (K.M.O.) 6 University Museum of Bergen, P.O. Box 7800, NO-5020 Bergen, Norway; [email protected] 7 Kummelnäsvägen 90, SE-132 37 Saltsjö-Boo, Sweden; [email protected] 8 Department of Zoology, University of Cambridge, Downing St., Cambridge CB2 3EJ, UK; [email protected] 9 Institute of Soil Biology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Na Sádkách 7, CZ-37005 Ceskˇ é Budˇejovice,Czech Republic; [email protected] Citation: Thunes, K.H.; Søli, G.E.E.; 10 Netherlands Food and Consumer Product Authority, P.O. -
Carcinogenic Pesticide Control Via Hijacking Endosymbiosis; The
in vivo 32 : 1051-1062 (2018) doi:10.21873/invivo.11346 Carcinogenic Pesticide Control via Hijacking Endosymbiosis; The Paradigm of DSB-A from Wolbachia pipientis for the Management of Otiorhynchus singularis THOMAS KOSTAROPOULOS 1, LOUIS PAPAGEORGIOU 1, SPYRIDON CHAMPERIS TSANIRAS 2, DIMITRIOS VLACHAKIS 1,3 and ELIAS ELIOPOULOS 1 1Genetics Laboratory, Department of Biotechnology, Agricultural University of Athens, Athens, Greece; 2Department of Physiology, School of Medicine, University of Patras, Patras, Greece; 3Faculty of Natural & Mathematical Sciences, King's College London, London, U.K. Abstract. Background/Aim: Pesticides have little, if any Nowadays cancer has evolved to a worldwide plague; specificity, to the pathogen they target in most cases. Wide according to the latest statistics cancer is at the top of the list spectrum toxic chemicals are being used to remove pestcides of causes of death worldwide (1, 2). It is a multi-step process and salvage crops and economies linked to agriculture. The (3) associated with genomic instability (4, 5) and caused by a burden on the environment, public health and economy is variety of factors and substances, called carcinogens, including huge. Traditional pestcide control is based on administering radiation, tobacco and alcohol, as well as lifestyle factors heavy loads of highly toxic compounds and elements that including an unhealthy diet, obesity and physical inaction essentially strip all life from the field. Those chemicals are (6-9). Likewise, chemicals of pesticides have been associated a leading cause of increased cancer related deaths in with increased incidence of cancer to those who are exposed countryside. Herein, the Trojan horse of endosymbiosis was to them directly or implicitly through their diet or their used, in an effort to control pests using high specificity environment (10). -
Biological Recording in 2019 Outer Hebrides Biological Recording
Outer Hebrides Biological Recording Discovering our Natural Heritage Biological Recording in 2019 Outer Hebrides Biological Recording Discovering our Natural Heritage Biological Recording in 2019 Robin D Sutton This publication should be cited as: Sutton, Robin D. Discovering our Natural Heritage - Biological Recording in 2019. Outer Hebrides Biological Recording, 2020 © Outer Hebrides Biological Recording 2020 © Photographs and illustrations copyright as credited 2020 Published by Outer Hebrides Biological Recording, South Uist, Outer Hebrides ISSN: 2632-3060 OHBR are grateful for the continued support of NatureScot 1 Contents Introduction 3 Summary of Records 5 Insects and other Invertebrates 8 Lepidoptera 9 Butterflies 10 Moths 16 Insects other than Lepidoptera 20 Hymenoptera (bees, wasps etc) 22 Trichoptera (caddisflies) 24 Diptera (true flies) 26 Coleopotera (beetles) 28 Odonata (dragonflies & damselflies) 29 Hemiptera (bugs) 32 Other Insect Orders 33 Invertebrates other than Insects 35 Terrestrial & Freshwater Invertebrates 35 Marine Invertebrates 38 Vertebrates 40 Cetaceans 41 Other Mammals 42 Amphibians & Reptiles 43 Fish 44 Fungi & Lichens 45 Plants etc. 46 Cyanobacteria 48 Marine Algae - Seaweeds 48 Terrestrial & Freshwater Algae 49 Hornworts, Liverworts & Mosses 51 Ferns 54 Clubmosses 55 Conifers 55 Flowering Plants 55 Sedges 57 Rushes & Woodrushes 58 Orchids 59 Grasses 60 Invasive Non-native Species 62 2 Introduction This is our third annual summary of the biological records submitted by residents and visitors, amateur naturalists, professional scientists and anyone whose curiosity has been stirred by observing the wonderful wildlife of the islands. Each year we record an amazing diversity of species from the microscopic animals and plants found in our lochs to the wild flowers of the machair and the large marine mammals that visit our coastal waters.