Article Reference
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

FINAL REPORT Quantitative Instrument to Measure Commune
FINAL REPORT Quantitative Instrument to Measure Commune Effectiveness Prepared for United States Agency for International Development (USAID) Mali Mission, Democracy and Governance (DG) Team Prepared by Dr. Lynette Wood, Team Leader Leslie Fox, Senior Democracy and Governance Specialist ARD, Inc. 159 Bank Street, Third Floor Burlington, VT 05401 USA Telephone: (802) 658-3890 FAX: (802) 658-4247 in cooperation with Bakary Doumbia, Survey and Data Management Specialist InfoStat, Bamako, Mali under the USAID Broadening Access and Strengthening Input Market Systems (BASIS) indefinite quantity contract November 2000 Table of Contents ACRONYMS AND ABBREVIATIONS.......................................................................... i EXECUTIVE SUMMARY............................................................................................... ii 1 INDICATORS OF AN EFFECTIVE COMMUNE............................................... 1 1.1 THE DEMOCRATIC GOVERNANCE STRATEGIC OBJECTIVE..............................................1 1.2 THE EFFECTIVE COMMUNE: A DEVELOPMENT HYPOTHESIS..........................................2 1.2.1 The Development Problem: The Sound of One Hand Clapping ............................ 3 1.3 THE STRATEGIC GOAL – THE COMMUNE AS AN EFFECTIVE ARENA OF DEMOCRATIC LOCAL GOVERNANCE ............................................................................4 1.3.1 The Logic Underlying the Strategic Goal........................................................... 4 1.3.2 Illustrative Indicators: Measuring Performance at the -

Enjeux Spatiaux Et Fonciers Dans Le Delta Intérieur Du Niger (Mali) : Delmasig, Un SIG À Vocation Locale Et Régionale
tnjeux spatiaux et fonciers dans le delta intérieur du Niger (Mali) Delmasig, un SIG à vocation locale et régionale Jérôme Marie Géographe Le présent article expose brièvement quelques-uns des résultats obtenus par l'utilisation du SIG Delmasig concernant l'évolution des rizières et les relations entre espace rizicole et espace pastoral. Ce système d'information géographique est dédié à l'aide à la décision pour une gestion régionale et locale des hommes, des milieux, des enjeux spatiaux et fonciers dans le delta intérieur amont du fleuve Niger au Mali (Marie, 2000). L'espace traité couvre les plaines de la cuvette du Niger depuis, en amont, Ké- Macina sur le Niger et Baramandougou sur le Bani, jusqu'au lac Débo en aval, y compris une fraction du Farimaké au nord-ouest du lac Débo, soit une superficie totale légèrement supérieure à 22 000 km2. Les données portent sur : - les formations végétales et leur relation avec la crue, dont dérive une modélisation des surfaces inondées ; -une analyse de l'évolution des surfaces cultivées en riz entre 1952, 1975 et 1989 : la comparaison diachronique de l'emprise des cultures de riz à ces trois dates permet d'en retracer l'évolution sur une quarantaine d'années, tandis que la comparaison de l'emprise des rizières avec les formations végétales permet de mettre en 558 T Gestion intégrée des zones inondables tropicales évidence les stratégies des riziculteurs et de suivre plus particulièrement l'évolution de l'espace « des crues utiles » année par année ; -une modélisation des nouveaux cadres territoriaux -

Usaid Mali Civic Engagement Program Year 5 Work Plan (October 1, 2020 to July 31, 2021)
USAID MALI CIVIC ENGAGEMENT PROGRAM YEAR 5 WORK PLAN (OCTOBER 1, 2020 TO JULY 31, 2021) Funding provided by the United States Agency for International Development under Cooperative Agreement No. AID-688-A-16-00006 Prepared by: FHI 360 Submitted to USAID September 8, 2020 Salimata Marico Leslie-Ann Nwokora Agreement Officer’s Representative/ AOR Agreement Officer [email protected] [email protected] Inna Bagayoko Cheick Oumar Coulibaly Alternate AOR Acquisition and Assistance Specialist [email protected] [email protected] 1 Table of Contents ACRONYMS AND ABBREVIATIONS 3 INTRODUCTION 4 I. CEP YEAR 5 IMPLEMENTATION APPROACH 4 A. OVERVIEW OF THE PROGRAM DURING YEAR 5 4 B. ALIGNMENT WITH THE GOVERNMENT OF MALI AND CIVIL SOCIETY ORGANIZATION PRIORITIES 5 C. KEY IMPLEMENTING CSOs AND PROGRAMMATIC PARTNERS AND THEIR TARGET AREAS: 5 D. SYNERGY WITH OTHER USAID-FUNDED PROGRAMS 7 E. STAFFING UPDATES/APPROACH 8 II. CEP OBJECTIVES AND PLANNED ACTIVITIES FOR YEAR 5 8 A. OBJECTIVE 1: MECHANISMS OF BOTTOM UP SOCIAL ACCOUNTABILITY 8 STRENGTHENED B. OBJECTIVE 2: CSOS COLLABORATE EFFECTIVELY WITH GOVERNMENT AND THE PRIVATE SECTOR TO DEVELOP PUBLIC 9 POLICY AND ADVANCE ISSUES OF COMMON INTEREST C. OBJECTIVE 3: CITIZENS UNDERSTAND THEIR RIGHTS AND RESPONSIBILITIES AND FEEL EMPOWERED TO ENGAGE WITH 10 THE GOVERNMENT OF MALI ACTORS D. OBJECTIVE 4: IMPACT OF COVID-19 MITIGATED IN TARGET COMMUNITIES 11 III. MONITORING, EVALUATION, LEARNING AND EXIT STRATEGY ACTIVITIES 12 IV. THE PROGRAM FINAL REPORTING 12 V. ANTICIPATED RISKS AND MANAGEMENT MEASURES DURING -

Redeployment of the State in Central Mali What Role for the Communities in the Return of State Services in the Mopti and Segou Regions?
This project is funded by the European Union Redeployment of the State in Central Mali What role for the communities in the return of state services in the Mopti and Segou regions? Alerted to the emergence of a new conflict in the This permanent mechanism for dialogue seeks to centre of Mali, the Government of Mali developed facilitate a series of negotiations to ensure that the Integrated Security Plan for the Central Re- the return of the state services meets the priority gions (Plan de Sécurisation Intégrée des Régions needs identified by the communities and it does du Centre, PSIRC) in 2017, with its aim to pacify not expose them to reprisals. and stabilize the region by restoring the state’s presence in the area. It is within this context that In addition to roadmaps drawn up jointly by par- in 2018 the Malian government called upon the ties for each of the seven target administrative Centre for Humanitarian Dialogue (HD) to help districts in the Mopti and Ségou regions, these secure the support of local communities. Since 180 leaders, split into district-based dialogue then, HD, with its mandate as a neutral interme- frameworks, are contributing to the return of pu- diary, has been facilitating an ongoing dialogue blic services and to improved collaboration between 180 community leaders, identified to between local communities and state authorities. represent the interests of their communities to A sampling of their achievements, in part due to the public authorities and state representatives HD support, are presented here. involved in the redeployment of public services. -

Dilemmas of UN Peacekeeping in Mali
OCTOBER 2018 Protecting Civilians in the Context of Violent Extremism: The Dilemmas of UN Peacekeeping in Mali NAMIE DI RAZZA Cover Photo: MINUSMA’s Nigerian ABOUT THE AUTHOR contingent secures and assists a health assessment operation near the border NAMIE DI RAZZA is a Research Fellow at IPI. with Niger to detect possible cases of Email: [email protected] Rift Valley Fever, Tamalet, Mali, October 29, 2016. Sylvain Liechti/MINUSMA. Disclaimer: The views expressed in this ACKNOWLEDGEMENTS paper represent those of the author and not necessarily those of the The author would like to thank all those who shared their International Peace Institute. IPI insights and perspectives during interviews conducted in welcomes consideration of a wide New York, Bamako, and Mopti, and during discussions at range of perspectives in the pursuit of various events. In particular, she is grateful to MINUSMA a well-informed debate on critical and the Peacekeeping School of Bamako for facilitating policies and issues in international two “field conversations” in June and October 2018, which affairs. enabled her to gather crucial insights from stakeholders operating in Mali. IPI Publications Adam Lupel, Vice President The author is grateful to all the UN officials, military Albert Trithart, Editor officers, and member states, as well as civil society representatives, experts, and researchers who took the Gretchen Baldwin, Assistant Editor time to discuss this important topic with her. Suggested Citation: The author is also extremely thankful to those who Namie Di Razza, “Protecting Civilians in provided feedback on earlier drafts of the report. Special the Context of Violent Extremism: The thanks to Jake Sherman for his indefectible support during Dilemmas of UN Peacekeeping in Mali,” the research and writing phases that led to the publication. -

The United Nations Foundation Team Traveled to Bamako, Gao, And
The United Nations Foundation team traveled to Bamako, Gao, and Timbuktu from September 16-26, 2018, to learn more about the United Nations Integrated Mission in Mali (MINUSMA). During our visit, we met with more than 50 UN officials, civil society groups, Western diplomats, and international forces including leadership in MINUSMA, Barkhane, and the G5 Sahel Joint Force. Below you will find our observations. Background The landlocked country of Mali, once a French colony and a cultural hub of West Africa, was overrun in January 2012 by a coalition of Tuareg and terrorist groups moving south towards the capital of Bamako. At the time, the Tuareg movement (MNLA) in northern Mali held legitimate grievances against the government and aligned itself with Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) and Ansar Dine (Defenders of Faith), the Islamic militants and jihadists in the region. Simultaneously, a mutiny of soldiers launched a military coup d’ etat led by Captain Amadou Sonogo, who took power from then President Amadou Toumani Touré and dissolved government institutions, consequently leading to a complete collapse of institutions in the northern part of the country. This Tuareg movement declared Kidal, Gao, and Timbuktu an Independent State of Azawad by April 2012. However, soon after, the Tuareg move- ment was pushed out by the jihadists, Ansar Dine and Movement for Oneness and Jihad in West Africa (MUJAO).1 In the early days of the conflict, the UN and Economic Community of West African States (ECOWAS) put together a power-sharing framework which led to the resignation of President Toure. Dioncounda Traoré was subsequently appointed interim President and a transitional government was established. -

The World Bank
Document of The World Bank FOR OFFICIAL USE ONLY Public Disclosure Authorized Report No: PAD2890 INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION PROJECT PAPER ON A PROPOSED ADDITIONAL GRANT IN THE AMOUNT OF SDR 21.6 MILLION (US$30 MILLION EQUIVALENT) Public Disclosure Authorized TO THE REPUBLIC OF MALI FOR THE RECONSTRUCTION AND ECONOMIC RECOVERY PROJECT Public Disclosure Authorized October 9, 2018 Social, Urban, Rural And Resilience Global Practice Africa Region This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of their official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization. Public Disclosure Authorized CURRENCY EQUIVALENTS (Exchange Rate Effective September 30, 2018) Currency Unit = FCFA CFAF 566.43 = US$1 SDR 0.71671743 = US$ 1 FISCAL YEAR January 1 - December 31 Regional Vice President: Hafez M.H. Ghanem Country Director: Soukeyna Kane Senior Global Practice Director: Ede Jorge Ijjasz-Vasquez Practice Manager: Meskerem Brhane Task Team Leader: Zie Ibrahima Coulibaly ABBREVIATIONS AND ACRONYMS AF Additional Financing AFD French Development Agency (Agence Française de Développement) CPF Country Partnership Framework DA Designated Account ESAF Environmental and Social Assessment Framework ESCOP Environmental and Social Codes of Practice ESIA Environmental and Social Impact Assessment ESMF Environmental and Social Management Framework ESMP Environmental and Social Management Plan FAMAs Malian Defense and Security Forces (Forces Armées Maliennes) FM Financial -

World Bank Document
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES REPUBLIQUE DU MALI FINANCES ------------------------------ UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI Public Disclosure Authorized PROJET DE RECONSTRUCTION ET DE RELANCE ECONOMIQUE Public Disclosure Authorized NOTICE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (NIES) POUR LA CREATION D’UN CENTRE DE DEVELOPPEMENT POUR LA PETITE ENFANCE DANS LA VILLE DE KONNA (COMMUNE DE KONNA) Public Disclosure Authorized Rapport final Public Disclosure Authorized Fousseyni T. TRAORE Consultant en évaluation environnementale et sociale Email : [email protected] Juillet 2018 TABLE DES MATIERES SIGLES ET ABREVIATIONS ................................................................................... 5 I. INTRODUCTION ................................................................................................. 6 1.1. Contexte...................................................................................................................... 6 1.2. Objectifs de l’Etude ................................................................................................... 7 1.3. Approche méthodologique de l’étude ...................................................................... 7 1.4. Méthodologie d’identification et d’évaluation des impacts ................................... 7 II. DESCRIPTION DE L'ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT .................................................................................................... 9 2.1. Situation géographique de la Commune de Konna .............................................. -

Région De Segou-Mali
! ! ! RÉGION DE SEGOU - MALI ! Map No: MLIADM22304 7°0'W 6°0'W 5°0'W 4°0'W M A U R I T A N I E !Ambiri-Habe Tissit ! CER CLE S E T CO M MU NE S D E SÉ GO U ! Enghem ! Nourani ! Gathi-Loumo ! Boua Moussoule SÉGOU BLA El Massouka 30 Communes 17 Communes ! ! Korientzé RÉGION DE SÉGOU Kolima ! ! Fani ! ! BellenYouwarou ! ! Guidio-Saré Kazangasso Koulandougou Sansanding ! ! Togou Touna ! P Chef-lieu Région Route Principale ! Dougabougou ! Korodougou Boussin Diena ! Diona Yangasso ! ! Chef-lieu Cercle Route Secondaire ! ! Sibila ! ! ! Tiemena Kemeni Gueneibé Zoumane ! ! ! Nampala NKoumandougou !Sendegué ! ! Farakou Massa Niala Dougouolo Chef-lieu Commune Piste ! ! ! ! Dioro ! ! ! ! ! Samabogo ! Boumodi Magnale Baguindabougou Beguene ! ! ! Dianweli ! ! ! Kamiandougou Village Frontière Internationale Bouleli Markala ! Toladji ! ! Diédougou 7 ! Diganibougou ! Falo ! Tintirabe ! ! Diaramana ! Fatine Limite Région ! ! Aéroport/Aérodrome Souba ! Belel !Dogo ! ! ! Diouna 7 ! Sama Foulala Somasso ! Nara ! Katiéna Farako ! Limite Cercle ! Cinzana N'gara ! Bla Lac ! ! Fleuve Konodimini ! ! Pelengana Boré Zone Marécageuse Massala Ségou Forêts Classées/Réserves Sébougou Saminé Soignébougou Sakoiba MACINA 11 Communes Monimpébougou ! N Dialloubé N ' ! ' 0 0 ° ° 5 C!ette carte a été réalisée selon le découpage administratif du Mali à partir des SAN 5 1 doGnnoéuems bdoe ula Direction Nationale des Collectivités Territoriales (DNCT). N I O N O 25 Communes Macina 1 Kokry Centre !Borko ! Sources: ! Souleye ! ! Konna Boky Were ! ! - Direction Nationale des Collectivités -
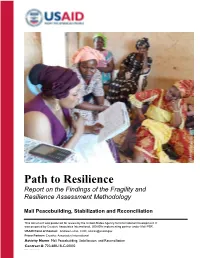
Path to Resilience Report on the Findings of the Fragility and Resilience Assessment Methodology
Path to Resilience Report on the Findings of the Fragility and Resilience Assessment Methodology Mali Peacebuilding, Stabilization and Reconciliation This document was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by Creative Associates International, USAID's implementing partner under Mali PSR. USAID Point of Contact: Andrew Lucas, COR, [email protected] Prime Partner: Creative Associates International Activity Name: Mali Peacebuilding, Stabilization, and Reconciliation PageContract 0 - Path #: t720o Resilience:-688-18- CReport-00002 on the findings of Fragility and Resilience Assessment Methodology Assessment. Contract #: 720-688-18-C-00002 Table of Contents Executive Summary ...................................................................................................... 3 1. Introduction ............................................................................................................. 7 Functionality of the System ...................................................................................... 8 Efficacy of the Governance System ......................................................................... 9 FRAMe® Report Content ......................................................................................... 11 2. Fragility and Resilience Assessment Methodology – FRAMe® ........................ 11 Overview of FRAMe® In PSR .................................................................................. 11 FRAMe® and the Path to Resilience ..................................................................... -

S2mv1905mlia0l-Mliadm223-Mali.Pdf
CARTE ADMINISTRATIVE - MALI Map No: MLIADM223 12°0'W 10°0'W 8°0'W 6°0'W 4°0'W 2°0'W 0°0' 2°0'E 4°0'E !! El Mzereb RÉPUBLIQUE DU MALI CARTE DE RÉFÉRENCE !^ Capitale Nationale Route Principale Ts!alabia Plateau N N ' ' 0 0 ° ° 4 ! 4 2 .! Chef-lieu Région Route Secondaire 2 ! ! Chef-lieu Cercle Frontière Internationale ! Dâyet Boû el Athem ! Chef-lieu Commune Limite Région ! Teghaza 7 Aéroport Fleuve Réserve/Forêts Classées Lac Zone Marécageuse ! A L G É R I E ! Bir Chali Cette carte a été réalisée selon le découpage administratif du Mali à partir des données de la Direction Nationale des Collectivités Territoriales (DNCT). ! Taoudenni ! Sources: Agorgot - Direction Nationale des Collectivités Territroriales (DNCT), Mali - Esri, USGS, NOAA - Open Street Map !In Dagouber Coordinate System: Geographic N N ' ! ' 0 Datum : WGS 1984 El Ghetara 0 ° ° 2 2 2 2 1:2,200,000 0 100 200 Tazouikert ! ! Kilometres ! ! Bir Ouane Tamanieret Oumm El Jeyem ! ! ! In-Afarak http://mali.humanitarianresponse.info El Ksaib Tagnout Chagueret ! In Techerene ! Foum El Alba ! ! Amachach Kal Tessalit ! ! Tessalit Taounnant In Echai ! ! N N ' Boughessa! ' 0 0 ° ° 0 ! ! 0 2 ! 2 ! Tanezrouft pist Tinzawatène Kal Tadhak Telakak ! T O M B O U C T O U Taghlit ! Bezzeg Tin Tersi ! K I D A L ! Iradjanatene Tassendjit! ! Tin Ezeman ! Tin Karr ! Aguel-Hoc Ouan Madroin! ! ! Adrar Tin Oulli Inabag ! ! Tafainak ! El M! raiti ! Inabag Kal Relle Tadjmart Avertissement: Les limites, les noms et les désignations utilisés sur cette carte n’impliquent pas une reconnaissance ! Abeïbara Elb Techerit ! ou acceptation officielle des Nations Unies. -

Les Résultats Du DEF Session Juin 2014, ACADEMIE DE DOUENTZA
LISTE DES ADMIS AU DEF -SESSION DE JUIN 2014- ACADEMIE DE DOUENTZA Jour Mois Année PRENOMS NOM de de de Lieu de Statut N° Place Sexe Ecole CAP de l'Elève de l'Elève Naiss Naissa Naissa Naiss. élève ance nce nce ADJAWIAKO 1 Alhousseïny M 14 Juin 2001 REG DOUENTZA SC I DOUENTZA YE 8 Ibrahim ALASSANE M 25 Septembre1996 Gao REG Koporo Na II KORO Mohamed ALMOULOU 11 M 25 Mars 1998 REG DOUENTZA SC I DOUENTZA Aldjoumat D Mamadou Tolo 9 Almoubareck Alhad M Vers 31/12/ 1999 Tombouctou REG Bandiagara 2°C II 12 Kadidia ALPHAGALO F Vers 1997 Koro REG Djibril Barry II KORO Diougodiè Dolo 14 Seydou ALPHAGALO M 31 Novembre1997 Ombo REG KORO I 16 Moussa Ambana M 31 12 2000 Komberou REG Ningari 2°C Bandiagara 17 Ousmane S Ambapil M Vers 31/12/ 1997 Indell REG Ondougou 2°C Bandiagara 19 Abdoulaye ARAMA M 27 10 1998 Sokoura REG Sokoura 2° C SOKOURA 22 Abdoulaye A Arama M 31 12 1999 Mounabondo REG Ouo 2°C Bandiagara Abdoulaye 23 Arama M 4 10 1999 Kendié REG GSGB 2°C Bandiagara dit Paul 24 Abdoulaye M Arama M 31 7 2000 Mandoli REG Ouo 2°C Bandiagara 26 Adiara ARAMA F 1 8 1998 Sokoura REG Sokoura 2° C SOKOURA 31 Aminata Arama F Vers 31/12/ 1997 Bandiagara REG Alpha Ali Seck I Bandiagara 35 Anne Marie Arama F 29 5 1997 Bandiagara REG Alpha Ali Seck I Bandiagara Bourkouma 36 Arouna Arama M 31 12 1998 Tassilima REG Bandiagara 2°C 37 Bacary Aly ARAMA M 1998 Koumoudou REG JYA 2°C BANKASS 39 Biba Arama F 31 12 2000 Ama REG Ouo 2°C Bandiagara 41 Boureima ARAMA M 1999 Simini REG Toun 2° C SOKOURA 42 Bouréima ARAMA M 1999 Tori REG A.KODIO 2°C A BANKASS 45 Daouda E