Maurice Maignen Apôtre Du Monde Ouvrier
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Blessed Sr. Rosalie (1786-1856)
Vincentiana Volume 49 Number 2 Vol. 49, No. 2 Article 12 3-2005 Martyr of Charity: Blessed Sr. Rosalie (1786-1856) Jean-Pierre Renouard C.M. Follow this and additional works at: https://via.library.depaul.edu/vincentiana Part of the Catholic Studies Commons, Comparative Methodologies and Theories Commons, History of Christianity Commons, Liturgy and Worship Commons, and the Religious Thought, Theology and Philosophy of Religion Commons Recommended Citation Renouard, Jean-Pierre C.M. (2005) "Martyr of Charity: Blessed Sr. Rosalie (1786-1856)," Vincentiana: Vol. 49 : No. 2 , Article 12. Available at: https://via.library.depaul.edu/vincentiana/vol49/iss2/12 This Article is brought to you for free and open access by the Vincentian Journals and Publications at Via Sapientiae. It has been accepted for inclusion in Vincentiana by an authorized editor of Via Sapientiae. For more information, please contact [email protected]. 3ª BOZZA STUDY “MARTYR OF CHARITY” Blessed Sr. Rosalie (1786-1856) by Jean-Pierre Renouard, C.M. Province of Toulouse “A martyr of Charity!” The phrase comes from St. Vincent. He spoke one day to the Daughters of Charity of Sr. Marie-Joseph from Etampes, one of the first sisters, and said of her: “This good daughter may be called a martyr of charity. Do you think that the only martyrs are those who spill their blood for the faith? For example, those daughters who went to find the queen, that is a martyrdom; for, while they did not die, they were exposed to the danger of death, and they did that willingly for the love of God; like so many good Daughters who have given their lives in the service of the poor, that is a martyrdom.” 1 Sr Rosalie was of that kind. -

Five Faces of Rosalie Rendu Contents
Five Faces of Rosalie Rendu Robert P. Maloney, CM at the Motherhouse of the Daughters of Charity, Paris, France, March 25, 2003 Rosalie Rendu was an extraordinary woman. Even though many of the biographies written about her are poor in quality.[1]] Rosalie’s energy, creativity, fidelity, courage shine out in the accounts of those who knew her.[2] Long before her death she had become famous. An immense crowd, estimated at 40-50 thousand people, from all strata of society flocked to her funeral on February 9, 1856. As we look forward to her beatification, I think of Shakespeare’s eloquent words: When she shall die, Take her and cut her out in little stars, And she will make the face of heaven so fine That all the world will be in love with night...[3] The Church beatifies and canonizes men and women precisely for that reason: that they might shine out like stars for us, that in the midst of darkness we might see, in their example, what it really means to be holy. Saints make holiness real, concrete. So, let me present to you today five faces of Rosalie Rendu. Contents 1 1. Prodigious Worker and Organizer 2 2. Local Superior 3 3. Intrepid Woman 4 4. Friend of Rich and Poor 5 5. Faithful, sometimes misunderstood, Daughter of Charity 1. Prodigious Worker and Organizer Rosalie was born on September 9, 1786, in Confort, a village in Savoy. At just 15 years of age she set off for Paris. There she spent more than 50 years of her life in the Mouffetard neighborhood. -

Blessed Sr. Rosalie (1786-1856)
3ª BOZZA STUDY “MARTYR OF CHARITY” Blessed Sr. Rosalie (1786-1856) by Jean-Pierre Renouard, C.M. Province of Toulouse “A martyr of Charity!” The phrase comes from St. Vincent. He spoke one day to the Daughters of Charity of Sr. Marie-Joseph from Etampes, one of the first sisters, and said of her: “This good daughter may be called a martyr of charity. Do you think that the only martyrs are those who spill their blood for the faith? For example, those daughters who went to find the queen, that is a martyrdom; for, while they did not die, they were exposed to the danger of death, and they did that willingly for the love of God; like so many good Daughters who have given their lives in the service of the poor, that is a martyrdom.” 1 Sr Rosalie was of that kind. By her life, her works, her spirituality, she embodied this vision painted by the saint of charity; you could say that she was the perfect realisation of what he taught: “Whoever gives her life for God may be deemed a martyr. And it is certain that your lives 1 COSTE X, 510. 3ª BOZZA 180 J.-P. Renouard are shortened by the work which you do; and, as such, you are martyrs.” 2 Even apart from the imperfect clichés which we have of her, a trained eye sees on her face the marks which indicate tenacity and strength: the set lips and the piercing eyes. How could one not think of the phrase of St. -

Rosalie Rendu: the Person Behind the Actions
from Chapters 1-2 of Sister Rosalie Rendu: Rosalie Rendu: A Daughter of Charity On Fire with Love for the The Person Behind the Actions Poor by Louise Sullivan, D.C. Brief Bio • Blessed Rosalie Rendu was born in the Jura Mountains, near the Swiss border in the current department of Ain, in 1786. At 15 she joined the Daughters of Charity of St. Vincent de Paul, attracted by their charity and spirit of service. • For 54 years, from her novitiate until her death, she dedicated herself to serving the poor in the Mouffetard, the most deprived district of Paris. A soul of continual prayer, she reportedly said: "Never have I prayed so well as in the street." • The numerous texts that have appeared since her death portray her heroic deeds on the barricades during the revolutions of 1830 and 1848, or her risking her own life at the bedside of the sick during the cholera epidemics of 1832, 1849, and 1854. They also recount in detail the great works that she founded for those who were poor, or that a street in Paris was named after her. Images from St. Vincent de Paul Image Archive Rediscovering the Secret of Sister Rosalie • As with St. Vincent and St. Louise, or in studying the life of any saint, there is the danger of losing the person behind the actions, of being so dazzled by the magnitude of their achievements that the spiritual and human motor that drove them disappears. Such has often been the case with Sister Rosalie. • Sister Rosalie, the woman, is far more and far less than the sum of her actions. -

Fifth Sunday in Ordinary Time 4 February 2018
St Peter’s Church, Phibsborough Parish Newsletter Fifth Sunday in Ordinary Time 4 February 2018 Jesus the Healer In today’s gospel we read about Jesus’ first healing in Mark’s Gospel. Jesus hears of the illness of the mother of Simon’s wife and goes to her. Due to the purity laws of his time this scene would have been considered controversial. His first healing is of a woman and we are told that he touches her, raises her up; he completely restores her to health. Many of his actions here would be considered taboo. The ‘whole city’ was crowded around the door as people wanted to also be healed. What a commotion! Jesus, very early on in his ministry, is clearly a very popular, attractive figure. Jesus is the healer. We might ask ourselves today: who do we know who is in need of healing of any kind? This week, how can we reach out to them? Another important aspect of this story is that Jesus does not remain comfortable in this house. He keeps moving, keeps going outward. This requires so much energy and an outpouring of love for those in need. Jesus shows us in today’s gospel what it takes to stay connected, to re-energise ourselves for our various tasks: quiet time and space for real encounter with God. Even then, the people hunted for him. ‘Everyone is searching for you’, and still today, everyone is searching. It is up to all of us to help those on this journey, the seekers, the lost and those in need of healing. -

Chapter Seven: the Woman Behind the Works
DePaul University Via Sapientiae Vincentian Studies Institute Monographs & Rosalie Rendu Publications 2006 Chapter Seven: The Woman Behind the Works Follow this and additional works at: https://via.library.depaul.edu/rendu Recommended Citation Chapter Seven: The Woman Behind the Works. https://via.library.depaul.edu/rendu/10 This Article is brought to you for free and open access by the Vincentian Studies Institute Monographs & Publications at Via Sapientiae. It has been accepted for inclusion in Rosalie Rendu by an authorized administrator of Via Sapientiae. For more information, please contact [email protected]. 97 CHAPTER VII THE WOMAN BEHIND THE WORKS SOURCES OF SISTER ROSALIE'S ENERGY FOR THE SERVICE OF THOSF. WHO WERE POOR Just as it is in the case of Vincent de Paul and his collaborator, Louise de Marillac, it is easy to lose the person behind the amazing catalogue of Sister Rosalie's accomplishments in the service of those who were poor. The mystic tends to disappear behind the person of action. Apostolic zeal clouds the examination of other equally important qualities and virtues. Moreover, for the founders of the Daughters of Charity, achieving the necessary balance between prayer and action, within the context of consecrated life lived in community, was a constant challenge, albeit a struggle, because of the crushing needs of those whom they were called upon to serve. Yet attaining this balance was the essential quality of their vocation. Late in her life, Louise de Marillac wrote a somewhat disconcerting letter in this regard to the early sisters who shared her vocation of service. -

Chapter Nine: Revolution and Disease: 1830-1854
DePaul University Via Sapientiae Vincentian Studies Institute Monographs & Rosalie Rendu Publications 2006 Chapter Nine: Revolution and Disease: 1830-1854 Follow this and additional works at: https://via.library.depaul.edu/rendu Recommended Citation Chapter Nine: Revolution and Disease: 1830-1854. https://via.library.depaul.edu/rendu/8 This Article is brought to you for free and open access by the Vincentian Studies Institute Monographs & Publications at Via Sapientiae. It has been accepted for inclusion in Rosalie Rendu by an authorized administrator of Via Sapientiae. For more information, please contact [email protected]. 149 CHAPTER IX REVOLUTION AND DISEASE : 1830-1854 SISTER ROSALIE AS HEROINE ON THE BARRICADES AND AT THE BEDSIL)E OF CHOLERA VICTIMS The Sister Rosalie that we turn to here is unquestionably the best known. She is most often viewed as a heroine of nearly mythical proportions. Her biographers portray her standing on the barricades during the fury of the revolutions of 1830 and 1848. Moreover, not only is she seen defying death in the streets of Paris but also at the bedside of victims of the cholera epidemics that wreaked havoc in the Mouffetard area in 1832, 1849, and 1854. This image of the heroine is accurate. We do not dispute it. The problem lies not in presenting this reality but in limiting Sister Rosalie's life to these actions, however extraordinary they may be. Given Sister Rosalie's character and up-bringing, it is not surprising that she reacted to events as she did. Born in 1786, she was not yet three-years-of-age when the Bastille was stormed and the Revolution of 1789, known simply as "THE French Revolution," began. -

St. Patrick Parish 71 Central Street, Stoneham, MA 02180 February 23, 2020 - Seventh Sunday in Ordinary Time
St. Patrick Parish 71 Central Street, Stoneham, MA 02180 February 23, 2020 - Seventh Sunday in Ordinary Time PASTORAL STAFF Rev. Mario J. Orrigo ~ Pastor Rev. Frank D. Campo ~ Associate Pastor Most Rev. Peter J. Uglietto ~ In Residence Rev. Jurgen Liias ~ Senior Priest Rev. Thomas F. Oates ~ Senior Priest Rev. Marcel Uwineza ~ Visiting Priest Deacon Frank Dello Russo Deacon Charles G. Hanafin Deacon Joseph A. Cooley Senior Deacon John R. Turner SUNDAY MASSES Saturday: 4:00 pm Sunday: 8:00 am 10:00 am (Family Mass) 12 Noon & 6:00 pm DAILY MASSES Monday Saturday: 12 Noon HOLY DAYS Vigil 7:00 pm Holy Day 12:00 Noon CONFESSIONS Saturday 3:00 pm to 3:45 pm MISSION STATEMENT In communion with the Roman Catholic Church throughout the world, St. Patrick Parish seeks to further the mission of Jesus Christ: that all may know God’s love for them, and grow in union with God and one another. With the Sacred Liturgy at the center of our parish life, we are formed by the Word of God and strengthened by the Eucharist. We move from the table of the Lord to proclaim God’s presence in our world today through a variety of ministries. Manifesting the life of the Holy Spirit in our midst, we strive to be a welcoming community where faith finds expression in service. ADMINISTRATIVE STAFF ROSARY ST. PATRICK PARISH AND SCHOOL Music Ministry Weekdays before 12:00 Noon Mass, INCLEMENT WEATHER POLICY CoDirector ~ Susan Columbus Monday & Friday 2:45 pm CoDirector ~ Phyllis Bunnell Tuesday 6:45 pm St. -

Rencontre Régionale De L'a C F À Bourg En Bresse Samedi 10 Juin
Région Centre Est Rencontre Régionale de l’A C F à Bourg en Bresse Samedi 10 Juin 2017 Préparée et animée par les équipes de l’AIN et le Père CATTIN A vous toutes femmes en ACF A vous les aumôniers fidèles de notre mouvement Merci à l’AIN, à Réjane, au Père Cattin de nous accueillir dans leur diocèse. A 2 équipes réunir 136 personnes, ce n’est pas rien. Vous méritez bien tous nos applaudissements Merci aussi à vous toutes d’avoir répondu présentes à cette rencontre. Il y a 2 ans maintenant, avec le bureau de région nous avons lancé cette idée de mettre en « avant » un département. Cela partait d’un constat : dans les diocèses il se fait toujours en ACF de belles choses. Peu importe la taille du diocèse, peu importe qu’il y ait beaucoup ou peu d’équipes. Ce qui compte ce sont les forces vives à l’œuvre pour un projet. Venir dans les départements c’est reconnaître toute cette énergie ACF - Ce « courant » qui passe entre les femmes signe d’amitié et de confiance - Ce feu qui nous anime pour aller à la rencontre de l’autre et partager avec lui nos joies, nos souffrances mais aussi nos espoirs - Cette lumière qui nous éclaire pour poser notre vie sous le regard de l’Evangile avec l’aide bienveillante de nos aumôniers ou de nos accompagnateurs spirituels - Cette source, qui coule en nous, et qui nous donne la force de nous engager Depuis Septembre, Réjane, Marie Noëlle, et leurs équipes mobilisées pour cette journée, se sont senties redynamisées. -

Spiritual Advisor Handbook
SPIRITUAL ADVISOR HANDBOOK THE SOCIETY OF ST. VINCENT DE PAUL NATIONAL COUNCIL OF THE UNITED STATES REVISED: FEBRUARY 2021 IN GRATITUDE TO THE TASK FORCE: TIM WILLIAMS, CHAIR NANCY JUNG DEACON HENRY KNAPP DEACON MIKE LYMAN RITA ST. PIERRE Table of Contents The Spiritual Advisor in the Society ................................................................................................... 2 Heritage ....................................................................................................................................................3 Our Vincentian Founders – Saints and Blesseds ...........................................................................................5 Our Vincentian Organization ......................................................................................................................8 Vincentian Spirituality .............................................................................................................................. 10 The Way of Vincentian Spirituality – the Vincentian Charism ........................................................................ 10 Fundamental Principles of Vincentian Spirituality.......................................................................................... 10 Vincentian Spirituality – On-Going Formation ................................................................................................ 13 Role and Responsibilities of the Spiritual Advisor ...................................................................................... 14 -

Circular Letter 2021
16th President General International Paris, 31 January 2021 CIRCULAR LETTER TO MY DEAR FELLOW MEMBERS OF THE CONFERENCES OF THE SOCIETY OF SAINT VINCENT DE PAUL AROUND THE WORLD 2021 - International Year of JULES DEVAUX 1. Introduction Praised be our Lord Jesus Christ! My dear members of Saint Vincent de Paul Conferences around the world, I first wish to ask for the abundant blessings of Our Lord Jesus Christ on you, and for our Blessed Lady to be with everyone, particularly those in need whom our Society helps, whether in special works or in Conferences. I am very pleased to be writing to you all again, sisters and brothers in the Vincentian Conferences around the world, for the sixth time since I was elected as 16th President General of the Society of Saint Vincent de Paul, with this Circular Letter for 2021. It has been the custom since 1841 for the Presidents General of the Society of Saint Vincent de Paul to write Circular Letters addressed directly to the members, covering important matters on the Vincentian agenda, or for guidance to improve the work of the Conferences, special works and Councils. The Letters of the Presidents General are, it seems, very important training materials for all our members. 1.1. 2020 has truly been a year like no other This past year has been a time which will be marked out in the history of humanity as one of the worst- ever health crises, affecting millions of lives, as well as leading to countless negative consequences for the economy of countries and of the whole world, increasing poverty, unemployment and vulnerability in society. -
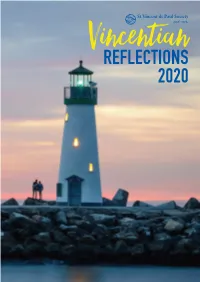
Vincentian Reflections
VincentianREFLECTIONS 2020 Opening Prayers In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Let us pause and open ourselves to the presence of God Come, Holy Spirit, fill the hearts of Your faithful and enkindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and renew the face of the earth. O God, by the light of the Holy Spirit, teach the hearts of the faithful and grant that by the same Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ Our Lord. Prayer for the Church and all Vincentians Compassionate God, we pray for our Church, especially our Pope, Bishops, Priests and Religious. May their leadership strengthen and nourish our Vincentian spirit. We pray for all members of the Vincentian family throughout the world, especially in those countries with which we are twinned. We pray that like Saint Vincent de Paul, we are open to the presence of Christ in the poor and are always willing to share our spirit and resources. Prayer for the Society Spirit Lord Jesus, we share in the faith and courage of our founders, especially Blessed Frédéric Ozanam, Blessed Rosalie Rendu, Fr Gerald Ward and Captain Charles O’Neill. May their spirit be renewed in the Society of today. May we be open to the needs of those suffering poverty and injustice, remaining receptive to the grace of the Holy Spirit. We pray that we build a sense of community wherever our members are gathered. Prayer for Reconciliation Holy Spirit, we pray that the St Vincent de Paul Society be a place in which the First Peoples of Australia are welcomed and deeply respected.