Discours William Christie 27-01
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
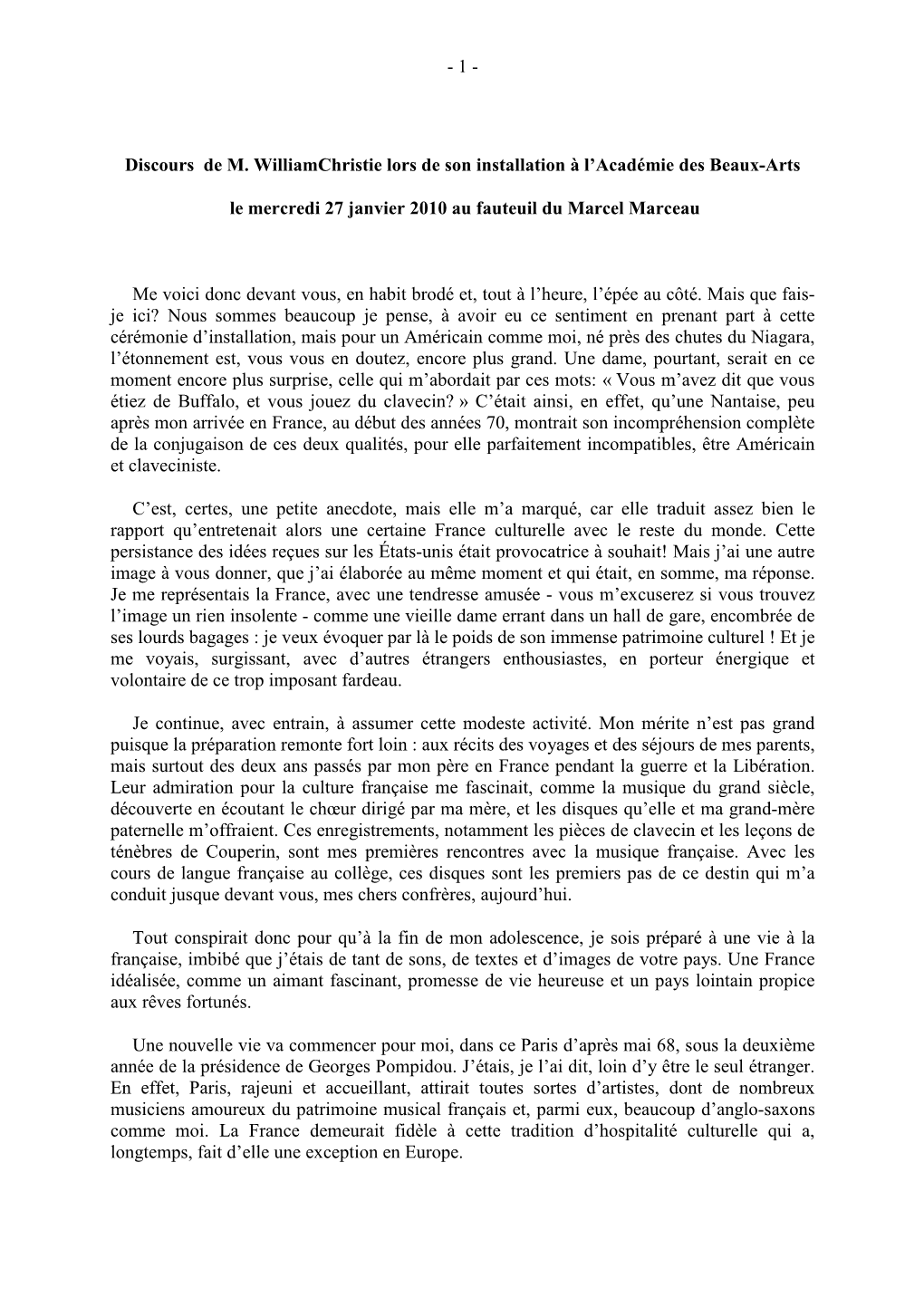
Load more
Recommended publications
-

January 2021
ESTMINSTER Volume XII No.1 UARTERLY January 2021 A Jewish society wedding c.1892 Anglo-Jewish High Society The Philippines and the Holocaust The Children Smuggler ‘The Little Doctor’ From the Rabbi ‘Woe is me, perhaps because I have have identified; they suggest that, as the sinned, the world around me is being Festival itself marks increased darkness, darkened and returning to its state of let the candles reflect this reality too. chaos and confusion; this then is the Remove one each day, starting with the kind of death to which I have been eighth. The view of the School of Hillel sentenced from Heaven!’ So he began may also acknowledge that the world is keeping an eight-day fast. getting darker, but the ritual response is the opposite. When the world gets darker But as he observed the winter solstice we bring more light. and noted the day getting increasingly longer, he said, ‘This is the world’s So let us pay respect to both views. course’, and he set forth to keep an eight- Together we have the strength in our day festival. community to acknowledge the darkness in the world, and also to bring more light. (Adapted from the Babylonian Talmud, Many of us in the last year have stepped tractate Avodah Zara, page 8a.) up to contact and care for other members of our community, and we have benefited Together we have the from the resulting conversations and How do we respond to increased relations. We have found new creativity darkness? In Franz Kafka’s short story, strength in our to ensure our togetherness, building Before the Law, a man spends his whole community to special High Holy Days. -

Study-Guide Trent Arterberry • Actions Speak Louder
Study-Guide Trent Arterberry • Actions Speak Louder make good choices in life. Mime is an authentic, immediate Synopsis of Program Actions Speak Louder i n t r o d u c e s and unique experience of live the- students to the communicative and atre, which teaches social skills and Designed for secondary audiences, expressive art form of mime, and the creates community. It stimulates Actions Speak Louder uses modern potential of the human body. concentration, imagination and scenarios to examine how our own Students will observe how the mime abstract thought. inner resources can help us to make creates characters, environments, the right decisions when con- narratives, and the passage of time Educational Objectives/ fronting challenges like peer pres- through the simple use of body and Responding to Show sure, moral confusion, dangerous s p a c e . drugs and coercive advertising. The educational goals of A c t i o n s Following is a an outline of a sample Trent Arterberry Speak Louder a r e : performance with a brief synopsis of During his 30 year career, Trent each piece. Arterberry has performed for thousands of 1. To introduce mime as an art audiences across North America, Europe f o r m . I n t r o d u c t i o n and Asia. He left pre-med studies at UCLA • What are some of the elements that —Uses mime technique and to study mime, eventually training with the the mime uses to communicate his monologue to illustrate the road renowned French master, Marcel s t o r i e s ? of life, and the many choices we Marceau. -

Marcel Marceau, This Book Shows How a Person's Dreams and Bravery Can Be Used for the Greater Good of Humanity During a Time Overrun by Fear
eSource Resources for Teachers and Students © KAR-BEN Publishing, a division of Lerner Publishing Group HC: 978-0-7613-3961-8 This guide may be downloaded for free at www.karben.com. PB:978-0-7613-3962-5 This guide may be used expressly for educational eB: 978-0-7613-7969-0 purposes only, and cannot be sold. Ages 7-11 | Grades 2-5 Please send questions or inquiries to [email protected]. To purchase the book, call 1-800-4KARBEN 241 1st Avenue North, Minneapolis, MN 55401 or visit www.karben.com. Why Teach About the Holocaust? The Holocaust was the systematic and deliberate murder of groups, primarily Jews, disliked by the Nazis in Europe between the years 1933-1945. Hitler and his followers convinced Germany and its allies that the murder of innocent people was necessary to create a New World Order. The study of the Holocaust provides one of the most effective tools to discuss prejudice and cultivate appreciation of diversity. A structured study of the Holocaust provides lessons for an investigation of basic morals and human behavior. Within classroom investigation of the Holocaust, students can realize that the Holocaust was personal, not just an historical event, and they can recognize the importance of democratic values and personal freedoms, as well as the responsibilities of citizenship in the world. How to Use This Guide As younger students learn about the Holocaust, it can be difficult for them to understand the danger and how a person's dreams are used during tragedy. Using the life of Marcel Marceau, this book shows how a person's dreams and bravery can be used for the greater good of humanity during a time overrun by fear. -

Dr. Ed's Movie Reviews 2020
Dr. Ed’s Movie Reviews 2020 Yardeni Research, Inc. Dr. Edward Yardeni 516-972-7683 [email protected] Please visit our sites at www.yardeni.com blog.yardeni.com thinking outside the box “1917” (+ +) received the Best Picture award during the Golden Globe Awards held on 1/5/20. It was well deserved. Directed, co-written, and produced by Sam Mendes, the film is about two young British soldiers during World War I who were ordered to deliver a message deep in enemy territory to save 1,600 of their compatriots from an ambush by German forces. The acting is excellent, and the cinematography is outstanding, with very long camera shots creating the impression of one continuous take. The depiction of war’s horrors was also exceptional. Even more exceptional was the 2018 documentary “They Shall Not Grow Old,” directed and produced by Peter Jackson. That film was created using original WWI footage that had been digitally restored. The agony of war, particularly trench warfare, was remarkably graphic. “Away” (+) is a binge-able Netflix series about an American astronaut, played by Hilary Swank, embarking on a dangerous mission to Mars as commander of an international space crew with representatives from China, India, Russia, and Ghana. The first season spends more time on the emotional toll of being away from family and loved ones on a three-year roundtrip to the Red Planet than on the actual journey, which obviously doesn’t go so smoothly with plenty of technical and interpersonal problems along the way there. So it’s a touchy-feely Mars movie. -

Date for Cinema Release of RÉSISTANCE – WIDERSTAND
PANTALEON Films GmbH: Successful completion of the shooting of GENERATION BEZIEHUNGSUNFÄHIG – Date for cinema release of RÉSISTANCE – WIDERSTAND Munich, July 10, 2020. PANTALEON Films, a wholly-owned film production subsidiary of PANTAFLIX AG (GSIN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7), announces the successful completion of the film shooting for the bestselling film version of GENERATION BEZIEHUNGSUNFÄHIG. Due to the restrictions by the health authorities to contain the coronavirus pandemic, the shooting had been paused between March and June. Now the time has finally come, and in compliance with the highest hygiene standards to protect all employees, the team of director Helena Hufnagel successfully completed the feature film project in co-production with Warner Bros. Entertainment and Brainpool TV. The author Hilly Martinek (HONIG IM KOPF, ROCCA VERÄNDERT DIE WELT) and Helena Hufnagel were responsible for the script of GENERATION BEZIEHUNGSUNFÄHIG. The successful non-fiction book with the same name, published by Edel Verlag, was written by Michael Nast. The focus is on Micha and Ghost, two city dwellers who are unwilling to be tied down, with Frederick Lau (DAS PERFEKTE GEHEIMNIS, NIGHTLIFE, 4 BLOCKS, VICTORIA) and Luise Heyer (DER JUNGE MUSS MUSS AN DIE FRISCHE LUFT, DAS SCHÖNSTE PAAR, EINMAL BITTE ALL). In addition, the cast includes Henriette Confurius (GOLDEN TWENTIES, THE COLD HEART), Maximilian Brückner (WONDERFUL, HINDAFING, THE BEST PAIR), Verena Altenberger (MAGDA MAKES THE GREATEST OF ALL WORLDS) and Tedros Teclebrhan (BAD BANKS, SYSTEM SPRENGER). Short Description Like most singles of his generation, Micha has a "problem": he is apparently unable to have a relationship. But he just uses this status to justify his lifestyle. -

Le Mime Marcel MARCEAU
Le mime Marcel MARCEAU Né le 22 mars 1923 à Strasbourg, Marcel Mangel qui deviendra le mime Marceau, est le fils du boucher de la communauté polonaise Adath Israël. Il reconnaît "avoir beaucoup souffert lorsque Hitler a lancé l’anathème sur la juiverie mondiale" et se souvient aussi de la guerre d’Espagne : "à treize ans, j’ai écrit, de ma main d’écolier, sur la guerre civile espagnole. Je la connaissais par coeur." Bien entendu, du côté des républicains. Les années de guerre Lorsqu’il a quinze ans, Strasbourg est évacuée. La famille part se réfugier en Dordogne . Ses dons artistiques, pour la peinture notamment, le conduisent à s’inscrire à l’école des arts décoratifs de Limoges. En 1943, Marcel "entre dans la Résistance française. Faussaire de génie, il copiera et imitera des papiers d’identité pour que ses camarades entrés en résistance puissent circuler. Après la déportation de son père (qui mourra à Auschwitz), Marcel décide de rejoindre son frère "quelqu’un d’important pour la Résistance, qui a formé plus tard les FTP (Francs-tireurs partisans)". Sa tante tient une colonie de vacance ; il y réalise des spectacles de théâtre avec des enfants : "J’imitais Chaplin, qui était mon dieu". Il y monte aussi des contes taoïstes et chinois. Lorsque des rumeurs se propagent sur les prochaines opérations de débarquement, le lieu n’est plus jugé assez sûr, et on envoie Marcel se cacher dans une maison à Sèvres près de Paris. C'est ainsi qu'il peut suivre les cours de Charles Dullin, au Théâtre de la Cité ou Sarah- Bernhardt. -

Marcel Marceau -With SHAWN BRYAN
THE UNIVERSITY MUSICAL SOCIETY OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN Marcel Marceau -with SHAWN BRYAN FRIDAY EVENING, MARCH 12, 1982, AT 8:00 POWER CENTER FOR THE PERFORMING ARTS ANN ARBOR, MICHIGAN PROGRAM Mr. Marceau will select his program from the following repertoire: Style Pantomimes Walking Contrasts Walking Against the Wind The Maskmaker The Staircase The Seven Deadly Sins The Tight Rope Walker Youth, Maturity, Old Age, and Death The Public Garden The Tango Dancer The Bill Poster The Small Cafe The Kite The Dice Players The Sculptor The Four Seasons The Painter The Dream The Cage The Creation of the World The Bureaucrats The Trial The Hands The Angel Remembrances Abel and Cain The Side Show The Dress The Pickpocket's Nightmare The Tree The Amusement Park The Pawnbroker INTERMISSION Bip Pantomimes Bip in the Subway Bip as a Baby Sitter Bip Travels by Tram Bip as a Professor of Botany Bip as a Skater Bip and the Dynamite Bip hunts Butterflies Bip as a Tragedian Bip plays David and Goliath Bip as a Lion Tamer Bip at a Ballroom Bip, the Illusionist Bip commits Suicide Bip looks for a Job Bip as a Soldier Bip in the Modern and Future Life Bip at a Society Party Bip, King of Sports Bip as a Street Musician Bip at the Athletic Club Bip as a China Salesman Bip pays tribute to the Silent Screen Actors Bip as a Fireman Bip as a Tailor in Love Bip as a Great Artist Bip dreams he is Don Juan Bip has a Date Presentation of Cards by SHAWN BRYAN ____ Fifty-third Concert of the 103rd Season Special Concert About the Artists Born in Strasbourg, France, Marcel Marceau's interest in mime began at an early age when his imagination was fired by such silent screen artists as Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harry Langdon, Stan Laurel, and Oliver Hardy, all of whom inspired him to pursue the art of silence as a profession. -

CHAPTER 14: Mime, Pantomime, and Clowning ■ 269 Two Arts, Let’S Use Marcel Marceau, the Well-Known French Mime
4 Special Topics in Theatre CHAPTER 14 ◆ Mime, Pantomime, and Clowning 268 CHAPTER 15 ◆ Interpreting Literature 286 CHAPTER 16 ◆ Storytelling 315 CHAPTER 17 ◆ Readers Theatre and Radio Theatre 329 CHAPTER 18 ◆ Puppetry, Shadow Play, and Masks 345 266 ■ ■ 267 Mime, Pantomime, 14 and Clowning LESSON 1 ◆ Mime and Pantomime 269 LESSON 2 ◆ Clowning 279 ◆ auguste clown ◆ mimesis ◆ character clown ◆ neat whiteface ◆ clowning ◆ pantomime ◆ grotesque ◆ pantomimus whiteface ◆ whiteface clown ◆ mime 268 ■ Unit 4: Special Topics in Theatre ■ antomime, mime, and clowning are closely related. They all express P dramatic ideas without words. All three arts require imagination, con- centration, observation, sensory awareness, and rhythmic and expres- sive movement—the personal resources you learned about in Chapter 3. In this chapter, we will explore the similarities and differences among mime, pantomime, and clowning, focusing on the techniques and impact of each art. Mime and Pantomime LESSON OBJECTIVES ◆ Define mime and pantomime. 1 ◆ Understand and identify similarities and differences between mime and pantomime. ◆ Research mimes and their art. ◆ Prepare and present pantomime exercises and activities. The words mime and pantomime are often used interchangeably. They are, however, two different arts. Even experts often disagree on their definitions, resulting in different interpretations of these two hile sitting at your desk, skills. Mime comes from the Greek word mimesis, meaning “to imitate W perform the following imaginary actions without talk- an activity.” Mime’s main activity is movement, and its content often ing: writing a letter; picking up deals with the complex meanings and forces of life. Pantomime comes a glass of cold water; drinking from the Latin word pantomimus, meaning “all gestures used in sup- a cup of hot chocolate; eating a port of a theme.” Pantomime revolves around character and plot, jumbo chocolate chip cookie in using imaginary props and people to tell a story. -

Marcel Marceau, Holocaust Hero By
From The Jewish Press www.jewishpress.com/sections/features/features-on-jewish-world/marcel-marceau-holocaust-hero Marcel Marceau, Holocaust Hero By Saul Jay Singer July 2, 2015 Marcel Marceau (1923-2007), recognized as “The World’s Greatest Mime,” performed professionally worldwide for over 60 with pantomime, which he referred to as the “art of silence.” His performances, which included such classic works as “The Cage,” “The Mask Maker,” “In The Park,” and “Walking Against the Wind” (which Michael Jackson imitated for what became his famous “moonwalk”), were universally recognized as works of sheer genius. Displayed here is a ticket to one of his Israel performances, on the back of which he signed his name and added the name of his signature character, “Bip,” complete with a drawing of Bip’s iconic red flower. Marceau first presented the chalk-faced Bip, whom he called “the dreamy little poet,” in 1947. Modeled after his movie hero, Charlie Chaplin’s Little Tramp, Bip was the classic underdog dressed in a striped shirt, white sailor pants, and a battered top hat with a single red flower sprouting from the lid. Marceau himself characterized Bip as his “alter ego,” a sad-faced twin, a modern everyman and free spirit whose eyes light up with childlike wonder as he discovers the world during his various misadventures. Marceau suggested a dark reason for his wordless art: “The people who came back from the [concentration] camps were never able to talk about it…. My name is Mangel. I am Jewish. Perhaps that, unconsciously, contributed towards my choice of silence.” Marceau was born in Strasbourg, France, as Marcel Mangel, son of a kosher butcher. -
Mime-Marceau.Pdf
LE POUI VVOIIR DUGGESTE Avec un hommage au Mime Marcel Marceau Salle de l’Aubette 31 Place Kléber, 67000 Strasbourg EXPOSITION du 1er au 26 mars 2017 du lundi au dimanche 11h00-19h00 Entrée gratuite www.unmuseepourlemime.com EXPOSITION Il n'y a pas que les espaces verts LE POUI VVOIIR Qu'il faut protéger... Les espaces vides aussi ! DUGGESTE Parce que vous avez des artistes, Les mimes en particulier, “Ils évoquent des figures... Ils tracent des lignes comme ça... Avec la révolution industrielle, un Dans l'espace... monde s’estompe, les notions de Et une fois que c'est terminé, temps, d’espace, de communication Ils saluent et ils sortent ! sont modifiées. Le mime moderne apparaît, interroge l’homme sur son Et ils laissent toutes ces formes rapport au corps, à l’autre et l’interpelle Fictives flotter dans l'atmosphère ! sur sa place dans la société. Raymond Devos Plusieurs personnalités illustrent ce re- nouveau qui influence toujours les courants artistiques des arts du mime et du geste aujourd’hui. Qui sont-ils ? Quels messages nous ont-ils laissés ? Comment les jeunes ” générations s’en emparent-elles ? Sommaire Et dans notre quotidien, comment utiliser le pouvoir du geste ? L’exposition : “Le pouvoir du geste” 3 Dans toute communication, trois Renseignements pratiques 4 éléments sont importants : La parole, son expression et la Parcours de l’exposition 5 gestuelle. La position du corps, l’utilisation des Documents inédits, pièces uniques. Iconographie 12 bras et des mains, l’orientation du re- gard…, sont les composantes d’un Le Mime Marcel Marceau et Strasbourg 14 langage efficace pour mieux se faire comprendre. -

“It Felt Better to Stay Quiet” Miming As a Non-Verbal Way of Coping with Trauma in Kathy Kacer’S Masters of Silence (2019)
Mateusz Świetlicki “It felt better to stay quiet” Miming as a Non-Verbal Way of Coping with Trauma in Kathy Kacer’s Masters of Silence (2019) Abstract: This article analyzes Kathy Kacer’s Masters of Silence (2019), a novel about Marcel Marceau – the renowned mime artist who during the war cooperated with the French Resistance – and two fictional Jewish siblings struggling with the trauma of losing their parents, anti-Semitism, and the suppression of identity in a Catholic convent in southern France. The author examines the narrative techniques used by Kacer, including the combination of fiction with history and some elements of the biography of Marceau, and demonstrates that she not only shares the next-generation memory of World War II with her young readers but also depicts non- verbal ways of coping with trauma as potentially effective and empowering. Whereas Kacer’s indifference to historical dates may be connected to her determination to portray Marceau as an adolescent role model, the novel is a successful narrative about trauma and the Holocaust history, and the depiction of Marceau’s acts of resistance does not overshadow the young protagonists who do not just quiver and follow the instructions of the adults but mainly try to gain agency. Keywords: Holocaust, World War II, trauma studies, affect, Canadi- an literature, children’s literature of atrocity ©2020 M Świetlicki. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/ licenses/by-nc/3.0/), permitting all non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. -

University Musical Society Marcel Marceau
UNIVERSITY MUSICAL SOCIETY MARCEL MARCEAU with Blanca Del Barrio and Bogdan Nowak Friday Evening, October 30, 1992, at 7:00 Power Center, Ann Arbor, Michigan PROGRAM Program to be selected from: Style Pantomimes Walking The Dream Walking Against the Wind The Creation of the World The Staircase The Trial The Tight Rope Walker A Sunday Walk The Public Garden Abel and Cain The Bill Poster The Deadly Smile The Kite The Dress The Sculptor The Pawnbroker The Painter The Angel The Cage The Tree The Bureaucrats Pygmalion The Hands The Tragic Actor on an Opening Night Remembrances The Bird Keeper The Side Show At the Clothier's The Pickpocket's Nightmare Lunapark The Amusement Park The Magician The Automat's Revolt Optical Illusion The Fisherman Tug of War The Chrlatan The Samurai's Sword Contrasts The Tempest The Maskmaker The Eater of Hearts The Seven Deadly Sins The Mirror Youth, Maturity, Old Age and Death Fight with Darkness The Tango Dancer Duel in the Dark The Small Cafe Obsession The Dice Players 1500 M Race The Four Seasons INTERMISSION Bip Pantomimes Bip in the Subway Bip and the Dynamite Bip Travels by Train Bip as a Lion Tamer Bip Travels by Sea Bip, the Illusionist Bip as a Skater Bip Looks for a Job Bip Hunts Butterflies Bip in the Modern and Future Life Bip Plays David and Goliath Bip at the Athletic Club Bip at a Ballroom Bip as a Tailor in Love Bip Commits Suicide Bip Dreams he is Don Juan Bip as a Soldier Bip and the Matrimonial Agency Bip at a Society Party Bip with a Traveling Circus Bip as a Street Musician Bip as a Children's Nurse Bip as a China Salesman Bip in High Society Bip as a Fireman Bip as an African Hunter Bip as a Great Artist Bip Looks for an Audition Bip has a Date Bip as a Museum Keeper Bip as a Baby Sitter Bip as a jeweler's Apprentice Bip as a Professor of Botany Bip Plays Faust Bip as a Matador Marcel Marceau is presented in association with Wil-Mar Productions Inc.