Les Licences Creative Commons: Libre Choix Ou Choix Du Libre?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
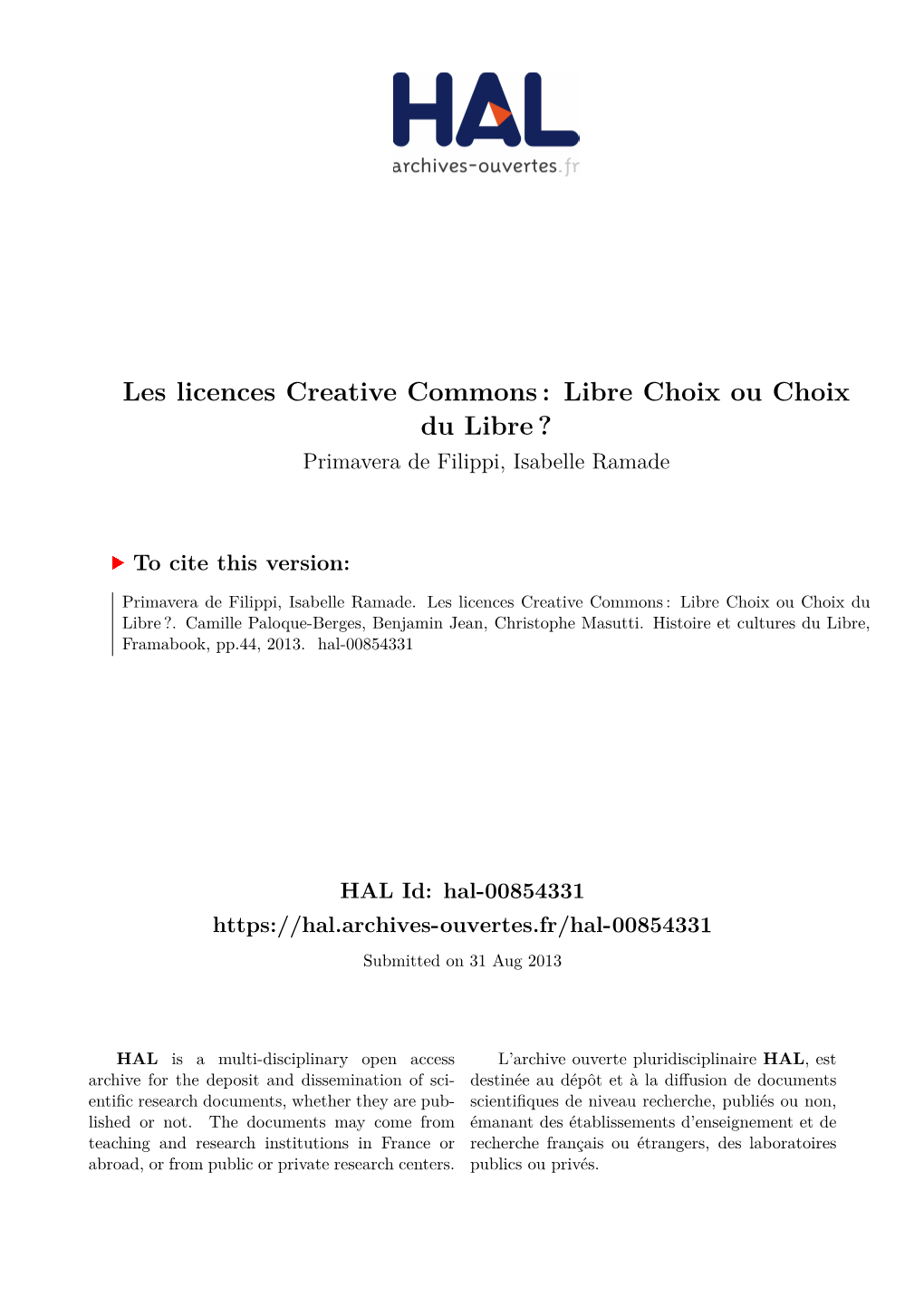
Load more
Recommended publications
-

5.Sustainability
P2Pvalue More than 95% of the cases surveyed use centralized servers to store the users’ data. Over the whole population of cases this would be lower, as less than 88% has a centralized architecture allowing for central storage. Index infrastructure provision On a scale of 1 to 9, half of the cases have less than 3, and 84.1% of the cases are at the intermediate level of the index (between 4 and 5). None of the cases are at the highest range of the index. 5.Sustainability Regarding the question of profitability versus non profitability character of infrastructure provision, what results from the data on the legal type of infrastructure provision (see table above as part of infrastructure provision section) is that non-profit organizations make up the majority of cases (57%), something that makes sense with the voluntary dimension of the majority of CBPP experiences. Nevertheless, we consider it important to highlight that 28.9% of the cases are for profit organizations, something that is closely related to the diffusion of hybrid cases in CBPP. The data on the type of organization connected to the case (see table at section infrastructure provider) notes that 25.1% of the cases are businesses, which is the second type of most common organization. What we highlight about this data concerning the main strategies to achieve economic sustainability is the high level of importance that is given to the non- monetary contributions. For instance, 51% of respondents assign a value of 10 to non-monetary contributions. Instead, when we analyze all the other strategies of sustainability, the median is very low. -

From Material Scarcity to Arti8cial Abundance – the Case of Fablabs and 3D Printing Technologies Primavera De Filippi, Peter Troxler
From material scarcity to arti8cial abundance – The case of FabLabs and 3D printing technologies Primavera de Filippi, Peter Troxler To cite this version: Primavera de Filippi, Peter Troxler. From material scarcity to arti8cial abundance – The case of FabLabs and 3D printing technologies. van den Berg B. & van der Hof S. 3D Printing : Legal, philosophical and economic dimensions., T.M.C. Asser Instituut pp. 65-83, 2015. hal-01265229 HAL Id: hal-01265229 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01265229 Submitted on 31 Jan 2016 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Primavera De Filippi & Peter Troxler [4] From material scarcity to arti8cial abundance – The case of FabLabs and 3D printing technologies Primavera De Filippi & Peter Troxler 1. Introduction Digital media allowed for the emergence of new artistic practices and innovative modes of production. In particular, the advent of Internet and digital technologies drastically enhanced the ability for multiple au- thors to collaborate towards the creation of large-scale collaborative works, which stand in contrast to the traditional understanding that artistic production is essentially an individual activity. The signi6cance of these practices in the physical world is illustrated by the recent deployment of FabLabs (Fabrication Laboratories), that employ innovative technologies – such as, most notably, 3D printing, which is recently gaining the most interest – to encourage the development of new methods of artistic production based on participation and interaction between peers. -

De Filippi & Tréguer
May 2014 Expanding the Internet Commons : The Subversive Potential of Wireless Community Networks by Primavera De Filippi1 and Félix Tréguer2 “Freedom is fostered when the means of communication are dispersed, decentralized, and easily available, as are printing presses and microcomputers. Central control is more likely when the means of communication are concentrated, monopolized, and scarce, as are great networks,” wrote professor Ithiel de Sola Pool (1984), an American political scientist and legal analyst of communications technologies. Beyond highlighting historical and technical trends in technology, Sola Pool also understood that there was nothing deterministic about how technologies evolve. While control over printing presses and microcomputers can, as it turns out, be highly centralized, the deployment and management of telecommunication networks can, eventually, undergo a process of decentralization. The outcome ultimately depends on political, technical, economic, institutional and legal arrangements shaping both the development of communications tools and their use. Often, when it comes to politics – and Internet policy is obviously no exception – the antagonism between freedom and control essentially comes down to the trade-off between centralization or decentralization. In the past year, the ongoing controversy regarding the massive surveillance undertaken by the US National Security Agency (NSA) and its allied organizations has encouraged a growing number of technology activists to deploy decentralized and free software3 alternatives to the centralized online services known to collaborate with the NSA. This trend can be likened to what happened repeatedly in the history of the Internet. The rise of the personal computer and the widespread adoption of the Internet network came out of a need to democratize computing technologies by taking them out of the hands of technocracy – decentralizing both the use of computers and the control of communication technologies. -

On the Supremacy of the User Interface Over Copyright Law
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics De Filippi, Primavera Article Law of the cloud: on the supremacy of the user interface over copyright law Internet Policy Review Provided in Cooperation with: Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society (HIIG), Berlin Suggested Citation: De Filippi, Primavera (2013) : Law of the cloud: on the supremacy of the user interface over copyright law, Internet Policy Review, ISSN 2197-6775, Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society, Berlin, Vol. 2, Iss. 3, pp. 1-8, http://dx.doi.org/10.14763/2013.3.175 This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/213968 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. -

Blockchain Technology As a Regulatory Technology from Code Is Law to Law Is Code
Blockchain Technology as a Regulatory Technology From Code is Law to Law is Code Primavera De Filippi1 & Samer Hassan2 1CERSA/CNRS & Berkman Center for Internet and Society, Harvard University 2Universidad Complutense de Madrid & Berkman Center for Internet and Society, Harvard University Abstract: “Code is law” refers to the idea that, with the advent of digital technology, code has progressively established itself as the predominant way to regulate the behavior of Internet users. Yet, while computer code can enforce rules more efficiently than legal code, it also comes with a series of limitations, mostly because it is difficult to transpose the ambiguity and flexibility of legal rules into a formalized language which can be interpreted by a machine. With the advent of blockchain technology and associated smart contracts, code is assuming an even stronger role in regulating people’s interactions over the Internet, as many contractual transactions get transposed into smart contract code. In this paper, we describe the shift from the traditional notion of “code is law” (i.e. code having the effect of law) to the new conception of “law is code” (i.e. law being defined as code). Introduction There are various ways in which law and technology can influence each other. The two interact through a complex system of dependencies and interdependencies, as both contribute (to a greater or lesser extent) to regulate the behavior of individuals. With the advent of modern information and communication technology, the relationship between the two has significantly evolved, as the latter is increasingly used as a complement or a supplement to the former. -

Analysing the Interplay Between Open Data and Sui-Generis Rights on Databases Primavera De Filippi, Lionel Maurel
The paradoxes of open data and how to get rid of it? Analysing the interplay between open data and sui-generis rights on databases Primavera de Filippi, Lionel Maurel To cite this version: Primavera de Filippi, Lionel Maurel. The paradoxes of open data and how to get rid of it? Analysing the interplay between open data and sui-generis rights on databases. Columbia Science & Technology Law Review, 2015, 23 (1), pp.1-22. 10.1093/ijlit/eau008. hal-01265200 HAL Id: hal-01265200 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01265200 Submitted on 2 Feb 2016 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. International Journal of Law and Information Technology, 2015, 23, 1–22 doi: 10.1093/ijlit/eau008 Advance Access Publication Date: 16 October 2014 Article The paradoxes of open data and how to get rid of it? Analysing the interplay between open data and sui-generis rights on databases Primavera De Filippi* and Lionel Maurel† ABSTRACT Open Data is an important public policy that contributes to achieving greater transpar- Downloaded from ency and broader access to information, more citizen participation and engagement, while also supporting innovation and economic growth. -

Blockchain Control
Law Critique (2018) 29:133–140 https://doi.org/10.1007/s10978-018-9227-x Blockchain Control Jannice Käll1 Published online: 30 May 2018 © The Author(s) 2018 Abstract Blockchain technology is often discussed and theorized in relation to cryptocurrencies such as Bitcoin. Its quality as a technology that produces advanced encryption keys between objects, however, also makes it interesting to those who seek to connect physical objects to digital elements. The reason for this is that the link between objects needs to be ‘secure’ from undesired external interference. In relation to such interests, blockchain has been identifed as a highly attractive tech- nology to support the general digitalization of society towards the Internet of Things, smart cities etc. In extension, the implementation of blockchain technology implies that it may work as a tool that has the capacity to direct which objects may/may not interact with each other. The ‘ledger of everything’ that blockchain may possibly produce as regards the ‘Internet of Everything’ is even suggested to make humans and other intermediary technologies redundant. In this essay, I argue that in order to sustain legal critique when the world moves into the next era of digitalization, we need to understand - and question - how technological control operates through e.g. blockchain technology by locking physical and digital elements to each other. Keywords Blockchain · Control · Internet of things · New materialisms · Property * Jannice Käll [email protected] 1 School of Business, Engineering and Science, Halmstad University, Box 823, 301 18 Halmstad, Sweden 1 3 134 J. Käll Introduction We have moved from the bio-power that Foucault exemplifed by compara- tive anatomy to a society based on the governance of molecular zoe power of today. -
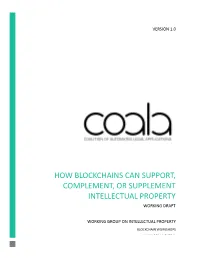
How Blockchains Can Support, Complement, Or Supplement Intellectual Property Working Draft
VERSION 1.0 HOW BLOCKCHAINS CAN SUPPORT, COMPLEMENT, OR SUPPLEMENT INTELLECTUAL PROPERTY WORKING DRAFT WORKING GROUP ON INTELLECTUAL PROPERTY BLOCKCHAIN WORKSHOPS WWW.COALA.GLOBAL WORKING DRAFT HOW BLOCKCHAINS CAN SUPPORT, COMPLEMENT, OR SUPPLEMENT INTELLECTUAL PROPERTY This document is a collaborative effort stemming from the contributions of: - Primavera De Filippi, CNRS / Berkman Center for Internet & Society at Harvard - Greg McMullen, ascribe - Trent McConaghy, ascribe - Constance Choi, Seven Advisory/COALA - Simon de la Rouviere, Consensys - Juan Benet, IPFS / Protocol Labs - Diana J. Stern, Distribu7ve 1. INTRODUCTION We live in a knowledge economy: a world where value creation is shifting away from moving atoms around, to moving bits around. The value represented by the bits is in ideas, which by nature are intangible. Intellectual property (IP) is a set of legal tools by which creators, connectors, and collectors may manage rights to ideas by claiming those rights, and transferring or assigning rights to access, publish, distribute, use, or build upon the ideas. INTELLECTUAL PROPERTY LAW IP law comes in three main flavors: copyright, patent, and trademark, each with its own limits that define what is eligible for protection and the strength of that protection. Copyright is perhaps the best known, and generally refers to original works by an “author”. These authored works include not only wring but nearly all other creative works, such as photography, filmmaking, painSng, music, soUware source code, and in some circumstances, eVen the contents of databases. Patents coVer useful inventions. Trademarks protect business branding in names, logos, slogans, and eVen jingles or sounds. The World Intellectual Property Office (WIPO) provides guidelines for IP through interpretation and management of international treaties, and individual countries implement these guidelines a variety of naonal laws. -

Introducing the Glossary of Decentralised Technosocial Systems
Volume 10 Issue| 2 Introducing the glossary of decentralised technosocial systems Valeria Ferrari University of Amsterdam [email protected] DOI: https://doi.org/10.14763/2021.2.1546 Published: 19 April 2021 Received: 19 April 2021 Competing Interests: The author has declared that no competing interests exist that have influenced the text. Licence: This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 License (Germany) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/deed.en Copyright remains with the author(s). Citation: Ferrari, V. (2021). Introducing the glossary of decentralised technosocial systems. Internet Policy Review, 10(2). https://doi.org/10.14763/2021.2.1546 Keywords: Peer-to-peer (P2P), User-centric technology, Privacy enhancing technologies, Decentralised technology, Distributed technology, Sovereign technology Abstract: Interdisciplinary glossary on peer-to-peer, user-centric and privacy-enhancing decentralised technologies 2 Internet Policy Review 10(2) | 2021 FIRST GLOSSARY ENTRIES IN THIS SECTION arrow_downward EDITORIAL: Introducing the glossary of decentralised technosocial systems Valeria Ferrari, University of Amsterdam Reputation Primavera De Filippi, CNRS Ori Shimony, dOrg Antonio Tenorio-Fornés, Universidad Complutense de Madrid Digital scarcity Jaya Klara Brekke, Durham University Aron Fischer, Colony Smart contracts Primavera De Filippi, CNRS Chris -

Blockchain, Or, Peer Production Without Guarantees
This is the author’s version of a chapter accepted for publication in the Handbook of Peer Production. Changes resulting from the publishing process such as copy-editing, typesetting, and other quality control mechanisms may not be reflected in this document. This author manuscript version is available for personal, non-commercial and no derivative uses only. Citation: González, P. V. & Tkacz, N. (2021). Blockchain, or, peer production without guarantees. In: M. O’Neil, C. Pentzold & S. Toupin (Eds.), The Handbook of Peer Production (pp. 238-253). Malden, MA: Wiley-Blackwell. ISBN 9781119537106 Available at: https://www.wiley.com/en-au/The+Handbook+of+Peer+Production-p-9781119537090 The Handbook of Peer Production Chapter 18 – Blockchain, or, Peer Production Without Guarantees Pablo Velasco González, University of Aarhus, Denmark & Nathaniel Tkacz, University of Warwick, UK Chapter 18 – Blockchain 2 1. Introduction Blockchains are aggregated and distributed databases: shared, chained, and immutable registries that conflate the production of digital tokens with their circulation. At their most basic level, they are technologies for keeping account, or records, of some form of activity, hence they are part of a long lineage of storing data, from clay tablets to bookkeeping. Perhaps their most significant quality is that they enable the distribution and storage of digital data, such as records of transactions, contracts or other statements, that are independent (or resilient) from centralized points of control. Such resilience is achieved by distributing data among a network of peers who validate the flows of information and store them as sequential blocks: the longer the chain of blocks and the bigger the network of peers, the more secure the transmission of reliable data and the more difficult it is to tamper with. -

Decentralized Blockchain Technology and the Rise of Lex Cryptographia
DECENTRALIZED BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND THE RISE OF LEX CRYPTOGRAPHIA Aaron Wright* & Primavera De Filippi** Just as decentralization communication systems lead to the creation of the Internet, today a new technology—the blockchain—has the potential to decentralize the way we store data and manage information, potentially leading to a reduced role for one of the most important regulatory actors in our society: the middleman. Blockchain technology enables the creation of decentralized currencies, self-executing digital contracts (smart contracts) and intelligent assets that can be controlled over the Internet (smart property). The blockchain also enables the development of new governance systems with more democratic or participatory decision-making, and decentralized (autonomous) organizations that can operate over a network of computers without any human intervention. These applications have lead many to compare the blockchain to the Internet, with accompanying predictions that this technology will shift the balance of power away from centralized authorities in the field of communications, business, and even politics or law. In this Article, we explore the benefits and drawbacks of this emerging decentralized technology and argue that its widespread deployment will lead to expansion of a new subset of law, which we term Lex Cryptographia: rules administered through self-executing smart contracts and decentralized (autonomous) organizations. As blockchain technology becomes widely adopted, centralized authorities, such as governmental agencies and large multinational corporations, could lose the ability to control and shape the activities of disparate people through existing means. As a result, there will be an increasing need to focus on how to regulate blockchain technology and how to shape the creation and deployment of these emerging decentralized organizations in ways that have yet to be explored under current legal theory. -
Luca Belli Primavera De Filippi Editors
Luca Belli Primavera De Filippi Editors Net Neutrality Compendium Human Rights, Free Competition and the Future of the Internet Preface by Vinton G. Cerf Postface by Louis Pouzin Net Neutrality Compendium Luca Belli • Primavera De Filippi Editors Net Neutrality Compendium Human Rights, Free Competition and the Future of the Internet Editors Luca Belli Primavera De Filippi Center for Technology & Society e-Gouv Fundação Getúlio Vargas CERSA / CNRS / Université Paris II Rio de Janeiro , Rio de Janeiro , Brazil Paris , France ISBN 978-3-319-26424-0 ISBN 978-3-319-26425-7 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-26425-7 Library of Congress Control Number: 2015953442 Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London © Springer International Publishing Switzerland 2016 This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifi cally the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfi lms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. The use of general descriptive names, registered names, trademarks, service marks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of a specifi c statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and therefore free for general use. The publisher, the authors and the editors are safe to assume that the advice and information in this book are believed to be true and accurate at the date of publication.