Plan National D'actions 2021
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Verdon Gorge Is Technical, Spicy and Run Out, So Why Is This Forgotten Climbing Style Now Becoming So Popular? by Whitney Boland • Photos by Keith Ladzinski
age OF Reason THE VERDON GORGE IS TECHNICAL, SPICY AND RUN OUT, SO WHY IS THIS FORGOttEN CLIMBING STYLE NOW BECOMING SO POPULAR? By Whitney Boland • Photos by Keith Ladzinski The view from the top of the Grand eycharme, a sector in the lower part of the Verdon Gorge. esus, Sam, just hang the draw,” I said. We were 1,000 feet above the twisting river of the Verdon Gorge, on a seldom-climbed but flawless route named Graphique (8a/5.13b). Sam was in the crux, hovering just above a hard-to-clip bolt that he had skipped, and 15 feet above his last draw. I wondered how best to catch what appeared to be an inevitable whipper on this “slab,” which, to sport climbers like us, meant any- thing less than 15-degrees overhanging. Graphique was dead vertical with shallow pockets and small crimps like sharpened meat cleavers. JSam reached far right and stepped his runout. Sam and I had come all the way but 100 difficult, runout ones. A drum lay; he untied his knot and pulled the left foot up. His shoulders tightened, and from Colorado to visit this sport-climb- roll of thunder played in the distance. rope. Sam climbed back up to the crux, I knew he was gripped. Grazing the edge ing museum, to experience an area How would we get out? Sam, howev- though this time he clipped the draw. of a tiny hold, he belted out, “Grawwww- where the climbing we love had begun. er, was only concerned with his failed We got to the top that day, though www!” and sailed off into the air. -
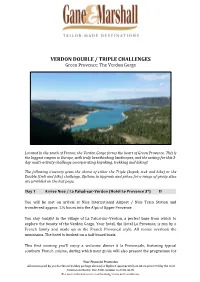
Verdon Double and Triple Challenge
VERDON DOUBLE / TRIPLE CHALLENGES Green Provence: The Verdon Gorge Located in the south of France, the Verdon Gorge forms the heart of Green Provence. This is the biggest canyon in Europe, with truly breathtaking landscapes, and the setting for this 3- day multi-activity challenge incorporating kayaking, trekking and biking! The following itinerary gives the choice of either the Triple (kayak, trek and bike) or the Double (trek and bike) challenge. Options to upgrade and prices for a range of group sizes are provided on the last page. Day 1 Arrive Nice / La Palud-sur-Verdon (Hotel Le Provence 3*) D You will be met on arrival at Nice International Airport / Nice Train Station and transferred approx. 2½ hours into the Alps of Upper Provence. You stay tonight in the village of La Palud-sur-Verdon, a perfect base from which to explore the beauty of the Verdon Gorge. Your hotel, the Hotel Le Provence, is run by a French family and made up in the French Provençal style. All rooms overlook the mountains. The hotel is booked on a half-board basis. This first evening you’ll enjoy a welcome dinner à la Provençale, featuring typical southern French cuisine, during which your guide will also present the programme for Your Financial Protection All monies paid by you for the air holiday package shown [or flights if appropriate] are ATOL protected by the Civil Aviation Authority. Our ATOL number is ATOL 3145. For more information see our booking terms and conditions. the following day. This a good chance to ask any questions you may have about the activities, preparation, kit, etc. -

IAPT/IOPB Chromosome Data 22 TAXON 65 (5) • October 2016: 1200–1207
Marhold & Kučera (eds.) • IAPT/IOPB chromosome data 22 TAXON 65 (5) • October 2016: 1200–1207 IOPB COLUMN Edited by Karol Marhold & Ilse Breitwieser IAPT/IOPB chromosome data 22 Edited by Karol Marhold & Jaromír Kučera DOI http://dx.doi.org/10.12705/655.40 Tatyana V. An’kova,1* Maria N. Lomonosova1 & BORAGINACEAE Victor V. Chepinoga2,3 Lappula anisacantha (Turcz. ex Bunge) Gürke, 2n = 12; Russia, Sakha (Yakutia) Republic, ML & EN 879 (NS). 1 Central Siberian Botanical Garden SB RAS, Zolotodolinskaya Str. 101, 630090 Novosibirsk, Russia CAPRIFOLIACEAE 2 The V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Ulan- Patrinia rupestris (Pall.) Dufr., 2n = 22; Russia, Sakha (Yakutia) Batorskaya Str. 1, 664033 Irkutsk, Russia Republic, ML & EN 849b (NS). 3 Irkutsk State University, Karl Marx Str. 1, 664003 Irkutsk, Russia GENTIANACEAE * Author for correspondence: [email protected] Halenia corniculata (L.) Cornaz, 2n = 22; Russia, Republic of Buryatia, E. Zolotovskaya & E. Gladkikh C168 (IRKU). All materials CHN; collectors: EN = E.G. Nikolin, ML = M.N. Lomonosova. GERANIACEAE Geranium sibiricum L., 2n = 28; Russia, Sakha (Yakutia) Republic, The reported study was partially supported by Russian Founda- ML & EN 858 (NS). tion for Basic Research (RFBR), project no. 16-05-00783. PLANTAGINACEAE ALLIACEAE Linaria acutiloba Fisch. ex Rchb., 2n = 12; Russia, Krasnoyarskii Allium ramosum L., 2n = 32; Russia, Sakha (Yakutia) Republic, ML Krai, ML 1141h (NS). & EN 831a (NS). Linaria genistifolia (L.) Mill., 2n = 12; Russia, Samarskaya Oblast’, Allium splendens Willd. ex Schult. & Schult.f., 2n = 16; Russia, Sakha ML 1068 (NS). (Yakutia) Republic, ML & EN 798 (NS). Plantago canescens Adams, 2n = 12; Russia, Sakha (Yakutia) Repub- lic, ML & EN 798 (NS). -

Detailed Trip File
One Foot Abroad Second Floor, 16/17 Suffolk Street SELF-GUIDED DeDublin 2,tIrealandiled trip file DEEPEST CANYON IN EUROPE (700 M) UK: +44 (0)20 3411 0701 FAMOUS HIKE IN THE CANYON Ireland: +353 (0)1 687 2141 TURQUOISE GREEN WATER USA: +1 916 287 8651 REGIONAL NATURAL PARK France: +33 (0)1 82 88 31 76 [email protected] O Summary A Magnificent and wild landscape characterised by its preserved nature and turquoise waters. Les Gorges du Verdon, also called "Le Grand Canyon du Verdon" or Verdon Canyon, define the border between the département Var and Alpes de Haute Provence. The Verdon River carved a deep canyon into the limestone cliffs here for about 21 km. It is much smaller than the Grand Canyon but it's Europe's deepest. This is a nature conservation area, the Parc Naturel Regional du Verdon. The Parc Naturel Régional du Verdon was inaugurated in 1997 finally recognising and officially protecting the special nature of the region. Les Gorges du Verdon is not only an exceptional natural site, we find a lot of beautiful typical villages through the Verdon River. Villages and towns of character such as Riez-la-Romaine, Moustiers-Sainte-Marie, Castellane, Entrevaux or Annot ( the villages ranked as "villages et cités de caractère") unfold on the hills covered with oaks, vineyards and orchards. La Palud sur Verdon is heaven on heart for climbers from all over the world, Castellane is an exceptional site, overlooked by Notre- Dame-du-Roc or Entrevaux, a medival town, has kept its ramparts and its citadel built by Vaudan. -

Saint-Raphaël
Saint-Raphaël Tourist guide 2012 Tourist and congress office **** www.saint-raphael.com Estérel • Côte d’azur TOURIST AND CONGRESS OFFICE**** ACCESS 99 quai Albert 1er - BP 210 By car : From the A8 motorway take exit n° 38 “Fréjus/Saint-Raphaël”, 83702 Saint-Raphaël Cedex direction Saint-Raphaël. Traffic Information by Bison Futé : 08 26 022 022 Tel. + 33 (0)4 94 19 52 52 . Fax. + 33 (0)4 94 83 85 40 [email protected] By train : Twenty trains (TGV) daily linking Paris and Saint-Raphaël www.saint-raphael.com (summer only). Journey takes 4 hours and 45 minutes. For journeys throughout the region: Fréjus, Boulouris, Le Dramont, Agay, Opening times : Anthéor and Le Trayas are linked by a frequent service to Nice, Monaco, Monday to Saturday 9am to 12.30pm and 2pm to 6.30pm Vintimille, Toulon, Marseille, Aix-en-Provence, Avignon, Gap and Briançon. Sundays and bank holidays: opening times according to season July and August: Monday to Saturday 9am to 7pm and Sunday 9.30am to 12.30pm and 2.30pm to 6.30pm For information on train services in the PACA region (times, prices and special offers) : www.ter-sncf/paca • Internet Access point Contact TER : 0 800 11 4023 (free from landlines) By plane : • Nice Côte d’Azur international airport. Tel. 0820 423 333 facebook.com/saintraphael.tourisme twitter.com/StRaphael_Var • Marseille airport. Tel. 0442 141 414 • Toulon/Hyères airport. Tel. 0825 018 387 The Tourist Office of Saint-Raphaël is an official “Tourisme & Handicap” centre and caters for the physically disabled and those with learning By bus : difficulties. -

Provence Discovery Tour
Provence Discovery Tour Destinations: France & Mediterranean Trip code: PVLEL HOLIDAY OVERVIEW With its rolling landscapes, pretty hilltop towns and fields of lavender and sunflowers, Provence has long provided inspiration to many artists including Van Gogh, Matisse and Cezanne. This discovery tour gets to the heart of this beguiling region with guided visits to some of the area’s most attractive towns and villages plus its most dominant natural feature – the plunging Verdon Gorge. In the spring the almond trees blossom, creating a wonderful scent in the air while in the summer months, many of the fields turn purple as the lavender blooms. Whatever the time of year, Provence delights with its historic, picturesque buildings and appealing landscapes. WHAT'S INCLUDED • Half Board en-suite accommodation • The services of an experienced HF Holidays leader • Full day excursions with all essential transport in resort • ‘With flight’ holidays include return flights from the UK and hotel transfers HOLIDAYS HIGHLIGHTS • Immerse yourself in the landscape of Matisse, Cezanne and Van Gough • Explore the traditional hilltop towns of Forcalquier www.hfholidays.co.uk PAGE 1 [email protected] Tel: +44(0) 20 3974 8865 • Enjoy the Lavender Route and the Verdon Gorge • Visit the elevated town of Les Baux de Provence for sweeping views across the landscape TRIP SUITABILITY Discovery holidays involve active sightseeing and you should expect to spend lots of time on your feet. Optional short walks of approximately 2½ miles allow you to stretch your legs and see the best of the local scenery. ITINERARY Day 1: Arrival Day Welcome to Hotel Villa Borghese. -

Ocean•Earth•Humanity
MAGAZINE IMPACT IMPACT MAGAZINE OCEAN • EARTH • HUMANITY FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO PRINCE ALBERT FONDATION PRIX DE LA PHOTOGRAPHIE ENVIRONNEMENTALE HOMME - FAUNE SAUVAGE DESTINS CROISÉS, TERRITOIRES PARTAGÉS Kathleen Ricker Gorilla by the water n°2 IMPACT IMPACT La lenteur des négociations climatiques et l’impossibilité The slow pace of the climate negotiations and the d’arriver à un consensus international rendent encore impossibility of reaching a global consensus make local plus importantes les actions locales, l’engagement des initiatives, the commitment of businesses and the work entreprises et le travail des ONG. J’avais misé autrefois of NGOs even more important. I used to favour a top- sur un processus top-down et vois aujourd’hui la valeur down process but now see the value of the bottom-up du bottom-up. Dans ce cadre-là, des organisations approach. In this context, organisations like ours, the comme les nôtres, Fondation Prince Albert II de Prince Albert II of Monaco Foundation and the Solar Monaco ou Fondation Solar Impulse, prennent encore Impulse Foundation, take on even greater importance. plus d’importance. We now need to demonstrate that environmental Nous devons maintenant démontrer que la protection de protection, far from driving a wedge between l’environnement, loin de cliver écologistes et industriels, environmentalists and industry, can bring them together peut les réunir dans un but commun tout en permettant behind a common goal while still allowing each to à chacun d’y trouver son intérêt. Et encourager les benefit. And we must encourage governments to play gouvernements à jouer leur rôle pour réconcilier their part in reconciling ecology and economics. -

Provence-Alpes-Côte D'azur Tourisme
WELCOME TO PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR La Grave La Meije rovence Alpes Côte d’Azur, three destinations with incredibly varied landscapes. Montgenèvre Serre-Chevalier ALPES P You can experience an exceptional region just 3 hours from Paris by train and Vallée Briançon 1 hour 10 minutes by plane. An invitation to a journey combining the sea, hills, lakes Puy-Saint-Vincent Briançon R 9 U and mountains, with breathtaking natural sites and outstanding monuments. fortress Z PROVENCE ’A D LES ÉCRINS LE QUEYRAS E T NATIONAL PARK REGIONAL Ô C NATURE PARK La Joue du Loup Orcières MEDITERRANEAN SEA Merlette Risoul Saint-Véran 1850 Vars L E Embrun R Super Dévoluy H O N Lake E 14 PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR Serre Ponçon Les Orres Gap 8 Boscodon Abbey LES BARONNIES Barcelonnette Le Sauze PROVENÇALES REGIONAL Pra Loup 13 Col de ITALY NATURE PARK la Bonette Valréas PARIS Val d’Allos 6 Vaison- 7 Sisteron Auron Isola 2000 la-Romaine Citadel A Y O Sisteron HAUTE-PROVENCE R LE MERCANTOUR A LYON NATURAL GEOLOGY RESERVE L ITALY Roman Theatre 5 Mont NATIONAL PARK 12 Vallée des 5 Ventoux Merveilles AVIGNON Orange of Orange Valberg AIX-EN-PROVENCE A7 A51 Digne-les-Bains NICE Les Mées TOULON-HYÈRES A9 MARSEILLE Carpentras 11 Cians SPAIN 6 Pénitents Gorge Forcalquier des Mées L’Isle-sur- 4 Sénanque Avignon la-Sorgue Abbey 4 The Ochre Moustiers- Range Sainte-Marie Castellane Pont du Gard 3 Palais PRÉALPES D'AZUR REGIONAL Gordes Manosque 50 km des Papes Roussillon NATURE PARK A8 Menton Cavaillon Verdon LUBERON REGIONAL 7 Saint-Rémy-de-Provence Gorge Vence 14 Place Monaco LES ALPILLES REGIONAL NATURE PARK Masséna Èze NATURE PARK Gréoux-les-Bains Grasse Roman heritageLE RHÔNE of Arles 2 Pertuis A51 VERDON REGIONAL Biot NICE in Saint-Rémy-de-Provence NATURE PARK Cagnes-sur-Mer Salon-de-Provence Antibes 13 Fort of Arles A54 Cannes Antibes A7 Draguignan Mandelieu-la-Napoule Pigment Design - © F. -

FRANCE ITINERARIES 2006 – 2019 (1. Summaries; 2. Complete Itineraries)
FRANCE ITINERARIES 2006 – 2019 (1. Summaries; 2. Complete itineraries) 1. Summary of all itineraries 2019 Cloyes sur Le Loir*; Maux*; Le Doucier*; Voucherons; Massignieu de Rives*; Lus la Croix Hautes; Visan*; Le Vigan; St. Pons de Thomieres; Argeles Plages; Tuchan; St. Girons*; Grenade sur L’Adour*; St. Symphorien; Chez Richon*; Saumur; Ricordeau, L’Aventura*;, Merville- Franceville Plage, Ouistraham, Home. 2018 Ouistraham, Montjean sur Loire*; Puy d’Anche*; St Aulaye*; St Symphorien*; Aramits*; Col de Pierre St Martin, Louvie-Juzon *; Heches*; Le Mas d’Azil*; Maury*; Argeles Plages; Tuchan; Vieussan*; Le Vigan; Col de Croix de Bor; Gervais d’Auvergne*; Pouilly sur Loire; Bonneval; Franceville; Ouistraham. 2017. Ouistraham, Bonneval; Jars*; La Celle en Morvan*; Montrevel en Bresse*; St Genix sur Guiers*; Nevache *; Larche; Le Vernet* St Laurent du Verdon; Lambesc*; Le Clos du Rhone; Sommieres (Masserau campsite) *; Pailleres (SW of Villefort)*; Col du croix de Bor; Trizac; Evaux les Bains; Rosnay; Savigny sur Braye*; Merville-Franceville Plage*, Oustraham, home. 2016. Ouistraham, Les Rosiers sur Loire; Rosnay in Brenne; Le Bugue; St Antonin Noble Val; Les Cammazes; Serignan-Plages; Tuchan; (Perpignan airport) Tuchan; Puivert; Matamale; Font- Romeu; Argeles Plages; Tuchan; Perpignan airport, St-Pons-de-Thomieres; St-Maurice- Navacelles, [wrongly taken Diversion around cirque de Navacelles] Le Vigan; Col de la Croix de Bor; Fay-sur-Lignon; Chatel-Montagne; Pouilly-sur-Loire; Bonneval; Merville-Franceville-Plage; Ouistraham, Portsmouth, Home. 2015. Ouistraham, Lac Rille; La Chaise Dieu; Luc en Diois; Larche; St Laurent; Avignon; Airport to say goodbye to Hugh; Le Vigan; Lac de Naussac; Col de la Croix-de-Bor; St. Flour, Argentat; Poinsouze; Lac des Varennes; Merville-Franceville-plage; Ouistraham, Portsmouth, Southampton. -

Background to Neanderthal Presence in Western Mediterranean Europe
Quaternary Science Reviews 217 (2019) 7e44 Contents lists available at ScienceDirect Quaternary Science Reviews journal homepage: www.elsevier.com/locate/quascirev Background to Neanderthal presence in Western Mediterranean Europe * Jose S. Carrion a, , Michael J. Walker b a Departamento de Biología Vegetal, Universidad de Murcia, 30100, Murcia, Spain b Departamento de Zoología y Antropología Física, Universidad de Murcia, 30100, Murcia, Spain article info abstract Article history: This paper provides a background to Neanderthal presence in Western Mediterranean Europe. Habitual Received 18 April 2018 tool-use underpinned human survival in late Early Pleistocene western Mediterranean Europe. By the Received in revised form onset of the early Middle Pleistocene, early humans (descendants of Homo antecessor in all likelihood) 21 August 2018 were exploiting diverse biotopes, sometimes (perhaps often) attaining primary access to large game, and Accepted 10 October 2018 deploying a variety of stone artifacts and rock types, which implies not only manual dexterity but also Available online 22 November 2018 technical competence and cognitive versatility. Late Early Pleistocene human behaviour foreshadowed that of Middle Pleistocene pre-Neanderthal humans whose background conceivably had deep regional Keywords: Human evolution roots. By the mid-Middle Pleistocene Homo heidelbergensis, some of whose anatomical features herald Palaeoanthropology Neanderthal morphology, was exploiting a wide range of natural resources in western Mediterranean Archaeology environments, including small game and plants. Neanderthal morphology began to emerge during the Palaeoecology second half of the Middle Pleistocene, accompanied by increasing technological diversity and an Palaeolithic expanding variety of small tools, conjecturally favoured by hafting, perhaps following development of Quaternary wooden spears (or other tools) and adhesive and binding technologies, and generation and heat-control Europe of fire (which undoubtedly was necessary for activities inside Bruniquel cave). -
Report on 2011 Geological Mapping Project for the Class of 2005 Mapping Fund Castellane
Report on 2011 Geological Mapping project For the Class of 2005 Mapping Fund Castellane Nathan Allen & Emma Woodward Overview of the mapping area Castellane in the southern sub-Alpine chains – approximately 100km NW of Nice in southeast France – is world-renowned for its ammonite fauna (including a stratotype location) and lies in the ‘Réserve Géologique des Alpes de Haute Provence’. The mapping area was centred around the villages of Chasteuil and Taloire at the head of the spectacular Verdon gorge, where the Mesozoic strata record a facies shift from platform to basin (in both time and space); since deformed during the Pyrenean and Alpine orogenies. Project objectives • Identify and define lithological units of the area • Interpret the transition between platform and basin in both time and space; and determine the depositional environments • Investigate structural relationships and attempt to deduce deformation history This work was carried out over July and August 2010 (see below). Total duration of field trip 35 days Duration of fieldwork 28 days Total area mapped 34km2 Transport to and from mapping area On foot Transport around mapping area On foot Hours spent daily in field 06:00 – 16:00 Temperature range 4˚C (early morning) – 38˚C (midday) Accommodation Camping Gorges Verdon (all geology within 3 hours walk) Land use Mixture of natural scrub, private grazing land, and artificial forest. Geological summary The Mesozoic carbonate sequence of Castellane, southeast France, records a transition from basinal (“Dauphinois”) pelagic facies in the north to platform (“Provençal”) neritic facies in the south; although this zone of transition is poorly studied and understood, despite excellent exposure and plentiful fossils. -

Routes4u Feasibility Study on a Mountain Heritage Route in the Alpine Region
Routes4U Feasibility Study on a Mountain Heritage Route in the Alpine Region Routes4U Project Routes4U Feasibility study on a Mountain Heritage Route in the Alpine Region ROUTES4U FEASIBILITY STUDY ON A MOUNTAIN HERITAGE ROUTE IN THE ALPINE REGION November 2019 The present study has been developed in the framework of Routes4U, the joint programme between the Council of Europe and the European Commission (DG REGIO). Routes4U aims to foster regional development through the Cultural Routes of the Council of Europe programme in the four EU macro-regions: the Adriatic and Ionian, Alpine, Baltic Sea and Danube Regions. A special thank you goes to the author Silvia Beltramo, and to the numerous partners and stakeholders who supported the study. The opinions expressed in this work are the responsibility of the author and do not necessarily reflect the official policy of the Council of Europe. Page 2 | 68 www.coe.int/routes4u Routes4U Feasibility study on a Mountain Heritage Route in the Alpine Region MOUNTAIN CULTURAL HERITAGE OF THE ALPINE REGION Introduction .................................................................................................................................. 4 Executive summary ....................................................................................................................... 6 Methodological framework ............................................................................................................. 7 I. ANALYSIS OF THE STATE OF THE ART OF THE MOUNTAIN HERITAGE OF ALP ........................