Le Conseil General Et La Creation De Nouvelles Stations De Sports D'hiver
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
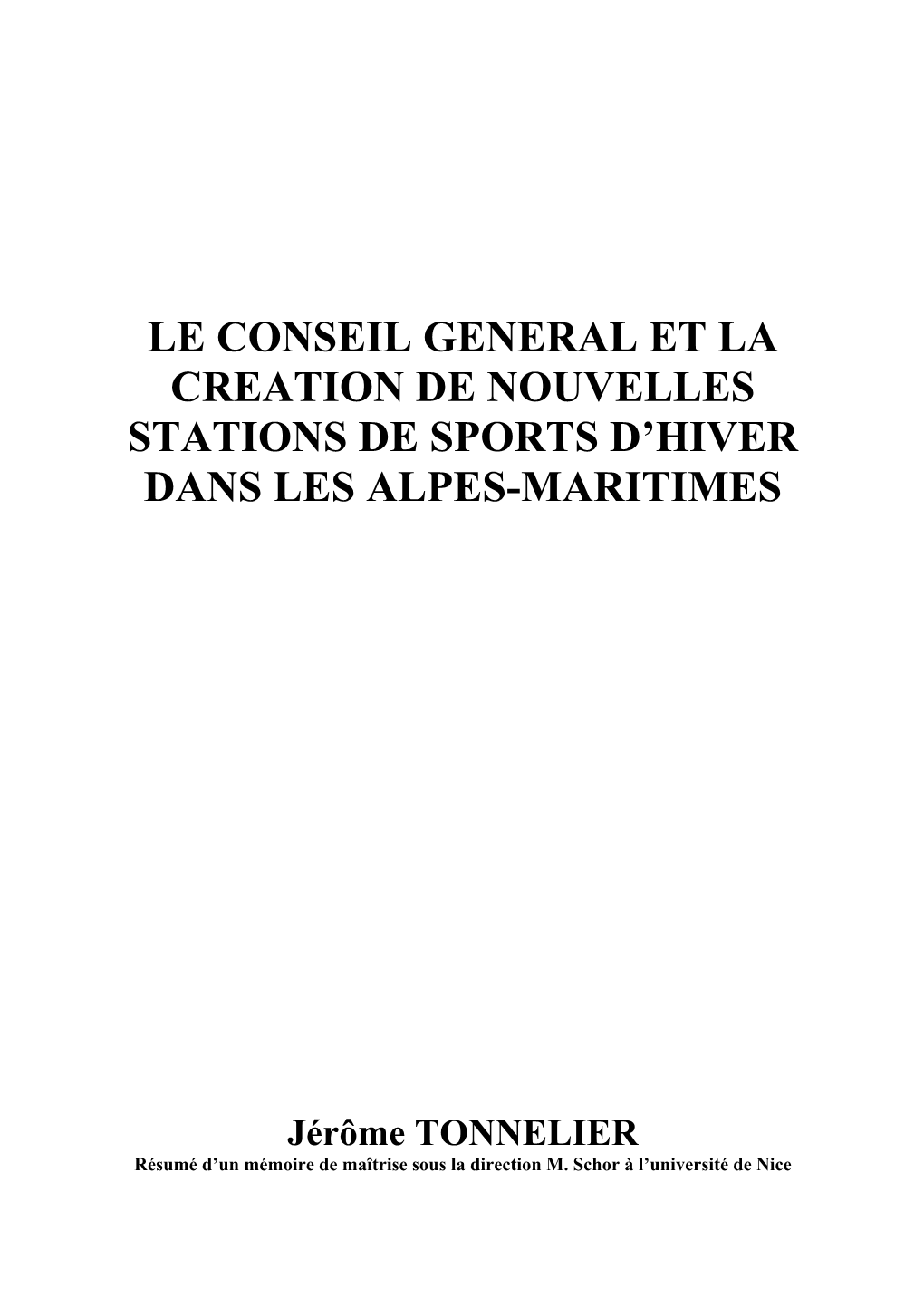
Load more
Recommended publications
-

Snowshoeing in France's Mercantour National Park
Snowshoeing in France’s Mercantour National Park By Lisa Abdolian Recently I heard a French teenager decline an invitation to hang out with friends over the weekend because she was going hiking with her family. As I braced myself for the teen-typical eye roll and sarcastic remark about “family time,” I realized that she was actually excited about wandering through the woods with her parents. It reminded me of one of the things I like most about France – the harmony between man and nature and the great respect people have for the landscape. The country’s peaks and valleys aren’t just for those in their physical prime; they are for families with children of all ages, the elderly who have spent the equivalent of years roaming the woods and for true athletes who enjoy the challenge of an adventure. Extremely well marked walking paths, called France Grandes Randonnées (GR), criss-cross the country, providing 37,282 miles of meandering trails that highlight the most remarkable aspects of an area. Winter, spring, summer and fall, the paths take visitors through the country’s national and regional parks, into intimate medieval mountain villages, past grazing cattle, to breathtaking coastal views, past cheese farms and small wineries. The paths unravel the history of the landscape and its people and reveal unique local traditions. Even on the highest mountain range walkers will find strings of refuges that allow them to rest in the evening with a shower, a good meal, a comfortable bed and an occasional sing-a-long. 1 Nowhere is this enthusiasm for nature more apparent than in France’s youngest national park. -

Mise En Page 1
2016/2017-Practical guide N I C E a b r n i l a l t i a u n r a c e l Contents 3 Nice 5 Location n 6 Weather n 6 History n 6 Discovering Nice 9 Getting around Nice n 10 Organised guided visits n 28 Sights, monuments & churches n 12 Introduction to the specialities of Nice n 31 Parks & gardens n 20 Shopping n 32 Museums, galleries & cultural activities n 23 Sports & leisure activities 37 Beaches & Water Sports n 38 Attractions & animal parks n 40 Sporting activities n 39 Leisure activities - Nice by night n 41 From Nice 43 Nice Côte d’Azur Metropolitan area n 45 Mercantour National Park n 50 Outside the City - West n 47 Ski resorts n 51 Outside the City - East n 49 Suggested tourist itineraries n 53 Practical information 57 Emergency services 24/7 n 57 Pets n 58 Currency exchange n 58 Repairs - Car parks n 59 Consumer services n 58 Recommendations n 59 Events & Shows 61 Annual events n 62 Nice, a natural brilliance Nice 5 n Location n Weather n History Nice is a city of paradox, audacity, discovery and pleasure. Located in the heart of one of the world’s most highly prized regions, at the gateway to major European cities, it offers its rich history, wonderfully mild sunny climate and geographic location between the sea and the mountains… A symbol of the Mediterranean art of living, it offers a perpetual invitation to travel. Its vicinity, too, provides ample opportunity for architectural and cultural discoveries, from pleasant strolls in museums to old palatial homes, from beaches to gardens and gastronomic adventures with countless flavours. -

Club Le Bristol NEWS UPDATE
Club Le Bristol NEWS UPDATE www.resort-solutions.co.uk WINTER 2014 Chairman’s Letter Isola 2000 improvements planned Last winter Isola 2000 was the is also planned. Mountain biking consistently reached the high goals “snowiest” ski resort in the French has recently become very popular she has set herself and this has Alps with record snow coverage. and two more runways have been resulted in the Club being awarded Unfortunately there was also heavy created. Biking events are held the RCI silver award for the 6th time. rainfall which resulted in a number in the summer. A nine-hole golf of landslides in the Tinée Valley, course with practice facilities Your Committee duly appointed including a tragic fatal landslide in is in the pipeline, although this CLC World Resort & Hotels as Isola village itself. depends on the release of land to Club Le Bristol sales and marketing Significant improvements arethe local municipality. Severine has agents last year. As a result of this expressed her concern about the planned for Isola 2000. Development agreement you will have received disturbance that may be caused of the Front De Neige area will a variety of invitations from them. include a new building to house when the work begins. A number of Owners (including my the Tourist Information Office, bus Resort Solutions and Severine have stop and general services. A sports maintained strict control of the wife and I) took advantage of this complex with an ice rink, a climbing Club’s finances without dropping and visited their resort in Fuengirola, wall and other indoor activities standards, indeed Severine has Spain for a week. -
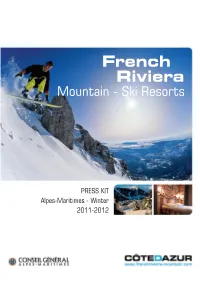
Mise En Page 1
French Riviera Mountain - Ski Resorts PRESS KIT Alpes-Maritimes - Winter 2011-2012 ABBREVIATIONS Motorway Dual carriageway Major roads Minor roads Tourist itinerary Borders Railway Station Tourist resort Ski resort Alpine skiing Cross-country skiing Snowpark MAP p. 4 Ski resorts in the Alpes-Maritimes, key figures, trends, investment, the challenges… p. 6 Key figures p. 7 Trends p. 8 Major investments p. 9 Challenges in the development of the ski resorts in Alpes-Maritimes p. 10 The press: we like what the journalists have written p. 11 A wealth of young champions p. 13 Events - winter 2011-2012 SUMMARY p. 16 Ski resorts in the Alpes-Maritimes, every one different! p. 18 Good holidays start with good ideas p. 18 Internet, gateway to the resorts p. 19 Isola 2000 p. 22 Auron p. 24 Saint-Dalmas-Le-Selvage p. 25 Valberg p. 27 Beuil-Les-Launes p. 27 Val Pelens - Saint-Martin-d’Entraunes p. 27 Estenc-Entraunes p. 28 La Colmiane-Valdeblore p. 29 Le Boréon (Saint-Martin-Vésubie) p. 31 Roubion-Les-Buisses p. 33 Turini-Camp d’Argent p. 33 Peïra-Cava p. 34 Castérino - Tende p. 35 Gréolières-Les-Neiges p. 36 L’Audibergue-La Moulière p. 38 Handiski p. 39 Practical Information SUMMARY 2 3 SKI RESORTS IN THE ALPES-MARITIMES KEY FIGURES – TRENDS – INVESTMENT... THE CHALLENGES 4 5 The Alpes-Maritimes ski resorts will be open from the beginning of December 2011 to mid-April 2012. This Department (c.f. English county), with its 15 resorts including 3 international ones (Isola 2000 – Auron and Valberg), pays special attention to the development of its mountain areas so as to ensure rapid access, top-quality skiing and the provision of other activities for non- skiing snow lovers. -

Interactive Comment on “Winter Tourism And
The Cryosphere Discuss., https://doi.org/10.5194/tc-2018-253-AC1, 2019 TCD © Author(s) 2019. This work is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 License. Interactive comment Interactive comment on “Winter tourism and climate change in the Pyrenees and the French Alps: relevance of snowmaking as a technical adaptation” by Pierre Spandre et al. Pierre Spandre et al. [email protected] Received and published: 17 March 2019 We thank O. Cenk Demiroglu for useful feedback. 1 Specific comments Printer-friendly version Snowmaking is referred as a "mitigation method" throughout the paper (p.2 line 34, p.8 line 12). This should be corrected as "adaptation method" in line with the common Discussion paper literature and the IPCC terminology. "Mitigating the impacts" phrases (p. 1 line 18, C1 p.9 lines 4&6, p.15 line 2) could also be rephrased (to e.g. "reducing") to avoid any confusion. TCD We agree with the suggestion. The term "mitigation" was replaced with the term Interactive "adaptation" where appropriate. comment p.2 line 15. "Slovenia" should be replaced with "Switzerland". We agree and have replaced "Slovenia" with "Switzerland". Interactive comment on The Cryosphere Discuss., https://doi.org/10.5194/tc-2018-253, 2018. Printer-friendly version Discussion paper C2 The Cryosphere Discuss., https://doi.org/10.5194/tc-2018-253-AC2, 2019 TCD © Author(s) 2019. This work is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 License. Interactive comment Interactive comment on “Winter tourism and climate change in the Pyrenees and the French Alps: relevance of snowmaking as a technical adaptation” by Pierre Spandre et al. -

Sports Events Calendar 2021 #Cotedazurfrance 2 Sports Events Calendar 2021
Sports events calendar 2021 #CotedAzurFrance 2 Sports events calendar 2021 23-25 > HISTORIC RALLYE 21-25 > NEW BIKINGMAN FRANCE JANUARY OF MONTE CARLO Le Cannet Until 19 March > Horse riding Monaco Ultra-long distance bicycle race WINTER MEETING www.acm.mc bringing together women and Cagnes-sur-Mer men around an event without any The winter meeting is an international assistance (food, repairs, orientation, meeting from mid december MAY no following vehicle). to mid march at the hippodrome of 8 > GRAND PRIX ÉlectriQUE Alone or in duo, you will explore your Cagnes-sur-Mer. Monaco limits day and night, in the heart of the www.hippodrome-cotedazur.com. www.acm.mc sublime Côte d’Azur, you will climb the Préalpes d’Azur park to reach the 8 & 9 > ANDROS TROPHY 20-23 > 78th FORMULA 1 GRAND PRIX Gorges du Verdon and the Géant de Isola 2000 Monaco Provence: Mont Ventoux (1,909 m). One stage of the French national Ice One of the most famous and After this mythical ascent, you will racing Championship with famous prestigious grand prix racing in the cross the Écrins national park and pilots. Principality of Monaco, created in 1929. join the highest road in Europe with www.tropheeandros.com www.acm.mc the Col de la Bonette (2,802 m). You will then finish with a breathtaking 18-24 > 89th MONTE-CARLO RALLY 24 > NEW MERCAN’TOUR CLASSIC view of the Mediterranean Sea. In total Monaco ALPES MARITIMES 1,000 kms of distance and 20,000 D+. Famous car rallye, over 85% of the Valberg www.bikingman.com/fr route has been changed, compared A new professional Cycling -

Sports Events Calendar 2021 #Cotedazurfrance 2 Sports Events Calendar 2021
Sports events calendar 2021 #CotedAzurFrance 2 Sports events calendar 2021 JANUARY 23-25 > HISTORIC RALLYE 19-20 > ONE & 1 RUN TO CAMP OF MONTE CARLO Tourrettes-sur-Loup Until 19 March > Horse riding Monaco 2 days of racing per stage and by team WINTER MEETING www.acm.mc of 2 with a breathtaking itinerary in Cagnes-sur-Mer the mountains up to Saint-Jeannet – The winter meeting is an international MAY Gourdon – Massif du Chieron…. meeting from mid december Green and Ecological commitments: to mid march at the hippodrome of 8 > GRAND PRIX ÉlectriQUE Two for Trees ! Cagnes-sur-Mer. Monaco www.one-and-1.com www.hippodrome-cotedazur.com. www.acm.mc Dates to be confirmed > LONGINES 8 & 9 > ANDROS TROPHY 20-23 > 78th FORMULA 1 GRAND PRIX GLOBAL CHAMPIONS TOUR Isola 2000 Monaco Cannes One stage of the French national Ice One of the most famous and www.jumpingcannes.com racing Championship with famous prestigious grand prix racing in the pilots. Principality of Monaco, created in 1929. 21-25 > NEW BIKINGMAN FRANCE www.tropheeandros.com www.acm.mc Le Cannet Ultra-long distance bicycle race 18-24 > 89th MONTE-CARLO RALLY 24 > NEW MERCAN’TOUR CLASSIC bringing together women and Monaco ALPES MARITIMES men around an event without any Famous car rallye, over 85% of the Valberg assistance (food, repairs, orientation, route has been changed, compared A new professional Cycling race in no following vehicle). to the previous edition, and the high mountain with famous Norwegian Alone or in duo, you will explore your 2021 program is a brand new mix of ex Pro Thor Hushovd as ambassador ! limits day and night, in the heart of the difficulties, alternating classic stages www.lamercantourcyclo.com sublime Côte d’Azur, you will climb and new portions the Préalpes d’Azur park to reach the www.acm.mc JUNE Gorges du Verdon and the Géant de Provence: Mont Ventoux (1,909 m). -

Best for Après Ski Recommended Restaurants Top Runs
R E V O 35 YEARS OUR VIEW ON ISOLA 2000, FRANCE E IS O T F ER SKI EXP Best for Après Ski • Le Petit Chamois - Highly recommended if you fancy a beer after a long day’s ski. • Le Cuban Café - As the name suggests, offers a Latin American atmosphere. • Le Crocodile - Probably the most popular bar in town. It serves many different flavoured rums – the house speciality being basil – and is open until the early hours of the morning. • Snowball Bar - If dancing is your main priority, then you should try ‘Bowling’ at Snowball Bar which is extremely popular with the younger crowd. Isola 2000 is a great choice for a long weekend: short transfers and Recommended snow-sure skiing with easy access to varied slopes that reach over Restaurants 2,600m. The resort itself is at 2,000m with 120km of mostly intermediate slopes, both above and below the tree line. There’s also plenty to • The Cow Club - Located on the nursery amuse advanced skiers, alongside one of the best village nursery slope. Serves great food in the evening slopes we have ever come across. If you want to explore further afield, and very popular at lunchtime. the smaller area of Auron is just a half-hour drive away. Here there is • La Vallette - Very popular with the a further 135km of piste (covered by the same lift pass), 21 lifts and 42 children; they have a donkey living in the pistes to enjoy. stable just below the restaurant. Book well in advance. • L’Ourson - Serves a large selection of local cuisine, including ‘escargots’ and Top Runs tartiflette for a very decent price. -

Gains from Investments in Snowmaking Facilities
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/306349305 Gains from investments in snowmaking facilities Article in Ecological Economics · August 2016 DOI: 10.1016/j.ecolecon.2016.08.003 CITATIONS READS 20 431 2 authors, including: Martin Falk University of South-Eastern Norway 185 PUBLICATIONS 2,992 CITATIONS SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: ESSLait View project Analysis of hotel cancellations/no shows View project All content following this page was uploaded by Martin Falk on 05 October 2018. The user has requested enhancement of the downloaded file. Gains from investments in snowmaking facilities Martin Falk* (Austrian Institute of Economic Research, WIFO) Laurent Vanat (Laurent Vanat Consulting Sàrl) Abstract The process of making snow requires low temperatures as well as vast quantities of water and considerable amounts of energy for the air compression. In this article the effectiveness of investment in snowmaking systems is investigated (equipment, construction works) based on data for 109 French ski resorts covering eight winter seasons (2006/2007 to 2013/2014). Both static and dynamic panel data estimations show that ski areas with large investments in snowmaking systems have a higher number of skier visits. On average a 10 percent higher capital stock of snowmaking infrastructure leads to an increase in the number of skier visits by eight percent over the winter seasons studied. However, positive effects of snowmaking can only be observed for ski areas located at high elevations, with a magnitude deceasing by higher cumulated investments in snowmaking, indicating diminishing returns to scale. -

Côte D'azur Mountain - Snow CRT CÔTE D’AZUR – Tel
PRESS KIT Côte d'Azur Mountain - Snow CRT CÔTE D’AZUR – Tel. 33 (0)4 93 37 78 78 Winter 2015 - 2016 www.cotedazur-tourisme.com CONTACT: Florence Lecointre [email protected] CONTENTS P. 4 CÔTE D’AZUR MOUNTAINS – WHAT'S THE DEAL? P. 6 CÔTE D’AZUR SNOW, TALES OF YORE AND LEGENDS P. 8 COTE D’AZUR, NEW THIS SEASON P. 12 COTE D’AZUR MOUNTAINS : PRODUCTS - WINTER 2015-2016 - Sea and snow products - Resort products - Eco-friendly tourism! P. 16 THE BEGINNER’S GUIDE TO THE CÔTE D’AZUR’S SKI RESORTS ! KEY POINTS P. 20 THE CÔTE D’AZUR'S KEY SKI RESORTS - Valberg - Isola 2000 - Auron P. 28 THE “STATIONS VILLAGES DES ALPES DU SUD®” [VILLAGE RESORTS OF THE SOUTHERN ALPS®] - Caille - L’Audibergue - Castérino - La Colmiane-Valdeblore - Roubion-Les-Buisses - Saint-Dalmas-Le-Selvage - Saint-Martin-Vésubie - Le Boréon P. 34 OTHER SKI RESORTS TO EXPLORE... - Gréolières-Les-Neiges - Val Pelens Saint-Martin-d’Entraunes - Estenc Entraunes - Turini-Camp d’Argent - Peïra-Cava P. 36 HANDI SKI P. 37 CALENDAR OF EVENTS EDITO This winter, the Alpes-Maritimes’ resorts will be continuing to invest in improving their runs, ski lifts, environmental quality and events and activities. Accommodation providers are offering stays that combine the Côte d'Azur's coast and snow-packed pistes, while resorts are busy putting together attractive packages and deals, subscribers to the Parc National du Mercantour's "Esprit Parc Naturel" eco-tourism charter are treating us to some fantastic winter offers and wildlife-themed tourism is taking off to the delight of young and old alike! Following the opening of Le Boréon's artificial ice-climbing waterfall a few years ago, the département is continuing to develop its range of non-skiing leisure facilities, with France's longest zip line arriving at La Colmiane this year: 2,663 metres of pure adrenaline, featuring 300 metres of altitude change and speeds of up to 120km/h starting at 1,776 metres and ending at 1,589 metres. -

Mathieu Faivre
L’information du village et de la station Janvier - février - mars 2021 Édition - n°5 Titania Web Edito SoMMAiRE Nous aurions beaucoup de raisons de ne retenir que le Autre raison de nous réjouir : nos champions Isoliens ont fait 2 - Activité mauvais de 2020... Et pourtant, face à la crise sanitaire, face une incroyable saison cet hiver. Mathieu Faivre, petit-fils de Jo à la tempête Alex, vous avez montré une vraie solidarité, et Mimi Otta, a fait briller les couleurs d’Isola et a fait retentir 3 - Noël ce sont vos initiatives, vos petits gestes quotidiens qui ont la Marseillaise 2 fois aux championnats du monde de ski alpin. permis aux plus fragiles de tenir le coup... DOUBLE CHAMPION DU MONDE NOTRE ISOLIEN ! 4 - Les enfants d’Isola Alors je retiendrai de 2020 cet élan de générosité, ces Mathieu, il a commencé à marcher sur la place vieille au village, Isoliens venus spontanément apporter leur aide pour faire les et à skier sur les pistes de 2000, il était à l’école primaire de 6 - Santé courses aux seniors pendant le confinement, cette collecte la station, au Club des Sports d’Isola... Il représente pleinement 7 - Solidarité qui est allée aux habitants de la Vésubie et de la Roya, la notre commune, merci Mathieu ! Merci pour l’attachement Daube et la Polenta servie à St Martin Vésubie par le Comité sincère que tu éprouves pour Isola, merci d’inspirer nos petits ! 8 - Sport des Fêtes, les parents d’élèves qui se sont montrés si attentifs Et puis, Julia Pereira, notre snowboardeuse, avec son éternel à la scolarité de leurs enfants quand ils ont été forcés de sourire ! Julia, c’est la simplicité, le partage...Julia, c’est aussi la « 12 - Dans les coulisses se convertir en professeur, l’investissement des enseignantes gnaque » ! Quelle belle saison pour elle aussi, avec sa médaille de aussi pour garder le contact avec leurs élèves.. -

Great Areas Guide 2018 / 2019 1 Chambéry Genève
alpes GREAT AREAS GUIDE 2018 / 2019 1 CHAMBÉRY GENÈVE A 48 A 43 LYO N MODANE TGV TGV A 41 SS24 GRENOBLE TUNNEL DE FRÉJUS MAJOR SKI RESORTS TGV TURIN TURIN N 91 A 480 LA GRAVE- BRIANÇONNAIS D 1091 LA MEIJE OULX VILLAR- D’ARÈNE D 1091 TGV NÉVACHE N 85 A 51 SERRE MONTGENÈVRE CHEVALIER BRIANÇON PUY-ST- VILLARD- VINCENT SAINT- CERVIÈRES HOW TO GET THERE? PELVOUX PANCRACE ÉCRINS ABRIÈS ÉCRINS VALLOUISE FROM AIRPORTS NATIONAL ARVIEUX LA-CHAPELLE-EN- PARK QUEYRAS REGIONAL VALGAUDEMAR QUEYRAS NATURE PARK Marseille: www.info-ler.fr D 1075 RISTOLAS PARIS MOLINES-EN-QUERAS Nice: www.lignesdazur.com CHAMPSAUR- DÉVOLUY ORCIÈRES GUILLESTROIS Lyon, Grenoble, Turin, Chambéry, VALGAUDEMAR MERLETTE ST VERAN 1850 CHAILLOL ST-LÉGER-LES-MÉLÈZES Milan, Genève: www.linkbus-alps. CEILLAC 3 hours LAYE SERRE-EYRAUD com L SUPERDÉVOLUY - E LA JOUE DU LOUP ANCELLE RISOUL LYON SERRE-PONÇON Grenoble Oulx R VARS H N 94 Turin ITALY FROM TRAINO STATIONS GAP RÉALLON SAINT-PAUL- ITALIE N SUR-UBAYE Briançon E EMBRUN Aix TGV, Marseille, Lyon TGV, Oulx TGV, VALENCE AVIGNON CRÉVOUX LAC DE AIX-EN-PROVENCE NICE Modane: www.linkbus-alps.com TGV GAPENÇAIS SERRE-PONÇON LES ORRES D 908 TOULON-HYÈRES www.autocars-resalp.com UBAYE MARSEILLE LARCHE www.autocars-imbert.com D 900STE ANNE SPAIN L’UBAYE BARCELONNETTE MEDITERRANEAN SEA D 1075 BLANCHE D 94 PRA SS21 CHABANON MONTCLAR LOUP BUËCH LA DURANCE SELONNET LARAGNE LE SAUZE VAL D 64 LE GRAND PUY D'ALLOS SAINT-DALMAS- LE-SELVAGE MERCANTOUR NATIONAL PARK D 902 ISOLA BARONNIES PROVENÇALES AURON 2000 REGIONAL NATURE PARK D 900 SISTERON TINÉE