Programme De Salle HECTOROCL.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Claude Debussy Ebook
CLAUDE DEBUSSY PDF, EPUB, EBOOK David J. Code | 216 pages | 15 Aug 2010 | Reaktion Books | 9781861897596 | English | London, United Kingdom Claude Debussy PDF Book That version of events is not corroborated by Debussy scholars such as Marcel Dietschy , Eric Frederick Jensen , Roger Nichols , Robert Orledge , Nigel Simeone or Stephen Walsh ; [67] and no mention of the Place de la Concorde appeared in even the most sensational press coverage at the time. London: Collins. See Article History. Jazz Latin New Age. London: Stainer and Bell. Chamber Music. Not a single idea is expressed fully, the form is terribly shriveled, and it lacks unity. Debussy had his piano lesson when he was 7 years old. For many follower composers, Debussy has successfully set up unique paradigm and tonal structure in his piece. String Quartet, L. Collaborated with. Jensen, Eric Frederick Debussy and Emma Bardac eventually married in , their troubled union enduring for the rest of his life. Debussy abandoned Dupont for her friend Marie-Rosalie Texier, known as "Lilly", whom he married in October , after threatening suicide if she refused him. At the Conservatoire, Debussy initially made good progress. Reti, Rudolph Estampes for piano gives impressions of exotic locations, with further echoes of the gamelan in its pentatonic structures. Mineola, US: Dover. Influenced by. Claude Debussy — Biography. Its origins are complex and fascinating, combining influences from poetry, the music of the Baroque period from around to , and Impressionism, a style in music following on from that in visual arts. His distinctive signature lay on the appealing combination of sensuality and modernism within mature composition that made his music known for its real beauty. -
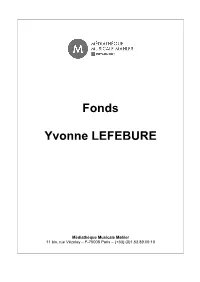
Fonds Yvonne Lefébure 2
Fonds Yvonne LEFEBURE Médiathèque Musicale Mahler 11 bis, rue Vézelay – F-75008 Paris – (+33) (0)1.53.89.09.10 Médiathèque Musicale Mahler – Fonds Yvonne Lefébure 2 Fonds Yvonne LEFEBURE Documents personnels 4 Documents biographiques 4 Documents personnels 5 Formation 5 Diplômes et distinctions 7 Distinctions, correspondance officielle 8 Divers 8 Professeur et pédagogue 9 Conservatoire National de Musique 9 Ecole Normale de Musique 9 Concours 9 Devoirs d'élèves annotés par Yvonne Lefébure 10 Ecrits d'Yvonne Lefébure 11 Articles de presse 13 Correspondance 14 Correspondance Yvonne Lefébure / Fred Goldbeck 14 Correspondance personnelle et familiale 14 Correspondance générale 15 Lettres et cartes non identifiées 49 Correspondance d'Yvonne Lefébure à Marthe Morhange-Motchane 50 Partitions 53 Manuscrits musicaux 53 Partitions imprimées et dédicacées 54 Partitions imprimées non dédicacées 55 Copies, reproductions et esquisses 58 Iconographie 59 Iconographie générale 59 Yvonne Lefébure et son entourage 60 Programmes 62 Programmes d'Yvonne Lefébure 62 Programmes divers 68 Affiches 70 Enregistrements 71 Documents divers 72 Livres 72 Documentation musicale 74 Revues 74 Objets 74 Fred Goldbeck 75 Papiers et documents personnels 75 Ecrits : manuscrits, livres, articles 75 Livre d'or de Fred Goldbeck 79 Mise à jour le 11 juin 2019 Médiathèque Musicale Mahler – Fonds Yvonne Lefébure 3 Additif Odile Budan 84 Documents biographiques Correspondance personnelle et familiale Correspondance nécrologique Correspondance générale Iconographie Notes professionnelles -

Memorial Library of Music Collection
http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt6r29p0pm No online items Partial Guide to the Memorial Library of Music Collection Special Collections staff Department of Special Collections Green Library Stanford University Libraries Stanford, CA 94305-6004 Phone: (650) 725-1022 Email: [email protected] URL: http://library.stanford.edu/spc/ © 2006 The Board of Trustees of Stanford University. All rights reserved. Partial Guide to the Memorial MLM 1 Library of Music Collection Partial Guide to the Memorial Library of Music Collection Collection number: MLM Department of Special Collections and University Archives Stanford University Libraries Stanford, California Processed by: Special Collections staff Date Completed: 2003 Encoded by: Bill O'Hanlon © 2006 The Board of Trustees of Stanford University. All rights reserved. Descriptive Summary Title: Memorial Library of Music collection Collection number: MLM Collector: Keating, George T. Collection Size: ca. 27 linear ft. Repository: Stanford University. Libraries. Dept. of Special Collections and University Archives. Abstract: This library is a collection of musical manuscripts and of printed and engraved scores inscribed by great composers, and constitutes a unique addition to Stanford's educational and cultural resources. Languages: Languages represented in the collection: English Access Collection is open for research; materials must be requested at least 24 hours in advance of intended use. Publication Rights Property rights reside with the repository. Literary rights reside with the creators of the documents or their heirs. To obtain permission to publish or reproduce, please contact the Public Services Librarian of the Dept. of Special Collections. Preferred Citation Memorial Library of Music Collection, MLM. Dept. of Special Collections, Stanford University Libraries, Stanford, Calif. -

Boston Symphony Orchestra Concert Programs, Season 100, 1980-1981, Subscription
^M *. / -^•rt § idredth Season . im M MST SOFTENS EVERYTHING rr touches. What a pleasant way to feel the soft touch of Irish Mist, in "Liquid Sunshine" Start with a tall glass of ice. add 1 part Irish Mist and 3 parts orange juice, Irish Mist, the centuries old liqueur sweetened with a hint of heather honey, will blend with almost anything. Pour the soft touch of Irish Mist anytime . anywhere. You'll like the way it feels. IRISH MIST THE LEGENDARY SPIRIT Imported Irish Mist® Liqueur. 70 Proof. ©1980 Heublein, Inc., Hartford, Conn. U.S.A. Seiji Ozawa, Music Director Sir Colin Davis, Principal Guest Conductor Joseph Silverstein, Assistant Conductor One Hundredth Season, 1980-81 The Trustees of the Boston Symphony Orchestra, Inc. Abram T. Collier, Chairman Nelson J. Darling, Jr., President Philip K. Allen, Vice-President Mrs. Harris Fahnestock, Vice-President Leo L. Beranek, Vice-President Sidney Stoneman, Vice-President Roderick M. MacDougall, Treasurer John Ex Rodgers, Assistant Treasurer Vernon R. Alden E. Morton Jennings, Jr. Irving W. Rabb Mrs. John M. Bradley Edward M. Kennedy Paul C. Reardon Mrs. Norman L. Cahners George H. Kidder David Rockefeller, Jr. George H.A. Clowes, Jr. David G. Mugar Mrs. George Lee Sargent Archie C. Epps III Albert L. Nickerson William A. Selke Mrs. John L. Grandin Thomas D. Perry, Jr. John Hoyt Stookey Trustees Emeriti Talcott M. Banks, Chairman of the Board Emeritus Allen G. Barry John T. Noonan Richard P. Chapman Mrs. James H. Perkins Edward G. Murray John L. Thorndike Administration of the Boston Symphony Orchestra Thomas W. -

Boston Symphony Orchestra Concert Programs, Season 101, 1981
BOSTON SOYMPHONY OWRCHESTRA n b Hundredth-L iUNDREDTH BirthdayDlRTHDAY OEASONSi sySny\ ORCHESTRA) I, SHJIOZAWA / 1881 -OCTOBER 22 -1981 >jl#rtW<A Sf -AC V.S.O.E. HEMY MAR : "i8»{Si n/£»*^e»fft* 4ft( ?S6^i^ <o/>. VSQp COGNAC r « A N c 6 ' ftOTTLFn hv t? bipmv AX FlNE CHAMPAGNE COG!| THE FIRST NAME IN COGNAC SINCE 1724 [waaBHw CA'AC: FROM THE TWO 'PREMIE Seiji Ozawa, Music Director Sir Colin Davis, Principal Guest Conductor Joseph Silverstein, Assistant Conductor Hundredth Birthday Season, 1981-82 Trustees of the Boston Symphony Orchestra, Inc. Abram T. Collier, Chairman Nelson J. Darling, Jr., President Leo L. Beranek, Vice-President George H. Kidder, Vice-President Mrs. Harris Fahnestock, Vice-President Sidney Stoneman, Vice-President Roderick M. MacDougall, Treasurer John Ex Rodgers, Assistant Treasurer Vernon R. Alden Archie C. Epps III Thomas D. Perry, Jr. J. P. Barger Mrs. John L. Grandin Irving W Rabb Mrs. John M. Bradley Edward M. Kennedy Mrs. George Lee Sargent Mrs. Norman L. Cahners David G. Mugar William A. Selke George H.A. Clowes, Jr. Albert L. Nickerson John Hoyt Stookey Trustees Emeriti Talcott M. Banks, Chairman of the Board Emeritus Philip K. Allen E. Morton Jennings, Jr. Mrs. James H. Perkins Allen G. Barry Edward G. Murray Paul C. Reardon Richard P Chapman John T. Noonan John L. Thorndike Administration of the Boston Symphony Orchestra Thomas W. Morris General Manager William Bernell Edward R. Birdwell Daniel R. Gustin Artistic Administrator Orchestra Manager Assistant Manager Caroline Smedvig Walter D. Hill Joseph M. Hobbs Director of Director of Director of Promotion Business Affairs Development Judith Gordon Joyce M. -

The Development of the French Violin
THE DEVELOPMENT OF THE FRENCH VIOLIN SONATA (1860 – 1910) BY DAVID ROGER LE GUEN B.Mus., The Australian National University, 1999 M.Mus., The University of Tasmania, 2001 Submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy (Violin Performance) University of Tasmania Hobart (May, 2006) ii DECLARATION This exegesis contains the results of research carried out at the University of Tasmania Conservatorium of Music between 2003 and 2006. It contains no material that, to my knowledge, has been accepted for a degree or diploma by the University or any other institution, except by way of background information that is duly acknowledged in the exegesis. I declare that this exegesis is my own work and contains no material previously published or written by another person except where clear acknowledgement or reference has been made in the text. This exegesis may be made available for loan and limited copying in accordance with the Copyright Act 1968. Date: David Le Guen iii ACKNOWLEDGMENTS I would like to thank the supervisors of my exegesis Dr Anne-Marie Forbes, Dr Marina Phillips and my violin teachers, Mr. Yun Yi Ma and Mr. Peter Tanfield, for their guidance and support throughout my studies. My special thanks to Professor Jan Sedivka, my mentor, who not only provided me with the inspiration for undertaking this research, but whose words of wisdom and support have also given me so much joy and motivation throughout my years of study in Hobart. In addition, I would like to thank Mrs. Beryl Sedivka, Mr. Christian Wojtowicz, Leon Stemler, and Myer Fredman who have also provided encouragement, support and a wealth of personal knowledge. -

BROCHURE FINALE JUIN 2018.Indd
Saison 2018 | 2019 LA SAISON EN UN COUP D’ŒIL PROGRAMME DES CONCERTS Mardi 25 septembre 2018 12h45 LE TEMPS DES SÉRÉNADES CROQUE-MUSIQUE Salle des Fêtes de la Mairie du IVe arr. p. 13 Jeudi 4 octobre 2018 20h LUDWIG 100% BEETHOVEN CONCERT SYMPHONIQUE Salle Gaveau p. 13 Mardi 6 novembre 2018 12h45 UN QUATUOR EN AUTOMNE CROQUE-MUSIQUE Salle des Fêtes de la Mairie du IVe arr. p. 15 Dimanche 18 novembre 2018 10h BÉBÉ CONCERT # 1 Salle Gaveau p. 15 17h THE BIG FOUR MAÎTRES VIENNOIS CONCERT SYMPHONIQUE Salle Gaveau p. 15 Mardi 4 décembre 2018 12h45 BASSONS À TABLE ! CROQUE-MUSIQUE Salle des Fêtes de la Mairie du IVe arr. p. 17 Dimanche 16 décembre 2018 10h BÉBÉ CONCERT # 2 Salle Gaveau p. 17 17h AMADEUS 100% MOZART CONCERT CHAMBRE LAMOUREUX Salle Gaveau p. 17 Mardi 8 janvier 2019 12h45 BALADE ROMANTIQUE À TRAVERS L’EUROPE CROQUE-MUSIQUE Salle des Fêtes de la Mairie du IVe arr. p. 19 Jeudi 17 janvier 2019 20h HECTOR 100% BERLIOZ CONCERT SYMPHONIQUE Théâtre des Champs-Élysées p. 19 Mardi 5 mars 2019 12h45 QUATUOR À CORDES CROQUE-MUSIQUE Salle des Fêtes de la Mairie du IVe arr. p. 21 Dimanche 17 mars 2019 10h BÉBÉ CONCERT # 3 Salle Gaveau p. 21 17h STABAT MATER CONCERT SYMPHONIQUE Salle Gaveau p. 21 Mardi 2 avril 2019 12h45 CLARA & CIE CROQUE-MUSIQUE Salle des Fêtes de la Mairie du IVe arr. p. 23 Samedi 13 avril 2019 10h BÉBÉ CONCERT # 4 Théâtre des Champs-Élysées p. 23 Dimanche 14 avril 2019 17h LES LAMOUREUX DE CLARA CONCERT SYMPHONIQUE Théâtre des Champs-Élysées p. -

MUSIC of the Impressionists
SEPTEMBER - OCTOBER 2016 I ISSUE 1 MUSIC OF THE Impressionists OPENING NIGHT: JOSHUA BELL THE SPY WHO LOVED ME WITH SHEENA EASTON ORGAN SPECTACULAR Claude Monet, Soleil Levant wso.ca I 204-949-3999 MESSAGE FROM THE MUSIC DIRECTOR Welcome to another season of your Winnipeg Symphony Orchestra! Every year, we push ourselves to program the best concert experiences we can, and we are starting this season with two blockbusters – Beethoven’s 7th, and Tchaikovsky’s Violin Concerto with non-other than Joshua Bell. To have this international star with the WSO in a special opening night gala is thrilling and a splendid way to open our season. From there, we open the Air Canada Pops series with the best of spy music from the realms of film, television, pop, and even Broadway, with pop idol Sheena Easton, who is a true bond girl. Then, we move into our fall festival – Music of the Impressionists. When I go to a museum, I am always drawn to the impressionist wing. I want to see Monet, Seurat, Van Gogh; the most beautiful and the most expensive these days. I wanted to recreate this in the musical world and create a festival where we perform impressionist musical paintings. I’m so looking forward to rehearsing with the orchestra in La mer to bring out all those musical colours, reflections of light and shadow that require a very different playing technique by the musicians compared to Beethoven, and Wagner later in the season. Then with Berlioz’s Symphonie fantastique, we’ve created this completely contemporary version with images and video.