Normalisation En Matière De Documentation
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Government Open Systems Interconnection Profile Users' Guide, Version 2
NIST Special Publication 500-192 [ Computer Systems Government Open Systems Technology Interconnection Profile Users' U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE National Institute of Guide, Version 2 Standards and Technology Tim Boland Nisr NATL INST. OF STAND & TECH R.I.C, A111D3 71D7S1 NIST PUBLICATIONS --QC- 100 .U57 500-192 1991 C.2 NIST Special Publication 500-192 . 0)0 Government Open Systems Interconnection Profile Users' Guide, Version 2 Tim Boland Computer Systems Laboratory National Institute of Standards and Technology Gaithersburg, MD 20899 Supersedes NIST Special Publication 500-163 October 1991 U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE Robert A. Mosbacher, Secretary NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY John W. Lyons, Director Reports on Computer Systems Technology The National Institute of Standards and Technology (NIST) has a unique responsibility for conriputer systems technology within the Federal government. NIST's Computer Systems Laboratory (CSL) devel- ops standards and guidelines, provides technical assistance, and conducts research for computers and related telecommunications systems to achieve more effective utilization of Federal information technol- ogy resources. CSL's responsibilities include development of technical, management, physical, and ad- ministrative standards and guidelines for the cost-effective security and privacy of sensitive unclassified information processed in Federal computers. CSL assists agencies in developing security plans and in improving computer security awareness training. This Special Publication 500 series reports CSL re- search and guidelines to Federal agencies as well as to organizations in industry, government, and academia. National Institute of Standards and Technology Special Publication 500-192 Natl. Inst. Stand. Technol. Spec. Publ. 500-192, 166 pages (Oct. 1991) CODEN: NSPUE2 U.S. -
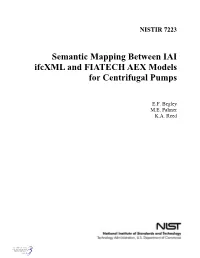
Semantic Mapping Between IAI Ifcxml and FIATECH AEX Models for Centrifugal Pumps
NISTIR 7223 Semantic Mapping Between IAI ifcXML and FIATECH AEX Models for Centrifugal Pumps E.F. Begley M.E. Palmer K.A. Reed NISTIR 7223 Semantic Mapping Between IAI ifcXML and FIATECH AEX Models for Centrifugal Pumps E.F. Begley M.E. Palmer K.A. Reed Building Environment Division Building and Fire Research Laboratory May 2005 U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE Carlos M. Gutierrez, Secretary TECHNOLOGY ADMINISTRATION Phillip J. Bond, Under Secretary of Commerce for Technology NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY Hratch G. Semerjian, Acting Director TABLE OF CONTENTS 1. INTRODUCTION ..................................................................................................................................................2 1.1 WHAT IS XML? ...................................................................................................................................................2 1.2 INTERNATIONAL ALLIANCE FOR INTEROPERABILITY AND THE INDUSTRY FOUNDATION CLASSES.......................4 1.3 IFCXML...............................................................................................................................................................5 1.4 IFC USE CASES....................................................................................................................................................6 1.5 FIATECH AND THE AEX PROJECT......................................................................................................................8 1.6 AEX USE CASES..................................................................................................................................................9 -

ISO/TC46 (Information and Documentation) Liaison to IFLA
ISO/TC46 (Information and Documentation) liaison to IFLA Annual Report 2015 TC46 on Information and documentation has been leading efforts related to information management since 1947. Standards1 developed under ISO/TC46 facilitate access to knowledge and information and standardize automated tools, computer systems, and services relating to its major stakeholders of: libraries, publishing, documentation and information centres, archives, records management, museums, indexing and abstracting services, and information technology suppliers to these communities. TC46 has a unique role among ISO information-related committees in that it focuses on the whole lifecycle of information from its creation and identification, through delivery, management, measurement, and archiving, to final disposition. *** The following report summarizes activities of TC46, SC4, SC8 SC92 and their resolutions of the annual meetings3, in light of the key-concepts of interest to the IFLA community4. 1. SC4 Technical interoperability 1.1 Activities Standardization of protocols, schemas, etc. and related models and metadata for processes used by information organizations and content providers, including libraries, archives, museums, publishers, and other content producers. 1.2 Active Working Group WG 11 – RFID in libraries WG 12 – WARC WG 13 – Cultural heritage information interchange WG 14 – Interlibrary Loan Transactions 1.3 Joint working groups 1 For the complete list of published standards, cfr. Appendix A. 2 ISO TC46 Subcommittees: TC46/SC4 Technical interoperability; TC46/SC8 Quality - Statistics and performance evaluation; TC46/SC9 Identification and description; TC46/SC 10 Requirements for document storage and conditions for preservation - Cfr Appendix B. 3 The 42nd ISO TC46 plenary, subcommittee and working groups meetings, Beijing, June 1-5 2015. -

Package 'Passport'
Package ‘passport’ November 7, 2020 Type Package Title Travel Smoothly Between Country Name and Code Formats Version 0.3.0 Description Smooths the process of working with country names and codes via powerful parsing, standardization, and conversion utilities arranged in a simple, consistent API. Country name formats include multiple sources including the Unicode Common Locale Data Repository (CLDR, <http://cldr.unicode.org/>) common-sense standardized names in hundreds of languages. Depends R (>= 3.1.0) Imports stats, utils Suggests covr, dplyr, DT, gapminder, ggplot2, jsonlite, knitr, mockr, rmarkdown, testthat, tidyr License GPL-3 | file LICENSE URL https://github.com/alistaire47/passport, https://alistaire47.github.io/passport/ BugReports https://github.com/alistaire47/passport/issues Encoding UTF-8 LazyData true RoxygenNote 7.1.1 VignetteBuilder knitr NeedsCompilation no Author Edward Visel [aut, cre] (<https://orcid.org/0000-0002-2811-6254>) Maintainer Edward Visel <[email protected]> Repository CRAN Date/Publication 2020-11-07 07:30:03 UTC 1 2 as_country_code R topics documented: as_country_code . .2 as_country_name . .3 codes . .5 country_format . .6 nato .............................................7 order_countries . .8 parse_country . 10 Index 12 as_country_code Convert standardized country names to country codes Description as_country_code converts a vector of standardized country names or codes to country codes Usage as_country_code(x, from, to = "iso2c", factor = is.factor(x)) Arguments x A character, factor, or numeric vector of country names or codes from Format from which to convert. See Details for more options. to Code format to which to convert. Defaults to "iso2c"; see codes for more options. factor If TRUE, returns factor instead of character vector. Details as_country_code takes a character, factor, or numeric vector of country names or codes to translate into the specified code format. -
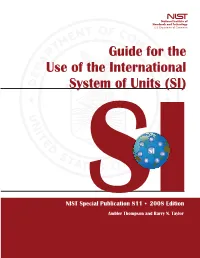
Guide for the Use of the International System of Units (SI)
Guide for the Use of the International System of Units (SI) m kg s cd SI mol K A NIST Special Publication 811 2008 Edition Ambler Thompson and Barry N. Taylor NIST Special Publication 811 2008 Edition Guide for the Use of the International System of Units (SI) Ambler Thompson Technology Services and Barry N. Taylor Physics Laboratory National Institute of Standards and Technology Gaithersburg, MD 20899 (Supersedes NIST Special Publication 811, 1995 Edition, April 1995) March 2008 U.S. Department of Commerce Carlos M. Gutierrez, Secretary National Institute of Standards and Technology James M. Turner, Acting Director National Institute of Standards and Technology Special Publication 811, 2008 Edition (Supersedes NIST Special Publication 811, April 1995 Edition) Natl. Inst. Stand. Technol. Spec. Publ. 811, 2008 Ed., 85 pages (March 2008; 2nd printing November 2008) CODEN: NSPUE3 Note on 2nd printing: This 2nd printing dated November 2008 of NIST SP811 corrects a number of minor typographical errors present in the 1st printing dated March 2008. Guide for the Use of the International System of Units (SI) Preface The International System of Units, universally abbreviated SI (from the French Le Système International d’Unités), is the modern metric system of measurement. Long the dominant measurement system used in science, the SI is becoming the dominant measurement system used in international commerce. The Omnibus Trade and Competitiveness Act of August 1988 [Public Law (PL) 100-418] changed the name of the National Bureau of Standards (NBS) to the National Institute of Standards and Technology (NIST) and gave to NIST the added task of helping U.S. -

International Standard @ 1000
International Standard @ 1000 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATIONoME~YHAPOLIHAROPTAHMSAUMR no CTAHAAPTM3AUHMaRGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION L SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units Unités SI et recommandations pour l'emploi de leurs multiples et de certaines autres unités Second edition - 1981-02-15iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai) ISO 1000:1981 https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a63c4770-3eda-4cd9-9c90- c032a9b11787/iso-1000-1981 UDC : : Ref. No. IS0 (E) 1 53.081 003.62 004.1 IOOO-1981 Descriptors : units of measurement, metric system, multiples, international system of units, utilisation s Price based on 14 pages Foreword IS0 (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards institutes (IS0 member bodies). The work of developing Inter- national Standards is carried out through IS0 technical committees. Every member body interested in a subject for which a technical committee has been set up has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for approval before their acceptance as International Standards by the IS0 Council. International Standard IS0 loo0 was idevelopedTeh SbyT TechnicalAND CommitteeARD ISO/TC PR 12,E VIEW Quantities, units, symbols, conversion factors and( sconversiontand atables.rd s.iteh.ai) This second edition was submitted directly to the IS0 Council, in accordance with clause 5.10.1 of part 1 of the Directives for the technical workIS Oof 1ISO.000: 1It9 cancels81 and replaces the first edition (i.e. -

Magensa Qwickpin, Generation/Verification of PIN Offset
Magensa QwickPIN Generation/Verification of PIN Offset Programmer’s Reference Manual March 18, 2021 Document Number: D998200466-11 REGISTERED TO ISO 9001:2015 Magensa, LLC I 1710 Apollo Court I Seal Beach, CA 90740 I Phone: (562) 546-6400 I Technical Support: (888) 624-8350 www.magtek.com Copyright © 2006 - 2021 MagTek, Inc. Printed in the United States of America INFORMATION IN THIS PUBLICATION IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE AND MAY CONTAIN TECHNICAL INACCURACIES OR GRAPHICAL DISCREPANCIES. CHANGES OR IMPROVEMENTS MADE TO THIS PRODUCT WILL BE UPDATED IN THE NEXT PUBLICATION RELEASE. NO PART OF THIS DOCUMENT MAY BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, FOR ANY PURPOSE, WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF MAGTEK, INC. MagTek®, MagnePrint®, and MagneSafe® are registered trademarks of MagTek, Inc. Magensa™ is a trademark of MagTek, Inc. DynaPro™ and DynaPro Mini™, are trademarks of MagTek, Inc. ExpressCard 2000 is a trademark of MagTek, Inc. IPAD® is a trademark of MagTek, Inc. IntelliStripe® is a registered trademark of MagTek, Inc. AAMVA™ is a trademark of AAMVA. American Express® and EXPRESSPAY FROM AMERICAN EXPRESS® are registered trademarks of American Express Marketing & Development Corp. D-PAYMENT APPLICATION SPECIFICATION® is a registered trademark to Discover Financial Services CORPORATION MasterCard® is a registered trademark and PayPass™ and Tap & Go™ are trademarks of MasterCard International Incorporated. Visa® and Visa payWave® are registered trademarks of Visa International Service Association. MAS-CON® is a registered trademark of Pancon Corporation. Molex® is a registered trademark and PicoBlade™ is a trademark of Molex, its affiliates, related companies, licensors, and/or joint venture partners. -
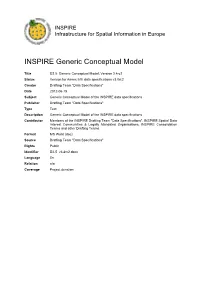
INSPIRE Generic Conceptual Model
INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe INSPIRE Generic Conceptual Model Title D2.5: Generic Conceptual Model, Version 3.4rc2 Status Version for Annex II/III data specifications v3.0rc2 Creator Drafting Team "Data Specifications" Date 2012-06-15 Subject Generic Conceptual Model of the INSPIRE data specifications Publisher Drafting Team "Data Specifications" Type Text Description Generic Conceptual Model of the INSPIRE data specifications Contributor Members of the INSPIRE Drafting Team "Data Specifications", INSPIRE Spatial Data Interest Communities & Legally Mandated Organisations, INSPIRE Consolidation Teams and other Drafting Teams Format MS Word (doc) Source Drafting Team "Data Specifications" Rights Public Identifier D2.5_v3.4rc2.docx Language En Relation n/a Coverage Project duration Table of contents Foreword ................................................................................................................................................ 6 Introduction ........................................................................................................................................... 8 1 Scope ............................................................................................................................................. 11 2 Normative references ................................................................................................................... 11 3 Terms and abbreviations ............................................................................................................ -

Download and Execution, Along with Metadata That Dr
Table of Contents Preface 5 Purpose and Membership 7 Ecma's role in International Standardization 9 Organization of Ecma International* 10 General Assembly 13 Ordinary members 14 Associate members 16 SME members 17 SPC members 18 Not-for-Profit members 19 Technical Committees 21 Index of Ecma Standards 57 Ecma Standards and corresponding International and European Standards 61 Technical Reports 81 List of Representatives 84 Ecma By-laws 139 Ecma Rules 146 Code of Conduct in Patent Matters 151 Withdrawn Ecma Standards and Technical Reports 153 History of Ecma International 165 Past Presidents / Secretary General 166 * Often called Ecma, or ECMA (in the past), short for Ecma International. - 3 - Preface Information Technology, Telecommunications and Consumer Electronics are key factors in today's economic and social environment. Effective interchange both of commercial, technical, and administrative data, text and images and of audiovisual information is essential for the growth of economy in the world markets. Through the increasing digitalization of information technology, telecommunications and consumer electronics are getting more and more integrated. Open Systems and Distributed Networks based on worldwide recognized standards will not only provide effective interchange of information but also help to remove technical barriers to trade. In particular harmonized standards are recognized as a prerequisite for the establishment of the European economic area. From 1961 until 1994, ECMA (European Computer Manufacturers Association), then Ecma International (Ecma, for short) has actively contributed to worldwide standardization in information technology, communications and consumer electronics (ICT and CE). More than 380 Ecma Standards and 90 Technical Reports of high quality have been published. -

Butcher's Copy-Editing
BUTCHER’S COPY-EDITING Judith Butcher, Caroline Drake and Maureen Leach BUTCHER’S COPY-EDITING The Cambridge Handbook for Editors, Copy-editors and Proofreaders Fourth edition, fully revised and updated cambridge university press Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo Cambridge University Press The Edinburgh Building, Cambridge cb2 2ru, UK Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York www.cambridge.org Information on this title: www.cambridge.org/9780521847131 © Cambridge University Press 1975, 1981, 1992, 2006 This publication is in copyright. Subject to statutory exception and to the provision of relevant collective licensing agreements, no reproduction of any part may take place without the written permission of Cambridge University Press. First published in print format 2006 isbn-13 978-0-511-25039-2 eBook (NetLibrary) isbn-10 0-511-25039-8 eBook (NetLibrary) isbn-13 978-0-521-84713-1 hardback isbn-10 0-521-84713-3 hardback Cambridge University Press has no responsibility for the persistence or accuracy of urls for external or third-party internet websites referred to in this publication, and does not guarantee that any content on such websites is, or will remain, accurate or appropriate. Contents List of illustrations viii 4 Illustrations 69 Preface to the fourth edition ix 4.1 What needs to be done 75 Preface to the third edition x 4.2 Line illustrations 80 Preface to the second edition xii 4.3 Maps 85 Preface to the first edition xii 4.4 Graphs 88 Acknowledgements -

Kyoto Convention
KYOTO CONVENTION GENERAL ANNEX GUIDELINES Chapter 7 APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY WORLD CUSTOMS ORGANIZATION Version 7 March 2014 Kyoto Convention – General Annex – Chapter 7 Guidelines on Application of Information and Communication Technology “Copyright © 2014 World Customs Organization All rights reserved. Requests and inquiries concerning translation, reproduction and adaptation rights should be addressed to [email protected]”. 2. Kyoto Convention – General Annex – Chapter 7 Guidelines on Application of Information and Communication Technology Table of Contents TABLE OF CONTENTS ...................................................................................................................................... 3 1. MANAGEMENT SUMMARY .................................................................................................................... 8 1.1. PURPOSE ....................................................................................................................................................... 8 1.2. THE STRATEGIC ROLE OF ICT....................................................................................................................... 8 1.3. FUTURE TRENDS ......................................................................................................................................... 12 1.4. SCOPE ......................................................................................................................................................... 15 1.5. CROSS REFERENCE -

Internet, Interoperability and Standards – Filling the Gaps
Internet, Interoperability and Standards – Filling the Gaps Janifer Gatenby European Product Manager Geac Computers [email protected] Abstract: With major changes in electronic communications, the main focus of standardisation in the library arena has moved from that of supporting efficiency to allowing library users to access external resources and allowing remote access to library resources. There is a new emphasis on interoperability at a deeper level among library systems and on a grander scale within the environment of electronic commerce. The potential of full inter-operability is examined along with its likely impact. Some of the gaps in current standards are examined, with a focus on information retrieval, together with the process for filling those gaps, the interoperation of standards and overlapping standards. Introduction Libraries now find themselves in a very new environment. Even though they have always co-operated with one another and have led standards efforts for decades, their inter- operability has been at arm's length via such means as store and forward interlibrary loans and electronic orders. The initial goals of standardisation were to increase efficiency, e.g. by exchanging cataloguing, by electronic ordering and only secondarily to share resources. Initial standards efforts in libraries concentrated on record exchange as part of the drive to improve efficiency by sharing cataloguing. This led to a raft of bibliographic standards concentrating on: the way in which catalogue records are made (contents - cataloguing rules such as AACR2, classification schemes, subject headings, name headings) how they are identified (LC card number, ISBN, ISSN etc.) how they are structured for exchange (MARC) Viewing library standardisation chronologically, acquisitions was the next area where libraries strove to increase efficiency co-operatively.