[Te Bespreken]
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Download Download
virtus 27 virtus Valbijl of vangnet? Natuurmonumenten, de adel en de verwerving van 9 landgoederen en buitenplaatsen, 1905-1980 Michiel Purmer Class, gender and national identity. Music-making in eighteenth-century 33 Dutch noble homes virtus Joris van Son Insignia Summorum Principum. Using symbols of power in pursuit of higher 55 27 2020 rank and status by German prince-electors and Polish-Lithuanian princes Jakub Rogulski Dossier Adellijke Vrouwen ‘Defending the castle like a man’: on belligerent medieval ladies 79 27 2020 Elizabeth den Hartog | Belle van Zuylen: schrijfster van adel, over de adel. Haar correspondentie 99 digitaal beschikbaar Suzan van Dijk Een ruk naar Brits. De internationale politiek van Anna van Hannover, 1756-1757 115 Simone Nieuwenbroek 9 789087 049249 9789087049249.pcovr.Virtus2020.indd Alle pagina's 11-02-2021 15:19 pp. 33-54 | Sounding identity Joris van Son Sounding identity Music-making in eighteenth-century Dutch noble homes 33 How can a sensible man be satisfied with a wife who thinks about music, singers and string players the whole day? And thus for the whole day dolls up, sits in front of the key board and forgets her housekeeping, husband and children?1 This normative statement by the moralist writer Cornelius van Engelen (17261793) gives insight into ideas about music and women in eighteenthcentury Dutch domes tic culture. Seeing housekeeping and raising children as the primary duties of mar ried women, he portrays music as a diverting but unproductive pastime. Does this imply that little music sounded in Dutch homes of the period, or that it was the sole province of men? On the contrary, the opposite is more likely. -

Isabelle De Charrière and the Novel in the 18Th Century
oratie opmaak 31-03-2005 14:12 Pagina 3 Monique Moser-Verrey Isabelle de Charrière and the Novel in the 18th Century English translation by Viorel-Dragos Moraru Faculteit der Letteren oratie opmaak 31-03-2005 14:12 Pagina 2 Oratie 6 april 2005 oratie opmaak 31-03-2005 14:12 Pagina 3 Monique Moser-Verrey Isabelle de Charrière and the Novel in the 18th Century English translation by Viorel-Dragos Moraru Faculteit der Letteren oratie opmaak 31-03-2005 14:12 Pagina 4 To the organizers of the conference Belle de Zuylen / Isabelle de Charrière : Education & Creation Utrecht, April 2005 Suzan van Dijk Yvette Went-Daoust Madeleine van Strien-Chardonneau 4 oratie opmaak 31-03-2005 14:12 Pagina 5 Isabelle de Charrière and the Novel in the 18th Century La Princesse de Clèves, Manon Lescaut, Werther, voilà à mon avis en fait de roman la gloire de la France et de l’Allemagne. (4 avril 1795; V, 79)1 The Belle van Zuylen chair was held ten years ago by Professor Cecil Courtney, a prominent specialist of Isabelle de Charrière’s life and works to whom I owe a lot. In his oratie titled “Belle van Zuylen and Philosophy” he gave a brilliant account of the way in which the works and thoughts of this remarkable 18th-century woman writer were rediscovered in the last decades of the 20th century. Having con- tributed to the critical edition of Belle de Zuylen/Isabelle de Charrière’s complete works and having published himself a splendid biography, he noted though that “no comprehensive study of Belle de Zuylen’s art as a novelist or letter-writer” existed to the date. -
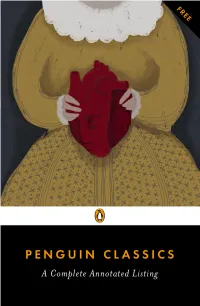
Penguin Classics
PENGUIN CLASSICS A Complete Annotated Listing www.penguinclassics.com PUBLISHER’S NOTE For more than seventy years, Penguin has been the leading publisher of classic literature in the English-speaking world, providing readers with a library of the best works from around the world, throughout history, and across genres and disciplines. We focus on bringing together the best of the past and the future, using cutting-edge design and production as well as embracing the digital age to create unforgettable editions of treasured literature. Penguin Classics is timeless and trend-setting. Whether you love our signature black- spine series, our Penguin Classics Deluxe Editions, or our eBooks, we bring the writer to the reader in every format available. With this catalog—which provides complete, annotated descriptions of all books currently in our Classics series, as well as those in the Pelican Shakespeare series—we celebrate our entire list and the illustrious history behind it and continue to uphold our established standards of excellence with exciting new releases. From acclaimed new translations of Herodotus and the I Ching to the existential horrors of contemporary master Thomas Ligotti, from a trove of rediscovered fairytales translated for the first time in The Turnip Princess to the ethically ambiguous military exploits of Jean Lartéguy’s The Centurions, there are classics here to educate, provoke, entertain, and enlighten readers of all interests and inclinations. We hope this catalog will inspire you to pick up that book you’ve always been meaning to read, or one you may not have heard of before. To receive more information about Penguin Classics or to sign up for a newsletter, please visit our Classics Web site at www.penguinclassics.com. -

The Eighteenth-Century Emigrant, Crossing Literary Borders
L’É RUDIT FRANCO -ESPAGNOL , VOLUME 2, FALL 2012 The Eighteenth-Century Emigrant, Crossing Literary Borders Melissa Wittmeier Northwestern University Few today would argue that France is not a good example of a nation-state with a culturally homogenous group sharing a common language, common institutions, and a common historical experience under laws established by the body politic for the whole of the territory. Nor would many argue that the French Revolution and its aftermath did not play an instrumental role in the formation of the nation-state that exists today. The transition from the Old Regime to the French Republic required a redefinition of the patrie . This task was necessarily facilitated by literature and the written word both during and after the Revolution. As other studies have demonstrated, contemporary works by and about French émigrés contributed to the formation of a new national identity.1 The contributions that these works made, however, were a function of the authors’ own identities and experiences. Works about émigrés simultaneously intellectualize and romanticize the exile experience, whereas works written by émigrés sanction and lament it without attempting to rationalize it (Weiner). Although authors tend to disappear behind the text of many literary genres, they tend to remain visible in the context of the émigré . Studies on the eighteenth-century French émigrés —those citizens who felt inclined or compelled to leave their homeland to reach foreign soil during the Revolution and its aftermath—have at once highlighted the diverse nature of the texts featuring them and underscored their similarities. Émigrés may appear in one work to be stereotypes and in another to be very real and, above all, very human figures. -

Isabelle De Charrière Et Jean-Jacques Rousseau
Isabelle de Charrière et Jean-Jacques Rousseau COMMUNICATION DE RAYMOND TROUSSON A LA SEANCE MENSUELLE DU 9 FÉVRIER 1985 a critique a souvent souligné l’étendue insolite de la culture de Mme de L Charrière. Romancière, essayiste, dramaturge, musicienne, brillante épistolière, son existence fut peu heureuse, d’abord, en dépit du nombre élevé de ses soupirants, dans un célibat prolongé jusqu’à la trentaine, puis dans un mariage décevant dont naîtra l’amertume des Lettres de Mistriss Henley. Aussi a-t-elle peut- être vécu surtout par l’esprit, entourée d’un petit cercle de familiers, entretenant une abondante correspondance. Jeune fille, elle s’épanche, parfois avec une rare audace, auprès de Constant d’Hermenches ; plus tard, la cinquantaine proche, elle noue avec Benjamin Constant une difficile relation intellectuelle et sentimentale. Un peu partout dans ces textes se font jour son amour des lettres, son attachement à l’esthétique classique. Spirituelle et diserte, elle y multiplie les jugements personnels sur les écrivains d’autrefois et de son temps. Parmi ces derniers, Rousseau devait tenir une place privilégiée, non seulement en raison d’une célébrité tapageuse qui le disputait à celle de Voltaire, mais aussi parce que Mme de Charrière a vécu, à Neuchâtel, dans un milieu où le souvenir du Genevois était demeuré vivace. N’est-elle pas l’intime de Pierre-Alexandre Du Peyrou, ami fidèle de Jean-Jacques et dépositaire de ses manuscrits ? Elle-même, de 1789 à 1790, écrit sur Rousseau quelques-unes des pages les plus originales de l’époque, entre en lice avec Mme de Staël en s’instituant le champion de Thérèse Levasseur, prend une part active dans la publication par Du Peyrou de la seconde partie des Confessions. -

Cahiers ISABELLE DE CHARRIERE BELLE DE ZUYLEN Papers
Cahiers ISABELLE DE CHARRIERE BELLE DE ZUYLEN Papers * Isabelle de Charrière et ses divers violons d’Ingres * Belle de Zuylen, music and art * Genootschap Belle van Zuylen 2011 No 6 Le comité de rédaction Isabelle de Charrière et ses divers violons d’Ingres Présentation du thème Depuis quelques années, des musiciens – aux Pays-Bas aussi bien qu’en Suisse – se sont mis à jouer et à présenter au public les compositions musi- cales d’Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen 1. On peut penser à Antoinette Lohmann 2, Paule Van Parys 3, Valérie Winteler 4, Christine Brandenburg avec son ensemble Zélide 5, et la Van Swieten Society, dirigée par Bart van Oort 6. Charrière musicienne ? L’intérêt nouveau porté à Isabelle de Charrière musicienne pourrait sur- prendre ceux qui connaissent l’opinion de Marius Flothuis sur ce sujet. Ce musicologue néerlandais, qui a collaboré à l’édition des Œuvres complètes commence ainsi, en 1975, un article : Soyons honnêtes: si nous nous intéressons aux compositions musicales de Belle van Zuylen, ce n’est pas en premier lieu pour des raisons purement musicales. […] L’insignifiance relative de ses œuvres musicales se révèle dès le premier abord […] 7 1 Le site web de l’Association néerlandaise Isabelle de Charrière présente une liste comportant tous les enregistrements dont nous avons connaissance. Voir : http://www.belle-van-zuylen.eu, sous « Muziek ». 2 Violoniste qui a réalisé avec le Utrechts Barok Consort un CD intitulé Belle van Zuylen/Mme de Charrière, een muzikaal verhaal (2005). 3 La claveciniste Paule Van Parys a joué des morceaux de Belle de Zuylen à l’occa- sion du bicentenaire de la mort de la romancière. -

Chapter II - Isabelle De Charrière: Her Career and Preoccupations As a Novelist
Chapter II - Isabelle de Charrière: Her career and preoccupations as a novelist The Novels of Isabelle de Charriere by Dennis Wood Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken, generally known to literary historians as Belle de Zuylen or Belle van Zuylen, was born on 20 October 1740 and received a private education at the family seat, Slot Zuylen, near Utrecht 1. From her earliest years she spoke and wrote French with great facility and was familiar with the works of the best French authors. She was an impulsive girl with a mind of her own, and was critical of the humdrum world of the Dutch provincial aristocracy which was epitomized in the personality of her father, Baron van Tuyll van Serooskerken, a thoroughly respectable man, but dour and rather stern. In later years Belle de Zuylen inevitably came into conflict with the rigid system of beliefs of this formidable figure. We are fortunate in possessing a written self-portrait by Belle which dates from her formative years and which gives us an impression of the unusual and highly intelligent personality that was imprisoned in such spiritually deadening surroundings: Compatissante par tempérament, libérale et généreuse par penchant, Zélide n’est bonne que par principe; quand elle est douce et facile, sachez-lui en gré, c’est un effort. Quand elle est longtemps civile et polie avec des gens dont elle ne se soucie pas, redoublez d’estime, c’est un martyre. Naturellement vaine, sa vanité est sans bornes: la connaissance et le mépris des hommes lui en eurent bientôt donné [...] Tendre à l’excès, et non moins délicate, elle ne peut être heureuse ni par l’amour, ni sans amour. -

Annotated Books Received
ANNOTATED BOOKS RECEIVED TABLE OF CONTENTS Philosophy and Religion....................................................44 Literary Works Reference............................................................................46 Anthologies..........................................................................1 Reprints ..............................................................................47 Reprints ................................................................................4 Social Sciences...................................................................48 Arabic...................................................................................7 Translation Studies.............................................................48 Catalan. ................................................................................7 Index of Translators ..........................................................51 Chinese.................................................................................7 Directory of Publishers ......................................................55 Croatian................................................................................8 Czech....................................................................................8 LITERARY WORKS Dutch....................................................................................8 ANTHOLOGIES Estonian................................................................................9 Finnish..................................................................................9 -

The Novels of Isabelle De Charriere (1740-1805)
The Novels of Isabelle de Charriere (1740-1805) by Dennis Wood Table of Contents • Abbreviations Used • Retrospect (1998) • Chapter I • Chapter II • Chapter III • Chapter IV • Chapter V • Chapter VI • Chapter VII • Conclusion • Bibliography © Dennis Wood , 1998 Abbreviations used The Novels of Isabelle de Charriere (1740-1805) by Dennis Wood A.J.F.S. Australian Journal of French Studies Simone Balayé Les carnets de voyage de Madame de Staël. Contribution à la genèse de ses œuvres (Geneva, 1971) Dorette Berthoud Madame de Charrière et Isabelle de Gélieu . Extrait des Actes de la Société jurassienne d’Emulation, Année 1971 (Imprimerie Roger Pfeuti, La Neuveville [1971]) B.V.N Bibliothèque publique de la Ville de Neuchâtel (of manuscript material) [since 1983 Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel] Constant Benjamin Constant, Œuvres , ed. Alfred Roulin [and Charles Roth] (Paris, 1957) Essai Frau von Staëls Essai sur les fictions (1795) mit Gœthes Übersetzung (1796) herausgegeben von J. Imelmann (Berlin, 1896) Godet Madame de Charrière et ses amis d’après de nombreux documents inédits (1740-1805) (Geneva, 1906), 2 vols. Honorine Honorine d’Userche, nouvelle de l’abbé de la Tour, suivie de trois dialogues (Leipzig, 1798) Le Noble Le Noble, conte moral (Amsterdam, 1763) Lettres à d’Hermenches Lettres de Belle de Zuylen (Madame de Charrière) à Constant d’Hermenches 1760-1775 , ed. Philippe Godet (Paris and Geneva, 1909) L.L. Lettres écrites de Lausanne: Histoire de Cécile. Caliste , avec une préface de Philippe Godet (Geneva, 1907) L.N. Lettres neuchâteloises, Mistriss Henley, Le Noble , avec une préface de Philippe Godet (Geneva, 1907) M.L.R. -

Belle Van Zuylen/Isabelle De Charriere (1740-1805) Tradition and Defiance
BELLE VAN ZUYLEN/ISABELLE DE CHARRIERE (1740-1805) TRADITION AND DEFIANCE Margriet Bruyn Lacy North Dakota State University Fargo (NO), USA Belle van Zuylen was born on October 20,1740 in the Netherlands, and she resided in that country until her marriage in 1771. She then lived mostly in Switzerland, until her death on December 27, 1805. She wrote several novels, essays, plays, short stories, and pamphlets, but is be~t known for her extensive correspondence. Belle van Zuylen, or more precisely, on her ability to reason, which accounts to Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van a large extent for her skepticism towards Serooskerken (1740-1805), belonged to a religion, in particular towards revelation. prominent, aristocratic, Protestant family in Thus, she wrote to Boswell: the Netherlands, the country where she lived until she moved to Switzerland in Everything tells me that there is a God, an 1771. One might say that she was a "black eternal, perfect, and all-powerful being .... sheep" in her family and in her society, Revelation has qualities of grandeur, because she was quite independent goodness, and mercy which are infinitely intellectually and did not hesitate to express entitled to our respect; if I understood it her often original ideas on any number of better, I should perhaps recognize the marks of divinity in it throughout; but I am held subjects, such as religion, marriage, the back by much that is obscure, and by what relationship between parents and children, appear to me contradictions. I doubt, and I and education, to name just a few. These keep my doubts to myself; I should think it topics were important to her because of the a crime to destroy the belief of others when role they each played in her own life, but I can replace it only by an anxious doubt.