2. a L'arrière Sur La Vesle
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
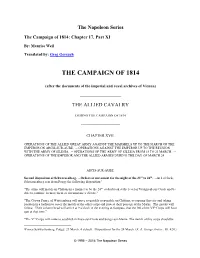
The Campaign of 1814: Chapter 17, Part XI
The Napoleon Series The Campaign of 1814: Chapter 17, Part XI By: Maurice Weil Translated by: Greg Gorsuch THE CAMPAIGN OF 1814 (after the documents of the imperial and royal archives of Vienna) _____________________ THE ALLIED CAVALRY DURING THE CAMPAIGN OF 1814 ________________________ CHAPTER XVII. OPERATIONS OF THE ALLIED GREAT ARMY AGAINST THE MARSHELS UP TO THE MARCH OF THE EMPEROR ON ARCIS-SUR-AUBE. -- OPERATIONS AGAINST THE EMPEROR UP TO THE REUNION WITH THE ARMY OF SILESIA. -- OPERATIONS OF THE ARMY OF SILESIA FROM 18 TO 23 MARCH. -- OPERATIONS OF THE EMPEROR AND THE ALLIED ARMIES DURING THE DAY OF MARCH 24. _________ ARCIS-SUR-AUBE. Second disposition of Schwarzenberg. --Orders of movement for the night of the 23rd to 24th. --At 4 o'clock, Schwarzenberg sent from Pougy the following disposition:1 "The army will march on Châlons in a manner to be the 24th at daybreak at the level of Vésigneul-sur-Coole and be able to continue its movement as circumstances dictate." "The Crown Prince of Württemberg will move as quickly as possible on Châlons, occupying this city and taking position in a fashion to cover the march of the other corps and protect their passage of the Marne. The guards will follow. Their column head will arrive at 9 o'clock in the evening at Sompuis, that the left of the VIth Corps will have quit at that time." "The Vth Corps will come to establish in Faux-sur-Coole and Songy-sur-Marne. The march of this corps should be 1Prince Schwarzenberg, Pougy, 23 March, 4 o'clock. -
FROM the KITCHEN FIZZ FRIES All Fries Served with Housemade Champagne Aoili
FROM THE KITCHEN FIZZ FRIES All fries served with housemade champagne aoili. Additional orders of aoli will incur a charge of $1.00. DUCK FAT FRIES P Tossed with truffle salt and served AwithM champagneA G aioli H N E Regular | $8 C Large | $15 PESTO FRIES Tossed with housemade pesto, balsamic reduction drizzle, and topped with shaved parmigiano reggiano Family Size | $18 BALLER FRIES These take our regular duck fat fries to a whole other level! Duck fat truffle fries drizzled with champagne aioli and creme fraiche, topped with a soft boiled egg, fresh chopped avocado, chives, fried prosciutto, and a dollop of caviar. Family Size | $25 OYSTERS IN THE HALF SHELL* Served with champagne mignonette sauce and lemon wedge Half Dozen | $20 B Dozen | $36 R U A CHEESE BOARDSH B B B Served with baguette, almond nuts & figL jamE S 3 Cheeses | $15 - 5 Cheeses | $19 - 7 Cheeses | $24 RUSTIC WHITE BEAN CROSTINI | $14 Seasoned white beans tossed with a blend of carrots, cellary, and onions topped fried sage on house made crostini OLIVES | $8 Pitted olives, marinated with herbs & red wine CHARCUTERIE & CHEESE BOARD | $21 CROQUE MONSIEUR | $13 French sandwich of grilled french ham, gruyere cheese, with champagne apple honey sauce - Add a sunnyside up egg for + $2 CAVIAR* 30g 50g Sterling - Classic Sturgeon $40 $60 Sterling - Supreme Sturgeon $65 $95 Served with choice of gluten free crackers or chips, or crème fraiche with chives WILD MUSHROOM & ARUGULA SALAD | $12 With shaved fennel, parmigiano reggiano, crushed almond nuts, tossed with champagne vinaigrette AVOCADO TOAST WITH SOFT BOILED EGG* | $12 With Caviar | $12 Seasoned with truffle salt & fresh ground pepper FIZZ FLOAT | $13 Berry sorbet topped with a floater of sparkling rose! CHOCOLATE PAIRING | $15 Enjoy three different artisan small batch chcolates to accompany your fizz *CONTAIN (or may contain) raw or undercooked ingredients. -

ELECTIONS MUNICIPALES 1Er Tour Du 15 Mars 2020
ELECTIONS MUNICIPALES 1er tour du 15 Mars 2020 Livre des candidats par commune (scrutin plurinominal) (limité aux communes du portefeuille : Arrondissement de Reims) Page 1 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Anthenay (Marne) Nombre de sièges à pourvoir : 7 M. ALLART David Mme BENDJEGUELLAL Yasmina M. BERNIER Alain M. BERNIER Marc-Antoine Mme DELACOURT Sylvie M. DIOUY Guy M. DIOUY Hervé M. GUIDEZ Bruno Mme LAURIN Cathy M. MOREAU Hubert M. NAEYAERT Nicolas M. VINCENT Yannick Page 2 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Aougny (Marne) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. AUBIN Eric Mme AUBIN Sylvie M. BERLOT Christian M. BERNARDO François M. DHUICQ Benôit M. FAILLIOT Sébastien M. LEQUART Alain M. LEROY Frédéric M. MERCIER Julien M. POUGNIET Aymeric M. RAMBOUT Raphaël M. RAULIN Bruno M. VAN DRIESSCHE Benoît Page 3 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Arcis-le-Ponsart (Marne) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. BERNIER David M. BILLET Julien M. COPET Frédéric M. DUBOIS Jean-Luc Mme GUILLEMIN Aude M. JOBERT Antoine M. MALAPEL Bernard M. PELLETIER Guillaume M. PIERROT Gérard M. PILORGET Stéphane Page 4 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Aubérive (Marne) Nombre de sièges à pourvoir : 11 Mme ALLART Nadine M. CAMUS Nicolas M. CARRY David M. FAVRE Vincent M. GALICHET Jean-Paul M. GILLE Fabrice M. JACQUET Thierry M. LEMERY Basile M. LOGIE Emmanuel M. LORIN Gérald M. -

Synthèse Collecte Marne Printemps 2021
Sites et dates de collecte_Marne_Printemps 2021 Filet / Ficelle / Ensilage / Big-bags et sacs d'engrais / Distributeur Sites Bidons, boîtes et sacs Enrubannage Sacs papier de semences COLIGNY 19 au 23 avril 2021 POMACLE VILLE EN TARDENOIS 19 au 23 avril 2021 GOURGANCON CERESIA 19 avril au 21 mai 2021 LE GAULT SOIGNY PONTFAVERGER-MORONVILLIERS 19 au 23 avril 2021 PROSNES REIMS BERGERES LES VERTUS DORMANS ECUEIL MARDEUIL ACOLYANCE VIGNE OIRY Collecte permanente REIMS RILLY LA MONTAGNE TREPAIL VERZY AVIZE COMPAS CHATILLON SUR MARNE Collecte permanente DAMERY Filet / Ficelle / Ensilage / Big-bags et sacs d'engrais / Distributeur Sites Bidons, boites et sacs Enrubannage Sacs papier de semences DORMANS GUEUX LUDES MANCY OIRY COMPAS Collecte permanente SAINT AMAND SUR FION SAINT THIERRY SERZY ET PRIN SEZANNE VERTUS COOPERATIVE AGRICOLE DE JUNIVILLE WARMERIVILLE 26 et 27 mai 2021 ANGLURE COLIGNY 19 et 20 mai 2021 NOVAGRAIN SEZANNE LE THOULT TROSNAY 26 et 27 avril 2021 CONFLANS SUR SEINE COOPERATIVE AGRICOLE D'ESTERNAY ESTERNAY 14 et 15 avril 2021 2 et 3 juin 2021 VILLENEUVE LA LIONNE AVIZE BOUZY CONGY DORMANS EPERNAY COOPERATIVE DU SYNDICAT GENERAL MAILLY CHAMPAGNE Collecte permanente DES VIGNERONS - CSGV MUIZON PIERRY PORT A BINSON SEZANNE VERTUS VILLEDOMMANGE ETS RITARD CHARLES ESCLAVOLLES LUREY Collecte permanente ANGLURE 17 au 21 mai 2021 SOUFFLET AGRICULTURE HUIRON 17 au 21 mai 2021 Filet / Ficelle / Ensilage / Big-bags et sacs d'engrais / Distributeur Sites Bidons, boites et sacs Enrubannage Sacs papier de semences LE FRESNE 17 au 21 mai -

Cartographie Des Réseaux De Défense Du Front Ouest Durant La Première
Cartographie des réseaux de défense du front ouest durant la Première Guerre Mondiale à différentes échelles Le programme de recherche « Emergence » IMPACT 14-18 a, entre autre, pour objectif d’étudier l’organi- 590000 680000 770000 860000 950000 1040000 sation spatiale des réseaux de défense en Champagne-Ardenne durant la Grande Guerre vis-à-vis de Légende : Dunkerque Classes d'altitude (mètres) : 7120000 R! la géomorphologie. Cette étude sous SIG replace dans leur contexte environnemental les infrastructures 0 40 Ville fortifiée du premier réseau 100 150 250 400 600 BELGIQUE 1000 2000 Séré de Rivières Frontières actuelles Ville fortifiée du second réseau militaires digitalisées à partir des plans directeurs produits par les Groupes de Canevas de Tir des Lille Frontière franco-allemande en 1914 Séré de Rivières Territoire annexé par l’Allemagne en 1871 Fort indépendant Armées (GCTA). Ces documents constituent une formidable banque de données cartographiques, posant Arras ! Réseau hydrographique Localité R!R R! Front de cuesta Couloir privilégié d’invasion ; trouée Maubeuge 7040000 Arras R! Limite des massifs anciens Front au 15/11/1914 les bases de la cartographie moderne (Projection Lambert, courbes de niveaux,...). R! R! Trouée de Massif Ardennais Chimay Amiens R! R! 765000 770000 775000 780000 La Suippe La Fère R! ! LUXEMBOURG Rideau 4 Légende : 6960000 Laon ! R! R! Classes d’altitude (mètres) : Trouée de ALLEMAGNE Reims Stenay ! Verdun Metz 40 100 135 170 205 330 Châlons- R! sur-Marne R! Paris R! 1ère ligne alliée au 12/10/1917 6880000 -

VALLEE DE LA VESLE DE LIVRY-LOUVERCY a COURLANDON (Identifiant National : 210000726)
Date d'édition : 27/10/2020 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210000726 VALLEE DE LA VESLE DE LIVRY-LOUVERCY A COURLANDON (Identifiant national : 210000726) (ZNIEFF Continentale de type 2) (Identifiant régional : 01520000) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN, G.R.E.F.F.E., .- 210000726, VALLEE DE LA VESLE DE LIVRY-LOUVERCY A COURLANDON. - INPN, SPN-MNHN Paris, 75P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210000726.pdf Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne Rédacteur(s) :MORGAN, G.R.E.F.F.E. Centroïde calculé : 724728°-2471445° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 24/06/2003 Date actuelle d'avis CSRPN : 23/09/2020 Date de première diffusion INPN : 23/10/2020 Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 6 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 6 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 6 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 7 6. HABITATS ...................................................................................................................................... 7 7. ESPECES .................................................................................................................................... -

Compte-Rendu Du Conseil Municipal Du 6 Février 2019
République Française Département MARNE TRIGNY Compte rendu de séance Séance du 6 Février 2019 L' an 2019 et le 6 Février à 20 heures , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances ,Salle de Conseil sous la présidence de BLIN Francis Maire Présents : M. BLIN Francis, Maire, Mmes : LAMOUREUX Pascale, TOUTAIN Anne, MM : CHAMELOT Jérôme, DIVOUX Grégory, GUILLEMART Anthony, HUTTAUX Sébastien, LONGUET Laurent, ROGE Jean-Claude, TISON Michel Excusé(s) : M. LONGUET Guillaume Absent(s) ayant donné procuration : Mme GOULARD Florence à M. HUTTAUX Sébastien, M. RODRIGUEZ Gérard à Mme TOUTAIN Anne Absent(s) : Mme BERTRAND Armelle, M. PETIT Benjamin Nombre de membres • Afférents au Conseil municipal : 15 • Présents : 10 Date de la convocation : 29/01/2019 Date d'affichage : 29/01/2019 Acte rendu exécutoire après dépôt en SOUS-PREFECTURE DE REIMS le : 24/05/2017 et publication ou notification du : 24/05/2017 A été nommé(e) secrétaire : Mme TOUTAIN Anne Objet(s) des délibérations SOMMAIRE • Délib n° 2019_01 : Vente du lot n°6 au lotissement "Le Fond du Poirier" • Délib n° 2019_02 : Création d’un poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences • Délib n° 2019_03 : Autorisation de signer une convention avec les Associations Foncières de Rosnay, Muizon et Gueux- Vrigny ainsi qu'avec les Associations Syndicales Autorisées de Trigny et de Chenay • Délib n° 2019_04 : Remplacement des radiateurs dans le bâtiment, Petite Rue de l'Eglise • Délib n° 2019_05 : Programme Local de l’Habitat du Grand Reims Période 2019-2024 - Avis du conseil municipal • Délib n° 2019_06 : Adhésion à la Centrale d'Achat de la Communauté Urbaine du Grand Reims Après approbation du compte rendu de la séance précédente, Monsieur le Maire rappelle que le lot n° 6 du lotissement "Le Fond du Poirier" avait déjà fait l'objet d'une délibération acceptant de le vendre à Mr ZNATI. -

COVID-19 : Le Point Sur La Gestion Des Déchets En Date Du 20 Mars 2020
20/03/2020 messagerie pro COVID-19 : le point sur la gestion des déchets en date du 20 mars 2020 TRI INFO <[email protected]> vendredi 20 mars 2020 à 09:00 réception À : DUPIN Martial , GRAMMONT Didier , MAIRIE ANTHENAY , MAIRIE D AOUGNY , MAIRIE D AOUGNY , MAIRIE D ARCIS LE PONSART , MAIRIE D ARCIS LE PONSART , MAIRIE D AUBILLY , MAIRIE D AUBILLY , MAIRIE D ORMES , MAIRIE D ORMES , MAIRIE DE BASLIEUX LES FISMES , MAIRIE DE BLIGNY , MAIRIE DE BLIGNY , MAIRIE DE BOUILLY , MAIRIE DE BOUILLY , MAIRIE DE BOULEUSE , MAIRIE DE BOULEUSE , MAIRIE DE BOUVANCOURT , MAIRIE DE BRANSCOURT , MAIRIE DE BRANSCOURT , MAIRIE DE BREUIL SUR VESLE , MAIRIE DE BREUIL SUR VESLE , MAIRIE DE BROUILLET , MAIRIE DE BROUILLET , MAIRIE DE CHÂLONS SUR VESLE , MAIRIE DE CHAMBRECY , MAIRIE DE CHAMBRECY , MAIRIE DE CHAMERY , MAIRIE DE CHAMERY , MAIRIE DE CHAUMUZY , MAIRIE DE CHENAY , MAIRIE DE CHENAY , MAIRIE DE COULOMMES LA MONTAGNE , MAIRIE DE COULOMMES LA MONTAGNE , MAIRIE DE COURCELLES - SAPICOURT , MAIRIE DE COURCELLES - SAPICOURT , MAIRIE DE COURLANDON , MAIRIE DE COURLANDON , MAIRIE DE COURMAS , MAIRIE DE COURMAS , MAIRIE DE COURTAGNON , MAIRIE DE COURTAGNON , MAIRIE DE COURVILLE , MAIRIE DE COURVILLE , MAIRIE DE CRUGNY , MAIRIE DE CRUGNY , MAIRIE DE CUISLES , MAIRIE DE CUISLES , MAIRIE DE FAVEROLLES ET COËMY , MAIRIE DE FAVEROLLES ET COËMY , MAIRIE DE FISMES , MAIRIE DE FISMES , MAIRIE DE GERMIGNY , MAIRIE DE GUEUX , MAIRIE DE GUEUX , MAIRIE DE GUEUX , MAIRIE DE HOURGES , MAIRIE DE HOURGES , MAIRIE DE JANVRY , MAIRIE DE JANVRY , MAIRIE DE JONCHERY SUR VESLE -

3. La Deuxième Bataille De La Marne
3 ‐ LA DEUXIEME BATAILLE DE LA MARNE juin à septembre 1918 A l'observatoire du Mont Sinaï, en juillet 1918, le Général Gouraud assiste à la défaite allemande. Le dispositif de la 45ème DI française dans le massif de St‐Thierry et le dispositif de la 21ème DW anglaise. Les 27,28 et 29 mai ; un désastre pour la 45ème Division On le savait, l’attaque allemande devait se produire le 27 mai sur le Chemin des Dames. La 6ème Armée du Général Duchêne était prête. A une heure du matin, plus de mille batteries vont, pendant deux heures et quarante minutes, tirer sur 90 Km de front et 12 km en arrière des lignes, utilisant massivement les obus à gaz. Les batteries françaises et anglaises sont neutralisées. A 3 heures 40, la 7ème Armée de von Boehm et la 1ère de von Bulow partent à l'assaut. A midi, l'Aisne est franchie. Au soir, devant Loivre, la route de Laon est dépassée, Bouvancourt est occupé. Le 28, en face, la 45ème DI tente de résister sur la ligne : Butte de Prouilly, col de Trigny‐Marzilly, hauteurs de Toussicourt, Villers‐Franqueux, Bois de Chauffour, Courcy, en liaison à droite avec la 134ème DI sur les cavaliers de Courcy. Mais l'avance allemande continue. A 21 h, les Allemands tiennent Thil. Le fort de St‐Thierry est pris à 18 h 30. La pression allemande est forte entre le col de Trigny (route d'Hermonville) et la butte de Prouilly. Le 29, ordre est donné de quitter la rive droite de la Vesle. -

THE FIRST BATTLE of the MARNE September 1914
THE FIRST BATTLE OF THE MARNE September 1914 The battle of Thillois During the night of the 11th September, the 3rd army corps from the Vth Army (General Hache) received the mission to head the following day towards la Vesle in the direction of the Saint‐Thierry Fort and Thillois. On the 12th September, the two divisions started marching. Pétain’s 6th infantry division, on the left, was on its way to Rosnay, Muizon, Châlons‐sur‐Vesle and Saint‐Thierry’s fort. General Mangin’s 5th infantry division headed towards Méry‐Prémecy, Gueux and Thillois. The 5th division marched without any trouble until the 204 hill, 2km south‐west from Gueux. Around 10 o’clock, the news broke: Gueux had just been evacuated and the road from Gueux to Thillois was cut by trenches full of enemy infantry. Two battalions from the 39th infantry regiment were sent towards Thillois and Gueux’s La Garenne. They were under the protection of two batteries based next to the 204 hill. Around noon, the enemy, who had evacuated the trenches between Gueux and Thillois without combat, was resisting in Thillois. The cavalry notified trenches on the north of Thillois, towards Champigny. Around 3 o’clock in the afternoon, the 39th infantry regiment attacked Thillois while the 74th infantry regiment attacked Gueux’s La Garenne. At 5 o’clock, the battle was frozen. The direct attack did not achieve anything. At this point, the artillery entered the battle and set aim for Thillois. The 74th Infantry Regiment, positioned on the East, and the 39th Infantry Regiment began the assault again. -

Compte Rendu Conference 23 09
TRAVAUX EAU- ASSAINISSEMENT – SECTEUR OUEST CENTRE DE GUEUX Conférence territoriale du 23 septembre 019 Sommaire Bilan à mi parcours 2019 Perspectives 2020 V Poursuite des opérations engagées V Nouveaux projets Sujets et questions diverses 1. Bilan + mi-parcours 019 1- Bilan mi parcours 019 Contr-les AC et ANC / !/ / !b/ 9h[L! . 9 A.is sur Autorisations du Droit des sols 5t t ! /#$ ! h
Fiche Structure : Alliance Villes Emploi
Fiche structure : Alliance Villes Emploi - www.ville-emploi.asso.fr TERRITOIRE Pays : France Région : Grand Est Département : (51) Marne Ville : Reims Liste des communes couvertes : Aougny ((51) Marne), Arcis-le-Ponsart ((51) Marne), Aubérive ((51) Marne), Aubilly ((51) Marne), Auménancourt ((51) Marne), Baconnes ((51) Marne), Baslieux-lès-Fismes ((51) Marne), Bazancourt ((51) Marne), Beaumont-sur-Vesle ((51) Marne), Beine-Nauroy ((51) Marne), Berméricourt ((51) Marne), Berru ((51) Marne), Bétheniville ((51) Marne), Bétheny ((51) Marne), Bezannes ((51) Marne), Bligny ((51) Marne), Bouilly ((51) Marne), Bouleuse ((51) Marne), Boult-sur-Suippe ((51) Marne), Bourgogne ((51) Marne), Bouvancourt ((51) Marne), Branscourt ((51) Marne), Breuil ((51) Marne), Brimont ((51) Marne), Brouillet ((51) Marne), Caurel ((51) Marne), Cauroy-lès-Hermonville ((51) Marne), Cernay-lès-Reims ((51) Marne), Châlons-sur-Vesle ((51) Marne), Chambrecy ((51) Marne), Chamery ((51) Marne), Champfleury ((51) Marne), Champigny ((51) Marne), Chaumuzy ((51) Marne), Chenay ((51) Marne), Chigny-les-Roses ((51) Marne), Cormicy ((51) Marne), Cormontreuil ((51) Marne), Coulommes-la-Montagne ((51) Marne), Courcelles-Sapicourt ((51) Marne), Courcy ((51) Marne), Courlandon ((51) Marne), Courmas ((51) Marne), Courville ((51) Marne), Crugny ((51) Marne), Dontrien ((51) Marne), Écueil ((51) Marne), Époye ((51) Marne), Faverolles-et-Coëmy ((51) Marne), Fismes ((51) Marne), Fresne-lès-Reims ((51) Marne), Germigny ((51) Marne), Gueux ((51) Marne), Hermonville ((51) Marne), Heutrégiville