Grand Rodez Pays D'art Et D'histoire
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tableau Récapitulatif Des Risques Par Commune
ddrm-12 Tableau départemental des risques par commune LES RISQUES Nombre Commune Inondation Mouvement Incendie Industirel Rupture Transport de de de de de barrage matières risques terrain forêt dangereuses accidents de par poids lourds voie ferrée AGEN D’AVEYRON X 1 AGUESSAC X X 2 ALMONT LES JUNIES X 1 AMBEYRAC X X 2 ARNAC SUR DOURDOU X 1 ARVIEU X 1 ASPRIERES X 1 AUBIN X X X X 4 AUZITS X X 2 BALAGUIER D’OLT X X X 3 BELCASTEL X 1 BELMONT SUR RANCE X 1 BERTHOLENE X X 2 BESSUEJOULS X X 2 BOISSE PENCHOT X X X 3 BOR ET BAR X X 2 BOUILLAC X X X X 4 BOURNAZEL X 1 BOZOULS X 1 BROMMAT X 1 BROQUIES X X 2 BROUSSE LE CHATEAU X 1 BRUSQUE X X 2 CALMONT X X X 3 CAMARES X X 2 CAMBOULAZET X 1 CAMJAC X 1 CAMPOURIEZ X 1 CANET DE SALARS X 1 CANTOIN X 1 CAPDENAC GARE X X X 3 BARAQUEVILLE X 1 CASSAGNES BEGONHES X X 2 CASTELNAU de MANDAILLES X 1 CENTRES X 1 CLAIRVAUX X 1 COMPEYRE X X 2 COMPOLIBAT X 1 COMPREGNAC X 1 COMPS LA GRAND VILLE X 1 CONQUES X X 2 CORNUS X 1 COSTES GOZON (Les) X 1 COUBISOU X 1 COUPIAC X 1 COUSSERGUES X 1 CRANSAC X X X 3 CREISSELS X X X 3 CRESPIN X X X 3 CRESSE (La) X 1 DECAZEVILLE X X X X 4 DRUELLE X 1 FEL (Le) X 1 ENTRAYGUES SUR TRUYERE X X X 3 ESPALION X X X 3 ESPEYRAC X 1 ESTAING X X X 3 FIRMI X X X 3 FLAGNAC X X X 3 FLAVIN X X 2 FLORENTIN LA CAPELLE X 1 GAILLAC D’AVEYRON X X 2 Edition 2008 / page 144 ddrm-12 LES RISQUES Nombre Commune Inondation Mouvement Incendie Industirel Rupture Transport de de de de de barrage matières risques terrain forêt dangereuses accidents de par poids lourds voie ferrée GOLINHAC X 1 GRAND VABRE X X 2 LACROIX -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°12-2018-002 Publié Le 2 Janvier 2018
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°12-2018-002 AVEYRON PUBLIÉ LE 2 JANVIER 2018 1 Sommaire Préfecture Aveyron 12-2018-01-02-024 - archidep VENTURINI 02 janvier 2018 (3 pages) Page 4 12-2018-01-02-002 - Arrêté médaille d'honneur agricole (2 pages) Page 8 12-2018-01-02-003 - Arrêté médaille d'honneur régionale, départementale et communale (32 pages) Page 11 12-2018-01-02-018 - ars Occitanie CAVALIER 02 janvier 2018 (9 pages) Page 44 12-2018-01-02-019 - aviatcivsud 31 AYOUN 02 janvier 2018 (3 pages) Page 54 12-2018-01-02-006 - chef équipe tech BIL SOUBRIE 02 janvier 2018 (1 page) Page 58 12-2018-01-02-010 - cuisinier NOLORGUES 02 janvier 2018 (1 page) Page 60 12-2018-01-02-025 - dasen CAMBE délégation générale 02 janvier 2018 (2 pages) Page 62 12-2018-01-02-005 - dcl SALVIGNOL 02 janvier 2018 (2 pages) Page 65 12-2018-01-02-004 - dcppat BSANYAS 02 janvier 2018 (2 pages) Page 68 12-2018-01-02-012 - ddcspp CHABANET délégation générale 02 janvier 2018 (6 pages) Page 71 12-2018-01-02-013 - ddcspp CHABANET ordo secondaire 02 janvier 2018 (3 pages) Page 78 12-2018-01-02-027 - ddfip AUGER ordo secondaire 02 janvier 2018 (2 pages) Page 82 12-2018-01-02-026 - ddfip DEFAYS délégation générale 02 janvier 2018 (4 pages) Page 85 12-2018-01-02-028 - ddfip homologation rôles 02 janvier 2018 (1 page) Page 90 12-2018-01-02-029 - ddsp TORRES délégation générale 02 janvier 2018 (2 pages) Page 92 12-2018-01-02-030 - ddsp TORRES ordo secondaire 02 janvier 2018 (3 pages) Page 95 12-2018-01-02-014 - ddt WENDLING délégation générale 02 janvier 2018 (7 pages) -

Week-End Des 24, 25 Et 26 Février 2017
Désignations des Arbitres - Week-end des 24, 25 et 26 février 2017 Code N° Equipe 1 Equipe 2 Poule Ville Date Heure Nom Prénom Nom Prénom Vendredi 24 février PRM 79 LUC PRIMAUBE BASKET IE - B.C. MARTIEL - 1 PRM LUC/PRIMAUBE 24/02/2017 21:00 TSOULI Mohamed VERCRUYSSE Aimee PRM 80 AVEYRON LOT BASKET ASS. - 2 SO MILLAU PRM CAPDENAC-GARE 24/02/2017 21:00 VERDIER Jean-marc VEDRUNE Henry PRM 84 IE - B.C. D'OLEMPS - 2 EN - BASSIN HOUILLER-B. DU LOT PRM LE MONASTERE 24/02/2017 21:00 CISSE Mamadou OLIVIER Stephanie D2M 56 B.C. RIEUPEYROUSAIN - 2 B.C. D'OLEMPS - 3 D2M RIEUPEYROUX 24/02/2017 21:00 VASSAL Pierre VOSSE Florent D2M 57 CLUB BASKET VALLON BASKET EN SEGALA D2M SAINT-CHRISTOPHE-VALLON 24/02/2017 21:00 HOUMADI Hakim OCULE Thierry D2M 58 RIGNAC BASKET CLUB - 2 SAINT GENIEZ BASKET D2M RIGNAC 24/02/2017 21:00 PILLE Arnaud LAUGIER Joel D2M 60 IE - B.C. MARTIEL - 2 AVEYRON LOT BASKET ASS. - 3 D2M MARTIEL 24/02/2017 21:00 DEVOUGE Eric FABRE Robert PRM 83 B.C. RIEUPEYROUSAIN - 1 IE - AS. B.C. DRUELLE - 2 PRM RIEUPEYROUX 24/02/2017 21:30 VASSAL Pierre VOSSE Florent Samedi 25 février R-U13F 5292 AVEYRON LOT BASKET ASS. PRADINES LOT BASKET B CAPDENAC-GARE 25/02/2017 13:00 MALIDE Elianrif CABANTOUS Nathalie R-U13M 5093 ST. RODEZ AVEYRON BASKET - 1 CAHORSAUZET BASKET B RODEZ 25/02/2017 13:00 TSOULI Mohamed GAUBERT Celine U17F - N2 42 CLUB BASKET VALLON B.C. -

Saison 2019 - 2020
DRUELLE FOOTBALL CLUB Saison 2019 - 2020 Le mot du président … Chers ami(e)s, Je suis heureux de vous présenter le DRUELLE Football Club. Créé au printemps 1974, notre club est encore jeune ; il a beaucoup évolué, partant d’une quinzaine de licenciés pour en être aujourd’hui à plus de 300 licenciés ce qui est exceptionnel pour une commune de 3200 habitants et le place dans les 10 plus gros clubs de l’ Aveyron. Cette progression s’est faite grâce aux différentes valeurs qui depuis le début de sa création, restent fondamentalement ancrées à l’image du club et qui attirent parents, joueurs, et éducateurs. Ces valeurs sont : - L’humilité, qui nous impose de rester toujours dans notre cadre et d’avoir les pieds sur terre comme nous l’impose nos racines ! - Le respect de l’autre, des adversaires, des arbitres, des partenaires, des éducateurs ; le respect mutuel est la condition pour que la compétition élève l’homme, qu’il soit acteur ou spectateur, dans sa dignité - La convivialité, la fraternité, la solidarité, valeurs de base pour construire un environnement qui dure et qui nous aide à sortir d’un quotidien ou ces valeurs sont souvent galvaudées - L’effort, qui permet de réussir à éduquer nos jeunes et à permettre au club de progresser sportivement, preuve avec l’accession de notre équipe senior 1, en R 2, et de l’équipe féminine en R 2 également, ce qui nous situe au 4ème rang des clubs Aveyronnais en terme de hiérarchie sportive Le sport et le football amateur en particulier, sont porteurs de hautes valeurs morales qui en font un moyen d’éducation exceptionnel et un facteur irremplaçable d’épanouissement. -

Re Estre Mairie De Druelle-Balsac Et Mairie De Clairvaux
Topo, ~gui'àe Ranàonnée D'àre estre Mairie de Druelle-Balsac et Mairie de Clairvaux Les 2 écoles de Balsac et Clairvaux-Bruéjouls ainsi que l'accueil de loisirs les Gastadous de l'USEP et les 2 mairies ont souhaité réaliser un projet permettant de relier par un sentier balisé les écoles des 2 villages. Ce chemin est dénommé: de la vigne à la cardabelle. Deux petits circuits validés Handis- ports autour des 2 villages ont également été balisés. LA CAZELLE 1 LA CA5ÈLA ) La volonté de tous les acteurs de travailler la "différence" a impliqué le partenariat avec le Centre Départemental pour Déficients Sensoriels (CDDS) et HANDI SPORT. Une cazeIle est une petite construction en pierre sèche, c'est-à-dire qu'elle est bâtie sans mortier liant les pierres entre elles. On en trouve souvent sur les Causses aveyronnais mais on peut égaIe- Chaque enfant a pu ainsi acquérir la connaissance du territoire et l'attachement à ce ment en trouver dans le Lot par exemple où elle porte généralement le nom de gariote. lieu de vie. Fonction: Origine: Ce projet a permis de: Qu'elle soit incorporée à une muraille ou En grande partie, ces constructions ont été • Créer du lien entre les enfants des 2 écoles indépendante, circulaire ou rectangulaire, construites par les ouvriers agricoles durant • Favoriser des échanges, des activités la caze Ile est, en fonction de sa taille, un le Xlx,me siècle, après avoir défriché les terres simple abri pour une, deux ou trois per- incultes du propriétaire. Les paysans, suite à • Sensibiliser les enfants au patrimoine local: flore, faune, culture de la vigne, petit pa- sonnes. -

3B2 to Ps Tmp 1..96
1975L0271 — EN — 14.04.1998 — 014.001 — 1 This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents ►B COUNCIL DIRECTIVE of 28 April 1975 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive No 75/268/EEC (France) (75/271/EEC) (OJ L 128, 19.5.1975, p. 33) Amended by: Official Journal No page date ►M1 Council Directive 76/401/EEC of 6 April 1976 L 108 22 26.4.1976 ►M2 Council Directive 77/178/EEC of 14 February 1977 L 58 22 3.3.1977 ►M3 Commission Decision 77/3/EEC of 13 December 1976 L 3 12 5.1.1977 ►M4 Commission Decision 78/863/EEC of 9 October 1978 L 297 19 24.10.1978 ►M5 Commission Decision 81/408/EEC of 22 April 1981 L 156 56 15.6.1981 ►M6 Commission Decision 83/121/EEC of 16 March 1983 L 79 42 25.3.1983 ►M7 Commission Decision 84/266/EEC of 8 May 1984 L 131 46 17.5.1984 ►M8 Commission Decision 85/138/EEC of 29 January 1985 L 51 43 21.2.1985 ►M9 Commission Decision 85/599/EEC of 12 December 1985 L 373 46 31.12.1985 ►M10 Commission Decision 86/129/EEC of 11 March 1986 L 101 32 17.4.1986 ►M11 Commission Decision 87/348/EEC of 11 June 1987 L 189 35 9.7.1987 ►M12 Commission Decision 89/565/EEC of 16 October 1989 L 308 17 25.10.1989 ►M13 Commission Decision 93/238/EEC of 7 April 1993 L 108 134 1.5.1993 ►M14 Commission Decision 97/158/EC of 13 February 1997 L 60 64 1.3.1997 ►M15 Commission Decision 98/280/EC of 8 April 1998 L 127 29 29.4.1998 Corrected by: ►C1 Corrigendum, OJ L 288, 20.10.1976, p. -
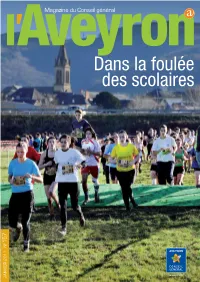
Dans La Foulée Des Scolaires 157 JANVIER 2011 N° JANVIER 2011 Point De Vue
Dans la foulée des scolaires 157 JANVIER 2011 N° JANVIER 2011 Point de vue SOMMAIRE ACTUALITÉS 3 Couverture haut débit, une démarche aveyronnaise exemplaire AGIR POUR L’AVEYRON 4 Aider les Aveyronnais à vivre mieux 5 Un regard extérieur sur la démarche aveyronnaise 6 L’Aveyron revendique toute sa place dans le schéma régional 7 Métiers de services : être connus et reconnus 8 La solidarité en actions 9 Vimenet : un modèle de restauration du patrimoine Je vous souhaite une très bonne année, à la PARTENARIAT mesure de ce que chacune et chacun d’entre 10 Fleurissement : les lauréats récompensés vous en espérez après des mois encore difficiles, 11 Le grand jardin de Salmiech vécus dans une conjoncture morose qui a pu 12 Comedia dell’Oc, vingt ans de théâtre nous faire douter mais jamais renoncer. 13 Cross du Conseil général : le sourire dans la gadoue La santé, du travail pour ceux qui en MAGAZINE manquent, des projets personnels et 14 Parcours roman à Campagnac collectifs, le bonheur avec vos proches… 15 Christine Sahuet, présidente des artisans La hiérarchie de vos attentes vous appartient. 16 Valon, l’harmonie sauvage de la lauze et de l’iris En revanche, nous avons en commun 17 CANTONS un espace de vie sur lequel nous pouvons agir efficacement. 18 GROUPES POLITIQUES Dans un monde toujours en quête de 19 AGENDA paix, de liberté et de justice, c’est en Notre HISTOIRE Aveyron que débute notre chantier. 20 L’incendie du château de Privezac En vous présentant mes meilleurs vœux pour 2011, j’exprime l’envie de partager avec vous mon ambition pour notre département : en faire un lieu de solidarité avec les plus fragiles d’entre nous, de développement équilibré au service de l’intérêt général, de générosité, de tolérance, de respect des autres et des différences. -

AGAZINE Février 2019 UNICIPAL ARCILLAC-VALLON
AGAZINE février 2019 UNICIPAL ARCILLAC-VALLON A la une On en parle Sur le terrain Du nouveau NOTRE VILLAGE CENTENAIRE LES TRAVAUX MOBILITÉ AUJOURD’HUI Édito 2018, une année intense pour l’équipe municipale Elle a été marquée par le passage du projet bourg centre à sa réalisation mobilisant les énergies. Comme cela arrive souvent ces transformations ont suscité des réactions passionnées positives ou négatives. Aujourd’hui le visage du centre bourg a changé. Ce nouveau bulletin rend compte à travers de nombreuses photos et commentaires de ces évolutions. Vous serez peut-être surpris de constater avec nous que dans bien des cas nous retrouvons dans le dessin actuel des espaces l’empreinte de la fin du 19ème siècle. Le patrimoine apparaît bien présent, remis en valeur par la création de perspectives, par le choix des matériaux et de l’éclairage (les façades, le Pont Rouge). Nous avons observé avec satisfaction que les habitants et les acteurs du territoire se sont très rapidement appropriés la nouvelle place, quai du Cruou. De nombreuses manifestations citoyennes, associatives, culturelles ou sportives s’y sont déroulées concrétisant notre volonté de conforter le lien social au cœur de la commune. Les aménagements assurant une meilleure visibilité et accessibilité aux services et commerces soutiennent leur attractivité et encouragent l’économie locale. Le partage de l’espace central entre les piétons qui peuvent circuler en toute sécurité et les voitures fonctionne bien malgré quelques incivilités. La mise en service cet été de l’aire de camping-car très appréciée, la réfection de la toiture de Foncourieu terminée fin septembre, l’achèvement des travaux autour des 2 terrains de tennis créés au pôle sportif de Kervallon viennent compléter ces réalisations. -

La Sage-Femme À Votre Écoute
Le Conseil départemental de l’Aveyron Dans le cadre de ses missions de prévention, le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Conseil départemental met à votre disposition Protection des professionnels de santé, afin de vous apporter informations, Maternelle écoute, conseil et suivi médical, Infantile au sein de chaque Territoire d’Action Sociale (TAS) La sage-femme à votre écoute aveyron.fr Où la rencontrer ? Une sage-femme de PMI est à votre disposition La sage-femme de PMI près de votre domicile. PMI La sage-femme quel est son rôle ? à votre écoute Vous pouvez rencontrer votre sage-femme dans les TAS, dans les Maisons des Solidarités Départementales, à votre domicile La PMI est un service du Conseil départemental ou avoir un contact téléphonique composé de professionnels de santé. avec elle. La sage-femme de PMI est à l’écoute : TAS VILLEFRANCHE-DE-RGUE, Maison des Solidarités Maison des Solidarités DECAZEVILLE Départementales Départementales - des femmes enceintes, 1 bis rue Emile Nègre 11 rue Borelly 11, rue Borelly 12300 DECAZEVILLE 12200 VILLEFRANCHE-DE-RGUE - des nouveaux nés et leurs parents. 12200 Villefranche-de-Rouergue Tél. : 05.65.75.83.50 Tél. : 05.65.73.39.00 Tél. : 05.65.73.39.00 ème Thérondels Mur-de- • entretien prénatal à partir du 4 mois de Barrez Brommat Cantoin TAS PAYS RUTHENOIS, Taussac grossesse avec un temps de rencontre et Lacroix- Argences en Aubrac LEVEZOU ET SEGALA Barrez Murols St-Symphorien- 4, rue François Mazenq St- de-Thénières d’échanges autour de la grossesse pour les Hippolyte Montézic Cassuéjouls St-Amans Huparlac Campouriez *LAGUIOLE 12000 Rodez des Côts Le Fel Soulages Bonneval St-Santin Entraygues- Florentin- Curières Tél. -

Ecoles Ouvertes Aveyron
COMMUNE NOM de l'école LAGUIOLE LAGUIOLE LASSOUTS LASSOUTS RODEZ FOCH RODEZ SAINT AMANS DES COTS SAINT AMANS DES COTS BROMMAT BROMMAT LUC J Prévert LUC LA PRIMAUBE MATERNELLE LA PRIMAUBE PIERREFICHE PIERREFICHE MUR DE BARREZ MUR DE BARREZ RODEZ PARAIRE RODEZ SAINT GENIEZ D'OLT SAINT GENIEZ D'OLT LE MONASTERE LE MONASTERE RODEZ RAMADIER RODEZ RODEZ MONTEIL RODEZ LE NAYRAC LE NAYRAC MONTEZIC MONTEZIC LA VITARELLE MONTPEYROUX LA VITARELLE MONTPEYROUX BOZOULS BOZOULS LACROIX BARREZ LACROIX BARREZ LA PRIMAUBE ELEMENTAIRE LA PRIMAUBE RODEZ FLAUGERGUES RODEZ ESPALION Elémentaire ESPALION STE GENEVIEVE STE GENEVIEVE DRUELLE DRUELLE RODEZ CAMBON RODEZ FLAVIN Elémentaire et maternelle FLAVIN RODEZ MITTERRAND RODEZ OLEMPS OLEMPS ESPALION Maternelle ESPALION Bertholène Castelnau Pégayrols Creissels Gages Gaillac d'Aveyron La Cavalerie La Cresse L'Hospitalet du Larzac Lioujas Le Crès Millau Puits de Calès Millau Nant Pierre Puel Onet le château Les narcisses Onet le château Jean Laroche Onet le château Palmas Rivière sur Tarn Saint-Beauzély Saint-Léons Saint-Martin de Lenne Séverac le château Verrières Viala du Tarn Saint-Georges de Luzençon Saint-Jean du Bruel Viala du Tarn CANET DE SALARS PONT DE SALARS SALMIECH SEGUR TREMOUILLES BELMONT SUR RANCE COUPIAC MONTLAUR ST AFFRIQUE BC ST ROME DE CERNON ST ROME DE TARN VABRES L ABBAYE ST FELIX DE SORGUES ALRANCE CASSAGNES BEGONHES DURENQUE LEDERGUES REQUISTA AGEN D AVEYRON RODELLE RODEZ JEAN ALBERT BESSIERE RODEZ CARDAILLAC SEBAZAC CONCOURES MATER SEBAZAC CONCOURES STE RADEGONDE Noëlle et Yves Duteil Boussac -

Tableau De Suivi Des Adap
Tableau de bord des Agendas d'Accessibilité Programmée (Ad'ap) approuvés par le département de l'Aveyron Nbr années Commune Nom de l'établissement Propriétaires/Exploitants Adresse Catégorie IOP Nbr ERP * demandées Agen d'Aveyron 3 Salle polyvalente Commune 4 place Marc Robert 3 1 Agen d'Aveyron 6 Adap de patrimoine Commune 10 Aguessac 3 WC public – Parking de la Sablière Commune 28 av des causses 1 Aguessac 3 WC public – Parking du Valat Commune 28 av des causses 1 Alrance 6 Adap de patrimoine Commune 10 Alrance 2 Camping Les Cantarelles SARL Les Cantarelles – ESPIN Doris Alrance 5 1 Argences en Aubrac 3 Boulangerie Ludovic BONAL Place des Tilleuls 5 1 Arques 3 Mairie Commune Le Bourg 5 1 Arvieu 6 Adap de patrimoine Commune 17 Aubin 3 Boucherie Alain RICARD 3 rue Jean Moulin 5 1 Aubin 3 Carrosserie BOULANGER Philippe 31 Av Jules Cabrol 5 1 Aubin 3 Banque Caisse d’Épargne 2 rue Henri Barbusse 5 1 Aubin 3 Bar tabac loto Cathy CHAPPE 38 allée du Musé 5 1 Aubin 5 Adap de patrimoine Commune 1 Place Maruéjoul 18 Aubin 1 Salon de Coiffure CORTIJO Sandrine 26 avenue Jules Cabrol 5 1 Auriac Lagast 1 Salle des Fêtes Commune Le Bourg 4 1 Auzits 3 École Communauté de communes du Pays Rignacois La Planque 4 1 Auzits 3 Adap de patrimoine Commune Place Martial Pleine Cassagne 9 Ayssènes 3 Mairie Commune Le Bourg 5 1 Baraqueville 3 Institut de Beauté Selkis ALBURQUERQUE Arlette 367 Av du Centre 5 1 Baraqueville 3 Hôtel restaurant de la Gare André LUTRAN 426 avenue de la Gare 4 1 Baraqueville 3 Cabinet infirmier Anne GAYRAUD 50 rue de l'Eglise 5 1 Baraqueville -

Ordre Alpha Noms
NOM POSTE ALAZET Carine RODEZ Paul Ramadier DECH DIR IMF ALBERICI Nathalie SENERGUES ELE DIR ALBERNY Joséphine RODEZ Flaugergues Option G ALBERT Céline ST AMANS DES COTS Op° E ALBOUY JOSSERAN Valérie ONET LE CHÂTEAU Ecole le Stade ELE ADJ ALLEGUEDE Nadège RODEZ ASH CONS PEDA EPS ALMA Thibault CAMARES ELE DIR AMBEC Sylvie ONET LE CHÂTEAU EDM Les Barbissous Op° C ANDRIEU Carole DURENQUE ecole François fabié ELE ADJ ANGLES Céline LA CAPELLE BLEYS ELE DIR ANGLES Guillaume ST BEAUZELY ELE BD ARLES Ludivine MILLAU J Henri Fabre OCCITAN Poste Fraction 3060 ARNAL Michel MILLAU LE CRES Op° E ARNAUD Sabine TREMOUILLES ELE ADJ ARRIEUX Pascale TOULONJAC ELE ADJ ASSIE Xavier ST AFFRIQUE Ecole François fabié ELE DIR ASSIER Gérard MARCILLAC VALLON Jean Auzel ELE ADJ AUBERT Jean Bernard MILLAU Puits de Cales IME Op° D AUGE Emilie HOPITAL RODEZ Op° D AURIERES Cindy VILLEFRANCHE DE R. LE TRICOT MAT BD AURIOL Isabelle TAYRAC ECU AVILA Clément LABASTIDE L'EVEQUE SOLVILLE ELE DIR BACH Magali CREISSELS ANGLAIS BARUSSEAU Lydie RULLAC ST CIRQ ELE DIR BAUDOUIN Emmanuelle CRANSAC Ecole Emile Zola BD BAUDUIN Anna laure NAUSSAC BEZ ELE ADJ BECKER Elodie RECOULES PREVINQUIERES ELE DIR BELARD Bénédicte MUR DE BARREZ 2 rue du Muret ELE DIR BERGONIER Jean Luc MILLAU SEGPA Marcel Aymard BERNARD hélène RODEZ IME Les Cardabelles Op° D BERNAT Julie ST CERNIN SUR RANCE ELE BD BERTRAND Sandrine SEVERAC L'EGLISE ECU BESSIERE Adeline PONT DE SALARS ELE BD BESSIERE Martine LEDERGUES Le Bourg ELE ADJ BINARD Nathalie LE NAYRAC ELE DIR BLANC Stéphanie MARCILLAC VALLON Jean Auzel