Histoire De Pont a Marcq
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Forum Soda S Club.Pdf
Tu as entre 14 et 17 ans, ? Viens profiter de nombreuses activités et mettre en place des projets culturels, sportifs... Des animateurs t’accueilleront, tout au long de l’année, hors vacances scolaires : • Viens participer à des activités variées et originales (roller-hockey, futsal, musique,...), • Viens créer ton prochain mini-séjour, • Organise des événements sur le territoire (concert, tournoi sportif, ...), • Deviens l’ambassadeur des ados en Pévèle Carembault avec le Conseil communautaire des jeunes. Contact Service Animation Jeunesse Pévèle Carembault 85, Rue de Roubaix - 59242 Templeuve-en-Pévèle Tél. : 03 28 76 99 76 [email protected] www.pevelecarembault.fr Du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30 FORUM ÉTÉ ADOS 2ème édition Contact Service Animation Jeunesse SAMEDI de 10h à 16h Pévèle Carembault à Genech 85, Rue de Roubaix - 59242 Templeuve-en-Pévèle 5 MAI Institut de Genech Tél. : 03 28 76 99 76 2018 rue de la Libération [email protected] www.pevelecarembault.fr Du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30 Pour les ados de 12 à 16 ans • Inscription à la semaine complète, • Tous les jours : accueil échelonné de 7h30 à 10h et de 17h à 18h30, • Restauration possible le midi, • Paiement des semaines d’activités après chaque vacances. Pour découvrir les activités de cet été Le 5 mai de 10h à 16h, venez rencontrer les équipes de direction de chaque Soda’s Club du territoire et découvrez ce qu’elles proposent aux ados : • Des mini-camps, • Des stages, • Des sorties, • Des animations, Venez • … nombreux ! Un t-shirt -

Voirie Départementale Viabilité Hivernale
Voirie Départementale BAISIEUX Viabilité Hivernale Agence Routière de PEVELE-HAINAUT CAMPHIN-EN-PEVELE Barrières de Dégel HIVER COURANT GRUSON WANNEHAIN SAINGHIN-EN-MELANTOIS R D0 093 VENDEVILLE BOUVINES WAVRIN RD0094A HOUPLIN-ANCOISNE R D BOURGHELLES 0 CYSOING 0 6 2 TEMPLEMARS PERONNE-EN-MELANTOIS R D 0 LOUVIL 0 1 A FRETIN 0 9 3 9 SECLIN 9 0 4 0 5 0 0 0 0 D D D R HERRIN R R R GONDECOURT D 3B 0 D009 9 R RD0039 1 7 BACHY 4 R 9 D 0 0 0 R 9 D D AVELIN 1 0 R 06 7 ENNEVELIN RD 2 R 03 COBRIEUX D 45 0 R 1 D 2 0 8 9 ALLENNES-LES-MARAIS 5 RD 5 7 0 TEMPLEUVE-EN-PEVELE 4 CHEMY 54 1 9 0 R D D 0 GENECH R R 1 R R D 2 D0 D2 0 8 14 549 5 5 CARNIN 49 5 RD 92 R 009 0 D 3 D 0 R 0 6 PONT-A-MARCQ 2 B R R D D RD 0 0 C 0 549 0 D0054 A ATTICHES R 9 MOUCHIN R 6 D0 62 1 955 0 2 7 R 0 B D D 01 R PHALEMPIN 28 FLINES-LES-MORTAGNE 8 R 0 D 0 CAMPHIN-EN-CAREMBAULT 8 0 0 0 3 R 6 D D 2A 9 R 0 R R 0 D 0 R 4 D MERIGNIES D 0 1 1 D 0 R 6 0 0 6 9 2 1 TOURMIGNIES 0 R 2 NOMAIN D 4 0 5 9 0 CAPPELLE-EN-PEVELE 5 MORTAGNE-DU-NORD 0 0 5 D 2 R 1 0 AIX D 6 2 LA NEUVILLE R 1 7 R 0 032 MAULDE D R D D 0 7 R RD R 2 D 2 127 012 6 01 RD0 7 A 8 0 D RUMEGIES 68 0 R 02 0 A D 8 7 012 R WAHAGNIES 8 D R 3 R D 9 CHATEAU-L'ABBAYE 0 5 0 A 5 D 3 5 4 R 9 9 THUN-SAINT-AMAND 7 0 0 R 0 D A D 6 R D R 4 2 0 95 0954 1 D 0 R D0 MONS-EN-PEVELE RD 0 RUMEGIES 0 HERGNIES 8 R R AUCHY-LEZ-ORCHIES D R 3 2 D 4 BERSEE R R R 6 5 D01 D 8 0 D 58 0 R 0 0 4 LECELLES 2 0 1 27 D 5 5 0 D 8D 0 4 8 6 R SAMEON 6 6 8 6 4 0 0 LECELLES 0 A VIEUX-CONDE D 2 0 D 0 R THUMERIES 2 R R R 1 1 LANDAS 0 D D 9 D R 0 NIVELLE 0 D0 0 008 6 R -

Euskotren (Spain) – Passenger Stations & Stops
FRANCE SNCF RAILWAYS - NORD SL 229 18.01.17 page 1 of 15 PASSENGER STATIONS & STOPS Based on Bradshaws Continental TT 1847 (x), Indicateur Chaix 1866 (y), Livret Chaix 1898 (z), 1914 (a), Indicateur Chaix 1924 (b), 1938 (c), 1958 (d), 1975 (e) and current TTs (f). f*: Atlas du Réseau Ferré en France 2013. Also. Indicateur Chaix 1887 (p), 1892 (q), Livret Chaix 1909 (r) Former names: [ ] Distances in kilometres* Gauge 4’ 8½” unless noted. (date)>(date) start/end of passenger service op. opened; cl. closed; rn. renamed; rl. relocated; tm. terminus of service at date shown; pass. passenger service Certain non-passenger locations shown in italics thus: (name) # Histories, #? Passengers? Reference letters in brackets: (a), location shown in public timetable, but no trains stop. x-f = xyzabcdef etc. Line nos. based on Indicateur Chaix 1938. * as shown in Chaix, these are generally tariff km-see Atlas Ferroviaire de la France, Schweers & Wall for actual distances. TGV Lines not included. 400. CHEMIN DE FER DE PETITE CEINTURE 40. La Varenne-Chennevières 37. Sucy-Bonneuil 0.0 Courcelles-Ceinture 33. Valenton 2. Avenue de Clichy [Batignolles-Clichy y ] 35. Villeneuve-Triage 3. Avenue de St-Ouen 36. Villeneuve-St-Georges 4. Boulevard Ornano > 33. Vigneux-sur-Seine [Draveil-Vigneux ] Le Pont-Marcadet (410) 29. Juvisy 5. La Chapelle-Nord-Ceinture q 27. Savigny-sur-Orge [La Chapelle-St-Denis-Nord-Ceinture p ] 25. Petit-Vaux 5. La Chapelle-St-Denis 23. Gravigny-Balizy ( ) 6. Est-Ceinture 21. Chilly-Mazarin 7. Pont-de-Flandre 20. Longjumeau 8. Belleville-Villette 18. Champlan 10. -

Departement Du Nord Pitgam Crochte Oost-Cappel West-Cappel
Dunkerque Dunkerque Centre BRAY-DUNES Dunkerque PetiteSynthe ZUYDCOOTE Coudekerque GHYVELDE INSPECTION ACADEMIQUE DU NORD LEFFRINCKOUCKE DUNKERQUE Branche ST-POL- FORT- le 25/06/2010- smf MARDYCK SUR-MER LESMOERES COUDEKERQUE- UXEM GRANDE-SYNTHE BRANCHE TETEGHEM GRAND-FORT- LOON-PLAGE CAPPELLE- PHILIPPE GRAVELINES LA-GRANDE COUDEKERQUE Dunkerque ANNEE SCOLAIRE 2010/2011 ARMBOUTS- CAPPEL SPYCKER HOYMILLE WARHEM Bergues ST-GEORGES- CRAYWICK BIERNE HONDSCHOOTE BERGUES SUR-L'AA KILLEM STEENE BROUCKERQUE BOURBOURG SOCX QUAEDYPRE REXPOEDE DEPARTEMENT DU NORD PITGAM CROCHTE OOST-CAPPEL WEST-CAPPEL BISSEZEELE LOOBERGHE WYLDER DRINCHAM BAMBECQUE ST-PIERRE- BROUCK CAPPELLE- Roubaix ESQUELBECQ BROUCK ERINGHEM Roubaix Dunkerque WORMHOUT Wasquehal Roubaix Est ZEGERSCAPPEL HERZEELE HOUTKERQUE Centre Grande Synthe Lille 1 BOLLEZEELE MERCKEGHEM LEDRINGHEM Lambersart MILLAM HOLQUE Lille 1 WINNEZEELE Marcq en Tourcoing RoubaixOuest VOLCKERINCKHOVE ARNEKE WATTEN OUDEZEELE RUBROUCK ZERMEZEELE Baroeul Roncq WULVERDINGHE BROXEELE OCHTEZEELE STEENVOORDE WEMAERS- HARDIFORT Lille2 ST-MOMELIN LEDERZEELE CAPPEL BUYSSCHEURE Lomme Tourcoing CASSEL TERDEGHEM BOESCHEPE - VILLE DE ROUBAIX - NIEURLET NOORDPEENE ZUYTPEENE GODEWAERSVELDE Ouest Sambre Avesnois STE-MARIE- OXELAERE CAPPEL EECKE BERTHEN HALLUIN BAVINCHOVE ST-SYLVESTRE- ST-JANS- WERVICQ- Tourcoing CAPPEL Lille2 SUD FLETRE CAPPEL BOUSBECQUE Dunkerque Armentières NEUVILLE- Est STAPLE HONDEGHEM CAESTRE EN-FERRAIN Cambrésis COMINES Gravelines METEREN WARNETON RONCQ PRADELLES LINSELLES RENESCURE EBBLINGHEM Roubaix -

Sectorisation Des Enseignants Référents Du Nord ( Mise À Jour Le 19/03/2017)
Sectorisation des Enseignants Référents du Nord ( mise à jour le 19/03/2017) Sect Appellation - Dénom Comp Adresse Postale Adre Adre Adresse - Enseignant Type Etablissments eur sse - sse - Localité référent 2016 (PU Boite Code d'Acheminement 2017 / PR) Post Post ale al PU 22 GRAND'RUE 5926 ABANCOURT LEVECQUE 8 Christelle PU JULES FERRY 11 RUE VAN 5921 ABSCON ? 1 COPPENOLLE 5 PU JULIEN BEAUVILLAIN 29 RUE VICTOR HUGO 5921 ABSCON ? 5 PU MARIUS ASSEZ 9 RUE VAN 5921 ABSCON ? COPPENOLLE 5 PR SAINTE ODILE 50 RUE JULES GUESDE 5921 ABSCON HOFMAN 5 Philippe PU 2 PLACE LA PLACE 5914 AIBES VERMEULEN 9 Sarah PU 39 RUE SADI CARNOT 5931 AIX SIMPLOT 0 Florence PU AUGUSTINE TESTELIN 6 RUE DE VERDUN 5925 ALLENNES LES DUMOULIN 1 MARAIS Véronique PU LE PETIT PRINCE RUE DE VERDUN 5925 ALLENNES LES DUMOULIN 1 MARAIS Véronique PU MAURICE LENNE 711 RUE GABRIEL PERI 5919 ANHIERS MAKALA 4 Corinne PU FRANCOIS WARTEL RUE AMEDEE 5958 ANICHE HENNIQUAUX ELEM DEREGNAUCOURT 0 Amélie PU ARCHEVEQUE RUE AMEDEE 5958 ANICHE HENNIQUAUX MAT DEREGNAUCOURT 0 Amélie PU JEAN SCHMIDT 6 RUE DELVAL CITE 5958 ANICHE HENNIQUAUX MAT HLM 0 Amélie PU MARCEL CACHIN 20 RUE WAMBROUCK 5958 ANICHE HENNIQUAUX MAT 0 Amélie PU MAXIME QUEVY BOULEVARD DRION 5958 ANICHE HENNIQUAUX ELEM 0 Amélie PU BASUYAUX 21 RUE GAMBETTA 5958 ANICHE HENNIQUAUX ELEM 0 Amélie www.ader59.fr mars 2017 PU YVON FOSSE 5958 ANICHE HENNIQUAUX MAT 0 Amélie PU THEODORE MONOD 5 RUE DU 89 5958 ANICHE HENNIQUAUX BICENTENAIRE DE LA 0 Amélie REVO PU PIERRE-JOSEPH LAURENT 128 RUE EDMOND 79 5958 ANICHE HENNIQUAUX LAUDEAU 0 Amélie -

1.3 Rapport De Présentation Partie 3
P.L.U. DE TEMPLEUVE-EN-PÉVÈLE RAPPORT DE PRESENTATION 61 Synthèse de l’environnement naturel Le territoire se localise à proximité de la vallée de la Marque et le marais d’Ennevelin. Les prescriptions environnementales sont principalement localisées au Nord avec la présence d’une ZNIEFF de type 1 et d’une ZNIEFF de type 2. Au cœur de cet espace de marais il existe de nombreuses zones à dominante humide qui sont identifiés dans le cadre du SDAGE Artois Picardie. De même, les espaces naturels situés à proximité et au sein de la trame bâtie sont importants dans le cadre de la qualité du cadre de vie et de la valorisation des continuités naturelles du territoire. L’ensemble de ces éléments participe à la constitution d’une véritable trame verte et bleue qui concoure au développement de continuités naturelles telles qu’elles sont inscrites dans le cadre du projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique. Enjeux : - Prendre en compte la localisation du territoire au cœur des espaces naturels de la Marque et des Marais d’Ennevelin. - Intégrer la présence de continuités naturelles en lien avec les trames verte et bleue. - Préserver les éléments paysagers emblématiques (alignements de saules têtards, fossés, parcs,…). - Renforcer la place du végétal dans la ville en facilitant la création d’espaces verts dans les quartiers et en permettant le renforcement des liens entre ces espaces P.L.U. DE TEMPLEUVE-EN-PEVELE RAPPORT DE PRESENTATION 62 4. A NALYSE DE L 'ETAT INITIAL DE L 'ENVIRONNEMENT NB : pour des éléments concernant l’état initial de l’environnement urbain, on peut utilement se reporter au chapitre « I - 31 l’urbanisation. -

15 Mars 2020 Etat Des Candidatures Régulièrement Enregistrées Arrond
Elections municipales et communautaires - premier tour - 15 mars 2020 Etat des candidatures régulièrement enregistrées Arrondissement de Lille Communes de moins de 1000 habitants Libellé commune Sexe candidat Nom candidat Prénom candidat Nationalité Beaucamps-Ligny F BAUGE Pascale Française Beaucamps-Ligny M BEHAREL Kilien Française Beaucamps-Ligny F BERGER Charlotte Française Beaucamps-Ligny F BOGAERT Caroline Française Beaucamps-Ligny M BONNEEL André Française Beaucamps-Ligny F DEBAECKER Noémie Française Beaucamps-Ligny F DEHAUDT Ingrid Française Beaucamps-Ligny M DEPOIX Eric Française Beaucamps-Ligny M DIGNE Eric Française Beaucamps-Ligny M DOURLOU Pascal Française Beaucamps-Ligny M DUMORTIER Tanguy Française Beaucamps-Ligny F DURREAU Cécile Française Beaucamps-Ligny M FLAVIGNY Fabrice Française Beaucamps-Ligny M FOUCART François Française Beaucamps-Ligny F GILMANT Claudine Française Beaucamps-Ligny M GUEGAN Julien Française Beaucamps-Ligny F HOUSPIE Karine Française Beaucamps-Ligny F JUMAUCOURT Bernard Française Beaucamps-Ligny F LECHOWICZ Sarah Française Beaucamps-Ligny F LEFEBVRE Catherine Française Beaucamps-Ligny M MAEKER Dominique Française Beaucamps-Ligny M MORCHIPONT Jérôme Française Beaucamps-Ligny M NONQUE Ferdinand Française Beaucamps-Ligny M PERCHE Gautier Française Beaucamps-Ligny M RENARD Ronny Française Beaucamps-Ligny M SCELERS Stéphane Française Beaucamps-Ligny M SEGUIN Antoine Française Beaucamps-Ligny F STAQUET Evelyne Française Beaucamps-Ligny F TALPE Sophie Française Beaucamps-Ligny F TOURBIER Véronique Française -

Recueil Des Actes Administratifs Du Departement Du Nord
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DU NORD Numéro 2016-24 Novembre SOMMAIRE Comité d’Hygiène et de Sécurité et des ACTION SOCIALE Conditions de Travail Enfance Arrêté en date du 22 juin 2016 portant composition des représentants du personnel au Arrêté en date du 22 mars 2016 autorisant Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Madame DEGAND née BLONDIAUX Béatrice Conditions de Travail .......................................... 9 à assurer l’encadrement technique de la micro- crèche dénommée « Petits Prodiges » à Marcq-en- Comité Technique Barœul.................................................................. 19 Arrêté en date du 18 mai 2016 autorisant Madame Arrêté en date du 12 septembre 2016 portant DELEGRANGE Sophie à assurer l’encadrement composition des représentants de l’administration technique de la micro-crèche dénommée au Comité Technique ......................................... 11 « Les Nourris’sons » à Tourcoing..................... 19 Arrêté en date du 19 mai 2016 portant Conseil Départemental d’Insertion modification de fonctionnement de l’établissement d’accueil collectif d’enfants de Arrêté en date du 04 juillet 2016 fixant la moins de 6 ans dénommé « Rigolo comme la Vie composition du Conseil Départemental – Sésame » à Roubaix......................................... 20 d’Insertion............................................................ 13 Arrêté en date du 06 juin 2016 portant autorisation d’ouverture de la micro-crèche Désignations dénommée « Les Malicieux de Mouvaux Corselle » à Mouvaux......................................... 20 Arrêté en date du 15 juillet 2016 désignant les Arrêté en date du 10 juin 2016 autorisant Madame représentants du Département pour siéger au sein LICTEVOUT Stéphanie à assurer l’encadrement des commissions de coordination des politiques technique de la micro-crèche dénommée publiques .............................................................. 15 « Les P’tites Canailles » à La Bassée ................ -

LISTE-DES-ELECTEURS.Pdf
CIVILITE NOM PRENOM ADRESSE CP VILLE N° Ordinal MADAME ABBAR AMAL 830 A RUE JEAN JAURES 59156 LOURCHES 62678 MADAME ABDELMOUMEN INES 257 RUE PIERRE LEGRAND 59000 LILLE 106378 MADAME ABDELMOUMENE LOUISA 144 RUE D'ARRAS 59000 LILLE 110898 MONSIEUR ABU IBIEH LUTFI 11 RUE DES INGERS 07500 TOURNAI 119015 MONSIEUR ADAMIAK LUDOVIC 117 AVENUE DE DUNKERQUE 59000 LILLE 80384 MONSIEUR ADENIS NICOLAS 42 RUE DU BUISSON 59000 LILLE 101388 MONSIEUR ADIASSE RENE 3 RUE DE WALINCOURT 59830 WANNEHAIN 76027 MONSIEUR ADIGARD LUCAS 53 RUE DE LA STATION 59650 VILLENEUVE D ASCQ 116892 MONSIEUR ADONEL GREGORY 84 AVENUE DE LA LIBERATION 59300 AULNOY LEZ VALENCIENNES 12934 CRF L'ESPOIR DE LILLE HELLEMMES 25 BOULEVARD PAVE DU MONSIEUR ADURRIAGA XIMUN 59260 LILLE 119230 MOULIN BP 1 MADAME AELVOET LAURENCE CLINIQUE DU CROISE LAROCHE 199 RUE DE LA RIANDERIE 59700 MARCQ EN BAROEUL 43822 MONSIEUR AFCHAIN JEAN-MARIE 43 RUE ALBERT SAMAIN 59650 VILLENEUVE D ASCQ 35417 MADAME AFCHAIN JACQUELINE 267 ALLEE CHARDIN 59650 VILLENEUVE D ASCQ 35416 MADAME AGAG ELODIE 137 RUE PASTEUR 59700 MARCQ EN BAROEUL 71682 MADAME AGIL CELINE 39 RUE DU PREAVIN LA MOTTE AU BOIS 59190 MORBECQUE 89403 MADAME AGNELLO SYLVIE 77 RUE DU PEUPLE BELGE 07340 colfontaine 55083 MONSIEUR AGNELLO CATALDO Centre L'ADAPT 121 ROUTE DE SOLESMES BP 401 59407 CAMBRAI CEDEX 55082 MONSIEUR AGOSTINELLI TONI 63 RUE DE LA CHAUSSEE BRUNEHAUT 59750 FEIGNIES 115348 MONSIEUR AGUILAR BARTHELEMY 9 RUE LAMARTINE 59280 ARMENTIERES 111851 MONSIEUR AHODEGNON DODEME 2 RUELLE DEDALE 1348 LOUVAIN LA NEUVE - Belgique121345 MONSIEUR -

Ligne Ligne Horaires Valables À Compter Du 01/09/2013 Horaires Valables À Compter Du 01/09/2013
LIGNE LIGNE Horaires valables à compter du 01/09/2013 Horaires valables à compter du 01/09/2013 206 LILLE / PONT A MARCQ / BERSEE / DOUAI 206 LILLE / PONT A MARCQ / BERSEE / DOUAI Course numéro 10 20 60 40 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 900 910920 Course numéro 10 20 60 40 70 80 90 100 110 120 130 140150 160 900 910 920 L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me Dim Dim Dim L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me Dim Dim Dim jours de circulation J V S J V S J V S J V J V S J V S J V J V S J V S J V S J V S J V J V S J V S Fêtes Fêtes Fêtes jours de circulation J V S J V S J V S J V J V S J V S J V J V S J V S J V S J V S J V J V S J V S Fêtes Fêtes Fêtes Particularités + + + TARIFS au 1er septembre 2013 C C C Particularités + + + C C C Lille Porte de Douai Douai 7:44 8:2011:0011:45 12:30 13:30 15:30 16:40 17:30 18:15 19:00 11:3016:3019:35 Retrouvez la gamme tarifaire sur le site d’Arc en ciel 2 (www.arcenciel2.fr), Lille Diderot 7:46 8:2211:0211:47 12:32 13:32 15:32 16:42 17:32 18:17 19:02 11:3216:3219:37 Lille Porte de Douai 7:44 8:20 11:00 11:45 12:3013:30 15:3016:40 17:3018:15 19:00 11:3016:30 19:35 Lille Porte d'Arras 7:49 8:2511:0411:49 12:34 13:34 15:35 16:45 17:35 18:20 19:04 11:3516:3519:40 sur le portail mobilité du Département du Nord (mobilite.lenord.fr) ou Lille Diderot Waziers 7:46 8:22 11:02 11:47 12:3213:32 15:3216:42 17:3218:17 19:02 11:3216:32 19:37 contactez notre agence commerciale au 03 20 89 30 30. -

Chrono 2017 Final
Résultats des 10 km - Foulées de Genech 14 Mai 2017 Classement Dossard NOM Prénom SEXE TEMPS Catégorie Classement catégorie H/F Ville 1 169 BOULANGER Thibault M 0:35:49 SE 1 LOMPRET 2 199 HENOCQ Nicolas M 0:35:50 SE 2 BAISIEUX 3 196 DE SOUZA Paulo M 0:36:36 V1 3 WANNEHAIN 4 206 DUBOIS Christian M 0:36:59 SE 4 TEMPLEUVE 5 172 PLANCHET Manu M 0:37:06 V2 5 CYSOING 6 107 DULIEU Anthony M 0:37:08 SE 6 Sailly 7 110 BONDUELLE Sébastien M 0:37:14 V1 7 TEMPLEUVE 8 113 JANAS François M 0:37:17 V1 8 CAPPELLE EN PÉVÈLE 9 168 BROVIDA Maxime M 0:37:57 SE 9 GENECH 10 224 DUCHATEAU Geoffrey M 0:37:58 SE 10 GENECH 11 105 MAGONI Léo M 0:38:16 SE 11 LILLE 12 133 TRACKOEN David M 0:38:23 SE 12 FACHES THUMESNIL 13 178 SION Christophe M 0:38:46 SE 13 GENECH 14 185 DEKERLE Guillaume M 0:38:51 V1 14 15 207 BERNARD Maxime M 0:38:52 SE 15 Belgique 16 100 LIBERT Thibault M 0:39:05 SE 16 COBRIEUX 17 118 BLANDIN Stéphane M 0:39:44 SE 17 VILLENEUVE D'ASCQ 18 189 KASZYNSKI Eric M 0:39:59 V1 18 AUCHY Les ORCHIES 19 191 VALLERAND Pascal M 0:40:04 V2 19 BERSEE 20 187 LIEKENS Denis M 0:40:38 V1 20 CHERENG 21 135 GHIBAUDO Sabine F 0:40:43 V2 1 ATTICHES 22 197 VANUXEM Sylvain M 0:41:35 V2 21 CAPPELLE EN PÉVÈLE 23 202 DELPORTE Jean Luc M 0:41:49 V1 22 BOURGHELLES 24 137 SCRIVE Benjamin M 0:42:07 JU 23 CAMPHIN EN PEVELE 25 145 DENIS Ludovic M 0:42:09 SE 24 GENECH 26 210 DENIS Emmanuel M 0:42:39 V1 24 TEMPLEUVE 27 108 PINTEAUX François M 0:42:45 SE 26 ESTEVELLES 28 217 BOGART Philippe M 0:42:52 V2 27 GENECH 29 126 DELEU Martin M 0:42:53 SE 28 LA MADELEINE 30 109 CUBIZOLLES -
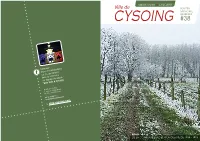
Ville-Cysoing.Com > Ville-Cysoing.Com
BULLETIN MUNICIPAL JANVIER 2018 #38 MIEUX VIVRE À CYSOING Retrouvez toutes les informations sur les animations dans la commune sur la page Facebook “Bien Vivre à Cysoing“ MAIRIE DE CYSOING 2, place de la République BP 67 - 59830 Cysoing 03 20 79 44 70 [email protected] > ville-cysoing.com DOSSIER DE LA CONQUÊTE DU CIEL À LA GUERRE DE 1914 - 1918 Édito Très chers Cysoniennes et Cysoniens, Sommaire BULLETIN MUNICIPAL La fin d’année mouvementée appelle à dresser un bilan de l’action S’agissant de notre Pyramide, le début des travaux a permis de JANVIER 2018 menée en 2017 et tracer quelques perspectives pour 2018. mettre en évidence l’urgence d’une intervention sur cette vieille dame de 267 ans. N’hésitez pas à participer au projet de restauration via Qu’il me soit permis de ne pas revenir sur le «grand la Fondation du Patrimoine, elle a besoin de votre soutien. chambardement politique» au niveau national. Les urnes ont parlé, Sur le plan des travaux, pour votre sécurité des aménagements #38 je tiens simplement à souhaiter la réussite, pour notre pays et nos ont été réalisés sur les rues Ladreyt, Jeanne d’Arc et au chemin concitoyens. Vous le savez, la politique ne se mesure pas aux des Caches Vaches. Les deux premiers passages piétons 3 D paroles, mais aux actes et ce qui est vrai au niveau national, de France ont également été testés autour de l’école maternelle l’est aussi au niveau local, c’est en tous cas tout le sens de notre Saint Exupéry.