Charles Gounod Européen »
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ellis.Jams.2012.Mireille
Ellis, K. (2012). Mireille's Homecoming? Gounod, Mistral and the Midi. Journal of the American Musicological Society, 65(2), 463-509. https://doi.org/10.1525/jams.2012.65.2.463 Publisher's PDF, also known as Version of record Link to published version (if available): 10.1525/jams.2012.65.2.463 Link to publication record in Explore Bristol Research PDF-document Published as Ellis, K. (2012). Mireille's Homecoming? Gounod, Mistral and the Midi. Journal of the American Musicological Society, 65(2). © 2012 by the American Musicological Society. Copying and permissions notice: Authorization to copy this content beyond fair use (as specified in Sections 107 and 108 of the U. S. Copyright Law) for internal or personal use, or the internal or personal use of specific clients, is granted by [the Regents of the University of California on behalf of the American Musicological Society for libraries and other users, provided that they are registered with and pay the specified fee via Rightslink® on JSTOR (http://www.jstor.org/r/ucal) or directly with the Copyright Clearance Center, http://www.copyright.com. University of Bristol - Explore Bristol Research General rights This document is made available in accordance with publisher policies. Please cite only the published version using the reference above. Full terms of use are available: http://www.bristol.ac.uk/red/research-policy/pure/user-guides/ebr-terms/ Mireille's Homecoming? Gounod, Mistral, and the Midi Author(s): Katharine Ellis Reviewed work(s): Source: Journal of the American Musicological Society, Vol. 65, No. 2 (Summer 2012), pp. 463- 509 Published by: University of California Press on behalf of the American Musicological Society Stable URL: http://www.jstor.org/stable/10.1525/jams.2012.65.2.463 . -

National-Council-Auditions-Grand-Finals-Concert.Pdf
NATIONAL COUNCIL AUDITIONS grand finals concert conductor Metropolitan Opera Bertrand de Billy National Council Auditions host and guest artist Grand Finals Concert Joyce DiDonato Sunday, April 29, 2018 guest artist 3:00 PM Bryan Hymel Metropolitan Opera Orchestra The Metropolitan Opera National Council is grateful to the Charles H. Dyson Endowment Fund for underwriting the Council’s Auditions Program. general manager Peter Gelb music director designate Yannick Nézet-Séguin 2017–18 SEASON NATIONAL COUNCIL AUDITIONS grand finals concert conductor Bertrand de Billy host and guest artist Joyce DiDonato guest artist Bryan Hymel “Martern aller Arten” from Die Entführung aus dem Serail (Mozart) Emily Misch, Soprano “Tacea la notte placida ... Di tale amor” from Il Trovatore (Verdi) Jessica Faselt, Soprano “Va! laisse couler mes larmes” from Werther (Massenet) Megan Grey, Mezzo-Soprano “Cruda sorte!” from L’Italiana in Algeri (Rossini) Hongni Wu, Mezzo-Soprano “In quali eccessi ... Mi tradì” from Don Giovanni (Mozart) Today’s concert is Danielle Beckvermit, Soprano being recorded for “Amour, viens rendre à mon âme” from future broadcast Orphée et Eurydice (Gluck) over many public Ashley Dixon, Mezzo-Soprano radio stations. Please check “Gualtier Maldè! ... Caro nome” from Rigoletto (Verdi) local listings. Madison Leonard, Soprano Sunday, April 29, 2018, 3:00PM “O ma lyre immortelle” from Sapho (Gounod) Gretchen Krupp, Mezzo-Soprano “Sì, ritrovarla io giuro” from La Cenerentola (Rossini) Carlos Enrique Santelli, Tenor Intermission “Dich, teure Halle” from Tannhäuser (Wagner) Jessica Faselt, Soprano “Down you go” (Controller’s Aria) from Flight (Jonathan Dove) Emily Misch, Soprano “Sein wir wieder gut” from Ariadne auf Naxos (R. Strauss) Megan Grey, Mezzo-Soprano “Wie du warst! Wie du bist!” from Der Rosenkavalier (R. -

10Th Muse Program2009.Pdf
A Note from Misha A Season of Wings Already you’re joining us for our second adventure. In November 2008 Divergence Vocal Theater premiered with The Ottavia Project. If this is your return visit with Diver- gence, thanks for joining us again. If this is your rst foray into our world: welcome. The 10th Muse has evolved into a sister performance to The Ottavia Project. It has felt a bit like giving birth to twins six months apart. Similar visual elements and dramatic themes emerge, and we continue to delve into relationships. This entire performance piece germinated from my going ga-ga over Gounod’s beau- tiful aria for Sapho, O ma lyre immortelle. That piece sent me down a rabbit hole rich with Gounod’s music and full of mythology--a realm I have always loved. Since Sapho was written for Pauline Viardot, the renowned 19th century Mezzo Diva (who doesn’t love a Mezzo Diva?), the music nerd in me wanted to include several of her works for piano and violin, as she was also an accomplished composer. So, you will hear her works alongside another (later) equally delicious female French composer, Lili Boulanger. I discovered Jill Alexander Essbaum’s poetry when I heard her read at a literary salon here in Houston. I fell head-over-heels-at-rst-sight and knew immediately she must be included in this performance. Please welcome her as our rst season’s Poetess-in- Residence. In mining Sapho’s works for this performance, I decided to write my own “versions” of her fragments, heavily inspired by both Julia Dubno and Anne Carson’s exquiste translations. -
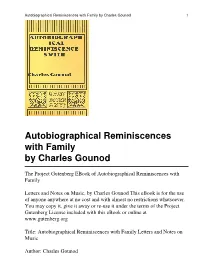
Autobiographical Reminiscences with Family Letters and Notes on Music
Autobiographical Reminiscences with Family by Charles Gounod 1 Autobiographical Reminiscences with Family by Charles Gounod The Project Gutenberg EBook of Autobiographical Reminiscences with Family Letters and Notes on Music, by Charles Gounod This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: Autobiographical Reminiscences with Family Letters and Notes on Music Author: Charles Gounod Autobiographical Reminiscences with Family by Charles Gounod 2 Translator: W. Hely Hutchinson Release Date: April 10, 2011 [EBook #35812] Language: English Character set encoding: ASCII *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK AUTOGIOGRAPHICAL REMINISCENCES *** Produced by Chuck Greif and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This book was produced from scanned images of public domain material from the Google Print project.) CHARLES GOUNOD [Illustration: Charles Gounod] CHARLES GOUNOD AUTOBIOGRAPHICAL REMINISCENCES WITH FAMILY LETTERS AND NOTES ON MUSIC FROM THE FRENCH BY THE HON. W. HELY HUTCHINSON [Illustration: colophon] LONDON WILLIAM HEINEMANN 1896 Autobiographical Reminiscences with Family by Charles Gounod 3 [All rights reserved] Printed by BALLANTYNE, HANSON & CO. At the Ballantyne Press CONTENTS CHARLES GOUNOD-- PAGE I. CHILDHOOD 1 II. ITALY 54 III. GERMANY 110 IV. HOME AGAIN 127 LATER LETTERS OF CHARLES GOUNOD 173 BERLIOZ 195 M. CAMILLE SAINT-SAENS AND HIS OPERA "HENRI VIII." 209 NATURE AND ART 225 THE ACADEMY OF FRANCE AT ROME 239 THE ARTIST AND MODERN SOCIETY 253 INTRODUCTION The following pages contain the story of the most important events of my artistic life, of the mark left by them on my personal existence, of their Autobiographical Reminiscences with Family by Charles Gounod 4 influence on my career, and of the thoughts they have suggested to my mind. -

Anthony Roth Costanzo (MM ’08), Voice
MASTER CLASS Anthony Roth Costanzo (MM ’08), voice Wednesday, February 26, 2020 | 4 PM William R. and Irene D. Miller Recital Hall Wednesday, February 26, 2020 | 4 PM William R. and Irene D. Miller Recital Hall MASTER CLASS Anthony Roth Costanzo (MM ’08), voice PROGRAM CHARLES GOUNOD “Amour, ranime mon courage“ (Poison Aria) from W. A. MOZART “Quanti mi siete intorno…Padre, germani addio” (1818–1893) Roméo et Juliette from Idomeneo Rosario Hernández, mezzo-soprano W. A. MOZART “Come scoglio” from Così fan tutte Contla de Juan Cuamatzi, Mexico (1756–1791) Makila Kirchner, soprano Student of Joan Patenaude-Yarnell Grand Haven, Michigan Diana Borshcheva, piano Student of Ruth Golden Boston, Massachusetts Yueqi Zhang, piano Student of Warren Jones Nanjing, China Student of Warren Jones VINCENZO BELLINI “Se Romeo t’uccise un figlio” from (1801–1835) I Capuleti e i Montecchi NED ROREM “Take Me Back” from Our Town (b. 1923) CHARLES GOUNOD “Ô ma lyre immortelle” from Sapho (1818–1893) Shelén Hughes, soprano W. A. MOZART “Quanti mi siete intorno…Padre germani addio” Cochabamba, Bolivia from Idomeneo Student of Ashley Putnam Katharine Burns, soprano Shiyu Tan, piano Mechanicsburg, Pennsylvania Shanghai, China Student of Shirley Close Student of Warren Jones Tong yao Li, piano Xuzhou, China Student of Kenneth Merrill ANDRÉ PREVIN “I want magic!” from A Streetcar Named Desire Alternates: (1929–2019) RICHARD STRAUSS “Presentation of the rose” from Der Rosenkavalier (1864–1949) VINCENZO BELLINI “O quante Volte” from I Capuleti e i Montecchi BENJAMIN BRITTEN “Come now a roundel” from A Midsummer Night’s Dream W. A. MOZART “Dalla sua pace” from (1913–1976) Don Giovanni Shan Hai, soprano Beijing, China GIUSEPPE VERDI “Lunge da lei.. -

Charles Gounod
1864 VERSION CHARLES GOUNOD FAUST Aljaž Farasin • Carlo Colombara • Marjukka Tepponen Lucio Gallo • Diana Haller • Ivana Srbljan • Waltteri Torikka Croatian National Theatre in Rijeka Opera Orchestra and Choir Ville Matvejeff Act I 24:56 $ Scene 6: Récitatif: Je voudrais bien 1:32 1 Introduction 6:39 (Marguerite) 2 Scene 1: Rien!… En vain j’interroge – % Scene 6: Chanson du Roi de Thulé: Chorus: Ah! Paresseuse fille 8:27 Ile était un roi de Thulé 6:16 (Faust, Maidens, Labourers) (Marguerite) 3 Récitatif: Mais ce Dieu 1:09 ^ Air des bijoux: Charles (Faust) Ah! Je ris de me voir 3:57 4 Scene 2: Duo: Me voici! 8:41 (Marguerite) GOUNOD (Méphistophélès, Faust) & Scene 7: Scène: Seigneur Dieu... – (1818–1893) Scene 8: Dame Marthe Schwerlein 2:57 Act II 27:15 (Marthe, Marguerite, Méphistophélès, Faust) 5 Scene 1: Chœur: Vin ou bière 4:45 * Scene 8: Quatuor: (Students, Wagner, Soldiers, Citizens, Prenez mon bras un moment! 7:22 Faust Maidens, Matrons) (Faust, Marguerite, Méphistophélès, Marthe) 6 Scene 2: Scène: O sainte médaille – ( Scene 10: Scène: Il était temps! 1:47 Opera in five acts (1858) (London version, 1864) Récitatif: Ah! Voici Valentin – (Méphistophélès) Libretto by Jules Barbier (1825–1901) and Michel Carré (1822–1872) Invocation: Avant de quitter ces lieux – ) Scene 11: Duo: Il se fait tard – Scene 3: Pardon! 6:47 Scene 12: Scene: Tête folle! – Additional text by Onésime Pradère (1825–1891) (Valentin, Wagner, Siébel, Students, Méphistophélès) Scene 13: Il m’aime 13:53 Sung in French 7 Ronde du Veau d’or: (Marguerite, Faust, Méphistophélès) Le veau d’or est toujours debout! 1:56 (Méphistophélès, Siébel, Wagner, Chorus) Act IV 46:13 Faust .............................................................................................. -

21M.013J the Supernatural in Music, Literature and Culture Spring 2009
MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu 21M.013J The Supernatural in Music, Literature and Culture Spring 2009 For information about citing these materials or our Terms of Use, visit: http://ocw.mit.edu/terms. Gounod, Faust Ellen T. Harris 1. Charles-François Gounod (1818-1893) compare: Liszt (1811-1886); Goethe (1749-1832) Early years and Rome •as a child, Gounod showed great abilities in drawing and music •at the age of 19 (1837), he won second place in the Prix de Rom, the most prestigious prize in Europe for music composition; he won first place in 1839 •in Rome in 1840, he was greatly influenced by the music of Palestrina (1525/26-1594), the greatest composer of the Catholic Counter-Reformation, whose contrapuntal style was (and is) considered the summa of Renaissance polyphony •his musical compositions for the Academy include an orchestral Mass and an a cappella Te Deum •he read Goethe’s Faust at this time Germany and Austria •he spent the third year of his fellowship in Austria and Germany, drinking deeply at the well of Beethoven (1770-1827) and Mozart (1756-1791) •he continued writing sacred music: in particular a Requiem à grand orchestre (1842) •he met Mendelssohn (1809-1847) in Leipzig; Mendelssohn praised Gounod’s compositions and offered the younger man a private performance of his own Scottish Symphony at the Gewandhaus •the music of Mendelssohn leaves a deep imprint on Gounod (NOTE: quotation/homage to Mendelssohn in quoting the opening of his “Midsummer Night’s Dream Overture” at the moment when Faust drinks the potion of -

Famous Composers and Their Music
iiii! J^ / Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Brigham Young University http://www.archive.org/details/famouscomposerst05thom HAROLD BLEBLffiR^^ PROVO. UTAH DANIEL FRANCOIS ESPRIT AUBER From an engraving by C. Deblois, 7867. 41 .'^4/ rii'iiMia-"- '^'', Itamous COMPOSERS AND THEIR MUSIC EXTRA ILLUSTPATED EDITION o/' 1901 Edited by Theodore Thomas John Knowlej Paine (^ Karl Klauser ^^ n .em^fssfi BOSTON M'^ J B MILLET COMPANY m V'f l'o w i-s -< & Copyright, 1891 — 1894— 1901, By J. B. Millet Company. DANIEL FRANCOIS ESPRIT AUBER LIFE aiore peaceful, happy and making for himself a reputation in the fashionable regular, nay, even monotonous, or world. He was looked upon as an agreeable pianist one more devoid of incident than and a graceful composer, with sparkling and original Auber's, has never fallen to the ideas. He pleased the ladies by his irreproachable lot of any musician. Uniformly gallantry and the sterner sex by his wit and vivacity. harmonious, with but an occasional musical dis- During this early period of his life Auber produced sonance, the symphony of his life led up to its a number of lietier, serenade duets, and pieces of dramatic climax when the dying composer lay sur- drawing-room music, including a trio for the piano, rounded by the turmoil and carnage of the Paris violin and violoncello, which was considered charm- Commune. Such is the picture we draw of the ing by the indulgent and easy-going audience who existence of this French composer, in whose garden heard it. Encouraged by this success, he wrote a of life there grew only roses without thorns ; whose more imp^i/rtant work, a concerto for violins with long and glorious career as a composer ended only orchestra, which was executed by the celebrated with his life ; who felt that he had not lived long Mazas at one of the Conservatoire concerts. -

Temps Fort Bicentenaire De La Naissance De Gounod (1818 – 2018)
TEMPS FORT BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE GOUNOD (1818 – 2018) Parmi les célébrations nationales 2018 les plus importantes, le bicentenaire de la naissance de Charles Gounod est mis en valeur à Saint-Raphaël en raison du séjour de ce dernier dans la cité balnéaire en 1865, pendant lequel il composa l’opéra « Roméo et Juliette », pièce majeure de son œuvre. La Médiathèque et le Conservatoire rendent hommage à ce grand musicien tout au long des mois de novembre et décembre 2018 à travers une exposition, des auditions, un concert à la Basilique Notre-Dame-de-la-Victoire, des conférences et une mise en valeur des ressources de la Médiathèque. L’occasion également d’évoquer la vie intellectuelle et artistique de cette époque à Saint-Raphaël liée à l’essor de la ville. Livres Livres généraux sur la musique et l’opéra : Massin, Brigitte et Jean (dir.) – Histoire de la musique occidentale Ed. Fayard, 1985 Cette histoire précisément délimitée dans le temps et l'espace, traite de l'évolution de la musique en Europe et en Amérique depuis le Moyen Age jusqu'à nos jours. Un chapitre complet sur « La musique française : Offenbach, Gounod, Bizet. 780.9 MAS Dermoncourt, Bertrand (dir.) – L’univers de l’opéra : œuvres, scènes, compositeurs, interprètes Ed. Laffont, coll. Bouquins, 2012 Les quelques 2000 entrées sont consacrées aux principales œuvres du répertoire, aux différents genres de l'art lyrique, à ceux qui font l'opéra, aux pays, villes et festivals qui accueillent des représentations, aux termes techniques, aux grandes synthèses historiques, mythologiques et sociologiques. 782.1 DER Batta, Andras – Opéra : compositeurs, œuvres interprètes Ed. -

Faust-Education-Pack.Pdf
Faust Music by Charles Gounod Libretto by Jules Barbier English Translation by Ruth Martin & Thomas Martin adapted by SCO Doctor Faust is alone. The promise of love and the return of his youth is enough to convince Faust to make a deal with the devil, Méphistophélès As Méphistophélès’ plan unravels, Faust is led down an increasingly darker path that will lead to love, death, greed and madness. Contents Introduction… 4 Faust by Gounod…5 - What is Opera?... 5 - Who was Gounod?... 6 - Who was Goethe?...6 - Who are SCO?... 7 The Story of Faust…8 - Plot summary…8 Key Characters of Faust…10 Creative view for Faust… 11 - Challenges of Touring …11 - Design of Faust…12 Cast of Faust Interviews… 13 Lesson Plans…14 - Music…14 - Drama…16 Tour Dates… 18 Introduction In September 1846 Verdi started work on a project to turn Johann Wolfgang von Goethe’s play Faust: Part 1 into an opera. The play tells the story of a doctor who is seduced by the devil with the promise of youth and love, and tracks his tragic fall into greed, lust and bloody violence. Gounod was seduced by the play’s dramatic plot, its elements of the supernatural, and the potential for creating a spectacular theatrical experience. Working with “… Musical ideas sprang to the poet Jules Barbier from a version of Goethe’s play by Michael Carré called ”Faust et Marguerite”, my mind like butterflies, and Gounod created a five act opera in French that was all I had to do was to stretch first performed in Paris in 1859. -

The Seven Last Words of Christ
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Doctoral Dissertations Graduate School 2013 The seven last words of Christ : a comparison of three French romantic musical settings by Gounod, Franck, and Dubois Vaughn Roste Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations Part of the Music Commons Recommended Citation Roste, Vaughn, "The es ven last words of Christ : a comparison of three French romantic musical settings by Gounod, Franck, and Dubois" (2013). LSU Doctoral Dissertations. 3987. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/3987 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Doctoral Dissertations by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please [email protected]. THE SEVEN LAST WORDS OF CHRIST: A COMPARISON OF THREE FRENCH ROMANTIC MUSICAL SETTINGS BY GOUNOD, FRANCK, AND DUBOIS A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts in The School of Music by Vaughn Roste B.A., Augustana University College, 1997 B.B.A, Canadian Lutheran Bible Institute, 1997 M.Mus., University of Alberta, 2003 May 2013 ii DEDICATION Writing a dissertation is a project not completed by one person but by several. I need to thank my family—Mom, Dad, Erica, Ben, Finn, and Anders—for their love and undying support through this convoluted and seemingly never-ending process. -

Palazzetto Bru Zane -Ciclo Gounod
La sua musica è divina tanto quanto la sua persona è nobile e distinta. Gounod è giustamente considerato l’apostolo di un romanticismo lirico, sensuale e seduttivo. Dal rapito stupore dell’«aria dei gioielli» del Faust CICLO Gounod ha un al candore pastorale di Mireille passando per la voluttuosità della scena del giardino in Roméo et Juliette, il compositore ha saputo cogliere immenso avvenire. e tradurre in musica i palpiti dell’anima umana vittima dell’amore, CHARLES Pauline Viardot sia esso folgorante o contrastato. Ma Gounod non fu solo il cantore del desiderio: l’obiettivo del ciclo che il Palazzetto Bru Zane gli dedica è appunto mostrarne tutti i diversi aspetti. E dunque, composizioni GOUNOD, poco note (il Concerto per pianoforte con pedaliera, la trascrizione da Mozart per coro a cappella) affiancheranno un evento quale la prima creazione in tempi moderni della sua ultima opera lirica, Le Tribut (1818-1893) de Zamora; al contempo, verrà rivolto uno sguardo nuovo a brani più famosi, in particolare la prima versione del Faust con testi parlati, DALLA CHIESA interpretata con strumenti d’epoca. ALL'OPERA In occasione del bicentenario della nascita del compositore, il Palazzetto Bru Zane si propone di far conoscere meglio un musicista che non fu soltanto l’autore del Faust e di Roméo et Juliette. 17 La sua musica è divina tanto quanto la sua persona è nobile e distinta. Gounod è giustamente considerato l’apostolo di un romanticismo lirico, sensuale e seduttivo. Dal rapito stupore dell’«aria dei gioielli» del Faust CICLO Gounod ha un al candore pastorale di Mireille passando per la voluttuosità della scena del giardino in Roméo et Juliette, il compositore ha saputo cogliere immenso avvenire.