Valberg Et Haut-Var. Beuil, Guillaumes, Péone
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
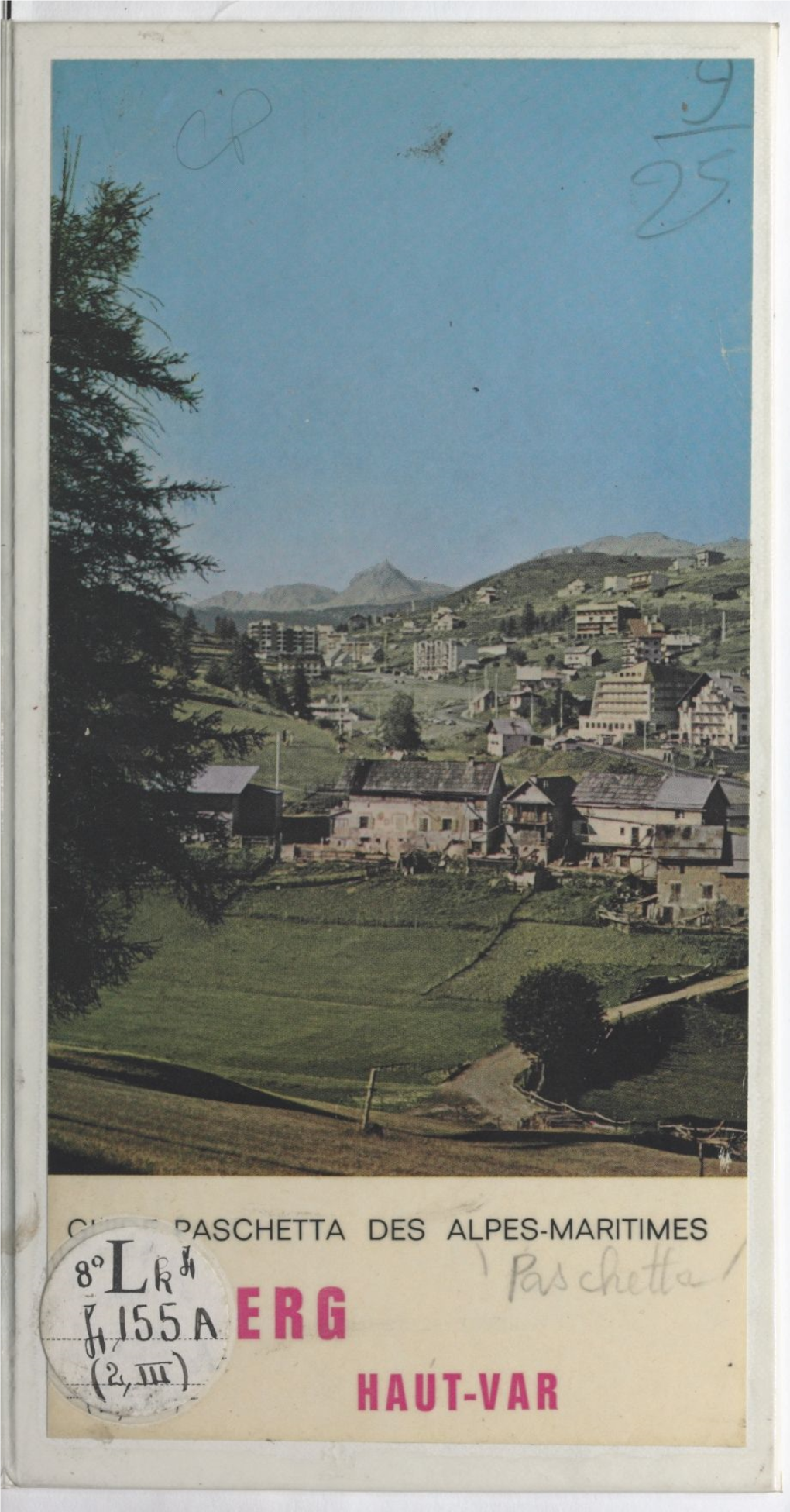
Load more
Recommended publications
-

Pelite N11 ANG Bats
n°11 | SEPTEMBER 2016 La Pélite The red gorge shows up in your mailbox when you least expect it. Discovering... Parti-coloured bat Bats The Haut-Var and Cians valleys are home to an especially large variety of bats. 25 of the 34 © species living in France can be found there! M. Corail LPO Due to the many dierent habitats (forested or rocky areas, heathland), many bat species live in the Gorges de Daluis Nature Reserve. Moreover, the reserve is characterised by the presence of cavities and ancient mines that are ideal for some species to go into hibernation, like the common pipistrelle. Indeed, during winter, bats enter a torpor state and seek calm, cool, and humid places. Other species are less Receptors can be placed in strategic locations to sensitive to changes in temperature and can record the ultrasounds that bats make at night. The Reserve team is grateful to Elisabeth Beneventi also hibernate in buildings or tree hollows, like By analysing them, we can identify which for her work and expresses their deep sorrow to her the Leisler’s bat. species are present in the area. In addition, some family during this dicult time. All of the bats living in Europe and in our bats are caught by setting large nets between regions are insectivores. They mainly eat their roosts and their hunting grounds. Once Did you know...? mosquitoes, aphids, or other small inverte- caught, scientists can study its morphology, and brates. They can eat as much as 600 insects per it can be equipped with a transmitter to keep The parti-coloured bat night, which help control population size. -
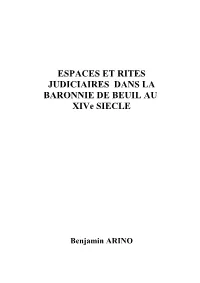
Recherches Régionales
ESPACES ET RITES JUDICIAIRES DANS LA BARONNIE DE BEUIL AU XIVe SIECLE Benjamin ARINO « Le pouvoir judiciaire n'est jamais qu'une composante du pouvoir tout court » affirmait Rodrigue Lavoie1. En Provence, la justice appartient au comte de Provence, source et incarnation du pouvoir dans le comté, véritable souverain; plus précisément, les droits de justice sont détenus par le comte de Provence qui les délègue en totalité ou partie à ses représentants dans les vigueries et baillies mises en place au XIIIe siècle2. De plus, il peut déléguer ces droits à un seigneur local. Les droits de justice établissent plusieurs niveaux de juridiction: les basse, moyenne et haute justice. La moyenne et la haute justice sont appelées dans la langue latine juridique merum et mixtum imperium. Le droit de merum imperium concerne la justice de sang, c’est-à-dire la capacité de juger les crimes et de prononcer des peines d’amputation et de mort. Le droit de mixtum imperium concerne les affaires civiles et pénales dont les sanctions n’entraînent pas d’effusion de sang. Notre étude se situe géographiquement dans une grande seigneurie de Provence orientale, la baronnie de Beuil. Elle est délimitée au nord par les villages de Péone, Beuil et Roure ; à l’est par les gorges du Cians ; à l’ouest par la vallée de la Tinée et au sud par le moyen-Var. Cette seigneurie fut érigée en baronnie à la fin du XIIIe siècle3. Elle s’étend sur une surface de 225 kilomètres carrés en formant un vague quadrilatère. Le seigneur de la baronnie de Beuil, détenteur par délégation du comte de Provence du merum et mixtum imperium, est représenté sur ses terres par ses agents: principalement des bailes, assistés de notaires judiciaires de la seigneurie. -

Subdivision Départementales D'aménagement
SUBDIVISIONS DEPARTEMENTALES D'AMENAGEMENT S.D.A. COMMUNES CHEFS ADRESSES N° TEL N° FAX M. Raymond LITTORAL EST Bendejun - Berre-les-Alpes - Blausasc - Cantaron - Châteauneuf-Villevieille - Coaraze - LEAUTIER 3279, Route des Escaillons 04.93.91.62.70 04.93.79.67.00 Contes - Drap - L'Escarène - Lucéram - Peille - Peillon - Touët-de-l'Escarène Sec : PEIRANI Murielle - 06390 BERRE-LES-ALPES MAUREL Paule Antibes - Biot - Caussols - Châteauneuf - Courmes - Gourdon - La Colle-sur-Loup - Le Bar- M. Michel VINCENT Sec LITTORAL 470 Avenue Jules Grec sur-Loup - Le Rouret - Opio - Roquefort-les-Pins - Saint-Paul - Tourrettes-sur-Loup - CIAUDO Marie- 04.93.64.11.42 OUEST ANTIBES 06600 ANIBES 04.89.04.50.20 Valbonne - Vallauris - Villeneuve-Loubet Christine Auribeau-sur-Siagne - Cabris - Cannes - Escragnolles - Grasse - La Roquette-Siagne - Le LITTORAL M. Christian ERRARD Cannet - Le Tignet - Mandelieu-la-Napoule - Mouans-Sartoux - Mougins - Pégomas - 209, avenue de Grasse OUEST CANNES Sec Sylvie TOSELLO 04.93.68.22.05 Peymeinade - Saint-Cézaire-sur-Siagne - Saint-Vallier-de-Thiey - Spéracèdes - Théoule-sur- 06400 CANNES 04.92.98.30.70 Aurélie Négro Mer MENTON ROYA M. Guillaume CHAUVIN 04.89.04.50.00 Beausoleil - Breil-sur-Roya - Castellar - Castillon - Fontan - Gorbio - La Brigue - La Turbie 6 Rue Masséna BEVERA Sec : BOSIO Sylvie - 04.92.09.72.04 - Menton - Moulinet - Roquebrune-Cap-Martin - Sainte-Agnès - Saorge - Sospel - Tende 06500 MENTON CONEGERO Michelle Aiglun - Amirat - Andon - Bezaudun-les-Alpes - Bonson - Bouyon - Briançonnet - Caille -

LES CIRCONSCRIPTIONS ET LES ÉCOLES DU DÉPARTEMENT Des ALPES-MARITIMES
LES CIRCONSCRIPTIONS ET LES ÉCOLES DU DÉPARTEMENT des ALPES-MARITIMES Antibes : M. LALLAI Antibes, Biot Moulin Neuf. 732, ch. des Eucalyptus - 06160 Juan les Pins Tél : 04.92.93.09.42 [email protected] ASH : Mr MARECHAL SEGPA, ULIS, hôpital, collèges, lycées, Etabs spécialisés. 53 avenue Cap de Croix – 06181 Nice Cédex 2 Tél : 04.93.72.63.41 [email protected] Cagnes/MER : M. COLIN Cagnes/Mer, St Laurent du Var, La Gaude La Baronne maternelle 2 passage Massenet - 06800 Cagnes / Mer Tél : 04.93.20.90.28 [email protected] Cannes : Mme LEFEVRE Cannes Ecole les Brousailles, 182 rue de Grasse - 06400 CannesTél : 04.93.39.80.00 [email protected] Grasse : M. BERRIAUX Andon, Briançonnet, Cabris, Caille, Caussols, Escragnolles, Grasse, St Auban, St Cézaire sur Siagne, St Vallier- de-Thiey, Séranon, Valderoure 13, Bd Fragonard – BP 78834 - 06130 Grasse Tél : 04.93.36.11.92 [email protected] Le Cannet : Mme CHIARDOLA Le Cannet, Mandelieu la Napoule, Théoule sur Mer Ecole Val des Fées - Chemin du Carimail - 06110 Le Cannet Tél : 04.93.46.52.92 [email protected] Menton : M. MESSINA Beausoleil, Breil/Roya, Castellar, Castillon, Fontan, Gorbio, La Brigue, Menton, Moulinet, Roquebrune Cap Martin, St Agnès, St Dalmas de Tende, Saorge, Sospel, Tende, Vintimille Ecole Anne Franck Guillevin - Chemin du Suillet - 06500 Menton Tél : 04.93.35.88.08 [email protected] Nice 1 : M. BATTESTI Beaulieu sur Mer, Cap d'Ail, Eze, St Jean Cap Ferrat, La Turbie, Villefranche sur Mer. -

ESA-299X212-2018-Tzanck.Pdf
Carte du Territoire d’intervention ANDON - ASCROS - AUVARE - BAIROLS - BEAULIEU-SUR-MER BEAUSOLEIL - BEUIL - BÉZAUDUN-LES-ALPES - BIOT - BONSON BOUYON - BRIANÇONNET - CAGNES-SUR-MER - CAILLE CAP-D'AIL - CARROS - CASTELLAR - CASTILLON - CAUSSOLS CHÂTEAUNEUF-D'ENTRAUNES - CIPIÈRES - CLANS - COLLONGUES Equipe Spécialisée CONSÉGUDES - COURMES - COURSEGOULES - CUÉBRIS DALUIS - ENTRAUNES - ESCRAGNOLLES - ÈZE - GARS - GATTIÈRES Alzheimer GILETTE - GORBIO - GOURDON - GRÉOLIÈRES - GUILLAUMES ILONSE - ISOLA - LA COLLE-SUR-LOUP - LA CROIX-SUR-ROUDOULE LA GAUDE - LA PENNE - LA TOUR - LA TURBIE - LE BAR-SUR-LOUP LE BROC - LE MAS - LES FERRES - LES MUJOULS - LIEUCHE MALAUSSÈNE - MARIE - MASSOINS - MENTON - MOULINET PEILLE - PÉONE - PIERLAS - PIERREFEU - PUGET-ROSTANG PUGET-THÉNIERS - REVEST-LES-ROCHES - RIGAUD - RIMPLAS ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN - ROQUEFORT-LES-PINS ROQUESTERON - ROQUESTÉRON-GRASSE - ROUBION - ROURE SAINT-ANTONIN - SAINT-AUBAN - SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE SAINTE-AGNÈS - SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE - SAINT-JEAN-CAP-FERRAT SAINT-JEANNET - SAINT-LAURENT-DU-VAR - SAINT-LÉGER SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES - SAINT-MARTIN-DU-VAR SAINT-PAUL - SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE - SALLAGRIFFON SAUZE - SÉRANON - SIGALE - SOSPEL - THIÉRY - TOUDON TOUËT-SUR-VAR - TOURETTE-DU-CHÂTEAU - TOURNEFORT TOURRETTES-SUR-LOUP - VALDEBLORE - VALDEROURE - VENCE UNISAD ESA VILLARS-SUR-VAR - VILLEFRANCHE-SUR-MER M Services de Soins Infirmiers à Domicile O VILLENEUVE-D'ENTRAUNES C . A I St-Dalmas- L le-Selvage O VILLENEUVE-LOUBET T 231, Avenue Docteur Maurice Donat O F St-Etienne-de-Tinée -

Dossier Départemental Sur Les RISQUES MAJEURS Dans Les
Cet ouvrage a été réalisé par : la Direction de la Défense et de la Sécurité de la Préfecture des Alpes-Maritimes Dossier Départemental Avec l’active participation de : sur les RISQUES MAJEURS dans les Alpes-Maritimes 06 06 Direction Régionale de l'Environnement de Provence-Alpes-Côte d’Azur – 2007 Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de Provence-Alpes-Côte d’Azur Direction Départementale de l'Équipement des Alpes-Maritimes Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt des Alpes-Maritimes Office National des Forêts - Service départemental de Restauration des Terrains en Montagne des Alpes-Maritimes Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes ALPES-MARITIMES Que soient également remerciés : Le Cyprès, la Délégation Régionale d’EDF PACA, Météo France, le BRGM et tous ceux qui ont répondu à nos sollicitations. DANS LES DANS RISQUES MAJEURS DOSSIER DÉPARTEMENTAL SUR LES DÉPARTEMENTAL DOSSIER > Préface > Sommaire général Le RISQUE NATUREL ou TECHNOLOGIQUE MAJEUR ............................. 3 Les ENJEUX en PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR et la SITUATION dans les ALPES-MARITIMES ............................. 13 Le RISQUE NATUREL dans les ALPES-MARITIMES ............................. 19 > Mouvement de terrain ........................................... 20 > Inondation ....................................................... 27 > Feu de forêt ...................................................... 35 > Sismique ......................................................... 42 > Avalanche -

L'incendie De VILLENEUVE D'entraunes
1924 – L’INCENDIE de VILLENEUVE d’ENTRAUNES Le village : Fondée au XIIème siècle en fond de vallée pour semble-t-il remplacer un village érigé sur la colline du Castel, VILLENEUVE (VILLA NOVA), avec les 21 maisons qui forment « le Claus » et « Villeneuve » de chaque coté du ravin du Bourdoux, est, en cet été 1924, une localité prospère qui regroupe 23 familles à l’activité essentiellement agricole. VILLENEUVE d’ENTRAUNES en 1911 En quelques heures… le feu dévastateur, allumé par d’imprudentes mains d’enfants, ne va laisser que cendres, ruines et désolation. Triste répétition de l’histoire, déjà, plus d’un siècle plus tôt, dans la nuit du 9 au 10 octobre 1810, l’incendie d’une maison et de sa grange avait semé l’émoi dans le village conduisant Monsieur le Sous-Préfet de Puget-Théniers à transmettre un rapport en Préfecture « cet incendie constaté par le juge de paix de Guillaumes a été le fait des enfants encore assez jeunes du fermier qui, étant allés le soir au grenier à foin pour prendre du fourrage durent laisser tomber quelques étincelles de la lumière qu’ils avaient ». Autre signe de la peur du feu, toujours présente dans nos villages, le 30 juillet 1879, 7 familles de VILLENEUVE avaient envoyé à Monsieur le Préfet un courrier exposant leurs craintes : « il existe au centre du village un four à pain communal qui a déjà mainte fois menacé de mettre le feu (…) son toit en planches très peu élevé sans avant voûte à l’intérieur, sa cheminée également basse et adossée à des maisons particulières prennent feu pour ainsi dire toutes les fois que l’on met le four en mouvement ». -

06001 Grasse 06002 Grasse 06003
Préfecture des Alpes-Maritimes Direction des élections et de la légalité COORDONNEES DES MAIRIES DES ALPES MARITIMES ET MAIRES Bureau des élections code Arrondis- Communes N° Téléphone N° fax Adresse 1 Adresse 2 Email Maire INSEE -sement Aiglun 06001 GRASSE 04 93 05 85 35 04 93 05 64 92 9 place de la Mairie 06910 AIGLUN [email protected] Mme MORALES Mario Amirat 06002 GRASSE 04 93 05 80 55 04 93 05 68 54 21 rue Mairie 06910 AMIRAT [email protected] M. CONIL Jean-Louis Andon 06003 GRASSE 04 93 60 45 40 04 93 60 74 23 23 place Victorien Bonhomme 06750 ANDON [email protected] Mme OLIVIER Michèle Antibes 06004 GRASSE 04 92 90 50 00 04 92 90 50 01 Cours Masséna - BP 2205 06606 ANTIBES [email protected] M. LEONETTI Jean Ascros 06005 NICE 04 93 05 84 21 04 93 05 68 24 Le Village 06260 ASCROS [email protected] M. GIOBERGIA Vincent Aspremont 06006 NICE 04 93 08 00 01 04 93 08 34 73 21 avenue Caravadossi 06790 ASPREMONT [email protected] M. FERRETTI Alexandre Auribeau-sur-Siagne 06007 GRASSE 04 92 60 20 20 04 93 60 93 07 Montée de la Mairie 06810 AURIBEAU SUR SIAGNE [email protected] M. VARRONE Jacques Auvare 06008 NICE 04 93 05 14 29 04 93 05 14 29 Le Village 06260 AUVARE [email protected] Mme DROGOUL Bernadette Bairols 06009 NICE 04 93 02 90 46 04 93 02 90 46 Le Village 06420 BAIROLS [email protected] M. -

Les Tremplins De Ski À Beuil
Les Tremplins de ski à Beuil Jean Paul DERAI Historien – Université de Nice UFR STAPS Au cours des années 20, la station de Beuil, située dans le Haut Pays niçois, est retenue pour les concours fédéraux et connait un essor indéniable, symbolisé par les concours de vitesse, des courses de fond et enfin, des concours de saut, particulièrement appréciés par la foule. Cet essor, en terme d’image, est à mettre à l’actif de personnalités, telles que le Maire de Beuil, le Président du Conseil Général des Alpes-Maritimes et d’influents militaires, adeptes du ski militaire. La station de Beuil acquiert rapidement une certaine renommée auprès de la clientèle sportive et fortunée, qui vient se divertir et se restaurer, grâce à la création dès 1930, du tremplin de la Condamine et à l’implantation de l’Hôtel du Mont-Mounier. Conjuguées au développement de la station de Valberg, et à l’amélioration de l’accès aux routes, le site de Beuil est conforté par le Conseil Général et la Commune, qui inaugurent en Février 1937, le nouveau tremplin olympique des Launes. L’engouement pour le saut se confirme en février 1938, avec l’organisation à Auron et Beuil des XXVIIe Championnats de France de ski. Suivi par plus de 15000 personnes et 60 journalistes à Beuil, le tremplin olympique devient une référence en France. Dans ce contexte, il convient de présenter les différentes phases qui participent à la structuration de la pratique du ski à Beuil, de connaitre les différents acteurs qui ont participé à la promotion de ce territoire. -

La Situation Linguistique Dans Le Comte De Nice Avant Le Rattachement a La France
LA SITUATION LINGUISTIQUE DANS LE COMTE DE NICE AVANT LE RATTACHEMENT A LA FRANCE Didier LARGE LANGUES ORALES ET LANGUES ECRITES Pourquoi distinguer entre langues orales et langues écrites ? A l'inverse d'aujourd'hui, langues orales et usages écrits ne se sont pas toujours confondus. Dans l'ancien comté de Nice, en ce qui concerne l'usage oral, dans la vie quotidienne, l'occitan est la langue vernaculaire, c'est-à- dire la langue commune à tous, que tout le monde parle, comprend et utilise, tandis que l'italien est langue officielle depuis 1561, c'est-à-dire la langue écrite de l'administration et de la justice. Cette langue officielle, l'italien, est-elle parlée ? Sans doute oui, par quelques fonctionnaires venus de Turin, par tous ceux qui ont de la culture, qui travaillent dans l'administration, ou qui ont affaire à elle, mais la grande majorité de la population ne parle qu'occitan. S'il était permis de résumer cette situation linguistique en une seule phrase, on pourrait dire : dans l'ancien comté de Nice, avant 1860, la population parle occitan et les clercs écrivent en italien. Malheureusement les choses ne sont pas aussi simples, comme on peut en juger : pas moins de quatre changements de frontières entre royaumes de France et de Sardaigne ont lieu au cours des XVIIIe et XIXe siècles ; et à chaque changement de souveraineté correspond un changement de langue officielle, français sous autorité française, italien sous autorité sarde. Pauvres habitants du comté de Nice ! De cette situation géographique aux frontières mutantes, il est résulté une situation linguistique écrite particulière. -

Passeurs De Mémoire
176 passeurs de mémoire Beuil 176varcian.pgs 07.12.2015 14:49 Megapom0492292500 Patrimoine des Alpes-Maritimes : Beuil 177 BEUIL ntre haute et moyenne montagne, le territoire de Beuil offre un paysage à Edominante alpine avec au nord plusieurs sommets dépassant les 2 000 m d’altitude. Le sud est occupé par des plateaux couverts de prairies et de bosquets de mélèzes. Le Cians, dont les gorges encaissées traversent la commune dans sa partie méridionale, est le principal cours d’eau, au côté de nombreux torrents qui entaillent les reliefs. Le village, à 1 450 m d’altitude, surveille de son piton rocheux la sortie des gorges du Cians et s’étend au pied du mont Mounier dont la masse imposante le domine de ses 2 817 m. Plusieurs hameaux s’éparpillent sur son territoire dont celui des Launes, à l’ouest, le plus important. Le territoire est occupé dès l’époque romaine. Un habitat fortifié dénommé Beuil est mentionné dès la première moitié du XIIIe siècle. La commune actuelle sem- ble résulter de la réunion de plusieurs territoires d’origines diverses. Le plus ancien serait centré sur ce qui est aujourd’hui la chapelle Saint-Jean. L’histoire de Beuil se confond avec celle de la célèbre famille des Grimaldi qui en devinrent les seig neurs en 1315 et d ominèrent une grande partie du haut pays niçois jusqu’à la chute d’Annibal Grimaldi en 1621. Beuil, érigé en comté depuis 1561, passa aux mains des Cavalca de Parme. Le bourg, que les Grimaldi avaient délaissé dès le XIVe siècle, vécut en autarcie jusqu’à la fin du XIXe siècle, pra- tiquant l’élevage et l’agriculture. -

Mercan'tour Classic a L P E S - M a R I T I M E S
MERCAN'TOUR CLASSIC A L P E S - M A R I T I M E S 24 MAI 2021 LIVRET TECHNIQUE / ROAD BOOK LES ÉDITOS LE DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES Le lundi 24 mai 2021, le département des Alpes-Maritimes sera l’hôte d’une nouvelle course cycliste professionnelle d’un jour, 30 ans après la dernière édition du Grand Prix de Cannes en 1991. Une classique 100% azuréenne qui aura la particularité d’être taillée pour les grimpeurs. Avec un départ et une arrivée depuis la station de Valberg, l’ascension des cols de la Couillole, la Colmiane ou encore Valberg, les coureurs arpenteront les plus beaux sommets azuréens. Sur le parcours, le passage du peloton sur les routes de la Vésubie durement touchées par la tempête Alex sera un symbole fort du retour à la vie normale pour les habitants de ces villages. Organisée par la « Société MerMonts Organisation » avec le soutien du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, cette course cycliste professionnelle aura pour ambition de s’inscrire durablement dans le calendrier de l’Union Cycliste Internationale. Diffusée dans près de 60 pays, la Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes sera un formidable outil de promotion du territoire et un moyen d’asseoir le Département des Alpes-Maritimes comme une destination incontournable pour le cyclisme. LES ORGANISATEURS CHRISTOPHE MENEI & LAURENT ELLEON C'est en 2020 qu'aurait dû être lancée la Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes, nouvelle épreuve d'un jour voulue et pensée pour les grimpeurs. La crise sanitaire est passée par là et c'est à regret que nous avons dû finalement jeter l'éponge l'an passé.