Les Aspects Juridiques D'une Union Monetaire
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
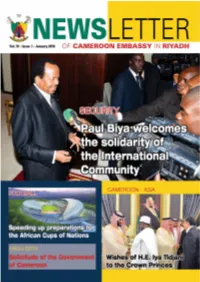
Mise En Page 1
Summary Retrospective 2015 EDITORIAL 3 Taking up the security challenge PRESIDENCY - Facts, pictures and dates 4 - Audiences at Unity Palace 5 - First Lady Chantal Biya named Ambassador of UNAIDS 7 POLITICS - ELECAM: a new management 8 COMMUNICATION TNT: imminent transition for Cameroonian TV channels 9 CULTURE - Manu Dibango: Ambassador of the Francophonie in Rio 12 ENVIRONMENT COP21: President Paul Biya Voices out the position of Central Africa 11 DOCUMENT Law N°2013/004 of 18 April 2013 to lay down private investment incentives in the Republic of Cameroon 12 ECONOMY - The major structuring projects underway 14 DIPLOMACY ON THE MOVE - Wishes to Saudi Crown Princes 17 - IDB: Cameroon honored at Maputo 18 INSIDE THE MISSION The Ambassador supports Cameroonian workers in Kuwait 21 A publication of REGIONAL NEWS Cameroon Embassy in Riyadh ISESCO: Yaounde, capital of Islamic culture for 2022 22 P.O Box 94 336 Riyadh 11693. Tel: +966 11 488 0022/ +966 11 488 0203 HAJ & OUMRA Fax: +966 11 488 1463 / +966 11 482 3520 Web site: www.ambacamsaudi.org Mecca Stampede: Special help assistance of the Head of State to families 23 Email: [email protected] TOURISM CHAIRMAN/ PUBLISHER: H.E. IYA TIDJANI New tourist areas 24 Ambassador SPORTS EDITORS: Mrs Inna DJEINABOU - They make Cameroon proud: Issa Hayatou and Kalkaba Malboum 26 Chief of Communication Center - Football: 2016-2019 African cup of nations Schedules 27 Mrs Suzanne NLEPNA EOG Communication Attaché IMAGE GALLERY 28 CONCEPTION & REALISATION Damien KIDAH Tel: +237 694 84 83 28 2 NEWSLETTER OF CAMEROON EMBASSY IN RIYADH • Vol IV. Issue I Retrospective 2015 Editorial Taking up the security challenge 2015 was marked in Cameroon Two months after the Yaounde Summit, the Heads by the safeguarding of the integrity of State and Government of member countries of ECCAS of the national territory. -

Observatory of Cultural Policies in Africa
Observatory of Cultural Policies in Africa The Observatory is a Pan African international NGO created in 2002 with the support of African Union, the Ford Foundation, and UNESCO. Its aim is to monitor cultural trends and national cultural policies in the region and to enhance their integration in human development strategies through advocacy, information, research, capacity building, networking, co- ordination, and co-operation at the regional and international levels. OCPA NEWS No 337 26 October 2015 OCPA News aims to promote interactive information exchange within Africa and between Africa and the other regions. Please send us information for dissemination about new initiatives, meetings, research projects and publications of interest for cultural policies for development in Africa. Thank you for your co-operation. * OCPA News a pour but de promouvoir un échange d’information interactif en Afrique ainsi qu’entre l’Afrique et les autres régions. Envoyez-nous des informations pour diffusion sur des initiatives novelles, réunions, projets de recherches, publications intéressant les politiques culturelles pour le développement en Afrique. Merci de votre coopération. *** Contact: OCPA Secretariat, Avenida Patrice Lumumba No. 850, Primeiro Andar, Caixa Postal 1207, Maputo, Mozambique Tel.: + 258 21306138 / Fax: +258 21320304 / E-mail: [email protected] Executive Director: Lupwishi Mbuyamba: [email protected] Editor: Máté Kovács: [email protected] OCPA WEB SITE - www.ocpanet.org OCPA FACEBOOK - www.facebook.com/pages/OCPA-Observatory-of-Cultural-Policies-in- -

Gouvernement De La République Du Cameroun
______________________ Annuaire Administratif 2011 SOMMAIRE Pages Gouvernement de la République du Cameroun ................................................................ 6 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN Secrétariat Général .......................................................................................................... 10 Cabinet Civil ................................................................................................................... 14 Services chargés des relations avec les Assemblées ......................................................... 15 Ministres chargés de mission ........................................................................................... 16 Etat-major particulier du Président de la République ....................................................... 16 Délégation Générale à la Sécurité Nationale .................................................................... 18 ASSEMBLEE NATIONALE ET CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL Assemblée Nationale ....................................................................................................... 21 Conseil Economique et social.......................................................................................... 22 DEPARTEMENTS MINISTERIELS Services du Premier Ministre .......................................................................................... 24 Ministère de l'Administration Territoriale et de la décentralisation (MINADT) ............... 31 Ministère des Affaires Sociales (MINAS) ...................................................................... -

Lueurs Et Leurres De La Sécurité Sociale Au Cameroun
LM 5152:LM 3342 23/09/18 21:45 Page1 N° 5152 DU LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018 CAMEROUN 400 F.CFA Menaces terroristes Yaoundé en état d’alerte • Une correspondance attribuée au ministre délégué à la présiden - ce chargé de la Défense (Mindef) adressée au général de corps d’armées, chef d’Etat major des armées, fait état de la présence des sécessionnistes dans certains quartiers de la capitale politique. P.9 Sérail Bilan Narcisse Mouelle Kombi Marcel Niat Lueurs et leurres Ce que je pense de « Paul Biya, Njifenji entre la de la Sécurité sociale pour le Libéralisme vie et la mort au Cameroun communautaire » • A 85 ans, le président du Sénat vient d’être évacué pour • Grégoire Owona passe la quatrième fois à l’étranger au scanner les réalisations • Lire la tribune du ministre pour soins médicaux P.8 de Paul Biya P.8 des Arts et de la Culture. Pp.6-7 Présidentielles 2018 Comment le Rdpc a « chassé » Maurice Kamto de Kribi • L'espace réservé au candidat du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (Mrc) pour battre campagne, a été abusivement occupé par les organisateurs du meeting du parti au pouvoir P.3 LM 5152:LM 3342 23/09/18 21:45 Page2 o Le Messager n 5152 Lundi 24 Septembre 2018 Edito PAR JEAN FRANçOIS CHANNON Emotions de campagne ! Une image déTesTable surabondammenT candidaTs Tels que Cabral Libii eT Maurice Même si le chef de l’ETaT sorTanT, qui uTili - parTagée sur les réseaux en ce débuT offi - KamTo à Douala, ou que l’on agiTe un rou - se jusqu’au bouT les faciliTés que lui ciel de campagne élecTorale pour l’élecTion leau compresseur judiciaire conTre Akere offrenT les avanTages de présidenT de la présidenTielle du 7 ocTobre 2018 au Muna, dans une affaire de famille, susci - République dans une campagne élecTorale Cameroun. -

CFA: the Debate Isopen Afro-Optimists” Aurélie Chazai
MAJOR PROJECTS AGRICULTURE ENERGY BUSINESS IN MINING INDUSTRY SERVICES FINANCE December 2019 - January 2020 / N° 82-83 December 2019 CAMEROON CFA: The debate is open in the CEMAC Aurélie Chazai: ”We are Cameroon becomes CEMAC’s afro-optimists” financial center FREE - CANNOT BE SOLD BUSINESSIN CAMEROON .COM Daily business news from Cameroon Compatible with iPads, smartphones or tablets APP AVAILABLE ON IOS AND ANDROID 3 By Brice R. Mbodiam Decentralization, let’s go… No sooner had they reviewed and approved the 2020 budget that the MPs were once again convened for a 15-day special session to review and vote the draft law on the code of decentralized territorial units. The session already started since December 13, 2019 and according the government explanatory statement, the focus law gathers all the legislative corpus for decentralized territorial units in a single document. Government says the drafting of this law is the concretization of “public authorities’ desire to speed up and deepen the decentralization process, reinforced by the recommendations resulting from the general meetings of communes, as well as those of the national dialogue”. Indeed, one of the outcomes of the national dialogue, initiated by the Head of State to find a way out of the Anglophone crisis that has been shaking the country since 2016, was to accelerate the decentralization process and grant a special status to the northwest and southwest regions. Decentralization was then chosen instead of federalism, supported by some of the participants, and the secession advocated by the separatists, who refused to participate in this great dialogue. It’s now effective that the country’s two Anglophone regions have a special status, “based on linguistic specificity, which is expressed through a particular educational and judicial system, the manage- ment methods of which are laid down by specific laws”. -

The Case of Cameroon
Research Collection Working Paper Marginalization: the case of Cameroon Author(s): Gabriel, Jürg Martin Publication Date: 1997 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-001846836 Rights / License: In Copyright - Non-Commercial Use Permitted This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use. ETH Library Eidgenössische Technische Hochschule Forschungsstelle für Internationale Beziehungen Jürg Martin Gabriel Marginalization: The Case of Cameroon Beiträge Nr. 11 / November 1997 ETH-Zentrum SEI E3 8092 Zürich Seilergraben 49 Tel. 01 632 67 61 Fax 01 632 19 45 Contents Introduction ......................................................................................................................... 1 1 The Post-Cold War Setting................................................................................................. 4 2 The Political Economy of Pre-Modern Elites.................................................................... 9 2.1Politics ............................................................................................................................ 10 2.2 Economics ..................................................................................................................... 18 2.3 Administration............................................................................................................... 24 3 Marginalization in Context.............................................................................................. -
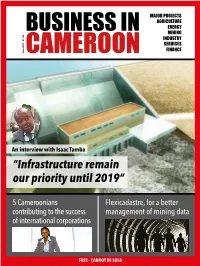
“Infrastructure Remain Our Priority Until 2019”
MAJOR PROJECTS AGRICULTURE ENERGY BUSINESS IN MINING INDUSTRY SERVICES FINANCE June 2017 - N° 52 June 2017 CAMEROON An interview with Isaac Tamba “Infrastructure remain our priority until 2019” 5 Cameroonians Flexicadastre, for a better contributing to the success management of mining data of international corporations FREE - CANNOT BE SOLD BUSINESSIN CAMEROON .COM Daily business news from Cameroon Compatible with iPads, smartphones or tablets APP AVAILABLE ON IOS AND ANDROID 3 Yasmine Bahri-Domon A bet on brilliant minds and infrastructures As much as Cameroon wishes to attract foreign has been carefully structured and planned until investors to boost its industrial production in 2020. It focuses mainly on the development sectors like agriculture, infrastructures, mining and modernization of infrastructures. It is the and to modernize other profitable industries government’s permanent leitmotiv. Based on like telecommunications, services as well as the assertions of the managing director of the help its digital economy bloom, it is important department of economy, public investment to know that many Cameroonians are the pride planning at the ministry of economy, planning of the nation, which is the leading economy and land development (MINEPAT), our readers of the CAEMC (Central African Economic and will, in the pages of this edition, get to know Monetary Community) region, heading various the major infrastructure projects being devel- renowned international financial institutions. oped in the country. They will be able to truly High executives and top technocrats, trained grasp the importance of these projects towards in the best schools, both in Cameroon and Cameroon’s emergence in 2035. In a difficult abroad, they are many, young men and women, global economic context, the country has Cameroonians, to lead multinationals. -

November That Elect Who Won a Seat in Parliament “The Commission Has Observed with Ms
PAN AFRICAN VISIONS MARKETING AFRICAN SUCCESS STORIES & MORE MAG 1120 Vol III, NOV. 2020. www.panafricanvisions.com Changing Direction For A Sinking Ship President Lazarus Chakwera On Building The Foundation For A New Malawi Cameroon: Global Outrage over School Killings But No Affirmative Action #EndSARS: And The Nigerian Youth Spoke But Is Buhari Listening? Kenya : New Panacea For A United Nation South Africa: Racial Tensions Over Farm Killings PAN-AFRICAN PRO-AFRICAN www.centurionlg.com Contents PAN AFRICAN VISIONs CONTENTS A Scar On The Global Conscience From The Kumba School Massa- USA ________________________________________ 29 cre _________________________________________ 2 Mozambique Faces Worst Humanitarian Crisis Due To Terrorist #EndSARS: And The Nigerian Youth Spoke _____________ 4 Attacks, Now Expanded To Tanzania __________________ 30 A Turning Point For Protests in Nigeria with End SARS-Veteran Dilemma Over How Rwanda Will Grow Cannabis Without Consum- Journalist Chido Onumah _________________________ 6 ing It ________________________________________ 31 We Are Laying The Foundation For A New Malawi-President Chak- Cameroon: Cases Of Rape Increasing At An Alarming Rate ___ 32 wera ________________________________________ 10 Education, Courtship, Family, and Africans Abroad. _______ 33 Cameroon School Killings: Another Heinous Crime, Mammoth African Countries Urged To Prioritise Mental Health Needs __ 34 Condemnations, National Mourning, No Affirmative Action __ 13 Africa Stands Behind Ngozi Okonjo-Iweala As She Inches Close -

Gouvernement De La République Du Cameroun
______________________ Annuaire Administratif 2014 SOMMAIRE Pages Gouvernement de la République du Cameroun ................................................................ 6 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN Secrétariat Général .......................................................................................................... 10 Cabinet Civil ................................................................................................................... 14 Services chargés des relations avec les Assemblées ......................................................... 15 Ministres chargés de mission ........................................................................................... 16 Etat-major particulier du Président de la République ....................................................... 16 Délégation Générale à la Sécurité Nationale .................................................................... 18 SENAT Bureaux de la Chambre ..................................................................................... 21 ASSEMBLEE NATIONALE ET CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL Assemblée Nationale ....................................................................................................... 24 Conseil Economique et social.......................................................................................... 25 DEPARTEMENTS MINISTERIELS Services du Premier Ministre .......................................................................................... 27 Ministère de l'Administration Territoriale et de la -

No. 344, May 2016
Pour la version française cliquez ici. Observatory of Cultural Policies in Africa The Observatory is a Pan African international NGO created in 2002 with the support of African Union, the Ford Foundation, and UNESCO. Its aim is to monitor cultural trends and national cultural policies in the region and to enhance their integration in human development strategies through advocacy, information, research, capacity building, networking, co-ordination, and co-operation at the regional and international levels. OCPA NEWS No 344 May 2016 OCPA News aims to promote interactive information exchange within Africa and between Africa and the other regions. Please send us information for dissemination about new initiatives, meetings, research projects and publications of interest for cultural policies for development in Africa. Thank you for your co-operation. *** Contact: OCPA Secretariat, Avenida Patrice Lumumba No. 850, Primeiro Andar, Caixa Postal 1207, Maputo, Mozambique Tel.: + 258 21306138 / Fax: +258 21320304 / E-mail: [email protected] Executive Director: Lupwishi Mbuyamba, [email protected] Editor of OCPA News: Máté Kovács, [email protected] 1 OCPA WEB SITE - www.ocpanet.org OCPA FACEBOOK - www.facebook.com/pages/OCPA-Observatory-of-Cultural-Policies-in- Africa/100962769953248?v=info You can subscribe or unsubscribe to OCPA News via the online form at http://www.ocpanet.org/activities/newsletter/mailinglist/subscribe-en.html or http://www.ocpanet.org/activities/newsletter/mailinglist/unsubscribe-en.html See previous issues -

IL ÉTAIT UNE FOIS LE CICIBA DIASPORA L'amérique Latine En CARNAVAL ISSN 0768-9403
EDITO : L'âge de la maturité CICIBA N° 3092 - SEPTEMBRE 2020 BULLETIN ELECTRONIQUE DU CICIBA + 3e année, n°2, Avril 2021 Bern HEINE : Gerhard KUBIK : Engelbert MVENG : Cyprien RUGAMBA : « The Dispersal of the « African Graphic « La symbolique dans « Le monde et les Bantu Peoples in the Systems (Bantu l'art négro-africain » avatars de transmission Light of Linguistic languages zone) » de la poésie dynastique Evidence » rwandaise » COMMÉMORATION 8 janvier 1983 GRANDES FIGURES BANTU Nelson MANDELA IL ÉTAIT UNE FOIS LE CICIBA DIASPORA L'Amérique latine en CARNAVAL ISSN 0768-9403 + N°2, Avril 2021 1 + 2 N°2, Avril 2021 EDITO Antoine MANDA TCHEBWA L'âge de la maturité ans ! C’est l’âge que donnera à voir, à grands traits, dogmatismes ethnocentristes. Il vient d’atteindre prioritairement : la force de cette y a en eux surtout cette manière le CICIBA depuis vision matricielle, le réalisme qui l’a hardie et audacieuse d’investir la le 8 janvier 2021. portée, ses rêves et ambitions, etc. réalité bantu, ses infrastructures En temps normal, Dans cette optique, ensemble organiques, ses structures sociales un tel événement tentons un voyage vers les origines et ses superstructures mentales, 38aurait donné lieu à une célébration d’une aventure qui, quoique cumulant matériaux culturels et fastueuse, et publique. Mais il n’en confrontée à moults écueils, a su historiques en raison de l’évidence a pas été question cette année. tenir ses principaux paris. Ce qui apodictique des faits interrogés. Ce Le cœur assez serré (COVID-19 n’est pas rien. Il suffira de revisiter qui, accordant une place de choix oblige), nous nous contenterons quelques grands moments de la à une articulation épistémique des cette année d’une simple évocation recherche du CICIBA, portés par plus aiguisées, a toujours le mérite par la mécanique de la rémanence. -

Cameroon Embassy Newsletter 2016-01
Summary Retrospective 2015 EDITORIAL 3 Taking up the security challenge PRESIDENCY - Facts, pictures and dates 4 - Audiences at Unity Palace 5 - First Lady Chantal Biya named Ambassador of UNAIDS 7 POLITICS - ELECAM : a new management 8 COMMUNICATION TNT : imminent transition for Cameroonian TV channels 9 CULTURE - Manu Dibango : Ambassador of the Francophonie in Rio 12 ENVIRONMENT COP21 : President Paul Biya Voices out the position of Central Africa 11 DOCUMENT Law N°2013/004 of 18 April 2013 to lay down private investment incentives in the Republic of Cameroon 12 ECONOMY - The major structuring projects underway 14 DIPLOMACY ON THE MOVE - Wishes to Saudi Crown Princes 17 - IDB : Cameroon honored at Maputo 18 INSIDE THE MISSION The Ambassador supports Cameroonian workers in Kuwait 21 A publication of REGIONAL NEWS Cameroon Embassy in Riyadh ISESCO : Yaounde, capital of Islamic culture for 2022 22 P.O Box 94 336 Riyadh 11693. Tel: +966 11 488 0022/ +966 11 488 0203 HAJ & OUMRA Fax: +966 11 488 1463 / +966 11 482 3520 Web site: www.ambacamsaudi.org Mecca Stampede : Special help assistance of the Head of State to families 23 Email: [email protected] TOURISM CHAIRMAN/ PUBLISHER: H.E. IYA TIDJANI New tourist areas 24 Ambassador SPORTS EDITORS: Mrs Inna DJEINABOU - They make Cameroon proud : Issa Hayatou and Kalkaba Malboum 26 Chief of Communication Center - Football : 2016-2019 African cup of nations Schedules 27 Mrs Suzanne NLEPNA EOG Communication Attaché IMAGE GALLERY 28 CONCEPTION & REALISATION Damien KIDAH Tel: +237 694 84 83 28 2 NEWSLETTER OF CAMEROON EMBASSY IN RIYADH • Vol IV. Issue I Retrospective 2015 Editorial Taking up the security challenge 2015 was marked in Cameroon Two months after the Yaounde Summit, the Heads by the safeguarding of the integrity of State and Government of member countries of ECCAS of the national territory.