On Veille Sur L'avenir
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
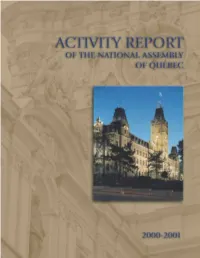
Rapport AN-2001
ACTIVITY REPORT OF THE NATIONAL ASSEMBLY 2000-2001 This publication was accomplished with the collaboration of the executive personnel and staff from all administrative branches of the National Assembly. Unless otherwise indicated, the data provided in this report concerns the activities of the National Assembly from 1 April 2000 to 31 March 2001. Director Cécilia Tremblay Coordinator Jean Bédard Supervisory Committee Jean Bédard Michel Bonsaint Hélène Galarneau Johanne Lapointe Patricia Rousseau Cécilia Tremblay Editor Johanne Lapointe assisted by Lise St-Hilaire Translator Sylvia Ford Revisors Nancy Ford Denise Léonard Design Joan Deraîche Page layout Robert Bédard Manon Dallaire Joan Deraîche Printing National Assembly Press Photographs Front cover: Eugen Kedl Luc Antoine Couturier Photographs of the Members of the 36th Legislature: Daniel Lessard Éric Lajeunesse Jacques Pontbriand Legal deposit - 2nd Quarter 2001 Bibliothèque nationale du Québec Bibliothèque nationale du Canada ISBN 2-550-37742-7 ISSN 1492-9023 2 TABLE OF CONTENTS Preface .............................................................................................................. 5 Foreword ........................................................................................................... 6 The National Assembly ......................................................................... 7 its mission ...................................................................................................... 9 the Members ................................................................................................. -

The Evolution of the Franco-American Novel of New England (1875-2004)
BORDER SPACES AND LA SURVIVANCE: THE EVOLUTION OF THE FRANCO-AMERICAN NOVEL OF NEW ENGLAND (1875-2004) By CYNTHIA C. LEES A DISSERTATION PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF FLORIDA 2006 Copyright 2006 By Cynthia C. Lees ACKNOWLEDGMENTS I would like to express my gratitude to the members of my supervisory committee, five professors who have contributed unfailingly helpful suggestions during the writing process. I consider myself fortunate to have had the expert guidance of professors Hélène Blondeau, William Calin, David Leverenz, and Jane Moss. Most of all, I am grateful to Dr. Carol J. Murphy, chair of the committee, for her concise editing, insightful comments, and encouragement throughout the project. Also, I wish to recognize the invaluable contributions of Robert Perreault, author, historian, and Franco- American, a scholar who lives his heritage proudly. I am especially indebted to my husband Daniel for his patience and kindness during the past year. His belief in me never wavered. iii TABLE OF CONTENTS Page ACKNOWLEDGMENTS ................................................ iii LIST OF FIGURES .................................................... vii ABSTRACT.......................................................... viii CHAPTER 1 SITING THE FRANCO-AMERICAN NOVEL . 1 1.1 Brief Overview of the Franco-American Novel of New England . 1 1.2 The Franco-American Novel and the Ideology of La Survivance ..........7 1.3 Framing the Ideology of La Survivance: Theoretical Approaches to Space and Place ....................................................13 1.4 Coming to Terms with Space and Place . 15 1.4.1 The Franco-American Novel and the Notion of Place . -

Group Continues to Lobby Quebec on Behalf
What’s going to cost more in 2020 Groceries In its Housing Market Outlook, the Canada Based on recent reports from universities Mortgage and Housing Corp. forecasts the researchers, food prices are expected to rise average price of a home to be in the range of between two and four per cent. $506,200 to $531,000 in 2020. For the average family following Canada’s food CMHC predicts modest home price increases guide, that can translate into an additional $487 over next two years. Quebec market will show on food, increasing the average household total “relatively strong” gains. grocery bill to $12,667. Also a report from Rentals.ca forecast that The cost of meats is expected to increase most overall, rents in the Greater Montreal Area, dramatically — between four to six per cent — will increase by 4.8 per cent. while on the low end of the spectrum, bakery Gasoline items are poised to stay the same or rise by If you were hoping for a break on gas, 2020 two per cent. won’t be your year. Housing Consumers that aren’t actively paying attention If you plan on moving or buying a home, those for lower prices, are going to end up spending costs are also expected to rise. anywhere from $200 to $300 more per year. Taxes, rebates and fees: What’s changing in Quebec in 2020 he new year means changes for your tax system for public daycare will be retroactive The savings will depend on where you live. Hydro-Québec rebate Tbill and your bottom line. -

Government of Lucien Bouchard
QUÉ BEC'S POSITIONS ON CONSTITUTIONAL AND INTERGOVERNMENTAL ISSUES FROM 1936 TO MARCH 2001 GOVERNMENT OF the popular vote each time expressed LUCIEN BOUCHARD and that, each time, our democracy (JANUARY 29, 1996 TO MARCH 8, 2001) has grown in strength, our right to choose become that much stronger. [...] There is nothing more sacred in the democratic life of a people than its capacity to dispose of its own des- tiny. This is the very essence of their liberty.400 379.As a reaction to federal intervention in the Bertrand case, the Québec National Assembly adopted the fol- lowing resolution: “That the National Assembly reaffirm that the people of Daniel Lessard Québec are free to take charge of their own destiny, to define without ••• Status of Québec interference their political status and 377.In North America, Québec is the only to ensure their economic, social and society with a French-Speaking major- cultural development.”401 ity, a well-defined territorial base, and political institutions it controls. The 380.The only judge and jury on the future people of Québec possess all the tra- of Québec happens to be the people of ditional characteristics of a nation. Québec. No judge can stand in the [...] The Québec people subscribe to way of a people’s democratic expres- the democratic concept of a French- sion. The government of Québec will Speaking nation, pluralist in its culture, not go before the Supreme Court of and open to international immigration Canada regarding the federal govern- [...].399 ment’s Reference concerning the future of the Québec people. -

Coalition Contre La Répression Et Les Abus Policiers
Mémoire au comité consultatif sur la réalité policière La réalité des victimes d’abus policiers Alexandre Popovic 15 octobre 2020 Table des matières Historique ............................................................................................................................................................................. p. 3 Avant-propos ...................................................................................................................................................................... p. 4 Une machine à rejeter les plaintes ............................................................................................................................. p. 9 Un BEI peu convaincant… ........................................................................................................................................... p. 21 Place aux enquêtes publiques du coroner ............................................................................................................. p. 26 Les interventions policières auprès de personnes en crise ............................................................................ p. 30 Les recommandations .................................................................................................................................................................... p. 39 2 Historique La Coalition contre la répression et les abus policiers été mise sur pied dans la foulée de la mort de Fredy Villanueva, qui a été abattu à l’âge de 18 ans lors d’une intervention du Service de police -

A New Franco-American Society – La Bibliothèque Nationale Franco-Américaine
Le FORUM “AFIN D’ÊTRE EN PLEINE POSSESSION DE SES MOYENS” VOLUME 34, #3 FALL/AUTOMNE 2009 New Website: francoamericanarchives.org another pertinent website to check out - Franco-American Women’s Institute: http://www.fawi.net $6.00 US Le Forum This issue of Le Forum is dedicated in loving memory to Marie-Anne Gauvin Ce numéro du “Forum” est dédié à la Le Centre Franco-Américain douce mémoire de Marie-Anne Gauvin, voir Université du Maine Orono, Maine 04469-5719 [email protected] page 4... Téléphone: 207-581-FROG (3764) Télécopieur: 207-581-1455 Sommaire/Contents Volume 34, Numéro 3 FALL/AUTOMNE Features Éditeur/Publisher Yvon A. Labbé Letters/Lettres...............................................................................3, 25-27 Rédactrice/Gérante/Managing Editor Lisa Desjardins Michaud L’État du Maine.........................................................4-10, 22, 23, 27, 44 Mise en page/Layout Lisa Desjardins Michaud L’État du Connecticut.....................................................................11-22 Composition/Typesetting Robin Ouellette L’État du Massachusetts......................................................................23 Lisa Michaud Aide Technique L’État du Minnesota.....................................................37, 38, 42, 47, 48 Lisa Michaud Yvon Labbé France-Louisiane..............................................................................50, 54 Tirage/Circulation/4,500 Imprimé chez/Printed by Books/Livres...............................................................................30, -

Le Forum, Vol. 41 No. 2 Lisa Desjardins Michaud, Rédactrice
The University of Maine DigitalCommons@UMaine Le FORUM Journal Franco-American Centre Franco-Américain 6-2019 Le Forum, Vol. 41 No. 2 Lisa Desjardins Michaud, Rédactrice Gérard Coulombe Guy Dubay James Myall Juliana L'Heureux See next page for additional authors Follow this and additional works at: https://digitalcommons.library.umaine.edu/ francoamericain_forum Recommended Citation Michaud, Rédactrice, Lisa Desjardins; Coulombe, Gérard; Dubay, Guy; Myall, James; L'Heureux, Juliana; Lacroix, Patrick; Staples, Ann Marie; Moreau, Daniel; Lessard, Treffle;e P rreault, Robert B.; Gauvin, Marie-Anne; Bérubé, Robert; and Chenard, Robert, "Le Forum, Vol. 41 No. 2" (2019). Le FORUM Journal. 91. https://digitalcommons.library.umaine.edu/francoamericain_forum/91 This Book is brought to you for free and open access by DigitalCommons@UMaine. It has been accepted for inclusion in Le FORUM Journal by an authorized administrator of DigitalCommons@UMaine. For more information, please contact [email protected]. Authors Lisa Desjardins Michaud, Rédactrice; Gérard Coulombe; Guy Dubay; James Myall; Juliana L'Heureux; Patrick Lacroix; Ann Marie Staples; Daniel Moreau; Treffle Lessard; Robert B. Perreault; Marie-Anne Gauvin; Robert Bérubé; and Robert Chenard This book is available at DigitalCommons@UMaine: https://digitalcommons.library.umaine.edu/francoamericain_forum/91 Le FORUM “AFIN D’ÊTRE EN PLEINE POSSESSION DE SES MOYENS” VOLUME 41, #2 SUMMER/ÉTÉ 2019 In This Issue: THE AMERICANIZATION OF THE MADAWASKA ACADIANS by GUY F. DUBAY Madawaska, -

The Sentinelle Affair: a Study in Multilingual Language Practices
University of Rhode Island DigitalCommons@URI Open Access Dissertations 2015 THE SENTINELLE AFFAIR: A STUDY IN MULTILINGUAL LANGUAGE PRACTICES Jason Peters University of Rhode Island, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.uri.edu/oa_diss Recommended Citation Peters, Jason, "THE SENTINELLE AFFAIR: A STUDY IN MULTILINGUAL LANGUAGE PRACTICES" (2015). Open Access Dissertations. Paper 307. https://digitalcommons.uri.edu/oa_diss/307 This Dissertation is brought to you for free and open access by DigitalCommons@URI. It has been accepted for inclusion in Open Access Dissertations by an authorized administrator of DigitalCommons@URI. For more information, please contact [email protected]. ! ! ! THE SENTINELLE! AFFAIR: A STUDY IN MULTILINGUAL! LANGUAGE PRACTICES BY! JASON PETERS! ! ! ! ! ! ! A DISSERTATION SUBMITTED IN !PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR! THE DEGREE OF ! DOCTOR OF PHILOSOPHY! IN! ENGLISH RHETORIC! AND COMPOSITION ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! UNIVERSITY OF !RHODE ISLAND 2015 ! ! ! ! ! ! DOCTOR OF PHILOSOPHY! DISSERTATION OF! ! JASON PETERS ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !APPROVED: !Dissertation Committee: !Co-Major Professor: Nedra Reynolds !Co-Major Professor: Caroline Gottschalk-Druschke ! Kim Hensley Owens ! Kenneth Rogers Nasser H. Zawia ! DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL ! ! ! UNIVERSITY OF RHODE ISLAND 2015 ABSTRACT Rhetorical historiography needs to disrupt existing archival arrangements of language differences. These arrangements preserve an ideology of linguistic modernity that effaces and oversimplifies the complex multilingual practices of actual language users. By disrupting the principles of selection and arrangement that make up an archive’s evidential value, rhetorical researchers can undermine ideologies of linguistic modernity and can recover an array of rhetorical resistance strategies that multilinguals have historically taken towards the political and socioeconomic dominance of English. This project does this disruptive work by analyzing the multisitedness of Mount St. -

Annual Report 2015 2016 2016
2016 ANNUAL REPORT 2015 2016 Last year more than ever before, CECI held out the promise of better days for populations in need, particularly in Nepal, where we helped tens of thousands of people recover from the earthquake that struck in April 2015. © KIRAN AMBWANI CECI’s swift response to support people of all ages in the wake of the disaster made it easier for them to return to the course of everyday life, especially by limiting the number of displacements of families and citizens. © KIRAN AMBWANI CECI helps populations restart and grow their economic activities so they can proudly take part in rebuilding and reinvigorating their communities. © KIRAN AMBWANI CECI not only offers temporary shelter, water, and emergency care, but a new future founded on sustainable development. © KIRAN AMBWANI © BENOIT AQUIN 12 Strategic plan 14 Where we work 14 Africa 16 Asia 17 Latin America 18 Haiti 20 Volunteer cooperation 24 Humanitarian assistance 26 CECI communications 30 Donors and contributors 32 Financial information 2015–2016 36 Members 37 Programs and projects 40 Contact info The UN Summit in September CECI recently wrapped up the second GLOBAL 2015 adopted the 2030 Agenda for year of its 2014–2019 strategic plan, Sustainable Development, which set 17 with the ambitious aim to create an ISSUES Sustainable Development Goals (SDG) international CECI that mobilizes key and laid out an operating framework actors for change in both the South and AND for sustainable development actors the North. like CECI. The goals recognize the SUSTAINABLE universality and the interconnectedness Several important targets have been of the world’s most pressing issues, reached—we have created the first DEVELOP- prompting us to tackle the underlying two advisory committees in countries causes of inequality with innovation and belonging to the CECI family (Haiti MENT creativity. -

Narratives of Canadian Identity at the Ultimate Fighting Championship
Western University Scholarship@Western Electronic Thesis and Dissertation Repository 12-3-2019 2:00 PM Narratives of Canadian Identity at the Ultimate Fighting Championship Jared V. Walters The University of Western Ontario Supervisor Heine, Michael The University of Western Ontario Graduate Program in Kinesiology A thesis submitted in partial fulfillment of the equirr ements for the degree in Doctor of Philosophy © Jared V. Walters 2019 Follow this and additional works at: https://ir.lib.uwo.ca/etd Part of the Canadian History Commons, Other Film and Media Studies Commons, Other Kinesiology Commons, and the Sports Studies Commons Recommended Citation Walters, Jared V., "Narratives of Canadian Identity at the Ultimate Fighting Championship" (2019). Electronic Thesis and Dissertation Repository. 6783. https://ir.lib.uwo.ca/etd/6783 This Dissertation/Thesis is brought to you for free and open access by Scholarship@Western. It has been accepted for inclusion in Electronic Thesis and Dissertation Repository by an authorized administrator of Scholarship@Western. For more information, please contact [email protected]. Abstract The purpose of this dissertation was to examine the use of representations and symbols of Canadian identity within the event coverage produced by the Ultimate Fighting Cham- pionship Corporation, in the context of its two key events, Ultimate Fighting Champion- ship, and Fight Night, produced in Canada. To establish the historical context in which the sport developed in Canada, a narrative historiography of the political and legal struggles that led to the legalization and increas- ing popularity of Mixed Martial Arts, and the UFCC’s version of the sport, in particular. This first major part of the dissertation is contained in Study 1. -

Études Internationales
Document generated on 09/27/2021 5:10 a.m. Études internationales II- Les relations extérieures du Québec Manon Tessier La politique extérieure du Japon : au-delà du réalisme ? Volume 30, Number 1, 1999 URI: https://id.erudit.org/iderudit/703997ar DOI: https://doi.org/10.7202/703997ar See table of contents Publisher(s) Institut québécois des hautes études internationales ISSN 0014-2123 (print) 1703-7891 (digital) Explore this journal Cite this document Tessier, M. (1999). II- Les relations extérieures du Québec. Études internationales, 30(1), 131–136. https://doi.org/10.7202/703997ar Tous droits réservés © Études internationales, 1999 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research. https://www.erudit.org/en/ CHRONIQUE DES RELATIONS EXTÉRIEURES DU CANADA ET DU QUÉBEC 131 11 novembre : Le ministre des Ressources naturelles du Canada et minis tre responsable de la Commission canadienne du blé, M. Ralph Goodale, rencontre son vis-à-vis argentin, Me Gumersindo Alonso, à Buenos Aires, pour discuter de questions liées aux secteurs de la foresterie et de l'agriculture. (Agriculture et Agroalimentaire Canada, Communiqué, 11 novembre 1998). 14 novembre : La ministre de l'Environnement, Mme Christine Stewart, se déclare satisfaite du Plan d'action de Buenos Aires sur les changements climatiques au sujet duquel 180 pays se sont entendus. -

2014–2015 Annual Report
2014–2015 annual report PRODUCTION produced, coordinated and written by | CECI Communications printed by | L’Empreinte print run | 700 French and 250 English copies Printed in Canada | This report has also been printed in French. © 2015 ceci (all rights reserved) © COVER PHOTO : ÉRIC ST-PIERRE / CECI Our international cooperation programs are funded by the Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada. A Word from the President and the Executive Director Innovating in a Sustainable and Inclusive Manner In the places we work, 2014–2015 was dictated by human security issues and natural disasters: conflicts in West Africa, the Ebola epidemic in Guinea, Typhoons Hayain and Hagupit in the Philippines and recurrent drought and food crises in the Sahel. Global warming has unleashed forces that are severely affecting some of the world’s poorest populations. Decline in arable land, depleted food reserves, increased flooding, prolonged drought and steadily increasing numbers of hurricanes, typhoons, and earthquakes displace large populations and aggravate poverty. CECI’s teams and partners were mobilized to bring a swift and adequate response to the needs of the most vulnerable populations. This report presents our activities and the way we obtain development results, in spite of and through these crisis situations. This year, the government officially confirmed a third phase of funding for our volunteer cooperation program, Uniterra (2015–2020). The program is jointly run with our long-term partner, World University Service of Canada (WUSC). It operates in 14 countries and aims to improve the socioeconomic living conditions of over 5 million people, of whom 60% are women and 50% are young people.