Rapport De Présentation Dossier Arrêt De Projet
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
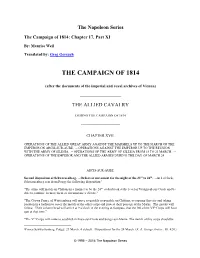
The Campaign of 1814: Chapter 17, Part XI
The Napoleon Series The Campaign of 1814: Chapter 17, Part XI By: Maurice Weil Translated by: Greg Gorsuch THE CAMPAIGN OF 1814 (after the documents of the imperial and royal archives of Vienna) _____________________ THE ALLIED CAVALRY DURING THE CAMPAIGN OF 1814 ________________________ CHAPTER XVII. OPERATIONS OF THE ALLIED GREAT ARMY AGAINST THE MARSHELS UP TO THE MARCH OF THE EMPEROR ON ARCIS-SUR-AUBE. -- OPERATIONS AGAINST THE EMPEROR UP TO THE REUNION WITH THE ARMY OF SILESIA. -- OPERATIONS OF THE ARMY OF SILESIA FROM 18 TO 23 MARCH. -- OPERATIONS OF THE EMPEROR AND THE ALLIED ARMIES DURING THE DAY OF MARCH 24. _________ ARCIS-SUR-AUBE. Second disposition of Schwarzenberg. --Orders of movement for the night of the 23rd to 24th. --At 4 o'clock, Schwarzenberg sent from Pougy the following disposition:1 "The army will march on Châlons in a manner to be the 24th at daybreak at the level of Vésigneul-sur-Coole and be able to continue its movement as circumstances dictate." "The Crown Prince of Württemberg will move as quickly as possible on Châlons, occupying this city and taking position in a fashion to cover the march of the other corps and protect their passage of the Marne. The guards will follow. Their column head will arrive at 9 o'clock in the evening at Sompuis, that the left of the VIth Corps will have quit at that time." "The Vth Corps will come to establish in Faux-sur-Coole and Songy-sur-Marne. The march of this corps should be 1Prince Schwarzenberg, Pougy, 23 March, 4 o'clock. -

ELECTIONS MUNICIPALES 1Er Tour Du 15 Mars 2020
ELECTIONS MUNICIPALES 1er tour du 15 Mars 2020 Livre des candidats par commune (scrutin plurinominal) (limité aux communes du portefeuille : Arrondissement de Reims) Page 1 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Anthenay (Marne) Nombre de sièges à pourvoir : 7 M. ALLART David Mme BENDJEGUELLAL Yasmina M. BERNIER Alain M. BERNIER Marc-Antoine Mme DELACOURT Sylvie M. DIOUY Guy M. DIOUY Hervé M. GUIDEZ Bruno Mme LAURIN Cathy M. MOREAU Hubert M. NAEYAERT Nicolas M. VINCENT Yannick Page 2 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Aougny (Marne) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. AUBIN Eric Mme AUBIN Sylvie M. BERLOT Christian M. BERNARDO François M. DHUICQ Benôit M. FAILLIOT Sébastien M. LEQUART Alain M. LEROY Frédéric M. MERCIER Julien M. POUGNIET Aymeric M. RAMBOUT Raphaël M. RAULIN Bruno M. VAN DRIESSCHE Benoît Page 3 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Arcis-le-Ponsart (Marne) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. BERNIER David M. BILLET Julien M. COPET Frédéric M. DUBOIS Jean-Luc Mme GUILLEMIN Aude M. JOBERT Antoine M. MALAPEL Bernard M. PELLETIER Guillaume M. PIERROT Gérard M. PILORGET Stéphane Page 4 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Aubérive (Marne) Nombre de sièges à pourvoir : 11 Mme ALLART Nadine M. CAMUS Nicolas M. CARRY David M. FAVRE Vincent M. GALICHET Jean-Paul M. GILLE Fabrice M. JACQUET Thierry M. LEMERY Basile M. LOGIE Emmanuel M. LORIN Gérald M. -

Document De Présentation COREST Marne Du 11/06/2018
Comité Régional des Services de Transport Marne Lundi 11 juin 2018 à 18h00 Hôtel de Ville Salle du Conseil Municipal Place de l’Hôtel de Ville Fismes COREST Marne: - Ligne TER Reims – Châlons-en-Champagne - Ligne TER Reims – Epernay - Ligne TER Reims – Laon - Ligne TER Reims – Fismes - Ligne TER Reims – Champagne-Ardenne TGV lignes ferroviaires - Ligne TER Châlons-en-Champagne – Verdun ligne routière COREST Marne - 11 juin 2018 2 La Région Grand Est, Autorité Organisatrice des Transports Avec un budget de 867 M€ 82 % en 2018 18 % Fonctionnement + de 30 % du budget régional Investissement Finance et organise les TER Accompagne les projets de modernisation des gares 441 M€ 15 M€ Coordonne l’intermodalité Finance à 100 % les Finance et organise les matériels roulants transports 80 M€ interurbains et scolaires Accompagne les 260 M€ projets d’infrastructures COREST Marne - 11 juin 2018 50 M€ 3 Ordre du jour 1- Vie des lignes TER : Point de conjoncture des lignes TER (régularité, trafic, suppressions), 2- Travaux sur le réseau ferroviaire Chantiers 2018 et projets en cours 3- Plan de modernisation des gares 4- Evolutions de l’offre de transport TER : Prospective SA 2020 5- Points spécifiques au COREST: Proposition de Groupes de Travail Technique 2018/2019 COREST Marne - 11 juin 2018 4 1 – Vie des lignes régionales À l’échelle du réseau TER Grand Est • Evolution du trafic : • Trafic cumulé 2017 : 1,94 Mrd voyages.km Évolution du trafic 2017/2016 : + 3,4 % Évolution du trafic 1er trimestre 2018/1er trimestre 2017 : + 0,07 % • Taux de régularité 94,62 % en 2017 et 94,05 % en 2018 (1er trimestre). -

Le Mot Du Maire
Le mot du Maire Chers Amis, Ce bulletin parait cet été dans des conditions particulières. La menace d’une seconde vague de la pandémie plane toujours sur nos têtes. Le déconfinement mis en place, certes apprécié, n’est que partiel et implique une poursuite des règles de prudence contre la contagion de l’épidémie. Lors de notre dernier bulletin, nous étions loin d’entrevoir ce qui allait se passer. La période de confinement, qui a brusquement stoppé les actions engagées par notre commune a eu pour principales conséquences : - la brutale fermeture des écoles et l’organisation du confinement, - l’arrêt des travaux engagés dans notre projet d’aménagement de la place, - un blocage de l’installation des exécutifs des collectivités paralysant les décisions et interdisant les réunions. Vous aviez élu un nouveau conseil municipal en mars, qui ne pouvait siéger ! La période qui suivit permit de dégeler certaines de ces situations et de prendre certaines mesures : - sur le plan communal : o de procéder à l’installation du conseil municipal dont je souhaite la bienvenue aux trois nouveaux qui ont intégré l’équipe existante et dont j’adresse mes remerciements aux anciens pour leur implication dans la vie du village, o de rouvrir les écoles dans le respect des protocoles sanitaires plus que stricts, en liaison étroite avec les Directeurs, o de relancer les procédures liées au marché d’aménagement de la place. o d’achever la réfection du pignon de la mairie, la pose de la nouvelle porte qui permettra d’accéder plus facilement au mécanisme de l’horloge, ainsi que la réfection des enduits des murs extérieurs de la cour. -

Maires De La Marne
COMMUNE CP SEXE NOM PRENOM Arrt 51240 Vitry-le- ABLANCOURT F BATY Hélène François 51150 Châlons-en- AIGNY F NICLET Chantal Champagne ALLEMANCHE LAUNAY ET 51260 SOYER M CHAMPION Bernard Epernay ALLEMANT 51120 F DOUCET Carole Epernay 51250 Vitry-le- ALLIANCELLES M GARCIA DELGADO Jean-Jacques François AMBONNAY 51150 M RODEZ Eric Epernay 51290 Vitry-le- AMBRIERES M DROIN Denis François ANGLURE 51260 M ESPINASSE Frédéric Epernay ANGLUZELLES ET 51230 COURCELLES M COURJAN Jean-François Epernay ANTHENAY 51700 F BERNIER Claudine Reims AOUGNY 51170 M LEQUART Alain Reims ARCIS LE PONSART 51170 M DUBOIS Jean-Luc Reims 51800 Sainte- ARGERS M SCHELFOUT Gilles Menehould 51290 Vitry-le- ARRIGNY F BOUQUET Marie-France François 51290 Vitry-le- ARZILLIERES NEUVILLE M CAPPE Michel François 51150 Châlons-en- ATHIS M EVRARD Jean-Loup Champagne AUBERIVE 51600 M LORIN Pascal Reims AUBILLY 51170 M LEROY Jean-Yves Reims 51240 Vitry-le- AULNAY L'AITRE M LONCLAS Michel François 51150 Châlons-en- AULNAY SUR MARNE M DESGROUAS Philippe Champagne AUMENANCOURT 51110 M GUREGHIAN Franck Reims 51800 Sainte- AUVE M SIMON Claude Menehould AVENAY VAL D'OR 51160 M MAUSSIRE Philippe Epernay AVIZE 51190 M DULION Gilles Epernay AY CHAMPAGNE 51160 M LEVEQUE Dominique Epernay BACONNES 51400 M GIRARDIN Francis Reims BAGNEUX 51260 M GOUILLY Guy Epernay BAIZIL 51270 F METEYER Christine Epernay BANNAY 51270 F CURFS Muguette Epernay BANNES 51230 M GUILLAUME Patrick Epernay BARBONNE FAYEL 51120 M BENOIST Jean-Louis Epernay BASLIEUX LES FISMES 51170 M FRANCOIS Jacky Reims 51700 BASLIEUX -

Catalogue-Parcours-C
CATALOGUE PARCOURS CCR Numéro Série rang Nom parcours Parcours km OpenrunnerDénivelé OpenrunnerAscension Lien Openrunner Identifiant OpenrunnerType 1 001 001 CCR_001_001 REIMS - BETHENY - BOURGOGNE - AUMENANCOURT - PONTGIVARD - ORAINVILLE - MERLET - AGUILCOURT - CONDE SUR 72 km 336 m 4,68 m/km http://www.openrunner.com/index.php?id=1260566 1 260 566 1 SUIPPE - GUIGNICOURT - JUVINCOURT -LA VILLE AUX BOIS LES PONTAVERT - PONTAVERT - RD 19 VERS ROUCY PUIS RD 22 - CORMICY - CAUROY LES HERMONVILLE - HERMONVILLE - VILLERS FRANQUEUX - THIL - RN 44 - LA NEUVILLETTE - REIMS 2 001 002 CCR_001_002 REIMS - BETHENY - BOURGOGNE - LOIVRE - VILLERS FRANQUEUX - HERMONVILLE - BOUVANCOURT - JONCHERY SUR 79 km 794 m 10,05 m/km http://www.openrunner.com/index.php?id=1260876 1 260 876 1 VESLE - BREUIL - UNCHAIR - CRUGNY - SERZY ET PRIN - SAVIGNY SUR ARDRES - FAVEROLLES ET COEMY - TRESLON - ROSNAY - GUEUX - THILLOIS - CHAMPIGNY - SAINT BRICE COURCELLES - REIMS 3 001 003 CCR_001_003 REIMS - BETHENY - BOURGOGNE - SAINT ETIENNE SUR SUIPPE - AUMENANCOURT - PONTGIVARD - ORAINVILLE - 47 km 280 m 5,94 m/km http://www.openrunner.com/index.php?id=1258825 1 258 825 2 BERMERICOURT - LOIVRE - VILLERS FRANQUEUX - THIL - LA NEUVILLETTE - REIMS 4 001 004 CCR_001_004 REIMS - BETHENY - BOURGOGNE - SAINT ETIENNE SUR SUIPPE - BOULT SUR SUIPPE - BAZANCOURT - ISLES SUR SUIPPE - 56 km 258 m 4,61 m/km http://www.openrunner.com/index.php?id=1252225 1 252 225 1,2 WARMERIVILLE - HEUTRÉGIVILLE - SAINT MASMES - EPOYE - LAVANNES - CAUREL - WITRY LES REIMS - BETHENY - REIMS 5 001 005 CCR_001_005 -

Fismes Br Ouillet Serzy-Et-Prin Route D'arcis
HOURGES • NINA COSCO «En plumes d’oie» Place de la gare • ADRIANN BÉGHIN "ANAMA" Jardin Maison Vide Rue du Bon Martin • AURORE-CAROLINE MARTY "Club paradise" Petit lavoir • JULIETTE JUPON "Mémoires flotantes" Lavoir communal ÉCOLE • ESTELLE CHRÉTIEN NORD "Propriété" FISMES Route d’Arcis • JULIEN PACI MAIRIE "Spectres" Rue des Quatre Vents Route d’Arcis SERZY-ET-PRIN • GUILLAUME CHIRON "Plan B from outer space" Parking de l’école ÉGLISE Rue de la Passerelle • ANAËLLE RAMBAUD Rue de la Gare "Reviviscence" Colline route d’Hourges Rue Clemenceau Rue du Lavoir • ROMAIN LEPAGE BAR MAISON VIDE "1924 (Écran)" l’Ardre Rue de Mannot Colline route d’Hourges Rue de la Montagne • CHRISTINE SEJEAN "La vie, la vraie" Chemin ville en Tardenois Rue du Grand Jardin Rue Haute • MARIANNE VILLIÈRE Chemin de ville en Tardenois «Clandestines» 29 Rue haute BROUILLET ROUTE D’ARCIS LE PONSART Aurore Caroline Marty, Anaëlle Rambaud, Juliette Jupon, «Club Paradise» «Reviviscence (Queue, Waller’s avocado, Griffe)» «Mémoires flottantes» Toutes ces sculptures traduisent ces formes qui me marquent Jeu d’échecs, salle de bal, théatre d’objets, tout cela peut-être ; un lorsque j’observe des sujets (animaux, végétaux), notamment à Un fantôme de nostalgie, de doux souvenirs ayant pris pour habits abandon dans une célébration liant l’antique et le kitsch. Mise en travers leurs images car celles-ci permettent de figer les corps les anciens draps que les lavandières venaient nettoyer au lavoir. scène et mise en abyme, scène et abyme ; le décorum surgit ou dans certaines postures. D’en créer des lignes, des courbes. Une Un moment suspendu dans une barque pleine d’histoires qui se sombre dans une poésie fantastique et onirique. -

Récapitulatif Général - Cahier D'attribution V2
Récapitulatif général - Cahier d'attribution v2 SECTEUR \ ORGANISME Espèce DEM ATT MINI 10 - Tardenois SAI 63 34 11 - Deux Morin SAI 434 350 12 - Marais St Gond SAI 40 23 13 - Parcs de chasse Sanglier SAI 2798 2798 PG S8 - PG SAI Suippes - Quatre Source - Basse Tourbe SAI 529 534 PG S9 - PG SAI Mourmelon Moronvilliers SAI 518 490 S1 - GIC Argonne Sud SAI 439 396 S2 - GIC Bocage Champenois SAI 97 149 S3 - GIC Montagne de Reims SAI 2033 2215 S4 - GIC La Traconne SAI 948 1053 S5 - GIC Aisne Vesle SAI 15 S6 - GIC Argonne Nord SAI 621 629 S7 - GIC Argonne Centre SAI 589 644 SF - GIC Brie des Etangs (Zone F) SAI 145 145 SG - GIC Brie des Etangs (Zone G) SAI 547 611 SH - GIC Brie des Etangs (Zone H) SAI 828 930 SM - Mailly Hauts de Champagne SAI 210 230 SN - GIC Trois Fontaines SAI 721 739 11575 11970 1/41 Campagne 2016-2017 Cahier d'attribution v2 Imprimé par : pmartinot Plan de chasse Sanglier Le 04/07/2016 Session Toute session Référence Commune Surfaces Demandeur Espèces DEM ATT MINI Bracelets 10 Tardenois 0263 CRUGNY Plaine 181,00 CHAPELET JEAN MARC SAI 1 - 51170 CRUGNY Bois non 10,00 ARCIS LE PONSART soumis COURVILLE Total 191,00 0440 UNCHAIR Plaine 200,00 DELAHAYE Jean louis SAI 11 - 51170 UNCHAIR Bois non 26,00 CRUGNY soumis HOURGES Total 226,00 0441 SAVIGNY SUR ARDRES Plaine 224,00 DEGODET FRÈRES - CACHET - DELAHAYE SAI 2 - Bois non 27,00 BRANSCOURT DELAHAYE LEON soumis VANDEUIL 51500 SACY Total 251,00 0998 COURCELLES SAPICOURT Bois non 95,00 LAMBREMONT Patrick SAI 0 - soumis 51140 PROUILLY MUIZON Plaine 55,00 Total 150,00 1063 MAGNEUX Plaine 28,00 CAPPE Daniel SAI 1 51170 FISMES Bois non 11,00 soumis Total 39,00 1213 SERZY ET PRIN Bois non 59,00 GNAT Eric SAI 3 - soumis 08190 HOUDILCOURT FAVEROLLES ET COEMY Plaine 10,00 Etang 3,00 Total 72,00 1558 ARCIS LE PONSART Bois non 285,00 ASSOCIATION FORÊT DE L'ABBAYE SAI 20 25 31551 - 31575 - soumis NAEYAERT ERIC LAGERY 51700 VANDIERES Plaine 78,00 Total 363,00 1681 MAGNEUX Plaine 42,00 STOLTZ CHRISTIAN SAI 1 51170 MAGNEUX Bois 12,00 soumis Total 54,00 2169 COURVILLE Plaine 49,00 ASS. -

Archives Départementales De La Marne 2020 Commune Actuelle
Archives départementales de la Marne 2020 Commune actuelle Commune fusionnée et variante toponymique Hameau dépendant Observation changement de nom Ablancourt Amblancourt Saint-Martin-d'Ablois Ablois Saint-Martin-d'Amblois, Ablois-Saint-Martin Par décret du 13/10/1952, Ablois devient Saint-Martin d'Ablois Aigny Allemanche-Launay-et-Soyer Allemanche-Launay Allemanche et Launay Par décret du 26 septembre 1846, Allemanche-Launay absorbe Soyer et prend le nom d'Allemanche-Launay-et- Soyer Allemanche-Launay-et-Soyer Soyer Par décret du 26 septembre 1846, Allemanche-Launay absorbe Soyer et prend le nom d'Allemanche-Launay-et- Soyer Allemant Alliancelles Ambonnay Par arrêté du 12/12/2005 Ambonnay dépend de l'arrondissement d'Epernay Ambrières Ambrières et Hautefontaine Par arrêté du 17/12/1965, modification des limites territoriales et échange de parcelles entre la commune d'Ambrières et celle de Laneuville-au-Pont (Haute-Marne) Anglure Angluzelles-et-Courcelles Angluzelle, Courcelles et Angluselle Anthenay Aougny Ogny Arcis-le-Ponsart Argers Arrigny Par décrets des 11/05/1883 et 03/11/1883 Arrigny annexe des portions de territoire de la commune de Larzicourt Arzillières-Neuville Arzillières Par arrêté préfectoral du 05/06/1973, Arzillières annexe Neuville-sous-Arzillières sous le nom de Arzillières-Neuville Arzillières-Neuville Neuville-sous-Arzillières Par arrêté préfectoral du 05/06/1973, Arzillières annexe Neuville-sous-Arzillières sous le nom de Arzillières-Neuville Athis Aubérive Aubilly Aulnay-l'Aître Aulnay-sur-Marne Auménancourt Auménancourt-le-Grand Par arrêté du 22/11/1966, Auménancourt-le-Grand absorbe Auménancourt-le-Petit et prend le nom d'Auménancourt Auménancourt Auménancourt-le-Petit Par arrêté du 22/11/1966, Auménancourt-le-Grand absorbe Auménancourt-le-Petit et prend le nom d'Auménancourt Auve Avenay-Val-d'Or Avenay Par décret du 28/05/1951, Avenay prend le nom d'Avenay- Val-d'Or. -

COVID-19 : Le Point Sur La Gestion Des Déchets En Date Du 20 Mars 2020
20/03/2020 messagerie pro COVID-19 : le point sur la gestion des déchets en date du 20 mars 2020 TRI INFO <[email protected]> vendredi 20 mars 2020 à 09:00 réception À : DUPIN Martial , GRAMMONT Didier , MAIRIE ANTHENAY , MAIRIE D AOUGNY , MAIRIE D AOUGNY , MAIRIE D ARCIS LE PONSART , MAIRIE D ARCIS LE PONSART , MAIRIE D AUBILLY , MAIRIE D AUBILLY , MAIRIE D ORMES , MAIRIE D ORMES , MAIRIE DE BASLIEUX LES FISMES , MAIRIE DE BLIGNY , MAIRIE DE BLIGNY , MAIRIE DE BOUILLY , MAIRIE DE BOUILLY , MAIRIE DE BOULEUSE , MAIRIE DE BOULEUSE , MAIRIE DE BOUVANCOURT , MAIRIE DE BRANSCOURT , MAIRIE DE BRANSCOURT , MAIRIE DE BREUIL SUR VESLE , MAIRIE DE BREUIL SUR VESLE , MAIRIE DE BROUILLET , MAIRIE DE BROUILLET , MAIRIE DE CHÂLONS SUR VESLE , MAIRIE DE CHAMBRECY , MAIRIE DE CHAMBRECY , MAIRIE DE CHAMERY , MAIRIE DE CHAMERY , MAIRIE DE CHAUMUZY , MAIRIE DE CHENAY , MAIRIE DE CHENAY , MAIRIE DE COULOMMES LA MONTAGNE , MAIRIE DE COULOMMES LA MONTAGNE , MAIRIE DE COURCELLES - SAPICOURT , MAIRIE DE COURCELLES - SAPICOURT , MAIRIE DE COURLANDON , MAIRIE DE COURLANDON , MAIRIE DE COURMAS , MAIRIE DE COURMAS , MAIRIE DE COURTAGNON , MAIRIE DE COURTAGNON , MAIRIE DE COURVILLE , MAIRIE DE COURVILLE , MAIRIE DE CRUGNY , MAIRIE DE CRUGNY , MAIRIE DE CUISLES , MAIRIE DE CUISLES , MAIRIE DE FAVEROLLES ET COËMY , MAIRIE DE FAVEROLLES ET COËMY , MAIRIE DE FISMES , MAIRIE DE FISMES , MAIRIE DE GERMIGNY , MAIRIE DE GUEUX , MAIRIE DE GUEUX , MAIRIE DE GUEUX , MAIRIE DE HOURGES , MAIRIE DE HOURGES , MAIRIE DE JANVRY , MAIRIE DE JANVRY , MAIRIE DE JONCHERY SUR VESLE -

THE FIRST BATTLE of the MARNE September 1914
THE FIRST BATTLE OF THE MARNE September 1914 The battle of Thillois During the night of the 11th September, the 3rd army corps from the Vth Army (General Hache) received the mission to head the following day towards la Vesle in the direction of the Saint‐Thierry Fort and Thillois. On the 12th September, the two divisions started marching. Pétain’s 6th infantry division, on the left, was on its way to Rosnay, Muizon, Châlons‐sur‐Vesle and Saint‐Thierry’s fort. General Mangin’s 5th infantry division headed towards Méry‐Prémecy, Gueux and Thillois. The 5th division marched without any trouble until the 204 hill, 2km south‐west from Gueux. Around 10 o’clock, the news broke: Gueux had just been evacuated and the road from Gueux to Thillois was cut by trenches full of enemy infantry. Two battalions from the 39th infantry regiment were sent towards Thillois and Gueux’s La Garenne. They were under the protection of two batteries based next to the 204 hill. Around noon, the enemy, who had evacuated the trenches between Gueux and Thillois without combat, was resisting in Thillois. The cavalry notified trenches on the north of Thillois, towards Champigny. Around 3 o’clock in the afternoon, the 39th infantry regiment attacked Thillois while the 74th infantry regiment attacked Gueux’s La Garenne. At 5 o’clock, the battle was frozen. The direct attack did not achieve anything. At this point, the artillery entered the battle and set aim for Thillois. The 74th Infantry Regiment, positioned on the East, and the 39th Infantry Regiment began the assault again. -

Commune De Baslieux-Les-Fismes (51170)
RÉGION GRAND EST DÉPARTEMENT DE LA MARNE COMMUNE DE BASLIEUX-LES-FISMES (51170) ENQUÊTE PUBLIQUE SUR L'ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME RÉALISÉE DU 03 JUIN AU 05 JUILLET 2019 Source : Google Map CONCLUSIONS MOTIVÉES et AVIS du Commissaire Enquêteur M. Jacky CLÉMENT Le Rapport d'Enquête fait l’objet d’un document séparé Enquête Publique sur l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Baslieux-lès-Fismes (51170) Conclusions motivées et Avis Décision du Tribunal Administratif n° E19000041 / 51 _ Arrêté du Vice-Président de la C.U.G.R. le 29 avril 2019 Page 1 sur 13 Enquête Publique sur l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Baslieux-lès-Fismes (51170) Conclusions motivées et Avis Décision du Tribunal Administratif n° E19000041 / 51 _ Arrêté du Vice-Président de la C.U.G.R. le 29 avril 2019 Page 2 sur 13 RÉGION GRAND EST DÉPARTEMENT DE LA MARNE COMMUNE DE BASLIEUX-LÈS-FISMES (51170) ENQUÊTE PUBLIQUE SUR L'ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME RÉALISÉE DU 03 JUIN AU 05 JUILLET 2019 CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS du Commissaire Enquêteur M. Jacky CLÉMENT SOMMAIRE pages CHAPITRE I : PRÉAMBULE, RAPPEL 5 I.1 Contexte local, genèse, résumé I.2 Les décisions communale et intercommunale I.3 Avis des P.P.A. (Personnes Publiques Associées) I.4 La réponse de la M.R.A.e. (Mission Régionale de l'Autorité environnementale) I.5 La procédure d’enquête publique I.6 L'Arrêté du Vice-Président de la C.U.G.R. (Communauté Urbaine du Grand Reims) I.7 Le dossier d’enquête CHAPITRE II : CONCLUSIONS MOTIVÉES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 8 II.1 Le constat II.2 La position de la Collectivité dans le cadre du Mémoire en Réponse II.3 Les déductions CHAPITRE III : AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 11 Enquête Publique sur l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Baslieux-lès-Fismes (51170) Conclusions motivées et Avis Décision du Tribunal Administratif n° E19000041 / 51 _ Arrêté du Vice-Président de la C.U.G.R.