Revue Géographique De L'est, Vol. 48
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
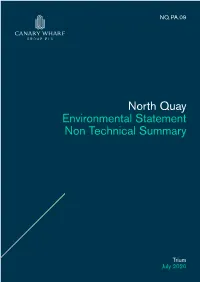
North Quay Environmental Statement Non Technical Summary
NQ.PA.09 North Quay Environmental Statement Non Technical Summary Trium July 2020 Trium Environmental Consulting LLP 68-85 Tabernacle Street London EC2A 4BD +44 (0) 20 3887 7118 [email protected] www.triumenvironmental.co.uk This Environmental Statement (the ‘Report’ has been prepared for the Client by Trium Environmental Consulting LLP with all reasonable skill, care and diligence and in accordance with the Client’s particular and specific instructions. This Report is issued subject to the terms of our Appointment, including our scope of Services, with the Client. This Report has been prepared for, and is intended solely for the use of, the Client alone and accordingly is personal to the Client. The Report should not be disclosed, exhibited or communicated to any third party without our express prior written consent. Trium Environmental Consulting LLP accepts no responsibility whatsoever to any third parties to whom this report, or any part thereof, is disclosed, exhibited or communicated to, without our express prior written consent. Any such party relies upon the Report at their own risk. Trium Environmental Consulting LLP disclaims any responsibility to the Client and others in respect of any matters outside the agreed scope of the Services. Trium Environmental Consulting LLP shall be under no obligation to inform any party of any changes or updates in respect of any matter referred to or contained in the Report. This report is the Copyright of Trium Environmental Consulting LLP. Any unauthorised use or reproduction by anyone other than the Client is strictly prohibited. NORTH QUAY CONTENTS INTRODUCTION ..................................................................................................................................... 1 Purpose of the Environmental Impact Assessment and Non-Technical Summary............................ -

LOCAL VIEW Canary Wharf | Islington Riverside | Wapping
LOCAL VIEW Canary Wharf | Islington Riverside | Wapping Spring/Summer 2013 Welcome to the Spring/Summer Edition of Local View 2013 In the following pages, we provide an insight into the unique London property market and showcase a selection of the most impressive London properties currently for sale and to rent with Knight Frank. The prime London property market continues to outperform, despite continued economic uncertainty. The clarity provided by December’s draft finance bill around the taxing of £2m+ properties owned through companies, resulted in a surge in activity in the early part of the year after months of uncertainty in the wake of the March 2012 budget. Activity levels are robust across all price bands in the market, and prices are still increasing, with levels already more than 20% higher than the previous peak in prices back in March 2008. However, it is interesting to note that growth at different price levels is moving at slightly different speeds. Since stamp duty for £2m+ purchases was raised from 5% to 7% in March last year, prices for properties under this threshold are advancing more quickly than those above the threshold. The exception is for properties worth £5m+, where prices are also climbing more steadily. London retains its reputation as a leading global hub and international demand remains a key factor driving price growth. Overseas buyers continue to view London property as a safe haven to invest in. Over the past 12 months, Knight Frank has expanded its global network, both in London and overseas, attracting more buyers and tenants from around the world. -
WHAT Architect WHERE Notes *** Stansted Airport Norman Foster
WHAT Architect WHERE Notes Built in 1991 as an airport. Service distribution systems are contained Bassingbourn Rd, within the 'trunks' of the structural 'trees' that rise from the *** Stansted Airport Norman Foster Stansted, Essex CM24 undercroft through the concourse floor. These trees support a roof 1QW canopy that is freed simply to keep out the rain and let in light. Zone 1: City of London Built in 1894 as a bridge which was originally the only crossing for the Thames. It took 8 years, 5 major contractors and the relentless labor ***** Tower Bridge Horace Jones Tower Bridge of 432 construction workers to build Tower Bridge. Tours are available Mon-Sun (10-18). General admission £8.00, £5.60 students. Built in 1078 as a Medieval castle. The White Tower, which gives the entire castle its name, was built by William the Conqueror in 1078. The peak period of the castle's use as a prison was the 16th and 17th centuries, when many figures that had fallen into disgrace, such as Elizabeth I before she became queen, were held within its walls. In the ** Tower of London - London EC3N 4AB First and Second World Wars, the Tower was again used as a prison, and witnessed the executions of 12 men for espionage. Tours include includes access to the Tower and the Crown Jewels display and other exhibitions. Tue-Sat (9.30-16.30) Sun-Mon (10-16.30). General admission £21.45, £18.15 students. Built in 2002 as a low-rise, energy-conscious office building for the Willis Faber & Dumas Headquarters. -

Housing Standards Review Viability Assessment
GREATER LONDON AUTHORITY Housing Standards Review Viability Assessment Draft Appendices Contents: Appendix 1………………………………………………………………………..3 Details of consultation surveys and those targeted Appendix 2……………………………………………………………………….24 Analysis of survey results Appendix 3……………………………………………………………………….30 NHF Written representations Appendix 4………………………………………………………………………..33 Evidence of CIL threshold land values Appendix 5………………………………………………………………………..35 Evidence used to support values adopted for 1 ha tile tests Appendix 6………………………………………………………………………..38 Key modelling assumptions for affordable housing Appendix 7………………………………………………………………………..42 Details of cost assumptions for 1 ha tile tests Appendix 8………………………………………………………………………..47 Details of CIL charging rates applied Appendix 9………………………………………………………………………..50 Details of carbon cost analysis Appendix 10………………………………………………………………………52 Full details of 1ha tile test results Appendix 11………………………………………………………………………83 Details of scheme types and assumed configurations Appendix 12………………………………………………………………………90 Cost assumptions for scheme types and value evidence for case studies Appendix 13…………………………………………………………………….139 Details of carbon reduction assumptions and carbon offset cost calculations for scheme types Appendix 14……………………………………………………………………..150 Full details of Scheme Type 1 case study results Appendix 15……………………………………………………………………..153 Full details of Scheme Type 2 case study results Appendix 16……………………………………………………………………..156 Full details of Scheme Type 3 case study results Appendix 17……………………………………………………………………..159 -

Crossrail Technical Report Assessment of Noise and Vibration Impacts Volume 4 of 8
Crossrail Technical Report Assessment of Noise and Vibration Impacts Volume 4 of 8 Central Section Report No. 1E315-C1E00-00001 Crossing the Capital, Connecting the UK Crossrail Technical Report Assessment of Noise and Vibration Impacts Volume 4 of 8 Central Section Final Report The preparation of this report by RPS has been undertaken within the terms of the Brief using all reasonable skill and care. RPS accepts no responsibility for data provided by other bodies and no legal liability arising from the use by other persons of data or opinions contained in this report. Cross London Rail Links Limited 1, Butler Place LONDON SW1H 0PT Tel: 020 7941 7600 Fax: 020 7941 7703 www.crossrail.co.uk CONTENTS Page No 1. INTRODUCTION 1 2. ENVIRONMENTAL BASELINE AND ASSESSMENT OF IMPACTS – ROYAL OAK PORTAL TO PUDDING MILL LANE PORTAL AND THE ISLE OF DOGS 6 Appendix A - Construction Impact Summary Tables, Route Windows C1 to C13 1. INTRODUCTION 1.1 This report presents the specialist noise and vibration assessment for route windows C1 to C13 and auxiliary route windows C8a and C13a of the Crossrail scheme. OVERVIEW OF CROSSRAIL WORKS IN CENTRAL ROUTE SECTION 1.2 The central route section represents the largest scale engineering component of the project. The route will comprise 6 m diameter twin-bore tunnels running under central London that will connect existing railways to the east and west. The tunnels will generally be at a depth of between 20 metres and 40 metres. At a point beneath Stepney Green, the route will fork: one route will continue north-eastwards towards Stratford, the other will head south-eastwards towards the Isle of Dogs. -

Revue Géographique De L'est, Vol. 48 / 1-2 | 2008 L’Opération De Régénération Des Docklands : Entre Patrimonialisation Et Inven
Revue Géographique de l'Est vol. 48 / 1-2 | 2008 Reconversion et patrimoine au Royaume-Uni L’opération de régénération des Docklands : entre patrimonialisation et invention d’un nouveau paysage urbain The operation of regeneration of the Docklands: between heritage and creation of a new townscape Die Regenerierung des Docklands : zwischen Patrimonialisierung und Entwicklung einer neuen Stadtlandschaft Perrine Michon Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/rge/1104 DOI : 10.4000/rge.1104 ISSN : 2108-6478 Éditeur Association des géographes de l’Est Édition imprimée Date de publication : 1 janvier 2008 ISSN : 0035-3213 Référence électronique Perrine Michon, « L’opération de régénération des Docklands : entre patrimonialisation et invention d’un nouveau paysage urbain », Revue Géographique de l'Est [En ligne], vol. 48 / 1-2 | 2008, mis en ligne le 09 octobre 2011, consulté le 10 décembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/rge/1104 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rge.1104 Ce document a été généré automatiquement le 10 décembre 2020. Tous droits réservés L’opération de régénération des Docklands : entre patrimonialisation et inven... 1 L’opération de régénération des Docklands : entre patrimonialisation et invention d’un nouveau paysage urbain The operation of regeneration of the Docklands: between heritage and creation of a new townscape Die Regenerierung des Docklands : zwischen Patrimonialisierung und Entwicklung einer neuen Stadtlandschaft Perrine Michon Introduction 1 L’opération de régénération urbaine entreprise au début des années 1980 par le gouvernement de Margaret Thatcher, sur une emprise équivalente au cinquième de Paris, a transformé l’ancien port de Londres en un nouveau quartier, qui abrite le troisième centre d’affaires de la capitale, où plus de 63 000 personnes viennent travailler quotidiennement et où 80 000 personnes ont élu résidence. -

July 20203 NORTH QUAY - STATEMENT of COMMUNITY INVOLVEMENT
NQ.PA.14 North Quay Statement of Community Involvement Elly Tabberer Consulting DRAFTJuly 20203 NORTH QUAY - STATEMENT OF COMMUNITY INVOLVEMENT This report has been prepared by Elly Tabberer Consulting on behalf of Canary Wharf (North Quay) Ltd. JULY 2020 2 NORTH QUAY - STATEMENT OF COMMUNITY INVOLVEMENT CONTENTS INTRODUCTION 5 1.0 EXECUTIVE SUMMARY 9 1.1 ABOUT THIS REPORT 9 1.2 PROPOSED DEVELOPMENT 9 1.3 SUMMARY OF THE CONSULTATION PROCESS 9 1.4 SUMMARY OF CONSULTATION FEEDBACK 10 1.5 RESPONSE TO FEEDBACK 12 2.0 CONSULTATION PROCESS 15 2.1 CONSULTATION OBJECTIVES 15 2.2 CONSULTATION PROCESS 15 2.3 CONSULTATION AREA 16 2.4 METHODS OF ENGAGEMENT 16 2.5 LEVELS OF ENGAGEMENT 18 3.0 STAKEHOLDER ENGAGEMENT 21 3.1 APPROACH TO ENGAGEMENT 21 3.2 STAKEHOLDER MEETINGS 21 3.3 STAKEHOLDER FEEDBACK 21 4.0 CONSULTATION FINDINGS 25 4.1 STAGE 1 CONSULTATION - EMERGING PROPOSALS 25 4.2 STAGE 1 FEEDBACK 25 4.3 STAGE 1 SUMMARY 27 4.4 STAGE 2 CONSULTATION - DRAFT MASTERPLAN 29 4.5 STAGE 2 FEEDBACK 29 4.6 STAGE 2 SUMMARY 31 5.0 CONCLUSION 33 5.1 CONCLUSIONS FROM CONSULTATION 33 APPENDICES 35 JULY 2020 3 NORTH QUAY - STATEMENT OF COMMUNITY INVOLVEMENT NORTH QUAY North Quay site photo (viewed from north-west) JULY 2020 4 NORTH QUAY - STATEMENT OF COMMUNITY INVOLVEMENT INTRODUCTION OVERVIEW is appropriately restricted, the OPA seeks approval for three Control Documents which describe the principal Canary Wharf (North Quay) Ltd (“the Applicant”), part components of the Proposed Development, define of Canary Wharf Group, is submitting applications for the parameters for the Proposed Development (the Outline Planning Permission (OPP) and Listed Building “Specified Parameters”) and control how the Proposed Consent (LBC) to enable the redevelopment of the North Development will come forward in future. -

Introduction Requirements for an Eia Outline Planning
North Quay Chapter 2: EIA Methodology INTRODUCTION Given the nature of the scheme, as described in ES Volume 1, Chapter 4: Proposed Development, the Proposed Development falls within the classification of Schedule 2, 10(b) (Infrastructure Projects – Urban This chapter of the ES sets out the overall approach to, and methodology for, undertaking the EIA in respect Development Projects) of the EIA Regulations. Considering the scale of the redevelopment and the Site and of the Proposed Development. It details the process for identifying the environmental issues (or ‘topics’) to be surrounding area context, it was considered that there is the potential for significant environmental effects to included in the EIA and the method of assessing the likely significant effects that have the potential to arise arise as a result of the redevelopment. The Proposed Development was therefore considered to constitute as a result of the Proposed Development, both during the enabling and construction works, and on completion ‘EIA development’ under the EIA Regulations, and so an EIA has been undertaken, which is reported upon and occupation of the Proposed Development. within this ES. This ES forms part of the suite of documents submitted as part of the OPA and LBC. The Proposed Development is defined by way of the Control Documents set out in ES Volume 1, Chapter 1: Introduction, and discussed within this chapter and in further detail in ES Volume 1, Chapter 4: Proposed OUTLINE PLANNING APPLICATION Development. Form of the Planning Application The methodology of the EIA is in accordance with applicable legislation, guidance, and case law and has The Town and Country (Development Management Procedure) (England) Order 20152 (‘DMPO’) sets out been tailored to each topic of the EIA using industry standard methods and criteria, and professional judgment requirements and guidance for outline planning applications. -

NQ.PA.08 ES Vol 1 Ch 9 Air Quality-July
North Quay Chapter 9: Air Quality the Site itself for development with respect to air quality; and the potential for impacts resulting from construction TOPIC AIR QUALITY activities. AUTHOR Air Quality Consultants Ltd ES Volume 3: Appendix Air Quality: For the assessment of road traffic emissions, the assessment set out in this ES chapter is based on ‘the Annex 1: Glossary; Maximum Transport Generating Scheme’ (as set out in ES Volume 1, Chapter 2: EIA Methodology) to allow Annex 2: Legislative and Planning Policy Context; the assessment to assess the reasonable worst case effects of road traffic. This scenario comprised the Annex 3: Construction Dust Assessment Procedure; Annex 4: EPUK & IAQM Planning for Air Quality Guidance; maximum amount of commercial and retail uses with the rest of the permissible total floorspace allocated to SUPPORTING APPENDIX Annex 5: Professional Experience; serviced apartments, as this produces the most road traffic from deliveries and servicing. Annex 6: Modelling Methodology; Annex 7: London Vehicle Fleet Projections; For the site suitability assessment, the key area of concern is the proposed facades in closest proximity to Annex 8: Air Quality Neutral Assessment; and Annex 9: Construction Mitigation. Aspen Way, as this is where air pollutant concentrations at the Site will be highest as a result of emissions from The London Borough of Tower Hamlets (the LBTH) has declared a borough wide Air Quality large volumes of traffic on Aspen Way. The approach to the assessment of site suitability is to use a series of Management Area (AQMA), due to exceedances of the annual mean nitrogen dioxide (NO2) and 24-hour mean particulate matter (PM10) objectives. -

Canary Wharf and Isle of Dogs Movie Map
CANARY WHARF AND ISLE OF DOGS MOVIE MAP The Isle of Dogs has provided stunning locations for some of the biggest MOVIE MAP blockbusters like the action-packed opening scenes of James Bond movie The World is Not Enough and other blockbusters like Batman Begins, The Constant Gardener, Love Actually and more recently 28 Weeks Later; the sequel to 28 Days Later. Follow this easy walk and you will be able to see lots of the locations for some of your favourite films. CANARY WHARF AND ISLE OF DOGS 2 WEST INDIA QUAY – GANGSTERS MOVIE MAP Start your tour at West India Quay DLR station. The building towering over the station is 1 West India Quay, which is the Marriott hotel and exclusive penthouse flats, home to movie stars and several Premiership footballers. The building is 111m high, designed by HOK Architects and was completed in 2003. In the film Layer Cake (2004), Daniel Craig's un-named character is dangled over the edge of the still unfinished tower by gangster Eddie Temple (Michael Gambon). A Walk past the cranes to the SS Robin, the world's oldest complete CANARY WHARF AND ISLE OF DOGS steamship. It’s now a gallery and arts venue, hosting photographic exhibitions. Past the SS Robin is the pedestrian bridge over the North Dock. 3 MOVIE MAP Before you go over the bridge, take a look at the old warehouses on West India Quay which now house the Museum in Docklands as well as bars and restaurants. This is all that remains of the original 19th century dock buildings.