Eohiers Lorrains
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Replacement of Natural Stone in Conservation of Historic Buildings Evaluation of Replacement of Natural Stone at the Church of Our Lady in Breda
Replacement of natural stone in conservation of historic buildings Evaluation of replacement of natural stone at the church of Our Lady in Breda W.J. (Wido) Quist Delft University of Technology, the Netherlands Faculty of Architecture, department ®MIT In this paper the decision process and the choice for specific types of natural stone for conservation purposes are investigated.1 Two successive 20th century conservation campaigns at the church of Our Lady in Breda are analyzed. It was specifically investigated in how far the architects involved took aspects of compatibility and durability of the replacement stone into account. It is concluded that in both conservation campaigns arguments of durability and sometimes compatibility have been used. A historic line over the twentieth century interventions runs from attention to aesthetic compatibility over durability to technical compatibility. Keywords: Conservation, restoration, compatibility, durability, natural stone, evaluation 1 Introduction This paper reflects a part of the PhD research with the working title Replacement of Natural Stone in the Twentieth Century in the Netherlands. This study is part of a program in the research portfolio of the department Modification Intervention and Transformation (®MIT) at Delft University of Technology. Gaining knowledge of techniques for diagnosis and conservation is the general aim of this program as expressed by Van Hees [2007]. Within the program the dissemination of the knowledge gained during research projects is a major 1 Here, the definitions of conservation, preservation, restoration and reconstruction from the Burra charter, 1999 will be used. Conservation means all the processes of looking after a place so as to retain its cultural significance. -

COMMUNAUTE De COMMUNES COMMERCY VOID VAUCOULEURS CONSEIL COMMUNAUTAIRE Du 14 Novembre 2018 Objet : Elaboration D'un Plan Clim
COMMUNAUTE de COMMUNES COMMERCY VOID VAUCOULEURS CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 14 novembre 2018 Objet : Elaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial : Modalités de mise en œuvre et de concertation L’an deux mille dix-huit, le quatorze novembre, à vingt heures trente, les Délégués des communes adhérentes à la Communauté de Communes Commercy Void Vaucouleurs, convoqués le six novembre 2018, selon les règles édictées par le Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis à Vaucouleurs. Etaient présents : Boncourt sur Meuse : MIDENET Éric; Boviolles : LIGIER Jean-Pierre ; Brixey-aux-Chanoines : TRAMBLOY Jean Marie ; Burey en Vaux : CAUMIREY Dominique ; Burey -La-Côte : LANGARD Jean Michel ; Chalaines : SANCHEZ Christine suppléante de HOCQUART Patrick ; Champougny : VINCENT Éric ; Chonville Malaumont : LANTERNE Bruno ; Commercy : BARREY Patrick, CAHU Gérald, DABIT Annette, GUCKERT Olivier, LEMOINE Olivier, LEFEVRE Jérôme, PAILLARDIN Delphine, RICHARD Suzel ; THIRIOT Elise ; Dagonville : WENTZ Dominique ; ; Euville : FERIOLI Alain, HERY Joël, HIRSCH Philippe, SOLTANI Denis ; Laneuville-au-Rupt : FURLAN Jacques ; Lérouville : VIZOT Alain, PORTEU Brigitte ; Marson sur Barboure : PETITJEAN Joël ; Maxey-sur-Vaise : DINTRICH Jean Luc ; Mécrin : MOUSTY Michel; Méligny le Petit : BOUCHOT Christian ; Nançois-Le-Grand : ORBION Claude ; Naives-En-Blois : VAUTHIER Daniel ;Neuville- les-Vaucouleurs : JACOB Bernard suppléant de TIRLICIEN Alain ; Ourches sur Meuse : GUILLAUME Jean Louis suppléant de GUILLAUME François ; Pagny la Blanche Côte -

Cousances-Lès-Triconville
COUSANCES-LÈS-TRICONVILLE MON TERRITOIRE » Quelles évolutions de la population pour Cousances-lès-Triconville? » Mon territoire est-il familial ? Vieillissant ? Riche ? CC DE COMMERCY - VOID - V. 140 74 La population Le nombre légale au 1er de logements janvier 2020 pour que compte Cousances-lès- Cousances-lès- Triconville, contre Triconville, alors 141 en 2012 que ce chiffre était de 64 en 1968 Source : DGFiP 2018 A l’échelle de la CC de Commercy - Void - V., la part des foyers fiscaux imposés la plus élevée est enregistrée pourMéligny-le-Pe - tit (53%). La part la plus faible est quant à elle enregistrée pour Épiez-sur-Meuse (0%). POINT MÉTHODE Cousances-lès-Triconville fait fichiers : taxe d’habitation, permis codes se réfèrent à la population l’objet d’un recensement de construire, fichiers des régimes légale (ex. dotations, nombre de exhaustif tous les cinq ans. Pour- d’assurance maladie... conseillers municipaux, barèmes tant, pour estimer au plus près la population légale au 1er janvier, Cette estimation est essentielle : de certaines taxes, implantation l’INSEE s’appuie sur différents près de 350 articles de lois ou de des pharmacies...). COUSANCES-LÈS-TRICONVILLE POPULATION PAR TRANCHE D’ÂGE 19 17,9 Le nombre de La durée moyenne familles avec en années de enfant(s) pour résidence dans Cousances-lès- son logement pour Triconville, soit 31% Cousances-lès- des ménages de la Triconville contre commune 18,4 ans pour la 25% de la population a moins de 14 ans pour Cou- Meuse sances-lès-Triconville. Source : INSEE 2017 RÉPARTITION DES MÉNAGES PAR TYPE 26 86% Le nombre Le taux d’activité d’entreprises de la population, présentes dans contre 73% pour la la commune Meuse (autoentreprises comprises), dont 2 comptent 1 salarié 0% des ménages de la commune sont des familles ou plus monoparentales. -

VAUCOULEURS Séance Du 22/04/21 2021
CC COMMERCY -VOID - VAUCOULEURS Séance du 22/04/21 2021/ COMMUNAUTE de COMMUNES de COMMERCY - VOID - VAUCOULEURS CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 22 AVRIL 2021 L’an deux mille vingt et un, le vingt deux avril, à vingt heures trente, les Délégués des communes adhérentes à la Communauté de Communes Commercy Void Vaucouleurs, convoqués le seize avril 2021, selon les règles édictées par le Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis à Vaucouleurs Etaient présents : Boncourt-sur-Meuse : LARDÉ Philippe ; Boviolles : LIGIER Jean-Pierre ; Brixey-aux-Chanoines : TRAMBLOY Jean–Marie ; Burey-en-Vaux : CAUMIREY Dominique ; Burey-La-Côte : LANGARD Jean- Michel ; Chalaines : KERCRET Brigitte ; Champougny : VINCENT Éric ; Chonville-Malaumont : LANTERNE Bruno ; Commercy : LEFEVRE Jérôme, BARREY Patrick, CAHU Gérald, GENART Angélique, GUCKERT Olivier, LEMOINE Olivier, MARCHAND Martine, REYRE Benoit, ROCHAT Philippe, THIRIOT Elise ; Cousances les Triconville : BIZARD Michel ; Dagonville : WENTZ Dominique ; Epiez-sur-Meuse : ANTOINE Fabienne ; Erneville-Aux-Bois : FOURNIER Catherine ; Euville : FERIOLI Alain, KIEFFER Hélène, SOLTANI Denis ; Goussaincourt : BISSINGER Michel ; Laneuville-au-Rupt : FURLAN Jacques ; Lérouville : HUMBERT Jean-Claude PORTEU Brigitte, VIZOT Alain ; Marson-sur-Barboure : PETITJEAN Joël ; Mécrin : MOUSTY Michel ; Méligny-le-Grand : WAGNER Dominique ; Méligny-le-Petit : BOUCHOT Christian ; Naives-En-Blois : VAUTHIER Daniel ; Nançois-Le-Grand : SCHMITT Robert ; Neuville-les- Vaucouleurs : TIRLICIEN Alain ; Ourches-sur-Meuse -

Tél.: (38) 63.80.01
BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL B.P. 6009 - 45060 Orléans Cedex - Tél.: (38) 63.80.01 DIRECTION DEPARTEMENTALE de 1'EQUIPEMENT GROUPE d?ETUDE et de PROGRAMMATION Estimation des besoins en granuláis et recensement des gisements potentiels dans la Vallée de la Meuse entre PAGNY-SUR-MEUSE et DOMREMY-LA-PUCELLE J. RICOUR avec la collaboration de Cl. MAROTEL Service géologique régional LORRAINE Rue du Parc de Brabois - 54500 Vandœuvre-lès-Nancy Tél. : (83) 51.43.51 79 SGN 587 LOR Vandoeuvre, le 26 novembre 1979 RESUME L'étude des ressources et des besoins en granuláis dans le Sud du département de la Meuse fait suite aux études antérieures réalisées en particulier pour le Groupement d'Etude et de Programmation de la DIRECTION DEPARTEMENTALE de 1'EQUIPEMENT. L'évaluation des besoins montre que ceux-ci sont en stagnation du fait de l'évolution de la démographie du secteur concerné. L'étude des ressources montrent que celles-ci sont en général de qualité moyenne à médiocre et sont susceptibles de couvrir la demande locale sous réserve que les exploitations plus importantes du secteur de PAGNY - VOID, au Nord, n'absorbent la demande du Sud du département. SOMMAIRE Pages Résumé 1 - Introduction.. 1 2 - Cadre géologique du secteur d'étude . 2 2.1. Aperçu géologique 2.2. Caractéristiques des matériaux rocheux et meubles 3 - Etude des besoins 8 3.1. Aperçu des besoins au niveau national 3.2. Définition des besoins au niveau local 4 - Etat des contraintes dans le secteur d'étude 13 4.1. Définition des contraintes 4.2. -
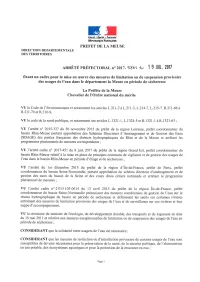
Arrêté Cadre Secheresse 2017
Page 1 Annexe 2 – Répartition des communes par zones d’alerte Zone d’alerte 1 : Aisne amont 55014 AUBREVILLE 55285 LAVOYE 55017 AUTRECOURT-SUR-AIRE 55116 LE CLAON 55023 AVOCOURT 55379 LE NEUFOUR 55032 BAUDREMONT 55253 LES ISLETTES 55033 BAULNY 55497 LES SOUHESMES-RAMPONT 55038 BEAULIEU-EN-ARGONNE 55254 LES TROIS-DOMAINES 55040 BEAUSITE 55289 LEVONCOURT 55044 BELRAIN 55290 LIGNIERES-SUR-AIRE 55065 BOUREUILLES 55295 LISLE-EN-BARROIS 55068 BRABANT-EN-ARGONNE 55301 LONGCHAMPS-SUR-AIRE 55081 BRIZEAUX 55343 MONTBLAINVILLE 55082 BROCOURT-EN-ARGONNE 55346 MONTFAUCON-D'ARGONNE 55103 CHARPENTRY 55380 NEUVILLE-EN-VERDUNOIS 55108 CHAUMONT-SUR-AIRE 55383 NEUVILLY-EN-ARGONNE 55113 CHEPPY 55384 NICEY-SUR-AIRE 55117 CLERMONT-EN-ARGONNE 55389 NUBECOURT 55128 COURCELLES-SUR-AIRE 55395 OSCHES 55129 COUROUVRE 55404 PIERREFITTE-SUR-AIRE 55518 COUSANCES-LES-TRICONVILLE 55409 PRETZ-EN-ARGONNE 55141 DAGONVILLE 55442 RAIVAL 55155 DOMBASLE-EN-ARGONNE 55416 RARECOURT 55174 EPINONVILLE 55419 RECICOURT 55175 ERIZE-LA-BRULEE 55446 RUMONT 55177 ERIZE-LA-PETITE 55453 SAINT-ANDRE-EN-BARROIS 55178 ERIZE-SAINT-DIZIER 55454 SAINT-AUBIN-SUR-AIRE 55179 ERNEVILLE-AUX-BOIS 55000 SEIGNEULLES 55185 EVRES 55517 SEUIL-D'ARGONNE 55194 FOUCAUCOURT-SUR-THABAS 55498 SOUILLY 55199 FROIDOS 55525 VADELAINCOURT 55202 FUTEAU 55527 VARENNES-EN-ARGONNE 55208 GESNES-EN-ARGONNE 55532 VAUBECOURT 55210 GIMECOURT 55536 VAUQUOIS 55251 IPPECOURT 55549 VERY 55257 JOUY-EN-ARGONNE 55555 VILLE-DEVANT-BELRAIN 55260 JULVECOURT 55567 VILLE-SUR-COUSANCES 55266 LACHALADE 55570 VILLOTTE-SUR-AIRE 55282 LAVALLEE -

C64 Official Journal
Official Journal C 64 of the European Union Volume 63 English edition Information and Notices 27 February 2020 Contents I Resolutions, recommendations and opinions RESOLUTIONS Council 2020/C 64/01 Council Resolution on education and training in the European Semester: ensuring informed debates on reforms and investments . 1 II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 64/02 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9707 — Aperam Alloys Imphy/Tekna Plasma Europe/ImphyTek Powders) (1) . 7 IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES Council 2020/C 64/03 Council conclusions on the revised EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes . 8 European Commission 2020/C 64/04 Euro exchange rates — 26 February 2020 . 15 2020/C 64/05 Commission notice on current State aid recovery interest rates and reference/discount rates applicable as from 1 March 2020 (Published in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EC) No 794/2004 of 21 April 2004 (OJ L 140, 30.4.2004, p. 1)) . 16 EN (1) Text with EEA relevance. NOTICES FROM MEMBER STATES 2020/C 64/06 Update of the list of border crossing points as referred to in Article 2(8) of Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) . 17 V Announcements PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF THE COMMON COMMERCIAL POLICY European Commission 2020/C 64/07 Notice of initiation of an expiry review of the anti-subsidy measures applicable to imports of certain rainbow trout originating in the Republic of Turkey . -
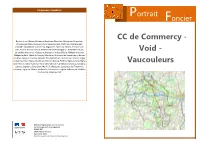
CC De Commercy Void Vaucouleurs
Communes membres : 0 Export_PDF de toutes les fiches A3 EPCI ortrait P Foncier CC de Commercy - Boncourt-sur-Meuse, Bovée-sur-Barboure, Boviolles, Brixey-aux-Chanoines, Broussey-en-Blois, Burey-en-Vaux, Burey-la-Côte, Chalaines, Champougny, Chonville-Malaumont, Commercy, Dagonville, Épiez-sur-Meuse, Erneville-aux- Bois, Euville, Goussaincourt, Grimaucourt-près-Sampigny, Laneuville-au-Rupt, Void - Lérouville, Marson-sur-Barboure, Maxey-sur-Vaise, Mécrin, Méligny-le-Grand, Méligny-le-Petit, Ménil-la-Horgne, Montbras, Montigny-lès-Vaucouleurs, Naives- en-Blois, Nançois-le-Grand, Neuville-lès-Vaucouleurs, Ourches-sur-Meuse, Pagny- la-Blanche-Côte, Pagny-sur-Meuse, Pont-sur-Meuse, Reffroy, Rigny-la-Salle, Rigny- Vaucouleurs Saint-Martin, Saint-Aubin-sur-Aire, Saint-Germain-sur-Meuse, Saulvaux, Sauvigny, Sauvoy, Sepvigny, Sorcy-Saint-Martin, Taillancourt, Cousances-lès-Triconville, Troussey, Ugny-sur-Meuse, Vadonville, Vaucouleurs, Vignot, Villeroy-sur-Méholle, Void-Vacon, Willeroncourt 0 Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement GRAND EST SAER / Mission Foncier Novembre 2019 http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/ 0 CC de Commercy - Void - Vaucouleurs Périmètre Communes membres 01/2019 54 ( Meuse : 54) Surface de l'EPCI (km²) 711,67 Dépt Meuse Densité (hab/km²) en 2016 EPCI 32 Poids dans la ZE Commercy*(99,3%) Bar-le-Duc(0,7%) ZE 23 Pop EPCI dans la ZE Commercy(52%) Bar-le-Duc(0,3%) Grand Est 96 * ZE de comparaison dans le portrait Population 2011 23 534 2016 22 749 Évolution 2006 - 2011 13 hab/an -

Compte Rendu Conseil Municipal Du 18 Décembre 2017 1/16 COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2017
Compte rendu Conseil Municipal du 18 décembre 2017 1/16 COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2017 L’an deux mille dix sept, le lundi dix huit décembre à 20 heures 30. Les membres du Conseil Municipal de la Commune de COMMERCY se sont réunis à l’Hôtel de Ville sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 11 décembre 2017 conformément aux articles L 2121-10, 2121-11, 2121-12 et L 2122-8, 2122-14 du Code Général des Collectivités Territoriales. La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Jérôme LEFEVRE, ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Adjoints : Delphine PAILLARDIN, Gérald CAHU, Claude LAURENT, Patrick BARREY, Jean-Philippe VAUTRIN, Elise THIRIOT, Martine MARCHAND Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux : Florent CARÉ, Olivier LEMOINE, Annette DABIT, Martine JONVILLE, Bruno MAUD'HEUX, Suzel RICHARD, Sylvie GENTILS, Olivier GUCKERT, Alain LE BONNIEC, Gérard LANDO, Majid HAMNOUCHE, Claudine JULLIEN ETAI(EN)T ABSENT(E)S) AVEC POUVOIR : Liliane BOUROTTE qui donne pouvoir à Jérôme LEFEVRE François-Christophe CARROUGET qui donne pouvoir à Delphine PAILLARDIN Jacques MAROTEL qui donne pouvoir à Suzel RICHARD Barbara WEBER qui donne pouvoir à Patrick BARREY Anne-Laure ARONDEL qui donne pouvoir à Majid HAMNOUCHE ETAIENT EXCUSÉS : Eva ABSYTE, Jean-Marie NOËL, Natacha BRETON, Nadine MALAGRINO Conseillers en exercice 29 - Présents 20 - Votants 25 Martine MARCHAND est désignée secrétaire de séance Objet : Codecom – Modification des Statuts – Approbation des articles 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 -

À Partir Du 1Er Novembre, Collecte 1 Semaine Sur 2, Certains Jours Changent !
À PARTIR DU 1ER NOVEMBRE, COLLECTE 1 SEMAINE SUR 2, CERTAINS JOURS CHANGENT ! Ci-dessous les premières dates pour vous guider. Fonctionnement identique en 2021. LUNDI SEMAINES IMPAIRES SEMAINES PAIRES 2, 16, 30 novembre | 14, 28 décembre 9, 23 novembre | 7, 21 décembre BONCOURT-SUR-MEUSE COMMERCY SECTEUR OUEST* CHONVILLE-MALAUMONT *se reporter au flyer complémentaire avec GRIMAUCOURT le nom des rues MÉCRIN PONT-SUR-MEUSE VADONVILLE VIGNOT MARDI SEMAINES IMPAIRES SEMAINES PAIRES 3, 17 novembre | 1, 15, 29 décembre 10, 24 novembre | 8, 22 décembre VOID-VACON VAUCOULEURS mercredi SEMAINES IMPAIRES SEMAINES PAIRES 4, 18 novembre | 2 , 16, 30 décembre 11*, 25 novembre | 9, 23 décembre BOVIOLLES *rattrapée le samedi 14 novembre BOVÉE-SUR-BARBOURE BRIXEY-AUX-CHANOINES COUSANCES-LÈS-TRICONVILLE BUREY-EN-VAUX DAGONVILLE BUREY-LA-CÔTE ERNEVILLE-AUX-BOIS LANEUVILLE-AU-RUPT CHAMPOUGNY LÉROUVILLE ÉPIEZ-SUR-MEUSE MARSON-SUR-BARBOURE GOUSSAINCOURT MÉLIGNY-LE-GRAND MAXEY-SUR-VAISE MÉLIGNY-LE-PETIT MONTBRAS MÉNIL-LA-HORGNE PAGNY-LA-BLANCHE-CÔTE NAIVES-EN-BLOIS SAUVIGNY NANÇOIS-LE-GRAND TAILLANCOURT SAINT-AUBIN-SUR-AIRE SAULVAUX REFFROY WILLERONCOURT À PARTIR DU 1ER NOVEMBRE, COLLECTE 1 SEMAINE SUR 2, CERTAINS JOURS CHANGENT ! jeudi SEMAINES IMPAIRES SEMAINES PAIRES 5, 19 novembre | 3, 17, 31 décembre 12, 26 novembre | 10, 24 décembre EUVILLE COMMERCY SECTEUR EST* PAGNY-SUR-MEUSE *se reporter au flyer complémentaire avec le nom des rues vendredi SEMAINES IMPAIRES SEMAINES PAIRES 6, 20 novembre | 4, 18 décembre 13, 27 novembre | 11, 25* décembre BROUSSEY-EN-BLOIS *rattrapée le samedi 26 décembre OURCHES-SUR-MEUSE CHALAINES SAUVOY MONTIGNY-LÈS-VAUCOULEURS SORCY-SAINT-MARTIN NEUVILLE-LÈS-VAUCOULEURS TROUSSEY RIGNY-LA-SALLE VILLEROY-SUR-MÉHOLLE RIGNY-SAINT-MARTIN SEPVIGNY SAINT-GERMAIN-SUR-MEUSE UGNY-SUR-MEUSE JOUR FERIÉ, LA COLLECTE N’EST PAS ASSURÉE LORS D’UN MAIS ELLE EST RATTRAPÉE : Le samedi précédent si vous êtes collectés un lundi ou mardi. -

Cousances Les Triconvilles
COMMUNE DE COUSANCES-LES-TRICONVILLE 12, rue de l’Épichée 55 500 Cousances-lès-Triconville DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT BEPG - Technopôle Nancy-Brabois - 2, Allée de Saint-Cloud - 54 600 VILLERS-LES-NANCY Tel : 03 83 51 87 87 - [email protected] - Code APE 7112 B Septembre 2017 Sarl au capital de 100 000 € - TVA Intracommunautaire : FR 60 + SIRET 429 157 019 00028 07 04 1886 Sommaire I. Préambule ________________________________ _____________________ 4 II. Caracteristiques du territoire communal ______________________________ 5 II.1. Présentation de la commune ______________________________________ 5 II.2. Population et habitat ____________________________________________ 6 II.3. Urbanisme ____________________________________________________ 6 II.4. Consommation - distribution d’eau potable ____________________________ 6 II.5. Milieu Naturel __________________________________________________ 7 II.5.1. Hydrographie __________________________________________________ 7 II.5.2. Géologie ____________________________________________________ 10 II.6. Contraintes environnementales ___________________________________ 10 II.7. Faisabilité de l’ANC ____________________________________________ 12 III. Situation de la commune vis-à-vis de l’assainissement __________________ 13 III.1. Le réseau de collecte ___________________________________________ 13 III.2. Situation de la commune vis-à-vis de l’assainissement collectif ___________ 13 III.3. Situation de la commune vis-à-vis de l’ANC __________________________ 13 IV. Comparatif des -

Lire L'histoire
HISTOIRE DU CANTON DE VOID Pour avoir plus d’informations vous pouvez consulter le site de la commune concernée. Les chiffres cités sont ceux de la population municipale donnée par l’INSEE en 2009. Le département de la Meuse, qui tire son nom du plus important cours d’eau, a été constitué le 30 janvier 1790, par un décret de l’Assemblée Générale, sur le rapport de Dupont de Nemours. Profondément atteinte par la Constitution de l’An III, cette organisation revit depuis 1800, avec quelques modifications : 4 arrondissements (dont celui de Commercy) au lieu de 8, 28 cantons au lieu de 79 et 588 communes au lieu de 597. Neuf routes impériales ont traversé le département de la Meuse dont 2 sur le canton : Route n°4 de Paris à Strasbourg et en Allemagne (Saulx – Ménil-la-Horgne – Void – Pagny/Meuse) et la route n° 64 de Neufchâteau à Mézières (Void). Trente-cinq chemins de grande communication complétaient ces axes dont le chemin n° 10 de Void à Grand (88) : il partait de la station de Sorcy, traversait Void et Sauvoy. Avant la Révolution, le territoire qui a formé le département de la Meuse, dépendait des diocèses de Trèves, de Toul, de Metz, de Reims, de Chalons et de Verdun. En 1790, un décret créa un évêché unique par département, Verdun devint le siège épiscopal constitutionnel de la Meuse jusqu’en 1801. Le Concordat supprima cet évêché et en réunit les paroisses au diocèse de Nancy. Le Concordat du 11 juin 1817 reconstitua le diocèse de Verdun jusqu’au 3 août 1823, où Monseigneur d’Arbat prit possession du nouvel évêché avec le département de la Meuse pour circonscription et Besançon comme métropole.