Bureau Interdepartemental Du 19 Mars 2010
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
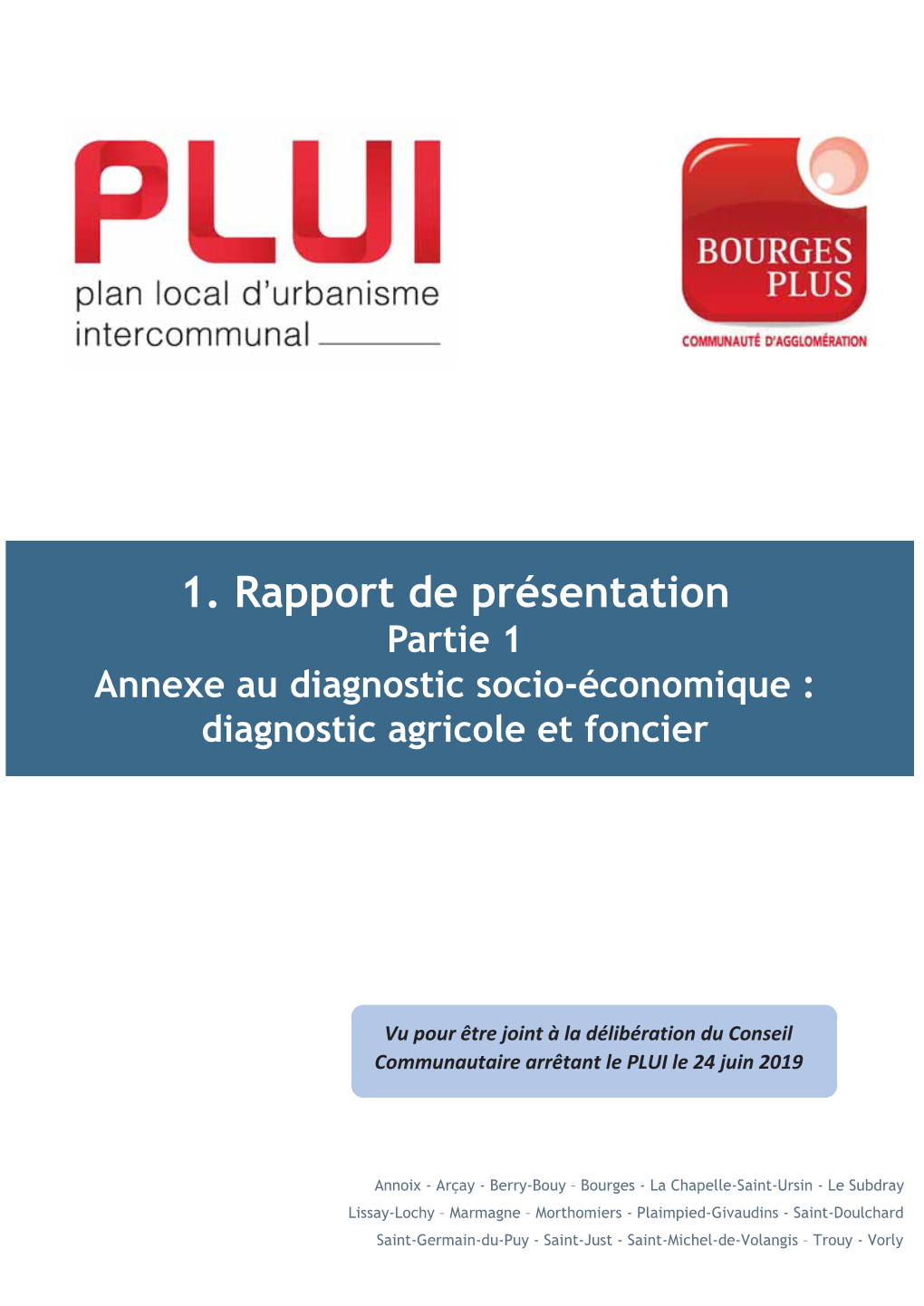
Load more
Recommended publications
-

Liste Des Relais Assistants (Es) Maternels (Les
LISTE DES RELAIS ASSISTANTS(ES) MATERNELS(LES) ADRESSE SECTEURS COUVERTS ALLOUIS RAMPE « A Petits Pas » ALLOUIS, MEHUN SUR YEVRE 02.48.20.51.74. 26 rue du Chemin Vert [email protected] 18500 ALLOUIS CDC Terres du Haut Berry Acheres, Allogny, Aubinges, Azy, Brecy, Fussy, Henrichemont, Humbligny, Les Aix d’Angillon, La Chapelotte, Menetou Salon, Montigny, Morogues, Moulins/Yevre, Neuilly en Sancerre, Neuvy deux Clochers, Parassy, Pigny, Quantilly, Rians, St Ceols, St Eloy de Gy, St Georges/Moulon, St Martin d’Auxigny, St Palais, Ste Solange, Soulangis, Vasselay, Vignoux ss les Aix CDC Vierzon Sologne Berry Dampierre en Graçay, Genouilly, Graçay, Méry/Cher, Nohant en Graçay, St Georges/La Prée, St Hilaire de Court, St Outrille, Thénioux ARGENT / SAULDRE RAM intercom. Sauldre et Sologne CDC Sauldre et Sologne 06.77.37.65.95. 7 rue du 4 septembre Argent sur Sauldre, Aubigny sur Nère, Blancafort, Brinon sur Sauldre, [email protected] 18410 ARGENT SUR SAULDRE Clemont, Ennordres, Ivoy le Pré, La Chapelle d’Angillon, Menetreol sur Sauldre, Mery es Bois, Oizon, Presly, Ste Montaine AUBIGNY / NERE RAM intercom. Sauldre et Sologne CDC Sauldre et Sologne 06.77.37.65.95. Allée du Printemps Argent sur Sauldre, Aubigny sur Nère, Blancafort, Brinon sur Sauldre, [email protected] 18700 AUBIGNY SUR NERE Clemont, Ennordres, Ivoy le Pré, La Chapelle d’Angillon, Menetreol sur Sauldre, Mery es Bois, Oizon, Presly, Ste Montaine AVORD RAMPE « La Septaine » CDC La Septaine 06.18.56.47.61 ou ZAC Les Alouettes Avord, Baugy, Chaumoux -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°18-2020-02-022 Publié Le 28 Février 2020
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°18-2020-02-022 CHER PUBLIÉ LE 28 FÉVRIER 2020 1 Sommaire PREFECTURE DU CHER 18-2020-02-28-002 - 1° Arrêté préfectoral n° 2020-00161 du 28 février 2020 établissant la liste des candidats aux élections municipales et communautaires pour le 1er tour de scrutin (2 pages) Page 3 18-2020-02-28-003 - 2° Annexe 1 - Livre des candidatures scrutin de liste (99 pages) Page 6 18-2020-02-28-004 - 3° Annexe 2 - Livre des candidatures scrutin plurinominal (233 pages) Page 106 18-2020-02-27-003 - Arrêté préfectoral n° 2020-158 du 27 février 2020 modifiant l'arrêté n° 2019-1103 du 29 aout 2019 portant désignation des bureaux de vote (1 page) Page 340 2 PREFECTURE DU CHER 18-2020-02-28-002 1° Arrêté préfectoral n° 2020-00161 du 28 février 2020 établissant la liste des candidats aux élections municipales et communautaires pour le 1er tour de scrutin Arrêté préfectoral n° 2020-00161 du 28 février 2020 établissant la liste des candidats aux élections municipales et communautaires pour le 1er tour de scrutin PREFECTURE DU CHER - 18-2020-02-28-002 - 1° Arrêté préfectoral n° 2020-00161 du 28 février 2020 établissant la liste des candidats aux élections municipales et communautaires pour le 1er tour de scrutin 3 PRÉFET DU CHER PRÉFECTURE Direction de la citoyenneté --- Bureau de la réglementation générale des élections ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 15 ET 22 MARS 2020 ARRÊTÉ n° 2020 -0161 du 28 février 2020 établissant la liste des candidats aux élections municipales et communautaires pour le 1er tour de scrutin Le Préfet du Cher Chevalier de l’Ordre National du Mérite VU le code électoral et notamment ses articles L. -

Livret D'accueil 2020
GUIDE DE PLAIMPIED-GIVAUDINS 2020 - 2021 LE MOT DU MAIRE Madame, Monsieur Plaimpied-Givaudins, née de la fusion des communes de Plaimpied et Givaudins en 1842, a connu une forte expansion depuis un demi-siècle, sa population passant de 700 à 2000 habitants. Pour autant, elle conserve l’authenticité d’un village au riche patrimoine historique avec l’abbaye de Plaimpied dont il nous reste une magnifique abbatiale romane, des bâtiments remarquables occupés aujourd’hui par la mairie et un immense parc. Plaimpied-Givaudins présente un vaste territoire de plus de 4 000 hectares traversé par la rivière l’Auron et le canal de Berry (longé d’une piste cyclable depuis 2019), avec au nord le lac d’Auron et l’espace naturel sensible du bas marais alcalin. L’attractivité de Plaimpied-Givaudins repose sur la présence de tous les commerces et services de proximité nécessaires ainsi que la richesse et la diversité de la vie associative proposant un choix très large d’activités culturelles ou sportives s’adressant à tous les âges. Pour répondre encore mieux aux attentes des habitants, la commune conduit un effort d’investissement important pour disposer d’équipements publics de qualité dans tous les domaines. Madame, Monsieur, vous êtes les bienvenus à Plaimpied-Givaudins et je vous souhaite d’y trouver la sérénité et la joie de vivre. Votre Maire, Patrick BARNIER 2 SOMMAIRE Plaimpied-Givaudins Développement durable Histoire et patrimoine ▪ Présentation 5 ▪ Collecte des ordures ménagères 31 ▪ Plan de la commune 6 ▪ Dépôt en déchetterie 31 ▪ Du Moyen-âge -

Plan Local D'urbanisme Intercommunal De BOURGES PLUS
PlanPlan locallocal d’urbanismed’urbanisme Juin 2016 IntercommunalIntercommunal dede BOURGESBOURGES PLUSPLUS PorterPorter àà connaissanceconnaissance dede l’Étatl’État F A S C I C U L E 3 Direction Départementale des Territoires du Cher 1 Service Connaissance, Aménagement et Planification Bureau Documents d’Urbanisme et Planification 2 SOMMAIRE 1. CONTEXTE G É N É RAL Situation p. 7 2. D É MOGRAPHIE, D É PLACEMENTS ET AM É NAGEMENTS Démographie p. 11 Logement p. 16 Déplacements et Transports p. 24 Consommation d’espace et structure urbaine p. 29 3. SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE, ATTRACTIVIT É Les entreprises et l’emploi p. 37 Situation sociale p. 41 Attractivité p. 46 4. ENVIRONNEMENT Assainissement p. 55 Ressource en eau p. 58 Milieux aquatiques et biodiversité p. 60 Forêt p. 65 Zonages environnementaux p. 66 Energies renouvelables p. 67 5. PATRIMOINE, PAYSAGE ET AGRICULTURE Patrimoine p. 71 Paysage p. 72 Agriculture p. 75 6. RISQUES, NUISANCES ET QUALIT É DE VIE Risques p. 81 Nuisances p. 87 7. ANNEXES p. 88 Annexe 1: Tableau de zones de frayères Annexe 2: Tableau de zonages environnementaux Annexe 3: Tableau des éléments à préserver Annexe 4: Tableau des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 3 4 1 CONTEXTE GÉNÉRAL 5 6 Sa Situation La communauté d’agglomération de « Bourges Plus » bénéficie d'une situation géographique favorable. Elle se situe à un carrefour d'axes de communication structurants, l'axe nord-sud reliant Paris au Massif Central et l'axe est-ouest reliant le sillon rhodanien à la façade atlantique. Hormis Châteauroux et Nevers situées à 60 et 80 kilomètres, les agglomérations telles qu'Orléans, Tours ou Clermont-Ferrand se trouvent à des distances de 120, 160 et 190 kilomètres accessibles en moyenne en une à deux heures. -

Table Des Matières
Table des matières Avant-propos ............................................................................................1 Synthèse .............................................................................................. 2-3 Territoires ............................................................................................. 4-5 Morphologie ....................................................................................... 6-12 Infrastructures - déplacements ......................................................... 13-20 Équipements Axes de communication Migrations alternantes, déplacements Démographie.................................................................................... 21-31 Évolution de la population Structure par âge Logement ......................................................................................... 32-44 Évolution et répartition géographique du parc Évolution de la vacance Parc locatif social Social ............................................................................................... 45-55 Ressources Localisation des populations en situation de pauvreté Économie ......................................................................................... 56-66 Spécialisations Évolution du nombre d’établissements et des effectifs Édition 2005 Portrait de l'aire urbaine de Bourges 67 Avant-propos ue ce soit en vue de préparer des documents de planification locale (schémas de cohérence territoriale) ou d’élaborer des contrats territoriaux (de ville, d’agglomération, de pays), la connaissance -

CR Du 27 Juin 2019
République Française Département du Cher Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal de VORLY séance ordinaire du 27 Juin 2019 à 18 heures 30 sous la présidence de M.BILLOT, Maire Etaient présents : Mme LEFEBVRE adjointe MM DEJOU, PARENT, VOLUT Mme CHARPENTIER Absents excusés : M.BERTHOMMIER Mmes CHARONNAT, PINTON, LARCHEVEQUE Absente : Mme MARTIN TILLIER Procurations : M. BERTHOMMIER à M.BILLOT Mme CHARONNAT à M.DEJOU Mme LARCHEVEQUE à Mme LEFEBVRE M.DEJOU a été élu secrétaire de séance. Date de convocation du Conseil Municipal : 20 Juin 2019 Approbation du procès verbal de la séance du 27 mai 2019 Le procès verbal de la séance 27 mai 2019 est adopté à l’unanimité. Questions soumises à l’approbation du Conseil Municipal Points à l’ordre du jour : - SEGILOG contrat à renouveler - Jeux d’Été en Berry (convention de participation) - Proposition de l’offre promotionnelle de santé communale à la commune de Vorly - Convention ENIR (Écoles Numériques Innovantes et Ruralité) - Accord local 2020 (conseil communautaire de Bourges Plus) - Règlement local de publicité intercommunal (RPLI) - ASRPI (recherche d’un local) - Fêtes du 14 Juillet (feu d’artifice, repas communal) - Questions diverses 2019-13 13 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de service que la commune avait signé avec la société SEGILOG arrive à échéance le 30 juin 2019. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte de renouveler le contrat pour une durée de trois ans. Conseil Municipal de la commune de VORLY en date du 27 juin 2019 Le coût annuel de cette prestation sera de 1 770.00 euros H.T (1 530 euros pour la cession du droit d’utilisation et 170 euros pour la maintenance et formation). -

Service Public De L'eau
. SERVICE PUBLIC DE L'EAU RAPPORT D'ACTIVITE 2008 ------------ SOMMAIRE 1 PERIMETRE DU SERVICE DE L'EAU EN 2008 ............................................................ 6 1.1 PERIMETRE DE BOURGES PLUS .......................................................................................... 6 1.2 PERIMETRES DE LA REGIE ET DE LA DELEGATION .............................................................. 7 1.3 LE SERVICE DE L'EAU ........................................................................................................ 8 1.3.1 Organisation du Service ............................................................................................ 8 1.3.2 Interventions du service ............................................................................................ 9 1.3.3 Suivi des demandes de renseignements et des réclamations usagers ...................... 12 1.3.4 Enquête de satisfaction clientèle ............................................................................. 14 2 INDICATEURS TECHNIQUES ....................................................................................... 15 2.1 INFRASTRUCTURES .......................................................................................................... 15 2.1.1 Infrastructures de production .................................................................................. 15 2.1.2 Infrastructures de relèvement et de stockage .......................................................... 17 2.1.3 Infrastructures de distribution ................................................................................ -

Compte Rendu De Séance Séance Du 21 Décembre 2020
République Française Département Cher Commune de BERRY-BOUY Compte rendu de séance Séance du 21 Décembre 2020 L' an 2020 et le 21 Décembre à 18 heures 30 , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu extraordinaire de ses séances , sous la présidence de Madame GOIN-DEMAY Bernadette Maire Présents : Mme GOIN-DEMAY Bernadette, Maire, Mmes : COURTOIS Corinne, DA COSTA Nathalie, JOYEUX Pascale, MEYER Katy, MORAND Laetitia, PLUCHARD-RENARD Justine, MM : AYIVI Yann, CHALOPIN Jean- Pierre, GEORGET Frédéric, LUQUET Philippe, MATHAULT Bernard Excusé(s) ayant donné procuration : Mme PROENCA Marie-Anne à Mme MEYER Katy Excusé(s) : M. LAURENT Jean-Yves Nombre de membres • Afférents au Conseil municipal : 14 • Présents : 12 Date de la convocation : 09/12/2020 Date d'affichage : 09/12/2020 Acte rendu exécutoire après dépôt en SOUS-PREFECTURE DE VIERZON le : et publication ou notification du : A été nommé(e) secrétaire : M. MATHAULT Bernard SOMMAIRE En l'application de la délibération D2020_05804 du 27 mai 2020 et de la délibération D2020_07_02 du 01 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal a donné délégation à Madame le Maire pour exercer un certain nombre de délégation, conformément aux articles L 2122-22, L 2122-23, L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, il vous est donné communication, comme prescrit, des décisions que Madame le Maire a été amenée à prendre depuis le dernier conseil municipal en date du 25 novembre 2020. Décision n°2 : Madame le Maire demande de prendre acte de la signature d'un devis (dans le cadre de sa délégation) concernant la création d'une évacuation d'eau de pluie devant le n°5 à Bouy pour un montant total de 6 168.80 € Approbation à l'unanimité du Conseil Municipal du 25 novembre 2020. -

Les Communes Du Cher
Communes Code commune Nom de la petite région agricole Région agricole Petite région agricole ACHERES 18001 PAYS FORT ET SANCERROIS 439 18439 AINAY-LE-VIEIL 18002 BOISCHAUT 436 18436 AIX-D'ANGILLON 18003 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 ALLOGNY 18004 SOLOGNE 343 18343 ALLOUIS 18005 SOLOGNE 343 18343 ANNOIX 18006 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 APREMONT-SUR-ALLIER 18007 VALLEE DE GERMIGNY 179 18179 ARCAY 18008 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 ARCOMPS 18009 BOISCHAUT 436 18436 ARDENAIS 18010 BOISCHAUT 436 18436 ARGENT-SUR-SAULDRE 18011 SOLOGNE 343 18343 ARGENVIERES 18012 VAL DE LOIRE 66 18066 ARPHEUILLES 18013 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 ASSIGNY 18014 PAYS FORT ET SANCERROIS 439 18439 AUBIGNY-SUR-NERE 18015 SOLOGNE 343 18343 AUBINGES 18016 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 AUGY-SUR-AUBOIS 18017 VALLEE DE GERMIGNY 179 18179 AVORD 18018 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 AZY 18019 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 BANNAY 18020 VAL DE LOIRE 66 18066 BANNEGON 18021 VALLEE DE GERMIGNY 179 18179 BARLIEU 18022 PAYS FORT ET SANCERROIS 439 18439 BAUGY 18023 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 BEDDES 18024 MARCHE 437 18437 BEFFES 18025 VAL DE LOIRE 66 18066 BELLEVILLE-SUR-LOIRE 18026 VAL DE LOIRE 66 18066 BENGY-SUR-CRAON 18027 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 BERRY-BOUY 18028 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 BESSAIS-LE-FROMENTAL 18029 VALLEE DE GERMIGNY 179 18179 BLANCAFORT 18030 PAYS FORT ET SANCERROIS 439 18439 BLET 18031 VALLEE DE GERMIGNY 179 18179 BOULLERET 18032 VAL DE LOIRE 66 18066 BOURGES 18033 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 BOUZAIS 18034 BOISCHAUT -

Questionnaire Caf : « Le Territoire Et Vous
QUESTIONNAIRE CAF : « LE TERRITOIRE ET VOUS... » Les communes de Plaimpied-Givaudins, Saint-Just, Vorly, Annoix, Lissay- Lochy et la communauté d’agglomération de Bourges Plus s'engagent dans la mise en œuvre d'une convention Territoriale Globale avec la Caf du Cher, la Msa et le Conseil Départemental Afin que ce projet de territoire réponde aux mieux à vos attentes, nous vous remercions de bien vouloir apporter votre contribution en répondant à ce questionnaire. Il permettra de mieux identifier vos besoins, connaître vos habitudes et recueillir votre point de vue. • Le domaine social ➢ Connaissez-vous les services de proximité ci-dessous sur votre bassin de vie (Plaimpied-Givaudins, St Just, Vorly, Lissay-Lochy) ? Oui Non Accueil des mairies Mission locale CCAS Autre service Si oui, pouvez-vous préciser lequel : ➢ Selon quelle fréquence les utilisez-vous ? Chaque semaine Chaque mois Une fois par an Jamais Accueil des mairies Mission Locale CCAS Autre service • Petite enfance, enfance, jeunesse et parentalité ➢ Connaissez-vous les services de proximité ci-dessous sur votre bassin de vie (Plaimpied-Givaudins, St Just, Vorly, Lissay-Lochy) ? Oui Non Non concerné(e) Relais Assistants maternels Assistant maternel Crèche/halte-garderie Accueil de loisirs Accueil périscolaire Atelier parentalité Espace de vie sociale (CACPG) Clubs sportifs Associations culturelles et artistique Maison Des Jeunes Autres services ou lieux Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous faire part de vos suggestions et vos besoins concernant les services de proximité petite enfance, enfance, jeunesse et parentalité du territoire : Accessibilité, horaires, présence... • L'accès aux droits et à l'information ➢ Diriez-vous que vous êtes suffisamment informé(e) sur vos droits ? Droits sociaux, juridiques.. -
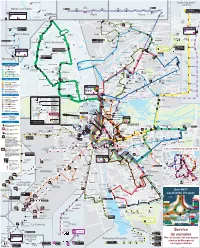
BOURGES 2021 V04(Sanscarreau)
Les Malandries D E F G H I Saint-Germain- J D40 du-Puy Pigny FUSSY Les Mairie Lizy Les Les 10 Mehun-sur-Yèvre 10 PIGNY Tuileries Villeneuve St-Michel Casseriaux Chardons Papin Bel Air Les Craies COLLÈGE IRÈNE 14 Juillet 2 ST-GERMAIN JOLIOT-CURIE 1 Rue de la Mairie D11 Route de Lizy D940 Route de Paris MAIRIE MAIRIE MAIRIE Terres des Chailloux MEHUN-SUR-YÈVRE Gare D2076 Petit Bois 10 ie MÉDIATHÈQUE 1 Pigny Fussy guiller Y L'Arcade ar D20 CHÂTEAU-MUSÉE Le Tronc M CHARLES VII STADE Alsace Rue de la Rue F H. LUQUET Rue C. F Rue du le e ranç l d'Alsac Le Briou Racines ois C 14 Juillet D940 u Rue Puits Neuf a oillar G d oucault s e e STADE t 3 d t P. DELVAL 3 e s Garenne u le o S r A B C l Petite a A Danton h Aujonnière C Roland Boual GYMNASE Boisselées e Les Gatis Blessangis Rue u R Châteaux 16 BERRY-BOUY n out s MAIRIE ANNEXE Past e e de ST-GERMAIN Gare e e is eur John v Graire y d Rue des A ar F S V auv te -S e olange Chardonnerets B Z 2 u ett Gauchère ost Montboulin de R des Blessang Fauvettes e Darlowo e es 2 out Rue Gauchèr John Bost R Alouettes Rue COLLÈGE Berry-Bouy Clos Blanc is JEAN ROSTAND Les Landes C1 MAIRIE COMPLEXE D151 Creuzettes R SPORTIF oulang Méry-es-Bois out La Gravette J. RIMBAULT D260 STADE e CIMETIÈRE ASNIÈRES te des C 16 MUNICIPAL C2 R Le Petit Nelson C2 d' Or Marais 2 Mandela ASNIÈRES 3 D940 Quatre Vents léans Ruelle des BERRY-BOUY 16 Gr Coulangis 10 osses P Grosses Plantes Maurice e e Croix de Varye l lan tiv 3 7 l Saint-Doulchard u tes Canon C1 a G ospec 16 Pr e d Foulonne Rue des is la COLLÈGE l Rue a de VICTOR HUGO GYMN. -

18) Loir Et Cher (41) Allier (03
LOIR ET CHER (41) Suivez le sillage des Mariniers LA LOIRE Mennetou- Villefranche- sur-Cher 18 La sur-Cher Châtres- A71 loire Langon à 2 sur-Cher RE Méry- vélo LD RN 76 Thénioux 3 U Vierzon Marseilles- A A 85 sur-Cher S RN 76 lès-Aubigny A L Gièvres 3 2 31 1 LE CHER B 2 20 Jouet- Châtillon- 5 CANAL Foëcy Fontmorigny sur-l’Aubois 1 sur-Cher Noyers- 3 4 4 1 Mehun- LATÉRAL vignobles & 30 sur-Cher découvertes Selles- 6 M sur-Yèvre sur-Cher A20 4 Torteron À RN 76 5 LA LOIRE M 8 6 Saint-Aignan Bourges A 7 L’ YÈVRE 5 Marmagne Le Chautay 10 9 11 La Guerche- sur-l’Aubois 29 A71 Saint-Just La Chapelle- Hugon 6 Annoix 17 Apremont- Plaimpied- sur-Allier Givaudins 10 Saint-Denis- de-Palin 7 Grossouvre M CHER (18) Dun- 12 28 M sur-Auron RN 76 26 27 •1• Parnay 19 L’ AURON Sancoins •2• 25 La région LE CHER 16 Verneuil Neuilly- Centre en-Dun EURE- 8 Bannegon Augy- ET-LOIRE Le Pondy Fontblisse sur-Aubois Réservoir LOIRET du Pondy Vernais LOIRE- 15 ET-CHER 10 8 9 13 Noirlac 7 Saint-Pierre- INDRE- Bourges les-Étieux Base St Amand- L ET-LOIRE A de loisirs 17 Montrond M A de Goule R CHER Charenton- M 11 9 A du-cher N D INDRE 16 E 18 M Drevant 10 12 Colombiers 20 14 19 C 11 Ainay- Base le-Vieil de loisirs 12 Légende 13 de l’étang de Pirot La Perche M 14 A71 Urçay LE CANAL DE BERRY : LA VIE SUR LE CANAL : LA VIE AUTOUR DU CANAL : LES MONUMENTS : Meaulne 21 en eau ouvrages du canal jardins château 15 M Épineuil- à sec M musées en relation espace naturel site archéologique le-Fleuriel 13 avec le canal gallo-romain remblayé Vallon- 14 en-Sully 22 base de loisirs