Asse -Travaux Entretien
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
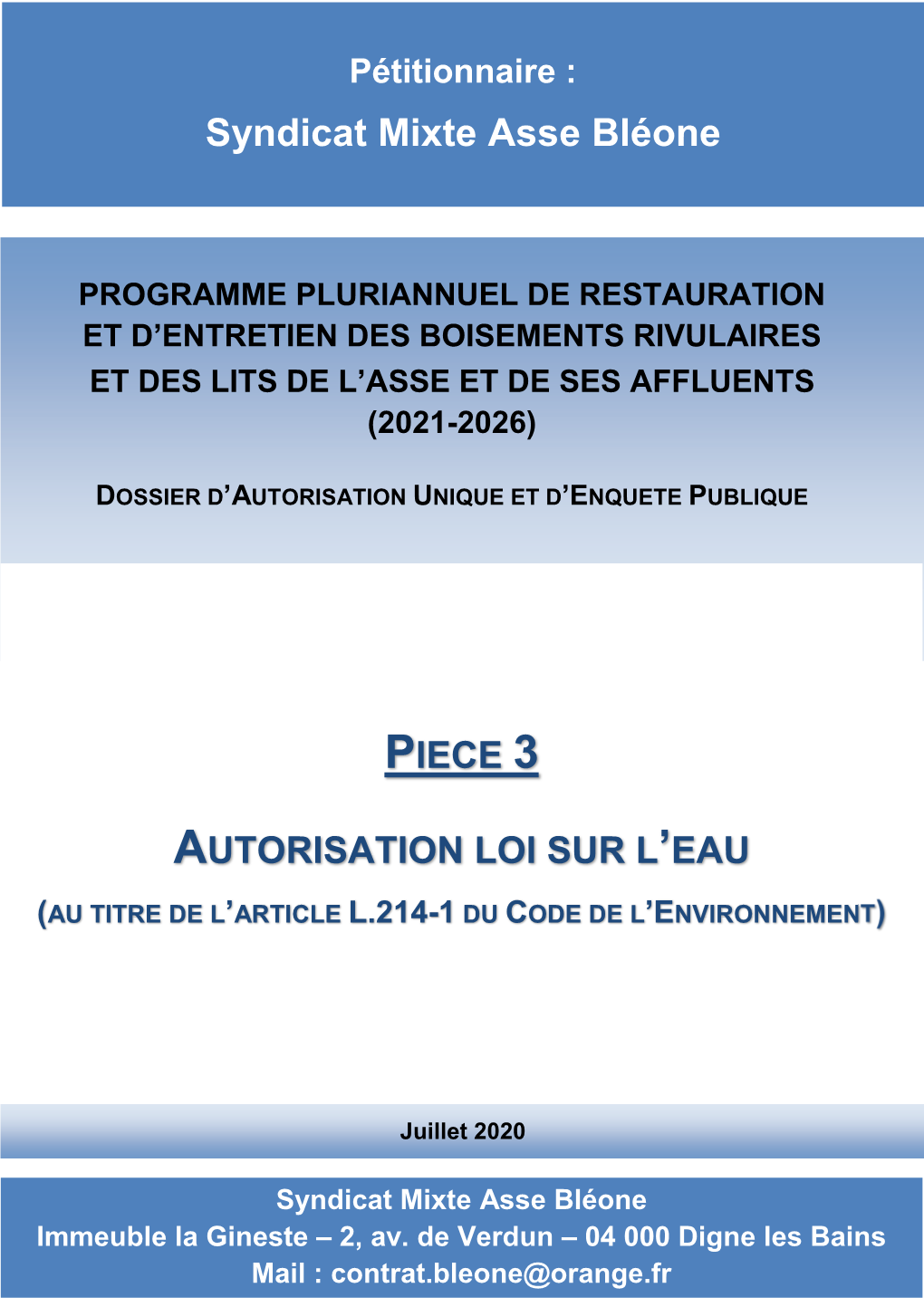
Load more
Recommended publications
-
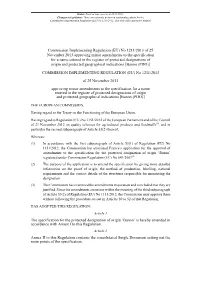
Commission Implementing Regulation (EU) No 1211/2013
Status: Point in time view as at 25/11/2013. Changes to legislation: There are currently no known outstanding effects for the Commission Implementing Regulation (EU) No 1211/2013. (See end of Document for details) Commission Implementing Regulation (EU) No 1211/2013 of 25 November 2013 approving minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Banon (PDO)] COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1211/2013 of 25 November 2013 approving minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Banon (PDO)] THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs(1), and in particular the second subparagraph of Article 53(2) thereof, Whereas: (1) In accordance with the first subparagraph of Article 53(1) of Regulation (EU) No 1151/2012, the Commission has examined France’s application for the approval of amendments to the specification for the protected designation of origin ‘Banon’ registered under Commission Regulation (EC) No 641/2007(2). (2) The purpose of the application is to amend the specification by giving more detailed information on the proof of origin, the method of production, labelling, national requirements and the contact details of the structures responsible for monitoring the designation. (3) The Commission has examined the amendments in question and concluded that they are justified. -

Liste Des Communes Reconnues Comme Zones De Biodiversité
ANNEXE : LISTE DES COMMUNES CONSTITUANT LES ZONES REMARQUABLES Département des ALPES de HAUTE PROVENCE ALLEMAGNE-EN-PROVENCE 04004 PUIMOISSON 04157 ALLOS 04006 QUINSON 04158 ARCHAIL 04009 REILLANNE 04160 AUBENAS-LES-ALPES 04012 MEOLANS-REVEL 04161 AUZET 04017 REVEST-DES-BROUSSES 04162 BARLES 04020 RIEZ 04166 BARREME 04022 LA ROBINE-SUR-GALABRE 04167 BEAUVEZER 04025 ROUGON 04171 BEYNES 04028 ROUMOULES 04172 BLIEUX 04030 SAINTE-CROIX-A-LAUZE 04175 LA BRILLANNE 04034 SAINTE-CROIX-DE-VERDON 04176 BRUNET 04035 SAINT-JURS 04184 LE CAIRE 04037 SAINT-LAURENT-DU-VERDON 04186 CASTELLANE 04039 SAINT-LIONS 04187 CASTELLET-LES-SAUSSES 04042 SAINT-MAIME 04188 CERESTE 04045 SAINT-MARTIN-DE-BROMES 04189 CHAUDON-NORANTE 04055 SAINT-MARTIN-LES-EAUX 04190 CLARET 04058 SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE 04192 CLUMANC 04059 SAINT-PAUL-SUR-UBAYE 04193 COLMARS 04061 SAUSSES 04202 DAUPHIN 04068 SENEZ 04204 ESPARRON-DE-VERDON 04081 SIMIANE-LA-ROTONDE 04208 ESTOUBLON 04084 TARTONNE 04214 GIGORS 04093 THORAME-BASSE 04218 L'HOSPITALET 04095 LES THUILES 04220 JAUSIERS 04096 VACHERES 04227 LA JAVIE 04097 VALBELLE 04229 LARCHE 04100 VALENSOLE 04230 LE LAUZET-UBAYE 04102 VERDACHES 04235 LIMANS 04104 VILLEMUS 04241 MAJASTRES 04107 VOLX 04245 MANOSQUE 04112 MEAILLES 04115 MELVE 04118 MONTAGNAC-MONTPEZAT 04124 MONTJUSTIN 04129 MORIEZ 04133 LA MOTTE-DU-CAIRE 04134 MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 04135 LA MURE-ARGENS 04136 OPPEDETTE 04142 ORAISON 04143 LA PALUD-SUR-VERDON 04144 PIEGUT 04150 PUIMOISSON 04157 Département des HAUTES ALPES ABRIES 05001 SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHENE 05146 AGNIERES-EN-DEVOLUY -

Nouveau Territoire D'itinérance
Alpes de Haute-Provence / Provincia di Cuneo nuovo territorio da scoprire - nouveau territoire d’itinérance Produits labellisés Huile d’olive Autoroutes Patrimoine naturel remarquable Olio d’oliva Routes touristiques / Strade turistiche Autostrade Patrimonio naturale notevole Torino Torino Fromage de Banon Carignano Routes principales Espaces protégés Formaggio di Banon Route des Grandes Alpes Asti Strada principale Strada delle Grandi Alpi Aree protette Vins régionaux / Caves / Musées Variante Routes secondaires Sommets de plus de 3 000 mètres Asti Enoteche regionali / Cantine / Musei Pinerolo Strada secondaria Routes de la lavande Montagne >3.000 metri Agneau de Sisteron Strade della lavanda Rocche del Roero Voies ferrées Via Alpina Agnello di Sisteron Ferrovie Itinéraire rouge - Point d’étape Casalgrasso Montà Govone Itinerario rosso – Punto tappa Canale Vergers de la Durance Route Napoléon Ceresole Polonghera S. Stefano Roero Priocca Train des Pignes Strada Napoléon Itinéraire bleu - Point d’étape Faule Caramagna d’Alba Frutteti della Durance Piemonte Monteu Roero Les Chemins de fer Itinerario blu – Punto tappa Castellinaldo de Provence Montaldo Vezza Sommariva Roero d’Alba Magliano Point étape des sentiers de randonnée trekking Racconigi d. Bosco Alfieri Maisons de produits de pays Murello Baldissero Digne-les-Bains > Cuneo Bagnolo Moretta d’Alba Castagnito Points de vente collectifs Piemonte Sanfrè Corneliano Punto tappa dei sentieri di trekking Cavallerieone Sommariva d’Alba Aziende di prodotti locali Perno Digne-les-Bains > Cuneo Rucaski Cardè Guarene Neive Raggruppamento di produttori con vendita diretta Villanova Piobesi M. Granero Torre Monticello Solaro d’Alba 3.171 m Abbazia S. Giorgio Pocapaglia d’Alba Barbaresco Barge Staffarda Castiglione Marchés paysans C. d. -

Note De Synthèse Asse.Pdf
Octobre 2012 . NOTE DE SYNTHESE Document d’objectifs Site Natura 2000 FR 9301533 « L’ASSE » Naturalia Environnement AGROPARC Rue Lawrence Durrell BP 31 285 84 911 Avignon Cedex 9 www.naturalia-environnement.fr SOMMAIRE I. PRESENTATION GENERALE DU SITE ....................................................................................................................................................... 1 I.1. Contexte et méthode ........................................................................................................................................................................................................... 2 I.2. Situation géographique ........................................................................................................................................................................................................ 3 I.3. Données administratives ...................................................................................................................................................................................................... 5 I.4. Agriculture et Pastoralisme .................................................................................................................................................................................................. 5 I.5. Protection et réglementation ............................................................................................................................................................................................... 8 I.6. -

Prefecture Des Alpes De Haute-Provence
Digne-les-Bains, le 8 mars 2017 Liste des personnes habilitées à établir des procurations de vote dans le département des Alpes-de-Haute-Provence Le vote par procuration permet à un électeur qui ne pourra pas voter personnellement le jour de l’élection de confier son vote à un électeur de son choix inscrit dans la même commune qui votera à sa place. Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, les procurations peuvent être établies par : les Vices-présidentes du Tribunal d’Instance de Digne-les-Bains ; le directeur des services de greffe judiciaire de ce tribunal ; pour les communes de Colmars-les-Alpes, Allos, Beauvezer, Thorame- Basse, Thorame-Haute, Villars-Colmars, Saint-André-les-Alpes, Allons, Angles, Moriez, La-Mure-sur-Argens, Lambruisse : les officiers et agents de police judiciaire de la communauté de brigades de Colmars-les-Alpes ; pour les communes d’Annot, Braux, Le Fugeret, Méailles, Saint- Benoît, Ubraye, Vergons, d’Entrevaux, Castellet-les-Sausses, La Rochette, Saint-Pierre, Sausses, Val-de-Chalvagne : les officiers et agents de police judiciaire de la communauté de brigades d'Annot ; pour les communes de Barcelonnette, Condamine, Enchastrayes, Faucon de-Barcelonnette, Jausiers, Val d’Oronaye, Saint-Paul-sur- Ubaye, Saint-Pons, Les Thuiles, Uvernet-Fours : les officiers et agents de police judiciaire de la communauté de brigades de Barcelonnette ; pour les communes de Barrême, Blieux, Chaudon-Norante, Senez, Clumanc, Saint-Jacques, Saint-Lions, Tartonne, Beynes, Bras-d’Asse, Chateauredon, Mézel, Estoublon, Saint-Jeannet, -

Fiche Horaire
Fiche Horaire Ligne : BV1 Bis - RIEZ - CASTELLANE SCOL E2 ANSF E1 E2 E1 E1 Itinéraires BV1A2 BV1A1 BV1A2 BV1A1 BV1A1 BV1A1 BV1A1 Commune Coordonnées Code Point d'arrêt lmmjv--- lmmjvsd- -----s-- lmmjvsd- lmmjvsd- lmmjvsd- lmmjvsd- CASTELLANE 6,51259 43,84638 220 Place M Sauvaire 07:35 11:20 12:25 15:50 18:15 6,49368 43,8393 203 Camping du Verdon 07:43 11:28 12:33 15:58 18:23 6,42802 43,83018 206 Chasteuil 07:50 11:35 12:40 16:05 18:30 ROUGON 6,43129 43,82271 953 Clos d'Arémus 07:55 11:40 12:45 16:10 18:35 1449 Pont de Soleil 08:00 11:45 12:50 16:15 18:40 6,43739 43,79606 951 Carajuan 08:05 11:50 12:55 16:20 18:45 6,3983 43,79442 958 Point Sublime 08:10 11:55 13:00 16:25 18:50 LA PALUD SUR VERDON 6,34106 43,77892 828 Village 08:25 12:10 13:15 16:40 19:05 MOUSTIERS STE MARIE 1360 Village 07:25 10:00 6,21956 43,84349 785 Déviation village RD952 09:00 12:45 13:50 17:15 19:40 ROUMOULES 6,12868 43,82479 963 Place du 19 mars 1962 07:40 10:15 6,12661 43,82596 964 RD952 09:15 13:00 14:05 17:30 19:55 RIEZ 6,09151 43,81569 946 Collège / Pré de Foire 07:50 09:20 10:25 13:05 14:10 17:35 20:00 Transporteur VOYAGES SUMIAN RETOUR E1 E2 SCOL ANSF E1 E2 SCOL E1 Itinéraires BV1R1 BV1R1 BV1R2 BV1R2 BV1R1 BV1R1 BV1R2 BV1R1 Commune Coordonnées Code Point d'arrêt lmmjvsd- lmmjvsd- --m----- -----s-- lmmjvsd- lmmjvsd- lm-jv--- lmmjvsd- RIEZ 6,09151 43,81569 946 Collège / Pré de Foire 09:25 10:35 12:15 12:15 13:15 16:15 17:00 19:10 ROUMOULES 6,12868 43,82479 963 Place du 19 mars 1962 12:25 12:25 17:10 6,12661 43,82596 964 RD952 09:30 10:40 13:20 16:20 19:15 MOUSTIERS -

Napoléon Et Sa Traversée Des Basses-Alpes
« L’Aigle va voler de clocher en clocher jusqu’à Notre-Dame » Napoléon et sa traversée des Basses-Alpes Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence / 2015 Réalisation de la plaquette --------------------------------------- Texte et conception : Jean-Christophe Labadie directeur des Archives départementales Recherches : Jean-Christophe Labadie Conception graphique : Jean-Marc Delaye photographe Relecture : Annie Massot, bibliothécaire ; Sophie Chouial, archiviste ISBN 978-2-86004-024-2 © Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence, Archives départementales 2, rue du Trélus, BP 214 04000 Digne-les-Bains Cedex [email protected] www.archives04.fr Impression : Imprimerie Presse-People 34670 Baillargues Dépôt légal : mars 2015 1 500 exemplaires « L’Aigle va voler de clocher en clocher jusqu’à Notre-Dame » Napoléon et sa traversée des Basses-Alpes vendredi 3 - dimanche 5 mars 1815 Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 2015 Sommaire Préface 5 Napoléon et sa traversée des Basses-Alpes 6 Castellane, « l’heureuse » surprise ! 8 Barrême, le repos de l’Aigle 10 Digne, « Napoléon vole comme l’éclair » 12 Malijai, au château 14 Sisteron, la clef ! 16 La fin du chemin 18 Napoléon, un héros romantique 20 L’inauguration de la Route Napoléon 22 Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 2015 5 Préface À l’occasion du bicentenaire du retour de Napoléon de son premier exil sur l’île d’Elbe en 1815, les Archives départementales ont choisi de se joindre aux initiatives qui, tout au long de la « Route Napoléon » le célèbreront. Les Archives proposent une exposition itinérante afin qu’elle puisse pérégriner tout au long de la route Napoléon, itinéraire touristique conçu et inauguré en juillet 1932 par les syndicats d’initiative des départements qu’elle traverse, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes- Alpes et l’Isère, de Golfe-Juan à Grenoble. -

Digne a 1/50 000
— 1 — NOTICE EXPLICATIVE DE LA FEUILLE DIGNE A 1/50 000 par p.c.de GRAClANSKY avec la collaboration de : G. DUROZOY P. GIGOT 1982 — 3 — SOMMAIRE APERÇU MORPHOLOGIQUE, STRUCTURAL ET PALÉO- GÉOGRAPHIQUE ................................................................................................ 5 DONNÉES UTILISÉES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA CARTE ..................... 7 DESCRIPTION DES TERRAINS ......................................................................... 8 TRIAS ET RHÉTIEN ................................................................................... 8 LIAS........................................................................................................................ 9 JURASSIQUE MOYEN ET SUPÉRIEUR ...................................................... 17 CRÉTACÉ ........................ ............................................................................. 24 TERTIAIRE .................................................................................................. 34 QUATERNAIRE ET FORMATIONS RÉCENTES ............................................ 47 DESCRIPTION TECTONIQUE ............................................................................. 49 INDICATIONS PALÉOGÉOGRAPHIQUES ......................................................... 61 RESSOURCES DU SOUS-SOL ET EXPLOITATIONS ........................................ 69 HYDROLOGIE ET HYDROGÉOLOGIE ................................................................... 69 SUBSTANCES MINÉRALES ......................................................................... -

Dossier Présentation
Action Cœur de ville Manosque – Dossier de présentation Page 1/61 Sommaire Préambule...........................................................................................................................................3 1 – Éléments de contexte..................................................................................................................4 1.1 - La communauté d'agglomération................................................................................................4 1.2 - Manosque Ville-Centre d’un bassin de vie...................................................................................7 2 – Un périmètre stratégique...........................................................................................................11 3 – La Gouvernance du projet.........................................................................................................12 4 – Éléments de diagnostic.............................................................................................................14 4.1 - Un habitat en quête d'attractivité...............................................................................................14 4.2 - Le développement économique et commercial..........................................................................15 4.3 - Mobilité et accessibilité............................................................................................................19 4.4 - Les espaces publics et le patrimoine ........................................................................................20 -

Contrat De Rivière Du Bassin Versant De L'asse
n Contrat de rivière « l’Asse et ses affluents » SOMMAIRE I TABLE DES MATIERES I Contexte du contrat de rivière .............................................................. 2 I.1 Présentation synthétique du bassin versant ..................................................................... 2 I.1.1 Situation géographique ............................................................................................................. 2 I.1.2 Contexte administratif ................................................................................................................ 4 I.1.3 Caractéristiques physiques du territoire.................................................................................... 5 I.1.4 Masses d’eau superficielles ...................................................................................................... 13 I.1.5 Contexte naturel ....................................................................................................................... 15 I.1.6 Contexte socio-économique .................................................................................................. 25 I.2 Motivation de la démarche .................................................................................................. 32 I.2.1 Genèse de la démarche ......................................................................................................... 32 I.2.2 « Contrat de rivière », un outil adapté au territoire ................................................................ 32 I.2.3 Acteurs de la gestion de -

Evaluation De La Présence De Vertigo Angustior Sites Natura 2000 Des Départements Des Alpes De Haute-Provence Et Des Hautes-Alpes
Etude Evaluation de la présence de Vertigo angustior Sites Natura 2000 des départements des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes Juin 2019 Etude Evaluation de la présence de Vertigo angustior Sites Natura 2000 des départements des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes Document réalisé par : Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur Pôle Biodiversité Régionale Etude financée par Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement Provence-Alpes-Côte d’Azur Document rédigé par : Cédric Roy – Référent malacologie – CEN PACA Relecture : Géraldine Kapfer –Responsable du pôle Biodiversité Régionale – CEN PACA Julie Delauge – Directrice adjointe – CEN PACA Christophe Perrier – Malacologue - ARIANTA Équipe de terrain : Marin Marmier – SC Malacologie – CEN PACA Anne-Sophie Oswald – SC Malacologie – CEN PACA Christophe Perrier – Malacologue – ARIANTA Cédric Roy – Référent malacologie – CEN PACA Date de réalisation : Juin 2019 Crédits photographiques : 1ère de couverture : Zone humide sous le col du Lauzet © H. Vanderpert – CEN PACA Pour le reste des illustrations, l’auteur est mentionné dans la légende Citation recommandée : Roy C. 2019. Evaluation de la présence de Vertigo angustior – Sites Natura 2000 des départements des Alpes de Haute- Provence et des Hautes-Alpes – CEN PACA, DREAL PACA, Arianta. Sisteron, 43 p. Sommaire Introduction ................................................................................... 5 1. Matériel et Méthode .............................................................. -

Provence Alpes Sommaire
Communauté d’agglomération PROVENCE ALPES SOMMAIRE Entrepreneuriat et potentiel 7 ÉCONOMIQUE Édito 3 LE TOURISME, 10 un acteur clé l’économie locale PROVENCE ALPES 4 AGGLOMÉRATION ATOUTS ET SPÉCIFICITÉS 12 du territoire Une population Un territoire 5 QUI SE STABILISE 14 NUMÉRIQUE Contact Agence Les projets de Développement UN SECTEUR TERTIAIRE ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES des Alpes non marchand prépondérant 6 15 DU TERRITOIRE de Haute-Provence [email protected] +33 (0)4 92 31 57 29 Ressources documentaires Population : Insee, Recensement de la population 2017 Offre touristique : AD04, APIDAE, OTSI, Atout France, Plate- Données thermalisme : Établissement thermal de Digne-les-Bains Emploi : CCI04, Insee, CLAP 2017 forme Class, 2018 Données remontées mécaniques : DSF, 2017 Transmission d’entreprise : Enquête auprès des entreprises du Fréquentation touristique : AD04, FVT Orange, 2017 Accès internet et couverture réseau mobile 3G : France Très territoire réalisée en septembre 2017, CCI04 Emploi touristique : CRT PACA - JLJECO - base COMETE, 2015 Haut Débit, 2018 / ARCEP, 2018 Agriculture : Agreste, recensements agricoles 2010 Consommation touristique : AD04, CRT PACA, Enquête régionale Les entreprises et le numérique : Enquête au 1er trimestre 2017 Ressources forestières : Observatoire régional de la forêt méditerranéenne auprès des clientèles touristiques 2010/2011/ AD04, FVT, 2017 auprès de entreprises implantées dans une commune de PAA, CCI04 Ce document a été réalisé avec le concours financier de l’Etat, la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur.