SLGRI De Mende-Marvejols
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
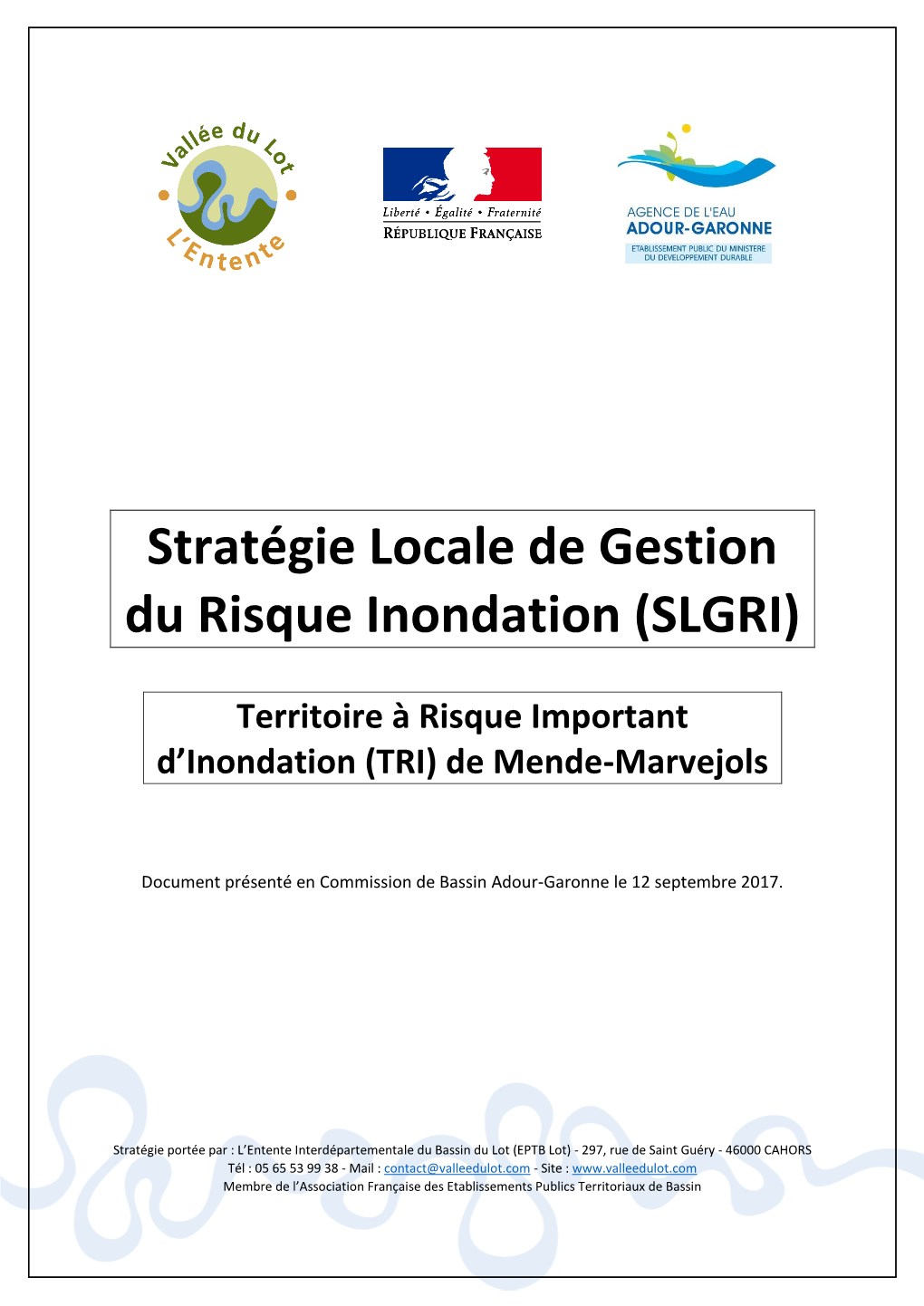
Load more
Recommended publications
-
Mise En Page 1
Ecole Départementale de Musique de Lozère 20 20 -20 21 Conservatoire à rayonnement intercommunal Artistiquement vôtre ! Plus de 800 élèves, enfants à partir de 5 ans, adolescents, adultes, 37 enseignants et intervenants, 11 antennes sur le département, plus de 20 disciplines proposées, de l’éveil, des orchestres, des ateliers, de la musique classique, contemporaine, des musiques actuelles, rock, jazz, de la musique traditionnelle, de la chanson, de la création par ordinateur, l’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire et en secteur social en musique, danse et théâtre, deux “orchestres à l’école”, des concerts, des spectacles, des rencontres avec des artistes… Voici en quelques mots la carte d’identité de l’Ecole Départementale de Musique de Lozère en 2020, chargée d’une mission culturelle et territoriale. Débutants ou confirmés, vous trouverez nécessairement au Conservatoire la formation et les pratiques que vous recherchez et qui correspondent à vos attentes, vous participerez aux activités de diffusion, ou bénéficierez de l’accompagnement des pratiques amateur, ou peut-être pourrez-vous utiliser les studios de répétition avec votre groupe. Bonne lecture. L’équipe L’administration Eric PARRA : Directeur Brigitte VIGUIER : Administratrice Karine BRASSAC : Secrétaire, chargée de la scolarité Adrian MARTINEZ : Chargé de la coordination de l'action culturelle et de la gestion des studios Les enseignants Frédéric ANTHOUARD : Guitare Samuel BERTHOD : Clarinette Nadia BESSERON : Intervenante Musique, Formation Musicale, Chorale Enfants -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2021
Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 48 LOZERE INSEE - décembre 2020 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 48 - LOZERE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 48-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 48-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 48-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 48-3 INSEE - décembre 2020 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, -

SAINT BONNET DE CHIRAC Cartographies Des Aléas Mouvements De Terrain Cartes D’Aléas Et Commentaires
SAINT BONNET DE CHIRAC Cartographies des aléas mouvements de terrain Cartes d’aléas et commentaires Rapport Février 2018 8 CONCLUSION..........................................................................................................................15 Table des matières 8.1 Rappels des objectifs de l'étude.............................................................................................15 8.2 Limites d'utilisation.................................................................................................................15 1 INTRODUCTION.........................................................................................................................1 9 BIBLIOGRAPHIE......................................................................................................................15 2 CONTEXTE DE LA COMMUNE DE SAINT-BONNET DE CHIRAC..........................................1 9.1 Guides méthodologiques........................................................................................................15 2.1 Contexte géologique de la commune.......................................................................................1 9.2 Autres références ayant servi à l’établissement de la méthodologie.....................................15 2.2 Nouveaux éléments..................................................................................................................1 2.3 Carte des observations............................................................................................................1 ANNEXE -

CC Du Gévaudan (Siren : 244800470)
Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC du Gévaudan (Siren : 244800470) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Marvejols Arrondissement Mende Département Lozère Interdépartemental non Date de création Date de création 30/12/2003 Date d'effet 31/12/2003 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président Mme Patricia BREMOND Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège Pôle d'activités du Gévaudan Numéro et libellé dans la voie 4 rue des Chazelles Distribution spéciale Code postal - Ville 48100 MARVEJOLS Téléphone 04 66 32 38 41 Fax 04 66 32 33 50 Courriel [email protected] Site internet Profil financier Mode de financement Fiscalité professionnelle unique Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) oui Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non Population Population totale regroupée 10 071 1/4 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Densité moyenne 38,24 Périmètre Nombre total de communes membres : 12 Dept Commune (N° SIREN) Population 48 Antrenas (214800054) 339 48 Bourgs sur Colagne (200058501) 2 164 48 Gabrias (214800682) 161 48 Grèzes (214800724) 236 48 Le Buisson (214800328) 229 48 Marvejols (214800922) 4 911 48 Montrodat (214801037) 1 285 48 Palhers (214801078) 187 48 Recoules-de-Fumas (214801243) 104 48 Saint-Bonnet-de-Chirac (214801383) 68 48 Saint-Laurent-de-Muret (214801656) 193 48 Saint-Léger-de-Peyre (214801680) 194 Compétences Nombre total de compétences exercées : 32 Compétences exercées par le groupement Production, distribution d'énergie - Autres énergies - Etudes préalables en matière d¿énergies renouvelables, proposition de création de zone de développement éolien et planification territoriale de l¿éolien. -

Le Journal De Ma Région
LE JOURNAL N° 28 Mai 2021 DE MA RÉGION LOZÈRE Produire et consommer autrement, c’est possible ! Lire pages 14 à 19 LIGNES À GRANDE SANTÉ : VITESSE : L’AVENIR SE PRÉPARE LA MOBILISATION EN OCCITANIE A PAYÉ Page 6 Pages 2 à 3 L’événement Santé, l'avenir se prépare en Occitanie L’opération Proxivaccin facilite la vaccination en Occitanie La campagne régionale de vaccination itinérante Proxivaccin a démarré mi-mars. Cette opération, destinée à vacciner les personnes éloignées des infrastructures de santé, s’étend progressivement à toute l’Occitanie. Grâce à un véhicule organisé dépourvues de centre de vac- comme un véritable centre de soins, cination fixe, de pharmacie, de avec un espace d’accueil des patients cabinet médical ou de maison de et 2 salles de vaccination, des pro- santé. Destiné aux personnes éli- fessionnels de santé se déplacent sur gibles à la vaccination, ce service l’ensemble du territoire. Un système est gratuit. Mi-avril, soit 1 mois informatique embarqué permet un après le début de l'opération, 3 406 traitement administratif instantané personnes avaient reçu 1 dose de des rendez-vous. vaccin. Il va s’étendre progressive- L’opération Proxivaccin vise en ment à tous les territoires ruraux priorité à proposer la vaccination de notre région. aux habitants d’Occitanie vivant Porté par le Centre européen des dans des zones rurales isolées, technologies de l’information en milieu rural (Cetir), ce programme est financé par la Région, l’ARS et les conseils départementaux 22 millions © Emmanuel Grimault C’est le nombre de masques que la Région concernés. -
Plaquette 2019 / 2020 De L'edml
Ecole Départementale de Musique de Lozère 2019 2020 Conservatoire à rayonnement intercommunal Artistiquement vôtre ! Plus de 800 élèves, enfants à partir de 5 ans, adolescents, adultes, 37 enseignants et interve - nants, 11 antennes sur le département, plus de 20 disciplines proposées, de l’éveil, des orches - tres, des ateliers, de la musique classique, contemporaine, des musiques actuelles, rock, jazz, de la musique traditionnelle, de la chanson, de la création par ordinateur, l’éducation artis - tique et culturelle en milieu scolaire et en sec - teur social en musique, danse et théâtre, un orchestre à l’école au collège de Sainte-Enimie, des concerts, des spectacles, des rencontres avec des artistes… Voici en quelques mots la carte d’identité de l’Ecole Départementale de Musique de Lozère en 2019, chargée d’une mission culturelle et ter - ritoriale. Débutants ou confirmés, vous trouverez nécessairement au Conservatoire la formation et les pratiques que vous recherchez et qui cor - respondent à vos attentes, vous participerez aux activités de diffusion, ou bénéficierez de l’ac - compagnement des pratiques amateur, ou peut-être pourrez-vous utiliser les studios de répétition avec votre groupe. Bonne lecture. Les disciplines enseignées : Bois : Musiques Flûte traversière, traditionnelles : Clarinette, Accordéon diatonique, Saxophone. Cabrette. Cuivres : Eveil musical Trompette/Cornet, (5 – 6 ans) Cor, Trombone, Formation musicale Tuba. (à partir de 7 ans) Cordes : Ensembles, Orchestres, Violon, Musique de chambre Violoncelle. Ateliers : Instruments Musique polyphoniques : traditionnelle, Piano, Jazz, Rock, Pop, Orgue, Chansons, Guitare. Création sonore (MAO). Voix : Chant, Chorales enfants Technique vocale. et adultes Musiques Interventions en actuelles : milieu scolaire : Guitare électrique, Musique, Danse Basse, et Théâtre. -

Cheeses Part 2
Ref. Ares(2013)3642812 - 05/12/2013 VI/1551/95T Rev. 1 (PMON\EN\0054,wpd\l) Regulation (EEC) No 2081/92 APPLICATION FOR REGISTRATION: Art. 5 ( ) Art. 17 (X) PDO(X) PGI ( ) National application No 1. Responsible department in the Member State: I.N.D.O. - FOOD POLICY DIRECTORATE - FOOD SECRETARIAT OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD Address/ Dulcinea, 4, 28020 Madrid, Spain Tel. 347.19.67 Fax. 534.76.98 2. Applicant group: (a) Name: Consejo Regulador de la D.O. "IDIAZÁBAL" [Designation of Origin Regulating Body] (b) Address: Granja Modelo Arkaute - Apartado 46 - 01192 Arkaute (Álava), Spain (c) Composition: producer/processor ( X ) other ( ) 3. Name of product: "Queso Idiazábaľ [Idiazábal Cheese] 4. Type of product: (see list) Cheese - Class 1.3 5. Specification: (summary of Article 4) (a) Name: (see 3) "Idiazábal" Designation of Origin (b) Description: Full-fat, matured cheese, cured to half-cured; cylindrical with noticeably flat faces; hard rind and compact paste; weight 1-3 kg. (c) Geographical area: The production and processing areas consist of the Autonomous Community of the Basque Country and part of the Autonomous Community of Navarre. (d) Evidence: Milk with the characteristics described in Articles 5 and 6 from farms registered with the Regulating Body and situated in the production area; the raw material,processing and production are carried out in registered factories under Regulating Body control; the product goes on the market certified and guaranteed by the Regulating Body. (e) Method of production: Milk from "Lacha" and "Carranzana" ewes. Coagulation with rennet at a temperature of 28-32 °C; brine or dry salting; matured for at least 60 days. -

Lieux Emplacements Affichage
L O Z E R E EMPLACEMENTS d'affichage - 2015/2016 ALBARET LE COMTAL 1 Place de l'église ALBARET SAINTE MARIE 1 Mairie - La Garde ALLENC 2 Parking de la mairie Le Puech ALTIER 1 Parking mairie ANTRENAS 1 Village ARZENC D'APCHER 1 A côté mairie ARZENC DE RANDON 1 en bordure de la mairie AUMONT-AUBRAC 1 Place du Foirail AUROUX 1 Place du village BADAROUX 1 Place de la Mairie - Rue de l'Egalité BAGNOLS LES BAINS 1 Place de la poste BALSIEGES 1 Route de FLORAC ( A gauche maison forestière d'Ausset) BANASSAC 2 Place de l'église ST MEDARD Le Ségala BARJAC 1 Grand-Place BARRE DES CEVENNES 2 Place de la Loue La Croisette BASSURELS 1 Place du village BASTIDE PUYLAURENT (LA) 1 Place de l'église BEDOUES 2 Mairie - Place de l'école parking Salle des fêtes BELVEZET 1 Mairie BESSONS (LES) 1 Place de la mairie BLAVIGNAC 1 Mairie BLEYMARD (LE) 1 Place de l'église BONDONS (LES) 1 Village BORN (LE) 1 La Chape - Village BRENOUX 1 Mairie BRION 1 Place du village BUISSON (LE) 1 A côté de la salle des fêtes CANILHAC 1 place du Village CANOURGUE (LA) 4 Près mairie Canourgue - Place du pré commun Près mairie d'Auxillac - Place de l'Eglise Près mairie La Capelle Près mairie Montjézieu CASSAGNAS 1 Mairie - Village CHADENET 1 Place de l'Eglise CHAMBON LE CHÂTEAU 1 Place du village CHANAC 2 Quartier La Vignogue Place de la Bascule CHASSERADES 1 D6 CHASTANIER 1 Mairie CHASTEL NOUVEL 1 place de la mairie CHATEAUNEUF DE RANDON 1 Place Du Guesclin CHAUCHAILLES 1 devant la mairie CHAUDEYRAC 1 Mairie CHAULHAC 1 Cour Mairie CHAZE DE PEYRE (LA) 1 Mairie CHEYLARD L'EVEQUE -

3B2 to Ps Tmp 1..75
1975L0271 — DA — 05.01.1977 — 003.001 — 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor ►B RÅDETS DIREKTIV af 28. april 1975 om fællesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsområder i henhold til direktiv 75/268/EØF (Frankrig) (75/271/EØF) (EFT L 128 af 19.5.1975, s. 33) Ændret ved: Tidende nr. side dato ►M1 Rådets direktiv 76/401/EØFaf 6. april 1976 L 108 22 26.4.1976 ►M2 Rådets direktiv 77/178/EØFaf 14. februar 1977 L 58 22 3.3.1977 ►M3 Kommissionens beslutning 77/3/EØFaf 13. december 1976 L 3 12 5.1.1977 Berigtiget ved: ►C1 Berigtigelse, EFT L 288 af 20.10.1976, s. 27 (76/401/EØF) 1975L0271 — DA — 05.01.1977 — 003.001 — 2 ▼B RÅDETS DIREKTIV af 28. april 1975 om fællesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsområder i henhold til direktiv 75/268/EØF (Frankrig) (75/271/EØF) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR — under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økono- miske Fællesskab, under henvisning til Rådets direktiv 75/268/EØFaf 28. april 1975 om landbrug i bjergområder og i visse ugunstigt stillede områder (1), særlig artikel 2, stk. 2, under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg (2), og ud fra følgende betragtninger: Republikken Frankrigs regering har i henhold til artikel 2, stk. 1, i direktiv 75/268/EØFgivet Kommissionen meddelelse om de områder, der i henhold til artikel 3, stk. 3, i dette direktiv egner sig til optagelse på fællesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsområder, samt oplysninger om disse områders særlige kendetegn; oplysningerne om de områder, der er beliggende i oversøiske departementer, er ikke tilstrækkeligt fuldstændige til, at Kommissionen for øjeblikket kan fremsætte nogen udtalelse herom; som kendetegn for meget vanskelige klimatiske forhold i henhold til artikel 3, stk. -

11 Décembre 2018 – Comte-Rendu
Département de la Lozère Communauté de communes Mont-Lozère Séance du vendredi 11 décembre 2018 Date convocation : 6 décembre 2018 Membres en exercice : 37 Date publication : 6 décembre 2018 Membres présents : 28 Suffrages exprimés : 31 Effectif légal du conseil communautaire : 37 Nombre de conseillers en exercice : 37 L’an deux mille dix-huit, le onze décembre à seize heures, conformément à l'article L5211-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), s’est réuni le conseil communautaire de la communauté de communes Mont-Lozère à son siège le Bleymard, commune Mont-Lozère et Goulet, sous la présidence de Monsieur Jean de LESCURE. Présents Absents Absents ayant Communes (21) nom prénom donné pouvoir à ALLENC ANDRE Jean-Bernard x ALTIER BALME Jean-Louis x LA BASTIDE PUYLAURENT TEISSIER Michel x DeLESCURE Jean BRENOUX BONNET Pierrette x AGUILHON Patrick BRENOUX AGUILHON Patrick x CHADENET SALANSON André (suppléant x CUBIÈRES MASSADOR Stéphan x CUBIERETTES BENOIT Christian x LANUEJOLS BRUGERON Christian x LANUEJOLS BRUEL Gilbert x LAUBERT DEBIEN Gilbert x MALONS ET ELZE DUMAS Philippe (suppléant) x MONTBEL MEYNIEL Sylvain x MONT LOZERE ET GOULET BEAURY Pascal X MONT LOZERE ET GOULET CUBIZOLLE Jeannine X MONT LOZERE ET GOULET CASTAN Francis X MONT LOZERE ET GOULET MOURET Evelyne x MONT LOZERE ET GOULET BOISSET Jean-Marie x MONT LOZERE ET GOULET DIET Anabelle x MONT LOZERE ET GOULET VEYRUNES Alain x PIED DE BORNE MASMEJEAN Christian x PONTEILS ET BRESIS DE LA RUE DU CAN Pierre x PONTEILS ET BRESISX MARTELLI Jean-Louis x POURCHARESSES -

Bulletin Municipal 2006
BULLETIN D’INFORMATION DE JANVIER LA MUNICIPALITE DE PALHERS 2006 Le Maire, le conseil municipal et la secrétaire de mairie vous présentent leurs meilleurs voeux pour l’année 2006 TRAVAUX REALISES EN 2005 OU EN COURS DE REALISATION AMENAGEMENT DU NOUVEAU CIMETIERE TRAVAUX DE VOIRIE FINANCES PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GEVAUDAN Pose d’un CAVEAU COMMUNAL et d’un COLUMBARIUM par l’entreprise BATIFOL Attendus depuis très longtemps, ces travaux ont pu être réalisés au mois de Pose d’un nouveau portail d’entrée et grilles en fer forgé par l’entreprise septembre dernier, dans de bonnes conditions. Bousquet de Marvejols VOIRIE DE RAZ Réfection des allées en goudron et grave calcaire par l’entreprise SOMATRA Nettoyage et débroussaillage du talus par l’entreprise HERMABESSIERE Curage de fossés, reprises d’aqueducs, enrochement, reprofilage de la plateforme, goudronnage de la COUT DE L’OPERATION : 18 990 € chaussée en bi-couche traditionnel. SUBVENTION CONSEIL GENERAL : 8 900 € Nous remercions les propriétaires qui ont acceptés de céder un peu de terrain, pour améliorer la sécurité en déplaçant l’entrée du chemin. TRAVAUX D’ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX Travaux réalisés par la SOMATRA pour un montant de 22 599 €. - acquisition de rayonnages pour la salle d’archive à la Mairie : 345 € VOIRIE DES FOURCHES - remplacement par l’entreprise Bodet du battant de la cloche qui était inadapté à l’automatisme de la sonnerie : 1116 € Curage des fossés, reprofilage de la plateforme, goudronnage de la chaussée - installation des bouteilles de gaz propane à l’extérieur de la salle des fêtes en bi-couche traditionnel. -

Inondation Page 10 Atlas Page 13
FEVRIER 2008 ---------- PREFECTURE DE LA LOZERE – Service interministériel de défense et de protection civile Sommaire Page 2 Préface Page 3 Préambule Page 4 Risque majeur et information préventive Page 5 Consignes générales de sécurité destinées aux habitants d'une zone à risque Page 7 Les risques naturels Page 8 Bilan général en France Page 9 - inondation Page 10 atlas Page 13 - mouvement de terrain Page 14 atlas Page 17 - feux de forêt Page 18 atlas Page 22 Les risques technologiques Page 23 Généralités Page 24 - industriel Page 25 atlas Page 28 - transport de matière dangereuse (TMD) Page 29 atlas Page 33 - rupture de barrage Page 34 atlas Page 37 Carte des communes à risque du département Page 38 Cartes des populations Page 39 - population sédentaire Page 39 - densité Page 40 2 L'information préventive consiste à renseigner le citoyen sur les risques majeurs, naturels et technologiques prévisibles, susceptibles de se développer sur ses lieux de vie, de travail et de vacances. Ainsi, l’article L. 125-2 du code de l’environnement prévoit-il que " les citoyens ont le droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles". En Lozère, un premier dossier départemental des risques majeurs (DDRM) a été élaboré et approuvé en 1995. La version d’octobre 2004 avait pris en compte les nouvelles connaissances en matière de risques majeurs sur le département. L’édition 2008, consultable dans chaque mairie du département, recense 111 communes comprenant au moins un risque prioritaire et 74 autres communes soumises à risque.