Recherches Régionales, 2001, 159, Pp
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
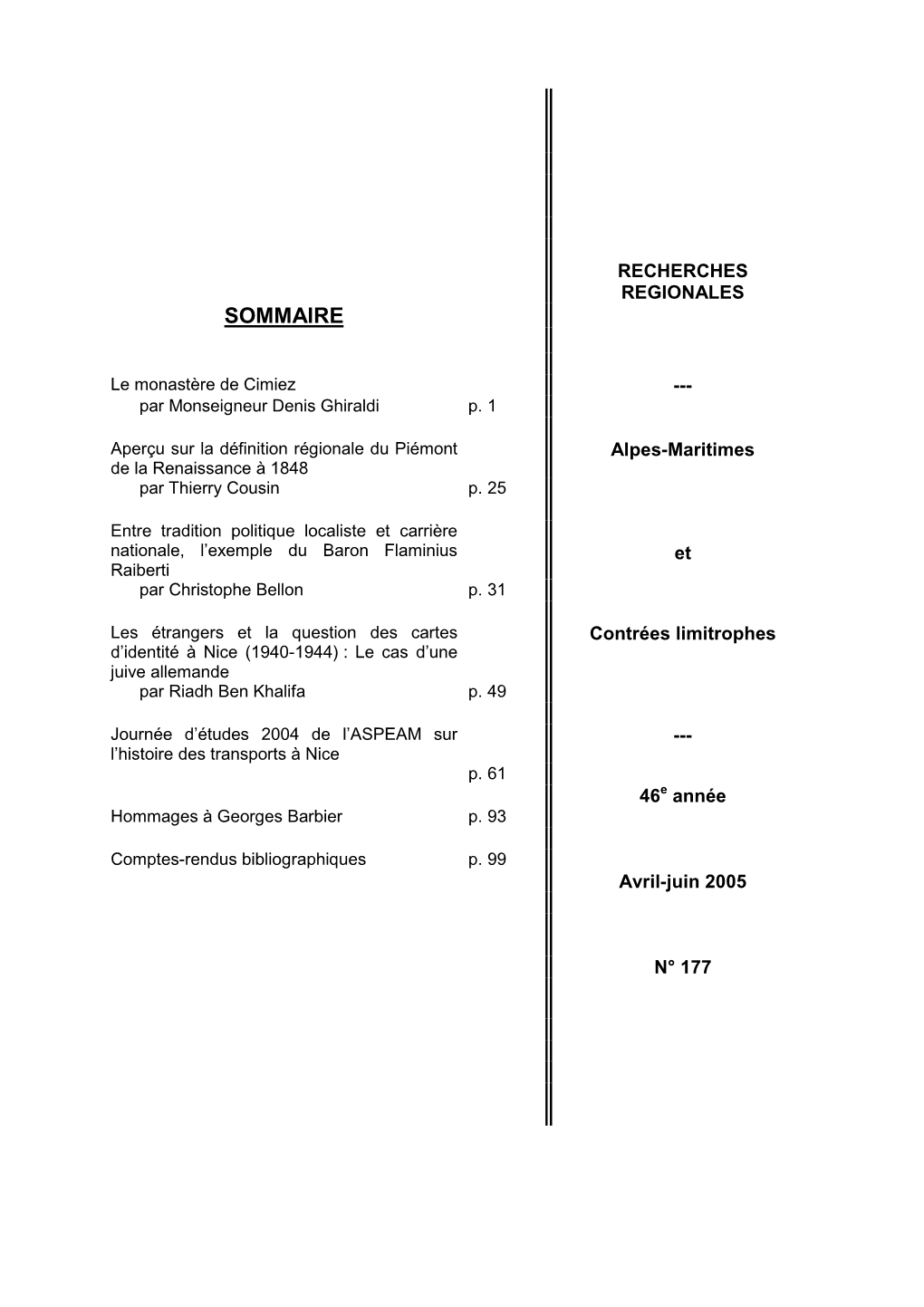
Load more
Recommended publications
-

Nombre Et Situation Des Emplacements D'affichage Mis À Disposition Dans Les Communes Des Alpes-Maritimes - Année 2020
Nombre et situation des emplacements d'affichage mis à disposition dans les communes des Alpes-Maritimes - année 2020 numéro des total Commune bureaux Adresse et localisation précises de l'emplacement nombre commune de vote AIGLUN Emplacement situé à côté du bureau de vote 1 1 1 9 place de la Mairie, sous la voûte de l'Auberge, sur la D10 AMIRAT Emplacement situé à côté du bureau de vote 1 1 1 Hôtel de Ville, 21 rue de la mairie ANDON Emplacements situés à côté des bureaux de vote 2 2 1 Mairie d'Andon, place Victorin Bonhomme, le long du mur de l'église en face de la mairie 2 Mairie annexe de Thorenc, 1 avevue du Belvédère, devant le balcon de la mairie annexe et/ou, en cas de besoin complémentaire, sur la barrière le long du boulevard Esmonet ANTIBES Emplacements situés à côté des bureaux de vote 4 29 ANTIBES 1 101 École du Pont Dulys - 114 chemin des Liserons 06160 ANTIBES, entrée de l'école 102-103-104 Collège Sidney Béchet A, B et C, 101 avenue des Amphores 06160 ANTIBES 1 emplacement à l'entrée du collège, avenue des Amphores. 105-106-107 Groupe scolaire Saint-Maymes A, B et C, 732 chemin des Eucalyptus 06160 ANTIBES 1 emplacement situé chemin des Eucalyptus, au niveau de l'abris-bus 108-109-110 École de la Tournière A, B et C, 1157 chemin de Rabiac Estagnol 06600 ANTIBES 1 emplacement au niveau du rond-point Tournière-Estagnol ANTIBES Emplacements situés à côté des bureaux de vote 13 ANTIBES 2 201 Mairie - cours Masséna 06600 ANTIBES, en façade de la mairie 202 Collège Fersen - 11 rue de Fersen 06600 ANTIBES, en façade 203-204-205 École Paul Arène A, B et C, 6 avenue Paul Arène 06600 ANTIBES, mur de clôture de l'école 206-207 Lycée Audiberti A et B - 39 avenue Gaston Bourgeois 06160 ANTIBES 1 emplacement contre la clôture du portail 208-209 École du Ponteil A et B - 9/11 avenue Henri Doniol 06600 ANTIBES 1 emplacement sur la clôture du portail de la cour de récréation. -

Politique, Littéraire Et Artistique .P1 Chos Et Nouvelles
QUARANTE-SIXIÈME ANNIE — N° 2370 %remis : Place de la Visitation Mardi 8 Décembre 1903 JOURNAL II E MONACO JOURNAL HEBDOMADAIRE Politique, Littéraire et Artistique PARAISSANT LE MARDI ABONNEMENTS: RÉDACTION ET ADMINISTRATION INSERTIONS : MONACO — FRANCE — ALGÉRIE- — TUNISIE Place de la Visitation Réclames, SO cent. la ligne ; Annonces , 15 cent. Un an , fr. ; Six mois, 6 fr. ; Trois mois, fr. te 3 Tous les ouvrages français et étrangers dont il est envoyé Pour les autres insertions, on traite de gré à gré. Pour l'ÉTRANGER, les frais de poste en sus deux exemplaires sont insérés dans le journal. Les Abonnements parlent des ler et 16 de chaque mois Les manuscrits non insérés seront rendus. S'adresser au Gérant, Place de la Visitation. PARTIE NON OFFICIELLE repartis, vers cinq heures, en automobile par la Nice, régates régionales : ier mai. route de Beaulieu et Villefranche, emportant le Monaco, régates régionales : 15 mai. meilleur souvenir de cette ravissante excursion. Naples, match Naples-Nice : 5 juin. .P1 chos et Nouvelles Marseille, régates régionales : 15 juin. En un grand déjeuner offert en leur magnifique Menton, régates régionales : 3 juillet. DE LA PRLVCIPA U Te villa La Poulido, = déjeuner auquel avaient été Nice, championnat Méditerranée : 17 juillet. invités M. le comte de Maleville, secrétaire général Thorrenc, courses régionales : 15 août. L'Institut International de la Paix a tenu une du Gouvernement ; M. André, consul de France, Le prochain Congrès se tiendra à Nice au séance, samedi dernier, sous la présidence de et M. le chanoine Mercier — M. Paul Gillibert, C. N. N. M. l'abbé Pichot, vice-président, séance à laquelle président du Comité de bienfaisance de la Colonie On procède ensuite au renouvellement du assistaient MM. -

Recherches Régionales N°
SOMMAIRE RECHERCHES REGIONALES Images de La Ciotat dans Les Compagnons de l’Ergador de Gabriel Audisio par Roger Klotz P 2 ALPES-MARITIMES Les idées politiques d’Eugène-Melchior de Voguë dans Les morts qui parlent Par Roger Klotz P 8 et Les cabarets parisiens de la Belle-Epoque dans les souvenirs de Francis Carco par Roger Klotz P 15 Contrées limitrophes Aspects de la Côte méditerranéenne chez Paul Bourger par Roger Klotz P 22 L’Ecole nationale d’art décoratif de Nice pendant l’Entre-deux-guerres 53e année Par le Doctorant Slim Jemai P 26 Recherches démographiques sur une population montagnarde pendant la Troisième République : Guillaumes 1870- 1936 par Christian Graille P 47 Janvier-juin 2012 « Nice, capitale d’hiver » : Robert de Souza, poète, érudit et urbaniste précurseur Par Suzanne Cervera P 66 L’enjeu politique du manuel scolaire dans la deuxième moitié du XIXe siècle Par Francesca Celi P 78 N° 201 L’invention du Sud Par Thierry Couzin P 85 ISSN 2105-2891 Historique de Sociétés de parfumerie de Grasse 1800-1939 Par Gabriel Benalloul P 91 Comptes-rendus bibliographiques P 121 IMAGES DE LA CIOTAT DANS LES COMPAGNONS DE L'ERGADOR DE Gabriel AUDISIO Roger KLOTZ 2 Gabriel Audisio est un écrivain né à Marseille le 27 juillet 1900 et mort à Issy-les- Moulineaux le 26 janvier 1978. Bien qu'il ait longtemps séjourné à Alger, ce chantre de la Méditerranée avait d'importantes attaches marseillaises. On sait ainsi qu'il était un ami de Louis Brauquier et qu'il a collaboré aux Cahiers du Sud de Jean Ballard. -

TRAIN DES MERVEILLES Limone
Torino Cuneo TRAIN DES MERVEILLES Limone L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE Fort Central De Nice à Tende, le train touristique des Merveilles Fort Pernante parcourt de somptueux paysages du littoral Fort Pépin méditerranéen au parc national du Mercantour. Fort de la Tunnel du Marguerie Ce train confortable et climatisé dessert les villages © Mairie de Saorge Col de Tende © département des Alpes-Maritimes des vallées du Paillon et de la Roya-Bévéra, MONASTÈRE DE SAORGE Gravures MUSÉE DES MERVEILLES découvrant des panoramas uniques sur l’arrière-pays. rupestres Viévola Fort Tabourde Le tracé du Train des Merveilles est reconnu comme Surplombant le village de Saorge, cet ensemble monastique Viaduc Ce lieu permet de découvrir l’histoire naturelle, l’archéologie, l’un des plus étonnants paysages ferroviaires du XVIIe siècle, a conservé un patrimoine paysager, architectural de la Chapelle 6 les arts et traditions populaires et surtout les gravures rupestres et mobilier exceptionnel. Tunnels de Musée des Merveilles de la région du mont Bego. Doté d’une muséographie d’Europe. L’été, un guide conférencier commente Rio-Freddo Mont Sainte-Marie résolument moderne et de technologie audiovisuelle et Morga votre itinéraire et raconte ce patrimoine naturel et Ouvert en saison touristique de 10 h à 12 h30 et de 14 h30 à 18 h30 2739 m Tende et multimédia de premier ordre, il présente à travers des cartes, (17 h en octobre). Tarif : 5,50 €, gratuit pour les moins Circuit des Trois villages des diaporamas, des moulages de roches gravées et des objets historique en tout point exceptionnel. Tunnel de Tende de 18 ans. -

Nombre Et Situation Des Emplacements D'affichage Mis À Disposition Dans Les Communes Des Alpes-Maritimes - Année 2021
Nombre et situation des emplacements d'affichage mis à disposition dans les communes des Alpes-Maritimes - année 2021 numéro des n° de total Canton Commune bureaux Adresse et localisation précises de l'emplacement nombre canton commune de vote 26 Vence AIGLUN Emplacement situé à côté du bureau de vote 1 1 1 9 place de la Mairie, sous la voûte de l'Auberge, sur la D10 11 Grasse 1 AMIRAT Emplacement situé à côté du bureau de vote 1 1 1 Hôtel de Ville, 21 rue de la mairie 11 Grasse 1 ANDON Emplacements situés à côté des bureaux de vote 2 2 1 Mairie d'Andon, place Victorin Bonhomme, le long du mur de l'église en face de la mairie 2 Mairie annexe de Thorenc, 1 avevue du Belvédère, devant le balcon de la mairie annexe et/ou, en cas de besoin complémentaire, sur la barrière le long du boulevard Esmonet 01 Antibes 1 ANTIBES Emplacements situés à côté des bureaux de vote 4 29 101 École du Pont Dulys - 114 chemin des Liserons 06160 ANTIBES, entrée de l'école 102-103-104 Collège Sidney Béchet A, B et C, 101 avenue des Amphores 06160 ANTIBES 1 emplacement à l'entrée du collège, avenue des Amphores. 105-106-107 Groupe scolaire Saint-Maymes A, B et C, 732 chemin des Eucalyptus 06160 ANTIBES 1 emplacement situé chemin des Eucalyptus, au niveau de l'abris-bus 108-109-110 École de la Tournière A, B et C, 1157 chemin de Rabiac Estagnol 06600 ANTIBES 1 emplacement au niveau du rond-point Tournière-Estagnol 02 Antibes 2 ANTIBES Emplacements situés à côté des bureaux de vote 13 201 Mairie - cours Masséna 06600 ANTIBES, en façade de la mairie 202 Collège Fersen - 11 rue de Fersen 06600 ANTIBES, en façade 203-204-205 École Paul Arène A, B et C, 6 avenue Paul Arène 06600 ANTIBES, mur de clôture de l'école 206-207 Lycée Audiberti A et B - 39 avenue Gaston Bourgeois 06160 ANTIBES 1 emplacement contre la clôture du portail 208-209 École du Ponteil A et B - 9/11 avenue Henri Doniol 06600 ANTIBES 1 emplacement sur la clôture du portail de la cour de récréation. -

TRAIN DES MERVEILLES Limone
TRAIN DES Torino Cuneo MERVEILLES TRAIN DES MERVEILLES Limone De Nice à Tende Fort Central Fort Pernante Fort Pépin Fort de la Tunnel du Marguerie Reconnu pour la beauté © Mairie de Saorge Col de Tende © département des Alpes-Maritimes MONASTÈRE DE SAORGE Gravures MUSÉE DES MERVEILLES sauvage de ses paysages, rupestres Viévola Fort Tabourde Surplombant le village de Saorge, cet ensemble monastique Viaduc Ce lieu permet de découvrir l’histoire naturelle, l’archéologie, le Train des Merveilles du XVIIe siècle, a conservé un patrimoine paysager, architectural de la Chapelle 6 les arts et traditions populaires et surtout les gravures rupestres et mobilier exceptionnel. Tunnels de Musée des Merveilles de la région du mont Bego. Doté d’une muséographie Rio-Freddo Mont Sainte-Marie résolument moderne et de technologie audiovisuelle est aussi remarquable et Morga Ouvert en saison touristique de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 2739 m Tende et multimédia de premier ordre, il présente à travers des cartes, (17 h en octobre). Tarif : 5,50 €, gratuit pour les moins Circuit des Trois villages des diaporamas, des moulages de roches gravées et des objets Tunnel de Tende par le génie qui a présidé de 18 ans. Visite libre ou commentée. (3h30) Notre-Dame originaux la richesse de ce patrimoine unique en Europe. Tunnel hélicoïdal 2 h saorge.monuments-nationaux.fr, 04 93 04 55 55 Mont Bego des Fontaines 2873 m Saint-Dalmas - La Brigue Ouvert du 16 juin au 15 septembre de 10h à 18h et du 4 1 h 30 5 à sa construction. -

Nombre Et Situation Des Emplacements D'affichage Mis À Disposition Dans Les Communes Des Alpes-Maritimes (Année 2017) 1
Nombre et situation des emplacements d'affichage mis à disposition dans les communes des Alpes-Maritimes (année 2017) 1 numéro des total Commune bureaux Adresse et localisation précises de l'emplacement nombre commune de vote NICE Emplacements situés à côté des bureaux de vote 39 1ere CIRCONSCRIPTION 101 - 102 Palais Masséna - 65 rue de France - contre grilles à droite de l'entrée 103 104 - 105 Ecole Ronchèse maternelle - rue Spitalieri - contre barrières 106 - 107 108 - 109 Ecole Auber mixte et maternelle - 35 avenue Auber - contre barrières 110 - 111 112 - 113 114 - 115 116 - 117 Ecole des Baumettes mixte et maternelle - 24 rue Dante - contre barrières sur trottoir 118 - 119 120 112 - 113 114 - 115 116 - 117 Ecole des Baumettes mixte et maternelle - 23 rue Dante - contre barrières sur trottoir 118 - 119 120 Lycée Honoré d'Estienne d'Orves - Rive gauche - 38 avenue d'Estienne d'Orves - contre les grilles 121 face au lycée 123 Ecole Saint Pierre d'Arène mixte - 26 rue Louis de Coppet - contre grilles du collège Daudet 402 C.C.A.S Gambetta - 141 boulevard Gambetta - contre façade 403 - 404 Lycée du Parc Impérial - avenue Paul Arène - à droite de l'entrée 407 501 - 502 Collège Vernier - 31 rue Vernier - contres barrières 601 - 602 Lycée Masséna - 2 avenue Félix Faure - sur mur contre grilles à gauche de l'entrée du Lycée 603 604 - 605 Ecole Rothschild maternelle - 8 rue Pierre Devoluy - contre barrières face hôpital 606 607 Ecole Dubouchage - 3 boulevard Dubouchage - contre barrières 608 - 609 Lycée Calmette - passage Meynell - contre parc -

Nombre Et Situation Des Emplacements D'affichage Mis À Disposition Dans Les Communes Des Alpes-Maritimes (Année 2019) 1
Nombre et situation des emplacements d'affichage mis à disposition dans les communes des Alpes-Maritimes (année 2019) 1 numéro des total Commune bureaux Adresse et localisation précises de l'emplacement nombre commune de vote AIGLUN Emplacement situé à côté du bureau de vote 1 1 1 Départementale 10, sous la voûte de l'auberge à côté de la boite à lettre de La Poste AMIRAT Emplacement situé à côté du bureau de vote 1 1 1 21 rue de la mairie, sur le mur en face de la mairie ANDON Emplacements situés à côté des bureaux de vote 2 2 1 Mairie d'Andon, place Victorin Bonhomme à gauche de l'entrée de la salle des fête 2 Mairie annexe de Thorenc, 1 avevue du Belvédère, devant la salle de la mairie annexe ANTIBES Emplacements situés à côté des bureaux de vote 4 29 ANTIBES 1 101 École du Pont Dulys - 114 chemin des Liserons 06160 ANTIBES 1 emplacement sur le mur de clôture de l'école. 102-103-104 Collège Sidney Béchet A, B et C- 101 avenue des Amphores 06160 ANTIBES 1 emplacement à l'entrée du collège, avenue des Amphores. 105-106-107 Groupe scolaire Saint-Maymes A, B et C - 732 chemin des Eucalyptus 06160 ANTIBES 1 emplacement situé chemin des Eucalyptus (au niveau de l'abris-bus). 108-109-110 École de la Tournière A, B et C - 1157 chemin de Rabiac Estagnol 06600 ANTIBES 1 emplacement au niveau du rond-point Tournière-Estagnol ANTIBES Emplacements situés à côté des bureaux de vote 13 ANTIBES 2 201 Mairie - cours Masséna 06600 ANTIBES 1 emplacement en façade de la Mairie. -

Politique, Littéraire Et Artistique PA.TIE OFFICIELLE Echos Et
QUARANTE-NI UVIÈME ANNÉE — N° 2498 Bureaux : Place de la Visitation Mardi 22 Mai 1906 JOURNAL DE MONACO JOURNAL HEBDOMADAIRE Politique, Littéraire et Artistique PARAISSANT LE MARDI ABONNEMENTS : RÉDACTION ET ADMINISTRATION INSERTIONS : MONACO — FRANCE — ALGÉRIE — TUNISIE Place de la Visitation Réclames, 50 cent. la ligne ; Annonces ,. 25 cent. Un an, Mt fr.; Six mois, 6 fr.; Trois mois, 3 fr. Il est rendu compte de tous les ouvrages français et étrangers Pour les autres insertions, on traite de gré à gré. Pour l'ÉTRANGER, les frais de poste en sus dont il est envoyé deux exemplaires au journal. Les Abonnements parlent des 1er et 16 de chaque mois Les manuscrits non insérés seront rendus. S'adresser au Gérant, Place de la Visitation. PA.TIE OFFICIELLE Paris, est reconnu comme établisement d'utilité pu- billets de banque. Ce porte-carte a été remis à sa blique. propriétaire qui a spontanément donné 500 fr. ART. 2. — Sont approuvés les statuts de ladite Fon- Par Ordonnance du 17 mai 1906, M. Emile de récompense à l'honnête femme de chambre. dation, tels qu'ils sont annexés au présent décret. Ont été également déposés ces jours derniers Bernich, Conseiller privé de S. A. S. le Prince, ART. 3. — Le Ministre de l'Instriiction publique, des dans les Commissariats de police de la Princi- est autorisé à accepter et à porter la Croix de Beaux-Arts et des Cultes est chargé de l'exécution du pauté : une montre en métal avec chaîne, trouvée présent décret, qui sera inséré at Commandeur de la Couronne d'Italie, qui lui a i Bulletin des lois et par M. -

Cahiers De La Méditerranée, 74 | 2007 Les Parlementaires Maralpins Et La Séparation Des Églises Et De L’État 2
Cahiers de la Méditerranée 74 | 2007 Les crises dans l'histoire des Alpes-Maritimes Les parlementaires maralpins et la séparation des Églises et de l’État Christophe Bellon Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/cdlm/2763 DOI : 10.4000/cdlm.2763 ISSN : 1773-0201 Éditeur Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine Édition imprimée Date de publication : 15 juin 2007 Pagination : 209-236 ISSN : 0395-9317 Référence électronique Christophe Bellon, « Les parlementaires maralpins et la séparation des Églises et de l’État », Cahiers de la Méditerranée [En ligne], 74 | 2007, mis en ligne le 14 novembre 2007, consulté le 10 décembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/cdlm/2763 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdlm.2763 Ce document a été généré automatiquement le 10 décembre 2020. © Tous droits réservés Les parlementaires maralpins et la séparation des Églises et de l’État 1 Les parlementaires maralpins et la séparation des Églises et de l’État Christophe Bellon 1 La réforme de la séparation des Eglises et de l’Etat, « la plus grande qui ait été tentée dans notre pays depuis la Révolution française »1, fut une étape importante dans la constitution progressive de la laïcité à la française. Certains diront qu’elle représenta le point d’aboutissement de la politique de sécularisation entreprise par les constituants de 1789. D’autres soutiendront qu’elle conservait de nombreux caractères du régime des cultes la précédant et que l’esprit concordataire n’avait pas disparu complètement. A cet égard, la France serait passée d’un régime des cultes reconnus à un régime « des religions connues »2. -

Recherches Régionales
ENTRE TRADITION POLITIQUE LOCALISTE ET CARRIERE NATIONALE, L’EXEMPLE DU BARON FLAMINIUS RAIBERTI Christophe BELLON Dans le premier tiers du XXème siècle, et singulièrement avant 1914, la société politique française n’est pas encore homogène. Le régime républicain a certes entraîné un progrès démocratique incontestable, par l’accession des masses à la vie politique, mais cette modernité civique s’accomplit dans une France encore rurale et la pratique électorale est très inégale sur l’ensemble du territoire. Les grands notables du début du régime n’ont pas tous été remplacés par des républicains. En effet, force est de constater que l’évolution sociologique des notabilités a laissé, dans la France de la fin du XIXème siècle, des poches de résistance dans lesquelles la notabilité « verticale » (N. Roussellier), par ses propres facteurs (clientélisme, réseaux politiques), assurait encore de longues carrières. De plus en plus menacés, ces féodalismes ont eux aussi évolué, mais d’une manière endogène, se coulant dans le moule républicain, tout en développant de nouvelles formes de notabilités. A cet égard, le département des Alpes-Maritimes offre un champ d’analyse intéressant. D’abord, la présence et l’évolution des vieilles notabilités y sont incontestables, démonstratives et laissent place à un nouveau type de clientélisme. Ensuite, le département est très hétérogène, politiquement bicéphale : le Comté de Nice et l’arrondissement provençal de Grasse, séparés par le fleuve le Var. Enfin, on observe une identité politique très prononcée dans ce « pays » dont une partie – le Comté de Nice – a été rattachée récemment à la France (1860), identité accrue par un isolement de la vie politique nationale dû aux barrières naturelles. -

Recherches Régionales, 2001, 159, Pp
RECHERCHES REGIONALES SOMMAIRE Le monastère de Cimiez --- par Monseigneur Denis Ghiraldi p. 1 Aperçu sur la définition régionale du Piémont Alpes-Maritimes de la Renaissance à 1848 par Thierry Cousin p. 25 Entre tradition politique localiste et carrière nationale, l’exemple du Baron Flaminius et Raiberti par Christophe Bellon p. 31 Les étrangers et la question des cartes Contrées limitrophes d’identité à Nice (1940-1944) : Le cas d’une juive allemande par Riadh Ben Khalifa p. 49 Journée d’études 2004 de l’ASPEAM sur --- l’histoire des transports à Nice p. 61 46e année Hommages à Georges Barbier p. 93 Comptes-rendus bibliographiques p. 99 Avril-juin 2005 N° 177 LE MONASTÈRE DE CIMIEZ Monseigneur Denis GHIRALDI En 1543 après avoir fait le siège de Nice, les troupes de François Ier, roi de France, détruisirent le couvent des Frères Mineurs de l’Observance situé au quartier dit Croix de Marbre. Ainsi obligés de chercher un centre d’accueil nouveau, les Frères Mineurs s’installèrent dans une maison particulière située au bas de la vieille ville dans le quartier dit le Trinquot qui s’étendait jusqu’au cimetière de Sainte-Réparate. Trois ans plus tard, le 15 novembre 1546, ils quittèrent le Trinquot et gagnèrent Cimiez où les Bénédictins de Saint- Pons leur cédèrent l’antique chapelle qu’ils y possédaient, dédiée à Notre-Dame, avec les terrains adjacents, en échange de l’emplacement et des jardins de leur couvent de Sainte- Croix totalement détruit. ● La chapelle Notre-Dame de Cimiez La mention d’une chapelle dédiée à Notre-Dame sise à Cimiez est donnée pour la première fois dans une charte du monastère de Saint Pons datée du 30 décembre 10101.