Etat Initial De L'environnement 1/2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
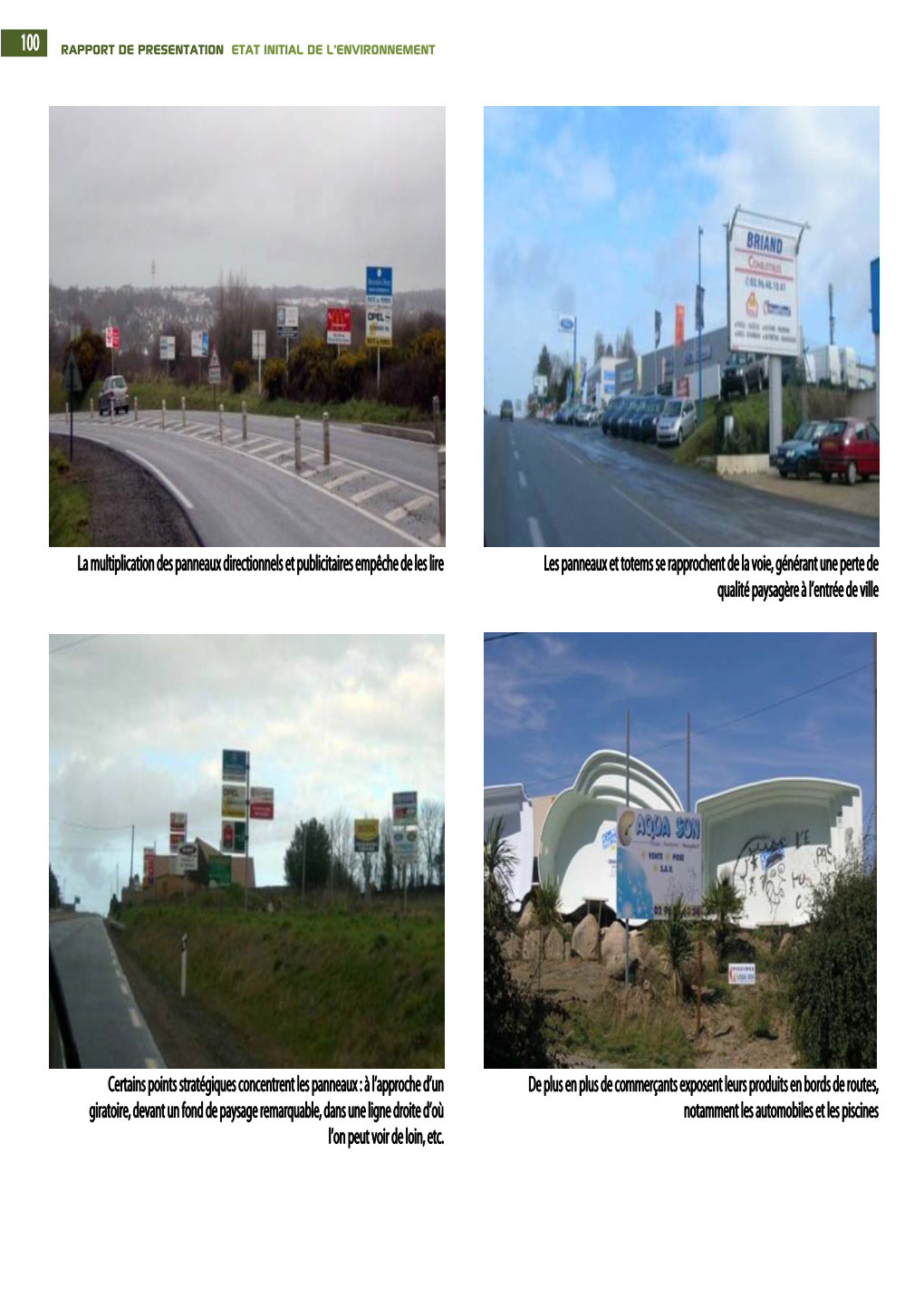
Load more
Recommended publications
-

Bavard'âge En Trégor Bavard'âge En
Maison du Département de Lannion Maison du Département de Lannion Bavard’âge Bavard’âge en Trégor en Trégor Devenir accompagnateur Devenir accompagnateur bénévole au domicile bénévole au domicile d’une personne âgée d’une personne âgée /solidarités /solidarités Accompagnateur bénévole Accompagnateur bénévole Être bénévole, c'est quoi ? Être bénévole, c'est quoi ? • C'est aller au domicile d'une personne âgée pour écouter, échanger, faire la • C'est aller au domicile d'une personne âgée pour écouter, échanger, faire la lecture, jouer à des jeux de société, jardiner... lecture, jouer à des jeux de société, jardiner... • C'est accompagner une personne âgée pour des sorties, promenades, visites • C'est accompagner une personne âgée pour des sorties, promenades, visites Comment fonctionne le réseau de bénévoles ? Comment fonctionne le réseau de bénévoles ? • L’accompagnateur bénévole est formé, accompagné et suivi par un profession- • L’accompagnateur bénévole est formé, accompagné et suivi par un profession- nel du Département nel du Département • Il apporte un peu de sa disponibilité gratuitement • Il apporte un peu de sa disponibilité gratuitement • Il s'engage avec une certaine régularité dans une relation d'accompagnement • Il s'engage avec une certaine régularité dans une relation d'accompagnement fondée sur le respect de la vie privée fondée sur le respect de la vie privée • La mise en relation entre le bénévole et la personne visitée est faite par un • La mise en relation entre le bénévole et la personne visitée est faite par un professionnel -

LES-GRÈVES Pleum
DÉCOUVREZ TOUS 7 NATURA LES SITES SUR 10 2000 PLOUMANAc’h Natura 2000 est un réseau européen de sites www.lannion-tregor.com naturels, terrestres et marins, identifiés pour la ent, Avec ses landes littorales et ses chaos LE MARAIS rubrique Environnem rareté et la fragilité des espèces sauvages, animales granitiques aux formes étranges, le DE GOUERMEL ou végétales, et de leurs habitats. N les espaces naturels site naturel de Ploumanac’h est un 9 concilie la préservation de la nat atura 2000 espace naturel emblématique. La Le marais de Gouermel revêt une humaines, dans une logique de développemenure et les activités Maison du littoral située face au grande valeur écologique. Aménagé durable. t phare de Mean Ruz constitue un LE MARAIS et exploité par l´homme depuis lieu d’accueil et de pédagogie qui plusieurs siècles, il est à la frontière Une grande partie du littoral (espaces marins mérite le détour. DE TRESTEL de la terre et de la mer : ici deux compris), le Léguer et l’étang du Moulin n partie du réseau Natura 2000. À deux pas de la plage de Trestel, mondes se rencontrent. Aujourd’hui euf font un sentier aménagé (avec boucle des vaches rustiques de race Highland cattle sont élevées dans le DES ÎLES, DES FORÊTS, Perros-Guirec PMR) permet de découvrir 32 ha de roselières, prairies et boisements. marais. des landes, des rivières… Peut-être découvrirez-vous l’Agrion de Mercure, petite libellule protégée en Europe, qui fréquente le ruisseau ? 8 Plougrescant LES RÉSERVES Diduamantoù en Trévou-Tréguignec NATURELLES takadoù natur e 11 L’ARCHIPEL Les réserves naturelles nationales sont des territoires d’excellence pour la préservation de LE GOUFFRE diversité biologique et géologique. -

LES-GRÈVES Pleum
DÉCOUVREZ TOUS 7 NATURA LES SITES SUR 10 2000 PLOUMANAc’h Natura 2000 est un réseau européen de sites www.lannion-tregor.com naturels, terrestres et marins, identifiés pour la ent, Avec ses landes littorales et ses chaos LE MARAIS rubrique Environnem rareté et la fragilité des espèces sauvages, animales granitiques aux formes étranges, le DE GOUERMEL ou végétales, et de leurs habitats. N les espaces naturels site naturel de Ploumanac’h est un 9 concilie la préservation de la nat atura 2000 espace naturel emblématique. La Le marais de Gouermel revêt une humaines, dans une logique de développemenure et les activités Maison du littoral située face au grande valeur écologique. Aménagé durable. t phare de Mean Ruz constitue un LE MARAIS et exploité par l´homme depuis lieu d’accueil et de pédagogie qui plusieurs siècles, il est à la frontière Une grande partie du littoral (espaces marins mérite le détour. DE TRESTEL de la terre et de la mer : ici deux compris), le Léguer et l’étang du Moulin n partie du réseau Natura 2000. À deux pas de la plage de Trestel, mondes se rencontrent. Aujourd’hui euf font un sentier aménagé (avec boucle des vaches rustiques de race Highland cattle sont élevées dans le DES ÎLES, DES FORÊTS, Perros-Guirec PMR) permet de découvrir 32 ha de roselières, prairies et boisements. marais. des landes, des rivières… Peut-être découvrirez-vous l’Agrion de Mercure, petite libellule protégée en Europe, qui fréquente le ruisseau ? 8 Plougrescant LES RÉSERVES Diduamantoù en Trévou-Tréguignec NATURELLES takadoù natur e 11 L’ARCHIPEL Les réserves naturelles nationales sont des territoires d’excellence pour la préservation de LE GOUFFRE diversité biologique et géologique. -

Secteur De Recrutement Collèges Et Lycées Par Commune
DIRECTION ACADÉMIQUE DES CÔTES D'ARMOR DIVEL * Modifications RS 2020 SECTEURS DE RECRUTEMENTS DES LYCÉES ET COLLÈGES CORRESPONDANTS PAR COMMUNES COMMUNES COLLÈGE DE RATTACHEMENT LYCÉE DE RATTACHEMENT ALLINEUC PLOEUC - L'HERMITAGE Lycée Rabelais - Saint-Brieuc ANDEL LAMBALLE Lycée H. Avril - Lamballe AUCALEUC DINAN - François Broussais Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BEAUSSAIS-SUR-MER (Ploubalay - Trégon - Plessix Balisson) PLANCOET Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BEGARD BEGARD Lycée A. Pavie - Guingamp BELLE-ISLE-EN-TERRE BELLE-ISLE-EN-TERRE Lycée A. Pavie - Guingamp BERHET BEGARD Lycée A. Pavie - Guingamp BINIC - ETABLES-SUR-MER (Binic-Etables sur Mer) ST-QUAY-PORTRIEUX Lycée Freyssinet - Saint-Brieuc BOBITAL DINAN - François Broussais Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BODEO (LE) (Pas d'école) QUINTIN Lycée Rabelais - Saint-Brieuc BON REPOS SUR BLAVET (LANISCAT) ST NICOLAS DU PELEM Lycée A. Pavie - Guingamp BON REPOS SUR BLAVET (PERRET) ROSTRENEN Lycée Sérurier de Carhaix (29) BON REPOS SUR BLAVET (ST GELVEN) GUERLEDAN (Mûr de Bretagne) Lycée F. Bienvenue - Loudéac BOQUEHO PLOUAGAT Lycée Freyssinet - Saint-Brieuc BOUILLIE (LA) ERQUY Lycée H. Avril - Lamballe BOURBRIAC BOURBRIAC Lycée A. Pavie - Guingamp BOURSEUL PLANCOET Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BREHAND MONCONTOUR Lycée H. Avril - Lamballe BREHAT PAIMPOL Lycée Kerraoul - Paimpol BRELIDY PONTRIEUX Lycée A. Pavie - Guingamp BRINGOLO PLOUAGAT Lycée A. Pavie - Guingamp BROONS BROONS Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BRUSVILY DINAN - François Broussais Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BULAT-PESTIVIEN CALLAC Lycée A. Pavie - Guingamp CALANHEL CALLAC Lycée A. Pavie - Guingamp CALLAC CALLAC Lycée A. Pavie - Guingamp CALORGUEN DINAN - Roger Vercel Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan CAMBOUT (LE) PLEMET Lycée F. -

Compte Rendu Du Conseil Municipal De Tonquédec Séance Du 11 Septembre 2014
Compte Rendu du Conseil Municipal de Tonquédec Séance du 11 septembre 2014 L’an deux mil quatorze, le 11 septembre à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune de TONQUEDEC dûment convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude LE BUZULIER, Maire. Présents : Le Maire : M. Jean-Claude LE BUZULIER, les Adjoints : M. René AUFFRET, Mme Joëlle NICOLAS, M. Patrick LE BONNIEC, Mme Marie-Yvonne LE MOAL et les Conseillers Municipaux : Mme Marianne RICHARD, M. Christophe MORELLEC, Mme Julie DENMAT, Mme Magali MARY, Mme Maryline ROUCOULET, M. Louis LE RUE, M. Tangi RUBIN, M. Jack LE BRIS, Mme Florence STRUILLOU, M. Joël PHILIPPE. Secrétaire de séance : Mme Marianne RICHARD Date de la convocation : le 3 septembre 2014 Date d’affichage : le 15 septembre 2014 **************************************** Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sans observation, approuve le procès-verbal de la séance précédente. ***************************************** Délibération n°20140911-01 : Avis sur l’Arrêté du Préfet des Côtes d’Armor en date du 26 juin 2014 portant fixation du périmètre de fusion entre la Communauté de Communes du Centre Trégor et Lannion Trégor Communauté Monsieur le Maire expose aux Conseillers Municipaux les modalités concernant l’arrêté de Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor en date du 26 juin 2014. Vu la Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités Territoriales ; Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son -

Transport À La Demande Service De Transport À La Demande
Transport à ec ma planète ! À quel moment faut-il J'ai un ticket av la demande remettre son ticket ? la ville plus facile CAVAN • À l’issue de votre trajet, vous devez remettre votre titre de Ligne A Ligne B Ligne C Ligne 30 À partir du 4 janvier 2O16 nombre de kilomètres et le trajet parcourus. Vous devrez en A B C 3O retour signer ce ticket attestant de l’exactitude des données (tout ticket signé avant le trajet sera refusé). Agglo’Taxi Agglo’Mobi l’ensemble des titres de transport à Lannion-Trégor Communauté. • Si vous n’êtes pas en mesure de présenter un ticket en vous sera facturé. Navette Express Ligne des plages Ligne du marché Les principes à respecter Ce service ne peut pas être utilisé : • pour des déplacements scolaires, • pour des déplacements pris en charge par la sécurité sociale, • par les enfants de moins de 14 ans non accompagnés par une personne majeure. ies - 02 96 68 43 g é t a r t S Abonnez-vous aux ibles & alertes SMS des C transports et tenez-vous informé en temps réel ! 1 rue Monge - CS 10761 22307 Lannion Cedex Tél. : 02 96 05 55 55 - Fax : 02 96 05 09 01 www.lannion-tregor.com [email protected] J'ai un ticket avec ma planète ! Les transports sont assurés du lundi au vendredi de 9h à 16h3O Transport (sauf jours fériés) € à la demande CAVAN Pour faciliter vos déplacements et répondre à vos besoins, Lannion- Les tarifs Trégor Communauté vous propose un Où le transport à la demande service de transport à la demande. -

La Sectorisation Des Transports Scolaires 2020-2021 En Côtes D'armor COLLÈGES LYCÉES
La sectorisation des transports scolaires 2020-2021 en Côtes d'Armor COLLÈGES LYCÉES COMMUNES NOUVELLES COMMUNES SECTEUR PUBLIC SECTEUR PRIVÉ SECTEUR PUBLIC SECTEUR PRIVÉ ALLINEUC PLOEUC-SUR-LIE PLOEUC-SUR-LIE SAINT-BRIEUC QUINTIN ANDEL LAMBALLE LAMBALLE LAMBALLE LAMBALLE AUCALEUC DINAN DINAN DINAN DINAN BEGARD BEGARD GUINGAMP GUINGAMP GUINGAMP BELLE-ISLE-EN-TERRE BELLE-ISLE-EN-TERRE GUINGAMP GUINGAMP GUINGAMP BERHET BEGARD TREGUIER GUINGAMP GUINGAMP BINIC - ETABLES BINIC ST-QUAY-PORTRIEUX ST-QUAY-PORTRIEUX SAINT-BRIEUC SAINT-BRIEUC BOBITAL DINAN DINAN DINAN DINAN BODEO (LE) QUINTIN QUINTIN SAINT-BRIEUC QUINTIN BOQUEHO PLOUAGAT QUINTIN SAINT-BRIEUC SAINT-BRIEUC BOUILLIE (LA) ERQUY PLENEUF VAL ANDRE LAMBALLE LAMBALLE BOURBRIAC BOURBRIAC GUINGAMP GUINGAMP GUINGAMP BOURSEUL PLANCOET CREHEN DINAN DINAN BREHAND MONCONTOUR LAMBALLE LAMBALLE LAMBALLE BREHAT PAIMPOL PAIMPOL PAIMPOL PAIMPOL BRELIDY PONTRIEUX PONTRIEUX GUINGAMP GUINGAMP BRINGOLO PLOUAGAT LANVOLLON GUINGAMP GUINGAMP BROONS BROONS BROONS DINAN DINAN BRUSVILY DINAN DINAN DINAN DINAN BULAT-PESTIVIEN CALLAC GUINGAMP GUINGAMP GUINGAMP CALANHEL CALLAC GUINGAMP GUINGAMP GUINGAMP CALLAC CALLAC GUINGAMP GUINGAMP GUINGAMP CALORGUEN DINAN DINAN DINAN DINAN CAMBOUT (LE) PLEMET PLEMET LOUDEAC LOUDEAC CAMLEZ TREGUIER TREGUIER TREGUIER LANNION CANIHUEL ST-NICOLAS-DU-PELEM ROSTRENEN GUINGAMP ROSTRENEN CAOUENNEC-LANVEZEAC LANNION LANNION LANNION LANNION CARNOET CALLAC GUINGAMP GUINGAMP GUINGAMP CAULNES BROONS BROONS DINAN DINAN CAUREL MUR-DE-BRETAGNE MUR-DE-BRETAGNE LOUDEAC LOUDEAC CAVAN BEGARD -

Préfecture Des Côtes-D'armor
Préfecture des Côtes-d'Armor Demandes d'autorisation d'exploiter parvenues à la direction départementale des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor entre le 11 et 24 août 2016. Références Date Date limite Propriétaire Commune Communes des cadastrales Superficie Commune d’enregistrement de dépôt des ou Demandeur Siège du N° dossier biens sollicités ou ateliers (ha) Propriétaire De la demande Demandes Mandataires Demandeur Hors sol repris complète Concurrentes BEGARD B 60 0,9477 M . Bernard ARZUL BRELIDY GAEC HENRY COATASCORN C22160069 23/08/16 23/10/16 BERHET A 40, 41, 755 et 756 1,4294 SARL DE KERVOEZEL MANTALLOT GAEC HENRY COATASCORN C22160070 23/08/16 23/10/16 BOURBRIAC XB 82 1,5 COATRIEUX Gilberte BOURBRIAC GAEC DE PEN AR LEGUER BOURBRIAC C22160055 17/08/16 17/10/16 A 44, 96 à 100, 105 à 107, 110 à 112, 114, 115, 235, 302, 303, 309, 321, 324 à 334, 385, 393 à 387, 402 à BRELIDY 407, 446, 450 à 454, 457 à 36,8739 M . Bernard ARZUL BRELIDY GAEC HENRY COATASCORN C22160069 23/08/16 23/10/16 461, 600, 811, 891, 995 et 1204, B 59, 60, 99, 102, 103, 126 à 128, 140, 152, 154, 593, 609, 926 et 928 BRELIDY A 119, 306, 308, 315 à 319 3,361 EARL LECH PARC BRELIDY GAEC HENRY COATASCORN C22160069 23/08/16 23/10/16 BRELIDY A 807 et B 616 1,6195 Mme Martine MERLIN LYON GAEC HENRY COATASCORN C22160069 23/08/16 23/10/16 BRELIDY B 209 et 210 0,6783 M. -

Kermaria- Sulard - Lannion - Ploubezre - Kerblat – Kerloas - Ploulec'h
CALENDRIER 2019 Composition du bureau pour la saison 2019 Président Gildas GORGE 02 96 48 45 59 Vice-président Hervé LE GUILLOU 02 96 15 99 06 Secrétaires André BOLLORE 02 96 46 38 23 Gérard PRIGENT 02 96 37 24 92 Trésoriers Alain KEROUANTON 02 96 37 96 40 Daniel LE MARECHAL 02 96 46 48 27 Membres Jean-Jacques ABGRALL 02 96 37 10 01 Daniel CARLUER 02 96 35 48 97 Notre but : Prendre du PLAISIR en pratiquant le vélo En toute SECURITE Dans un esprit de SOLIDARITE PLAISIR c-à-d : De prendre un grand bol d’air chaque dimanche (ou en semaine) en pratiquant notre sport favori : le vélo. De se retrouver après chaque sortie pour un moment d’échange et de détente. De se réunir à l’occasion des principaux évènements de la vie du club (galette des rois, Tour du Trégor, sortie familiale, …) De contribuer à l’animation de la commune en organi- sant ou en participant à des manifestations telles que vide-grenier ou autre …. SECURITE c-à-d : Faire contrôler au moins une fois l’an son aptitude à la pratique du vélo (visa médecin sur licence). Veiller au maintien tout au long de la saison de son vélo en bon état. o Respecter strictement le code de la route. o Rouler au maximum à deux de front. o Garder le mieux possible son couloir. Prévenir immédiatement le groupe de l’apparition de toute forme de danger : o véhicules automobiles. o travaux en cours. o défauts de la chaussée. o obstacles divers (objets, bris de verre, animaux, …) o autres cyclistes ou piétons sur le côté de la route. -

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 25 Sur 99
20 février 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 25 sur 99 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Décret no 2014-150 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Côtes-d’Armor NOR : INTA1325462D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3113-2 ; Vu le code électoral, notamment son article L. 191-1 ; Vu le décret no 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint- Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ensemble le I de l’article 71 du décret no 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi no 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; Vu la délibération du conseil général des Côtes-d’Armor en date du 7 octobre 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète : Art. 1er.−Le département des Côtes-d’Armor comprend vingt-sept cantons : – canton no 1 (Bégard) ; – canton no 2 (Broons) ; – canton no 3 (Callac) ; – canton no 4 (Dinan) ; – canton no 5 (Guingamp) ; – canton no 6 (Lamballe) ; – canton no 7 (Lannion) ; – canton no 8 (Lanvallay) ; – canton no 9 (Loudéac) ; – canton no 10 (Mûr-de-Bretagne) ; – canton no 11 (Paimpol) ; – canton no 12 (Perros-Guirec) ; – canton no 13 (Plaintel) ; – canton no 14 (Plancoët) ; – canton no 15 (Plélo) ; – canton no 16 (Plénée-Jugon) ; – canton no 17 (Pléneuf-Val-André) ; – canton no 18 (Plérin) ; – canton no 19 (Pleslin-Trigavou) ; – canton no 20 (Plestin-les-Grèves) ; – canton no 21 (Ploufragan) ; – canton no 22 (Plouha) ; – canton no 23 (Rostrenen) ; – canton no 24 (Saint-Brieuc-1) ; . -

Demandes D'autorisation D'exploiter Pour Mise En Valeur Agricole
15/02/2018 PREFET DES COTES-D'ARMOR Demandes dautorisation dexploiter pour mise en valeur agricole enregistrées par la Direction Départementale des Territoire et de la Mer des Côtes-d'Armor ouvertes à la concurrence au 15/02/2018 Conformément aux articles R331-4 et D331-4-1 du code rural et de la pêche maritime, la Direction Départementale des Territoires et de la mer des Côtes-d'Armor publie les demandes dautorisations dexploiter enregistrées ci-dessous : Date limite de Date dépôt des Nom et prénom des propriétaires ou d'enregistrem demandes Commune Références cadastrales Surface Demandeur Cédant N°dossier mandataires ent de la concurrentes demande (dossier complet) A773 A774 A775 A777 A779 A780 A806 A807 A808 A809 A810 A811 A812 A813 A814 A815 A816 A817 A818 A819 A820 A821 A823A A824 A827 A828 A829 A839 A840 NICOLAS/SERGE 22140 BEGARD GAEC DES NICOLAS Sophie 22140 BEGARD A841 A842 A843 A844 34,04 LE GOFF/SOPHIE 22140 BEGARD MONTBELIARDES C22171098 08/12/2017 21/02/2018 BEGARD A1229A A1231 A1233 C65 LE GOFF/SOPHIE 22140 BEGARD 22140 BEGARD C66 C67 C117 C118 C120 C121 C122 C124 C125 C126 C666 C668 F7 F8 F14 F15 F18 F2302A F2409 G568 G569 DELISLE/MARIE MADELEINE 22140 PRAT LE MO/JEAN-YVES 56300 PONTIVY GAEC DE GOAS RIVET BEGARD A34 0,23 C22171116 18/12/2017 21/02/2018 LEMO/CHRISTINE MARIE 22140 COATASCORN YVONNE 22140 PRAT LE MO/ALAIN ROBERT MARIE 22730 TREGASTEL AH56J AH56K AH56L CAROFF JULIA 22140 BEGARD 9,12 SCI AVEL BRAZ 22140 BEGARD C22180141 09/02/2018 15/04/2018 AH56M BEGARD BELLE-ISLE-EN-T B77 B78 B79 B80 B81 B130 MME LUCAS NEE -
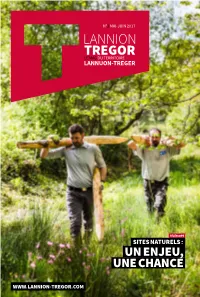
T N__3 Web.Compressed.Pdf
N°3 MAI-JUIN 2017 TÉLÉSCOPE SITES NATURELS : UN ENJEU, UNE CHANCE WWW.LANNION-TREGOR.COM RÉSOR Clic… un instant saisi, le reflet d’une émotion, la beauté d’un paysage trégorrois. Photographes amateurs, à vous de jouer ! La nouvelle partition de l’école de musique communautaire EXTO Un nouveau site internet pour les entrepreneurs L’actualité de votre territoire en images À la croisée des métiers de l’habitat À Pégase, à Lannion, où en est le projet de l’Agglo ? EMPS FORTS Au lycée Pommerit, Margot et Mathias tracent leur voie Un territoire qui bouge et investit Vous avez dit « objèterie » ? pour construire son avenir Un meilleur accès au Parc du Radôme ÉLESCOPE CES ESPACES NATURELS BEAUx… MAIS FRAGILES Le Trégor, véritable échantillon du patrimoine naturel de Bretagne. Quels sont ces espaces qui requièrent tant d’attention ? ÊTE-À-TÊTE Elise Laudren, jeune agricultrice de fromage productrice au Vieux-Marché EMPS PARTAGÉ L’Agglo, tremplin vers l’emploi Ce qui compose votre quotidien Un nouvel espace pour les jeunes à Cavan et les services utiles à votre cadre de vie À Ti Dour, le sport à la carte UYAUX Transports scolaires : vos inscriptions en ligne ! ERRITOIRE Pleubian, un esprit presqu’îlien et terrien Ça se passe près de chez vous UD BRO-DREGER RIBUNE Carte blanche à un auteur et un lexique Se glisser au cœur de la vie politique pour le plaisir de la langue bretonne EMPS LIBRE Une sélection de rendez-vous culturels, MAI. JUIN. 2017 | N°3 sportifs et autres sorties du moment 2 Abaoe ar 5 a viz Mae, bemdez, pa vez dav din ober war-dro un teuliad a bouez, e vezan e soñj da gomz eus se gant Corinne Erhel.