Document D׳Objectifs Du Site Natura 2000 Fr2410002 « Beauce Et Vallee De La Conie »
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
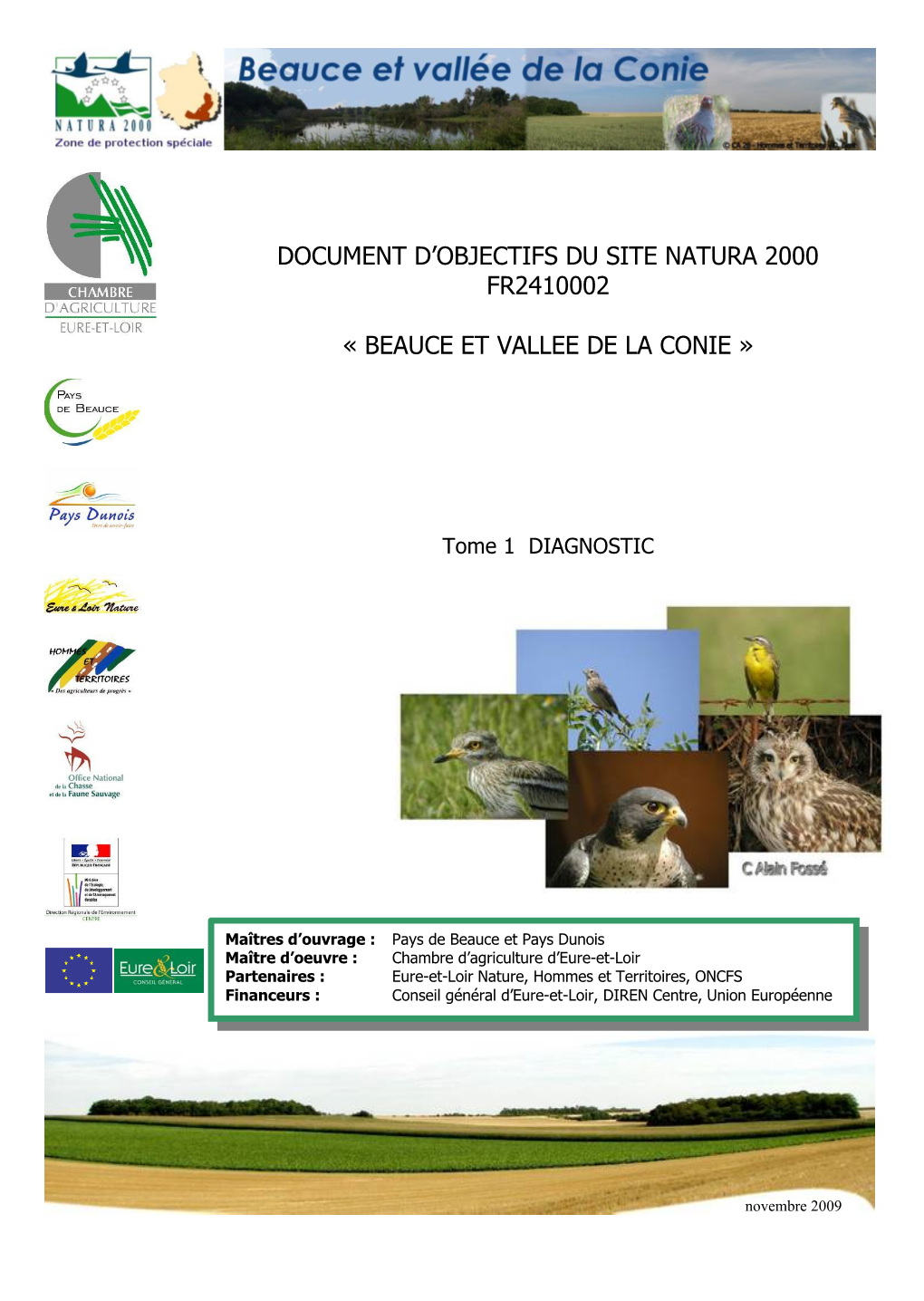
Load more
Recommended publications
-

Rapport Annuel Sur Le Prix Et La Qualité Du Service Public D'élimination Des
Année 2014 Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés Utilisateur Rapport établi conformément à la loi n°95-101 du 2 février 1995, dite loi Barnier et du décret d’application du 11 mai 28/05/2015 2000 1 SOMMAIRE 1. PRÉSENTATION DE LA COLLECTIVITÉ 1.1. Organisation politique 1.2. Le SICTOM et son territoire 2. ORGANISATION GÉNÉRALE DU SICTOM 2.1. La Compétence « Collecte » 2.1.1. Les collectes en « porte à porte » 2.1.2. Les collectes en « points d’apport volontaire » 2.1.3. Les collectes spécifiques 2.2. La Compétence « Traitement » 2.2.1. Gestion des déchetteries 2.2.2. La reconversion de l’UIOM de Châteaudun 3. LES INDICATEURS TECHNIQUES 3.1. Collecte et traitement des O.M.R : les principaux chiffres 3.2. Collecte et traitement des E.M.R : les principaux chiffres 3.2.1. Les E.M.R. collectés en porte à porte 3.2.2. Les J.R.M. collectés en P.A.V. 3.2.3. Le verre collecté en P.A.V. 3.3. Collecte spécifique des cartons des commerçants, artisans et industriels 3.4. Les déchetteries 3.4.1. Les tonnages captés et leurs évolutions 3.4.2. Le devenir des déchets captés 3.5. Synthèse des tonnages et bilan environnemental 2 4. LES INDICATEURS FINANCIERS 4.1. Évolution des dépenses de fonctionnement 4.2. Évolution des recettes de fonctionnement 4.3. Synthèse des coûts de collecte et de traitement 5. CONCLUSION 6. ANNEXES 3 B.O.M. -

CC Du Grand Châteaudun (Siren : 200069961)
Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC du Grand Châteaudun (Siren : 200069961) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Châteaudun Arrondissement Châteaudun Département Eure-et-Loir Interdépartemental non Date de création Date de création 01/01/2017 Date d'effet 01/01/2017 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président M. Fabien VERDIER Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège 2 route de Blois Numéro et libellé dans la voie Distribution spéciale Code postal - Ville 28200 CHATEAUDUN Téléphone Fax Courriel Site internet Profil financier Mode de financement Fiscalité professionnelle unique Bonification de la DGF oui Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non Population Population totale regroupée 41 497 1/5 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Densité moyenne 53,80 Périmètre Nombre total de communes membres : 23 Dept Commune (N° SIREN) Population 28 Brou (212800619) 3 393 28 Chapelle-Guillaume (212800783) 189 28 Châteaudun (212800882) 13 413 28 Cloyes-les-Trois-Rivières (200064764) 5 776 28 Commune nouvelle d'Arrou (200064632) 3 791 28 Conie-Molitard (212801062) 418 28 Dampierre-sous-Brou (212801237) 465 28 Donnemain-Saint-Mamès (212801328) 687 28 Gohory (212801823) 321 28 Jallans (212801989) 839 28 La Bazoche-Gouet (212800270) 1 240 28 La Chapelle-du-Noyer (212800759) 1 208 28 -

Les Ecclésiastiques Ayant Administré La Paroisse De Villampuy Depuis L’An 1614 Jusqu’À L’An 1968 Face À La Chronologie De L’Histoire De France
Les Ecclésiastiques ayant administré la Paroisse de Villampuy depuis l’an 1614 jusqu’à l’an 1968 face à la chronologie de l’histoire de France Louis XIII dit le Juste est roi de France et de Navarre depuis 1610 . Il le sera jusqu’en 1643. Il est le fils d’Henri IV et de Marie de Médicis et le père de Louis XIV. Son premier ministre est le Cardinal de Richelieu. 1614 – 1615 Messire FOURMENTIN est curé pendant deux années. 1615 – 1616 Messire BARRÉ lui succéda et resta curé de Villampuy jusqu’en 1616. A cette époque, la famille L’AUMONIER règne sur la seigneurerie de Pareau. 1616 – 1677 Messire François AUPES lui succède en 1616 et fut curé de Villampuy jusqu’en 1677, soit pendant 61 ans. Son corps a été inhumé dans l’église de la paroisse par son successeur le 23 Août 1677. Dans ce temps là, il y avait un Vicaire. En 1626, fut inhumé dans l’église le corps de Monsieur Jacques de L’Aumonier, Seigneur de Pareau En 1631, deux de ses filles y furent également enterrées Comme cela se faisait, les gens se faisaient enterrer dans l’église, car la superstition faisait croire que l’âme du défunt était plus rapidement montée au ciel si le corps se trouvait dans l’église et plus il était proche du chœur plus l’ascension et la protection était rapide. Mais, contre écus sonnants et trébuchants, les religieux accordaient une place plus ou moins rapprochée de la Croix. Ceux qui ne pouvaient pas avoir cette chance, demandaient à être le plus prés possible des murs de l’église pour d’une part être rapprochés du chœur mais aussi pour être sous l’eau tombant du toit de l’église, qui était censée être bénite et de ce fait avoir une protection complémentaire. -

Châteaudun C’Est : Châteaudun C’Est Le Canton De Née En 1790, Électorale Circonscription Une En 1801
FICHE CANTONALE CANTON DE CHÂTEAUDUN CANTON Nouveau canton DE JANVILLE CANTON CANTON DE Châteaudun Le canton de Châteaudun c’est : Une circonscription électorale née en 1790, remaniée en 1801. 17 COMMUNES Châteaudun, Civry, Conie-Molitard, Donnemain Futur Canton N°7 limite de l’actuel canton de Châteaudun Saint-Mamès, Jallans, La Chapelle-du-Noyer, Lanneray, Logron, Lutz-en-Dunois, Marboué, Moléans, Ozoir-le-Breuil, Saint-Christophe, Saint-Cloud-en-Dunois, N°7 CHÂTEAUDUN Saint-Denis-les-Ponts, Thiville, Villampuy. Son chef-lieu de canton est Châteaudun (13 640 hab.) 2 510,7 KM Les communes sont regroupées au sein de 2 communauté de communes : du Dunois, des Plaines et Vallées Dunoises. 307 KM2 32 085 HABITANTS Châteaudun est l’un des 5 cantons de l’arrondissement de Châteaudun. 2 23 383 HABITANTS 62,8 HABITANTS/ KM Présence de : gendarmerie, poste, trésor public, collège, centre d’exploitation routier, Espace Cyber Emploi, pom- 26 KM piers, établissements personnes âgées et handicapées, 76,3 HABITANTS/ KM2 entre les communes les plus éloignées d’Est en Ouest équipements sportifs et culturels. En tant que sous-préfecture, ce canton bénéficie d’une forte présence bancaire et de services sociaux de proximité. 39 KM entre les communes les plus éloignées du Nord au Sud RÉPARTITION DE LA POPULATION PAR TRANCHES D’ÂGE 29 COMMUNES* 90 ans et plus : 1 % Alluyes, Bonneval, La Chapelle-du-Noyer, Châteaudun, Civry, Conie-Molitard, Dancy, Dangeau, Donne- 75-89 ans : 10,9 % main-Saint-Mamès, Flacey, Jallans, Lanneray, Logron, Lutz-en-Dunois, Marboué, Moléans, Montboissier, Monthar- 0-14 ans : 18,2 % ville, Moriers, Ozoir-le-Breuil, Saint-Christophe, Saint-Cloud-en-Dunois, Saint Denis-les-Ponts, Saint Maur-sur-le- 60-74 ans : 15,6 % Loir, Saumeray, Thiville, Trizay-lès-Bonneval, Villampuy, Villiers-Saint-Orien. -

Trions Plus Pour Jeter Moins Liste Des Abréviations
RAPPORT D’ACTIVITÉ Trions plus pour jeter ANNÉE 2017 moins SICTOM DE LA RÉGION DE CHÂTEAUDUN Rapport établi conformément à la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite « loi Barnier » et du décret d’application du 11 mai 2000. Crédits : new7ducks / Freepik RAPPORT D’ACTIVITÉ Trions plus pour jeter moins Liste des abréviations B.P. : Budget Primitif C.A. : Compte Administratif D.D.S. : Déchets Diffus Spécifiques D.E.E.E. : Déchets d’Équipements Électroniques et Électroménagers D.M.A. : Déchets Ménagers et Assimilés D.M.S. : Déchets Ménagers Spécifiques D.V. : Déchets Verts E.M.R. : Emballages Ménagers Résiduels E.P.C.I. : Établissement Public de Coopération Intercommunale I.N.S.E.E. : Institut National de la Statistique et des Études Économiques J.R.M. : Journaux Revues Magazines O.M.R. : Ordures Ménagères Résiduelles PAP : Porte à Porte P.A.V. : Point d’Apport Volontaire P.E.H.D. : Polyéthylène à Haute Densité P.E.T. : Polyéthylène Téréphtalate P.V.C. : Polychlorure de Vinyle S.I.C.T.O.M. : Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères S.I.TR.E.VA : Syndicat Intercommunal de TRaitement Et de VAlorisation T.E.O.M. : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères T.V. : Tout Venant U.I.O.M. : Unité d’Incinération des Ordures Ménagères U.V.E. : Unité de Valorisation Énergétique SICTOM de la région de Châteaudun | Rapport annuel 2017 1 SOMMAIRE I - PRÉSENTATION DE LA COLLECTIVITÉ ..................................................................................... 4 I – 1 Le territoire .................................................................................................................................... 4 Illustration n°1 : Situation géographique du S.I.C.T.O.M. -
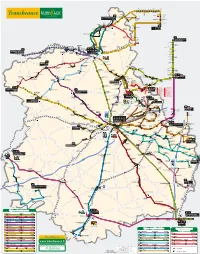
Transbeauce Final Version
VersaillesMairie Église Ruelles Arrêt desFerme Cars Mairie Mairie MongazonsCytises Fontenay Ormes Tilleuls Auchan FAVRIEUX LONGNES SOINDRES MAGNANVILLE MONDREVILLE Val St-Georges Église MANTES-LA-VILLE 28 LE MESNIL-SIMON Gare Quai 24 Pl. de l’Abreuvoir FLINS-NEUVE-ÉGLISE Gare Quai 10 LA CHAUSSÉE D’IVRY Mare à l’ogre DAMMARTIN- École EN-SERVE MANTES-LA-JOLIE Place de l’Europe D 928 Grande Rue Les Gâtines Calmette Rouges Centre TILLY Église Salle des OULINS RER - Gare Nord Fêtes Le Gleen La Cordelle POISSY ÉZY-SUR- 87 D143 Rte de Mantes EURE Bd. Gambetta Centre Cial R. d’Anet Mairie Longues Hautes Salle 88 SAUSSAY Perou des Fêtes Les Has Château AUFFREVILLE Tennis Les Marronniers ANET BERCHÈRES- POISSY CROTH R. des Tilleuls Lycée Abribus Sorel- SUR-VESGRE Peugeot Centre Moussel Centre Le Ranch Gendarmerie Écoles H. de Sorel 215 D MARCILLY-SUR-EURE SOREL- D 933 Église MOUSSEL Pont de Fer ST-LUBIN-DE Monument ROSAY 28 LA-HAYE 89 Rue de Herces Gare ST-QUENTIN-EN-Y. 88 SNCF Gare Routière 87 HOUDAN Trou du Berger République La Poste ST-GEORGES- Centre l’Étang Pont MOTEL ST-QUENTIN- ST-GERMAIN EN-YVELINES NONANCOURT SUR-AVRE Gradient 1 et 2 Pt. République Cocherelle FERMAINCOURT Marchezais- Hôtel de Bretagne MONTREUIL Route d’Anet Broué 60 Arpents Gare Routière Av. Hugo Centre Imp. de la VERT-EN- ACON Mairie Peluche Les Haut Vrissieul DROUAIS 1 6 8 Osmeaux N 12 6 le Rousset La Poste Mairie 88 Einstein Les Grandes L’Espérance 10 Arpents 25 26 28 88 Les Landes Vignes Longchamp Petit CHERISY TRAPPES VERNEUIL-SUR-AVRE Cherisy Marc Seguin Centre ST-LUBIN DES Chapeau DREUX Salle des Fêtes JONCHERETS des Roses ST-RÉMY- Le Luat Châtelet Les Cités TILLIÈRES- SUR-AVRE sur Vert Gare Routière SUR-AVRE Le Plessis Louveterie Oriels St-Rémy Les Bâtes S. -

Eure Et Loir
Direction Départementale de l'Agriculture Service du Génie Rural des Eaux et Forêts Département d'Eure et Loir ETUDE POUR L'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE DANS LES COMMUNES DE: Guillonville, Bazoches enDunois,Péronville Villampuy, S Cloud en Dunois, Ozoir le Breuil (Eure et Loir) BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES SERVICE GEOLOGIQUE REGIONAL CENTRE' 83SGN632CEN lO.avenue Buffon_ 45045 Orléans Cedex Octobre 1983 Tel: (38) 63.55.66 ?r.T^^ Direction Départementale de l'Agriculture Service du Génie Rural des Eaux et Forêts Département d'Eure et Loir ETUDE POUR L'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE DANS LES COMMUNES DE: Guillonville, Bazoches en DunoiSjPéronville Villampuy, S Cloud en Dunois, Ozoir le Breuil (Eure et Loir) Par D.Chigot BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES SERVICE GEOLOGIQUE REGIONAL CENTRE OOOuNOO^l/tN 10,avenueBuffon_45045 Orléans Cedex Octobre 1983 Téh (38) 63.55.66 GENERALITES - 1 1 - GENERALITES Dans le Sud-Est du département de l'Eure-et-Loir, la teneur en nitrates des eaux distribuées approche ou dépasse la norme admissible fixée à 50 mg/l. C'est pourquoi la Direction Départementale de l'Agriculture a demandé à ce que l'environnement hydrogéologique des captages soit étudié en détail afin de déterminer l'origine de ces teneurs élevées et d'indiquer les remèdes éventuels. Toutes les communes étudiées sont alimentées en eau à partir de forages ou de puits qui captent les eaux du calcaire lacustre de Beauce, à l'exception de Villampuy qui capte en plus les eaux de la craie. Pour chaque commune l'étude a porté sur : - l'environnement des captages (géologie, hydrogéologie), - leur situation par rapport aux directions d'écoulement des eaux souterraines, - la position de l'aquifère capté par rapport à la surface d'équilibre de la nappe, - la variation piézométrique des aquifères, - l'historique des teneurs en nitrates sur chacun des captages. -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2021
Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 28 EURE-ET-LOIR INSEE - décembre 2020 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 28 - EURE-ET-LOIR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 28-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 28-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 28-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 28-3 INSEE - décembre 2020 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires -

Carte Des Adhesions Voirie 2021.Pdf
COMPETENCE VOIRIE (adhésions) Situation au 1er avril 2021 Guainville Gilles la Chaussée le Mesnil d'Ivry Simon Oulins St Ouen Adhésion Anet Marchefroy Saussay Boncourt Berchères sur Vesgre Limite cantonale Sorel Rouvres Moussel St Lubin de la Haye Bû Abondant Havelu Goussainville Montreuil Marchezais St Lubin des Serville Dampierre Joncherets Vert en Cherisy sur Avre St Rémy Broué Bérou la sur Avre Drouais Dreux Germainville Mulotière Louvilliers Ste Gemme Boutigny Boissy en Montigny Prudemanche Moronval la Chapelle Prouais Revercourt Escorpain en Drouais sur Avre Allainville Vernouillet Mézières Forainvilliers Drouais Luray Rueil la Gadelière St Lubin en Drouais Fessanvilliers Ecluzelles Ouerre de Cravant Laons Garancières Garnay les Pinthières Mattanvilliers en Drouais Charpont Brézolles Châtaincourt St Laurent Boissy lès Croisilles Beauche Tréon la Gâtine Perche Crécy Faverolles Rohaire Couvé Marville Villemeux Bréchamps les Châtelets Crucey Villages Moutiers Brûlé sur Eure St Ange Saulnières Aunay la Chapelle Morvilliers et Torçay Coulombs Fontaine sous Crécy le Boullay Senantes Fortin la Mancelière Chaudon les Ribouts Mivoye Maillebois Puiseux Lormaye St Lucien Lamblore Boullay les le Boullay la Saucelle St Jean de deux Eglises Thierry Ormoy Nogent la Puisaye Louvilliers Rebervilliers le Roi Villiers la Ferté lès Perche le Morhier St Martin St Sauveur Vidame la Framboisière de Nigelles Droué les Ressuintes Marville Serazereux Néron le Mesnil Chateauneuf sur Tremblay les Villages Thomas St Maixme en Hanches Drouette Thymerais Pierres -

Découpage Géographique Par Secteur Collège
DECOUPAGE GEOGRAPHIQUE par SECTEUR En rouge, le nom su secteur, en noir la commune des écoles concernées SECTEUR CHARTRES ET ENVIRONS Chartres ville Chartres Chartres environs Barjouville Mignières Berchères les Pierres Morancez Coltainville Nogent le Phaye Corancez Prunay le Gillon Fontenay/Eure Sours Le Coudray Thivars Luisant Ver les Chartres Lucé Mainvilliers Amilly Jouy Lèves Bailleau l'Evêque Lèves Berchère St Germain Lucé Champhol Mainvilliers Cintray Poisvilliers Clévilliers St Aubin des Bois Fontaine la Guyon St Prest Gasville Oisème Epernon Nogent le Roi Bailleau Armenonville Houx Gallardon Maintenon Bouglainval Lormaye Chaudon Maintenon Coulombs Néron Droué/Drouette Nogent le Roi Ecrosnes Pierres Epernon St Laurent la Gâtine Faveroles St Piat Gallardon Villiers le Morhier Gasville Oisème Yermenonville Hanches Voves Boisville la St Père Allonnes Moutiers en Beauce Dammarie Boisvile la St Père Ouarville Boncé Rouvray St Florentin Dammarie Theuville Louville la Chenrard Voves Montainvile Ymonville Janville Toury Baudreville Péronville Orgères en Beauce Bazoches en Dunois Rouvray St Denis Guillonville Sancheville Janville Terminiers Notonville Toury Orgères en Beauce Auneau Sainville Aunay/Auneau Le Gué de Longroi Auneau Maisons Béville le Comte Oysonville Chatenay St Léger des Aubées Denonville St Symphorien le C. Francourville Sainvile Garancières en B. Ymeray Houville La Branche SECTEUR CHATEAUDUN ET ENVIRONS Châteaudun et environs Châteaudun Marboué Civry Ozoir le Breuil Donnemains St M. St Denis les Ponts Jallans St Cloud -

Commune De Logron
Q SOMMAIRE q Éditorial . 3 q Index des annonceurs . 5 q Associations mode d’emploi . 7 Qu’est -ce qu’une association ? . 7 Quelles sont les principales caractéristiques d’une association ? . 7 Comment créer une association ? . 9 Que faire en cas d’éventuelles modifications ? . 9 Comment dissoudre une association ? . 10 Comment et où effectuer ces déclarations ? . 11 Quelles sont les règles comptables et fiscales applicables aux associations ? . 12 Quelles sont les autorisations administratives à respecter pour organiser des activités et des manifestations ? . 12 Les liens utiles . 13 q Annuaire des associations . 15 Q Commune de Châteaudun . 16 Culte Nature-Environnement Sports Divers Patriotique Syndicats Jeunesse - Enseignement Santé-Handicap Associations Loisirs - Culture Social-Solidarité Professionnelles Q Commune de Civry . 31 Q Commune de Conie-Molitard . 31 Q Commune de Donnemain-Saint-Mames . 32 Q Commune de Jallans . 33 Q Commune de la Chapelle-du-Noyer . 34 Q Commune de Lanneray . 35 Q Commune de Logron . 37 Q Commune de Lutz-en-Dunois . 37 Q Commune de Marboué . 38 Q Commune de Moléans . 39 Q Commune de Ozoir-le-Breuil . 40 Q Commune de Saint-Christophe . 41 Q Commune de Saint-Cloud-en-Dunois . 41 Q Commune de Saint-Denis-les-Ponts . 43 Q Commune de Thiville . 44 Q Commune de Villampuy . 45 q Coupons avantages . 47 Direction de la Publication : Impression : Dépôt légal : 2014 Serge FAUVE Imprimé en CEE Conseiller général Toute reproduction, représentation ou présentation, Edition, conception, publicité : même partielle, est soumise à l’autorisation écrite de l’éditeur . Crédits photos : La responsabilité de l’éditeur ne saurait être engagée Fotolia, Shutterstock pour les éventuelles erreurs ou omissions contenues Serge Fauve 70, avenue du Général de Gaulle dans cet ouvrage . -
28-Eure-Et-Loir
Commune 28570 Abondant 28500 Allainville 28150 Allonnes 28800 Alluyes 28300 Amilly 28170 Ardelles 28700 Ardelu 28290 Arrou 28700 Aunay-sous-Auneau 28500 Aunay-sous-Crécy 28330 Autels-Villevillon 28330 Authon-du-Perche 28150 Baignolet 28300 Bailleau-l'Évêque 28310 Barmainville 28310 Baudreville 28330 Bazoche-Gouet 28270 Beauche 28420 Beaumont-les-Autels 28240 Belhomert-Guéhouville 28630 Berchères-les-Pierres 28270 Bérou-la-Mulotière 28330 Béthonvilliers 28700 Béville-le-Comte 28190 Billancelles 28220 Boisgasson 28500 Boissy-en-Drouais 28150 Boisville-la-Saint-Père 28150 Boncé 28260 Boncourt 28130 Bouglainval 28170 Boullay-les-Deux-Églises 28210 Boullay-Mivoye 28210 Boullay-Thierry 28360 Bourdinière-Saint-Loup 28410 Boutigny-Prouais 28800 Bouville 28210 Bréchamps 28300 Briconville 28400 Brunelles 28410 Bû 28800 Bullainville 28120 Cernay 28300 Challet 28410 Champagne 28240 Champrond-en-Gâtine 28400 Champrond-en-Perchet 28700 Chapelle-d'Aunainville 28200 Chapelle-du-Noyer 28500 Chapelle-Forainvilliers 28290 Chapelle-Royale 28330 Charbonnières 28120 Charonville 28500 Charpont 28220 Charray 28480 Chassant 28270 Châtaincourt 28170 Châteauneuf-en-Thymerais 28120 Châtelliers-Notre-Dame 28700 Châtenay 28190 Chuisnes 28300 Cintray 28200 Civry 28300 Clévilliers 28480 Combres 28200 Conie-Molitard 28140 Cormainville 28240 Corvées-les-Yys 28630 Coudray 28330 Coudray-au-Perche 28400 Coudreceau 28140 Courbehaye 28190 Courville-sur-Eure 28500 Crécy-Couvé 28210 Croisilles 28520 Croth 28270 Crucey-Villages 28160 Dampierre-sous-Brou 28350 Dampierre-sur-Avre