Ben Semaoune Youcef 2008 Parcours Sahariens in Nouvel Dynamique Spatiale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
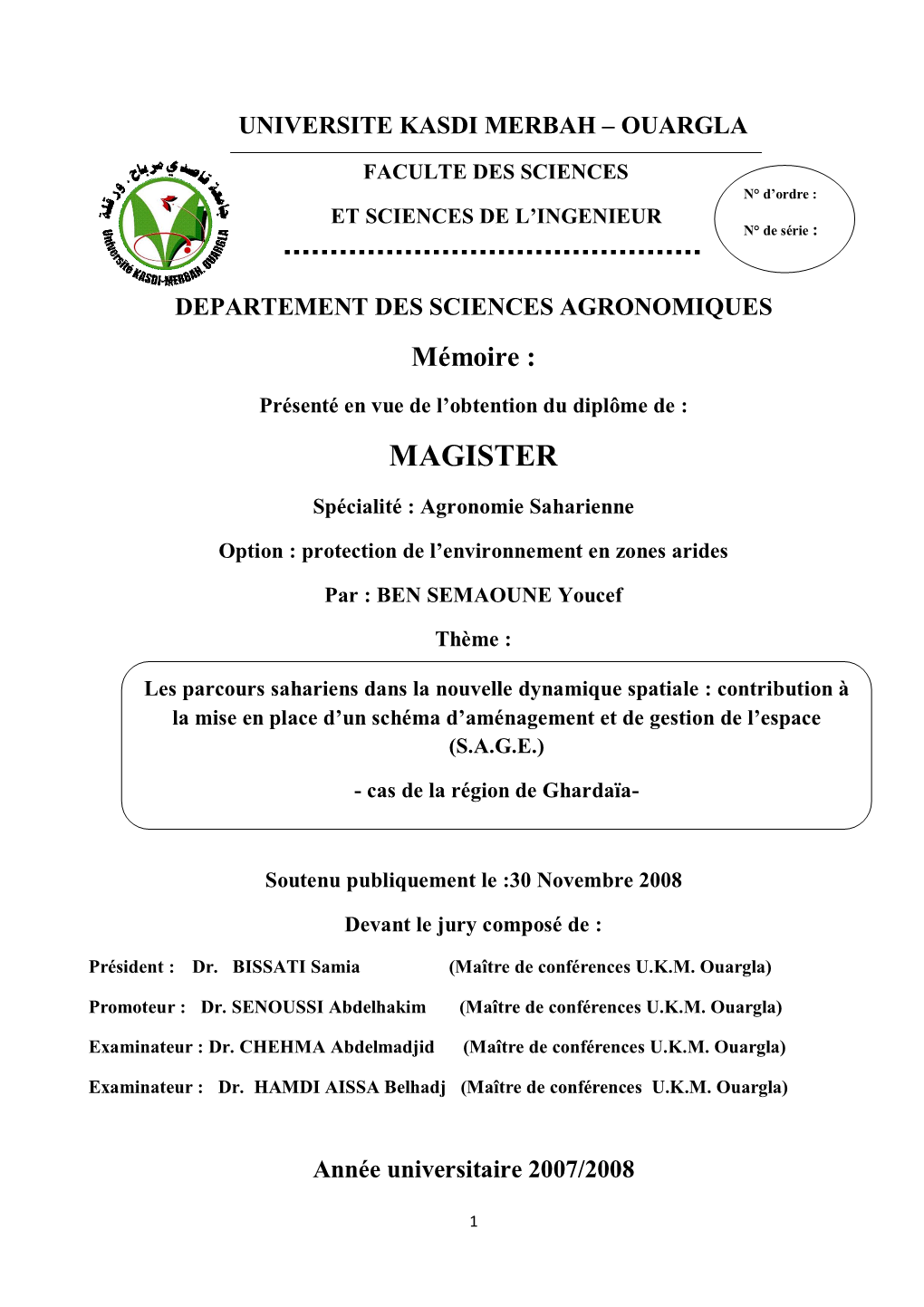
Load more
Recommended publications
-

Journal Officiel = De La Republique Algerienne Democratique Et Populaire Conventions Et Accords Internationaux - Lois Et Decrets
No 22 ~ Mercredi 14 Moharram 1421 ~ . 39 ANNEE correspondant au 19 avril 2000 Pee nls 43 Ub! sess Sbykelig bte é yr celyly S\,\n JOURNAL OFFICIEL = DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS. ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANCAISE) Algérie ; ER DIRECTION ET REDACTION: Tunisie ETRANGER SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libyeye que le Maghreb) ” , Mauritanie Abonnement et publicité: : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An- 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 a 17 - C.C.P. 3200-50 | Edition originale.....ccccsesseeees 856,00 D.A| 2140,00 D.A _ ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ . BADR: 060.300.0007 68/KG Edition originale et sa traduction}1712,00 D.A|. .4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d'expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 20,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant baréme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Priére de joindre la derniére bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22.14 Moharram 1421 19 avril 2000 SOMMAIRE | | ; ARRETES, DECISIONS ET AVIS | MINISTERE DES FINANCES Arrété du 13 Ramadhan 1420 correspondant au 21 décembre 1999 modifiant et complétant l'arrété du 26 Rajab 1416 -correspondant au 19 décembre 1995 portant création des inspections des impéts dans les wilayas relevant de la _,direction régionale des imp6ts de Chlef... -

Algerian Inuleae Tribe Species Distribution Modeling Under Influence of Current and Future Climate Conditions
Biodiv. Res. Conserv. 57: 23-31, 2020 BRC www.brc.amu.edu.pl DOI 10.2478/biorc-2020-0002 Submitted 28.02.2020, Accepted 31.03.2020 Algerian Inuleae tribe species distribution modeling under influence of current and future climate conditions Djilali Tahri*, Fatiha Elhouiti, Mohamed Ouinten & Mohamed Yousfi Laboratoire des Sciences Fondamentales à l’Université Amar Telidji de Laghouat, Route de Ghardaïa BP37G (03000), Laghouat, Algérie; ORCID: DT https://orcid.org/0000-0002-9408-6188, FE https://orcid.org/0000-0001-8191-1428 *corresponding author ([email protected]) Abstract. This study aims to predict the impact of bioclimatic variables in current and future climatic scenarios on the distribution of Inuleae tribe species. Modeling the distribution of 30 species of the Inuleae tribe in Algeria was carried out with a maximum entropy model. Two models with 99 occurrence points were obtained with mean values of Area Under a Curve (AUC) of 0.987±0.01 and 0.971±0.02, reflecting excellent predictive power. Three bioclimatic variables contributed mainly to the first model and four - to the second one with cumulative contributions of 83.8% and 79%, respectively elucidating differences between species of the two major climatic zones in Algeria: the Tell and the Sahara. Two-dimensional niches of Algerian Inuleae species allowed to distinguish these two groups with the distribution of 18 Tell species, characterized by high rainfall (14-18°C, 400-1000 mm) and the other 12 species – distributed in hot and dry environments (17-24°C, 20-200 mm). Modeling the distribution under future conditions showed that habitats of the Saharan region would be much less suitable for these species with a variation in the annual mean temperature increase up to 20% and a decrease in annual precipitation, which could raise to 11 and 15%. -

LES MAMMIFERES SAUVAGES D'algerie Répartition Et Biologie
LES MAMMIFERES SAUVAGES D’ALGERIE Répartition et Biologie de la Conservation Mourad Ahmim To cite this version: Mourad Ahmim. LES MAMMIFERES SAUVAGES D’ALGERIE Répartition et Biologie de la Con- servation. Les Editions du Net, 2019, 978-2312068961. hal-02375326 HAL Id: hal-02375326 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02375326 Submitted on 22 Nov 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. LES MAMMIFERES SAUVAGES D’ALGERIE Répartition et Biologie de la Conservation Par Mourad AHMIM SOMMAIRE INTRODUCTION 1 CHAPITRE 1 – METHODES DE TRAVAIL 1.1. Présentation de l’Algérie 3 1.2. Géographie physique de l’Algérie 3 1.2.1. Le Sahara 3 1.2.2. L’Algérie occidentale 4 1.2.3. L’Algérie orientale 4 1.3. Origine des données et présentation du catalogue 5 1.4. Critères utilisés pour la systématique 6 1.4.1. Mensurations crâniennes 6 1.4.2. Mensurations corporelles 6 1.5. Présentation du catalogue 6 1.6. Critères de classification pour la conservation 7 1.7. Catégories de la liste rouge 7 CHAPITRE 2 –EVOLUTION DES CONNAISSANCES SUR LES MAMMIFERES D’ALGERIE 2.1. -

10 19 Joumada Ethania 1432 22 Mai 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 29 Annexe Compétence Territoriale
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 19 Joumada Ethania 1432 10 22 mai 2011 Annexe Compétence territoriale des tribunaux administratifs Tribunaux administratifs Communes Adrar - Bouda - Ouled Ahmed Timmi - Tsabit - Sebaâ - Fenoughil - Temantit - Temest - Adrar Timimoun - Ouled Saïd - Ouled Aïssa - Aougrout - Deldoul - Charouine - Metarfa - Tinerkouk - Talmine - Ksar Kaddour - Reggane - Sali - Bordj Badji Mokhtar - Timiaouine - Zaouiet Kounta - In Zghmir - Aoulef - Timekten - Akabli - Tit. Chlef - Sendjas - Oum Drou - Labiod Medjadja - El Hadjadj - Boukadir - Ouled Ben Abdelkader - Oued Sli - Sobha - Ténès - Abou El Hassan - El Marsa - Beni Haoua - Sidi Chlef Akkacha - Souk El Bagar - Talassa - Moussadek - Oued Goussine - Breira - Ouled Farès - Chettia - Bouzeghaïa - Tadjena - Zeboudja - Benaïria - Aïn Merane - Taougrite - Herenfa - Dahra. Aïn Defla - Rouina - El Amra - Arib - Djelida - Bourached - Zeddine - Mekhatria - Djemaâ Ouled Chikh - Bathia - El Attaf - Ouled Abbès - Béni Bouateb - Harchoun - El Abadia - Aïn Defla Tiberkanine - El Maïne - Belass - Aïn Bouyahia - Tacheta Zougagha - Beni Rached - El Karimia - Oued Fodda - Miliana - Ben Allel - Hammam Righa - Aïn Benian - Aïn Torki - Hoceinia - Khemis Miliana - Tarik Ibn Ziad - Sidi Lakhdar - Bir Ould Khelifa - Bordj Emir Khaled - Djendel - Oued Chorfa - Barbouche - Oued Djemaâ - Aïn Lechiakh - Aïn Sultan - El Hassania - Bou Medfaâ. Laghouat - Ksar El Hirane - Mekhareg - Sidi Makhelouf - Hassi Delaâ - Hassi R'Mel - Aïn Laghouat Madhi - Tadjmout - El Assafia - El Houaïta -

Congrès Algérien De Mécanique
Université de Ghardaia ﺟـــﺎﻤﻌﺔ غــــــردايــــــــﺔ Congrès Algérien de Mécanique Congrès Algérien de Mécanique 23—26 février 2020 • Ghardaia, Algérie 23—26 février 2020 • Ghardaia, Algérie Association Algérienne de Transfert de Second Call for Papers / Second Appel à Communication Président d’honneur / Honorary Chair All submitted papers (2 pages of extended abstract in DOC format) should be DADAMOUSSA Belkhir (Recteur Univ. Ghardaia / President ) Technologie (a2t2) اﻠﺠــﻤﻌــﻴﺔ اﻠﺠـﺰاﺌرﻴﺔ ﻠﺘﻨﻗﻞ اﻠﺗﻜﻨﻮﻠﻮﺠيﺎﺖ written in accordance with the template provided at the CAM2019 website. Co-Président d’honneur / Honorary Co-Chair Submission implies the willingness of at least one of the authors to register the DAMOU Ahmed (Président de @2t2 / @2t2 President) work. All the submitted papers should be submitted via online to the following system. Please click Submission through EasyChair requires that an account in the system be created by a prospective author first. In order to create a new Comité d’Organisation National / National Organizing Committee account, select the "I have no EasyChair account" option. The paper submission Président / General Chair Co-Présidents / Co-Chairs system is: MAARADJ Houari (Ghardaïa) MILOUDI Abdelhamid (Alger) Congrès Algérien https://easychair.org/conferences/?conf=cam2019 BOUARAOUR Kamel (Ghardaïa) Deadline for communication submission April 30, 2019 May 31, June 30, 2019 Notification of acceptance June 30, 2019 July 31, 2019 Membres / Members de Mécanique Deadline of final Registration October 31, 2019 AGGOUNE Med Salah (Ghardaïa) Deadline of Registration Fees Payment October 31, 2019 ARIF Mohamed (Ghardaïa) BAHRI Ahmed (Ghardaïa) Tous les articles soumis (2 pages d’un résumé étendu au format DOC) doivent BEKAR Belkacem (Ghardaïa) être rédigés conformément au modèle disponible dans le site web du congrès. -

Selmani Et Al., Afr J Tradit Complement Altern Med., (2017) 14 (3): 175-186 Doi:10.21010/Ajtcam
Selmani et al., Afr J Tradit Complement Altern Med., (2017) 14 (3): 175-186 doi:10.21010/ajtcam. v14i3.19 ETHNOBOTANICAL SURVEY OF PHOENIX DACTYLIFERA L. POLLEN USED FOR THE TREATMENT OF INFERTILITY PROBLEMS IN ALGERIAN OASES. Cherifa Selmani, Djamila Chabane, Nadia Bouguedoura. Research Laboratory of Arid Areas (LRZA). Faculty of Biological Sciences. University of Sciences and Technology Houari Boumediene (USTHB). PO Box, 32 El Alia Bab-Ezzouar, 16111, Algiers, Algeria. Corresponding author Email: [email protected], [email protected] Abstract Background: The Phoenix dactylifera L. (date palm) is known for its traditional medicinal properties across the history of native population in Algerian Sahara. There is a large trend of consumption of date palm pollen preparations in many human infertility cases in our country. However, the validity has not been scientifically tested. There has been no direct scientific research on this application. This study was undertaken to identify cultivars with greater potential in the traditional medicine uses. To evaluate the effects of date palm pollen on some sexual behavioural parameters of male adult rats, we tested the role of pollen powder from Deglet Nour cultivar on some male reproductive parameters. Materials and Methods: An Ethnobotanical survey was conducted in 17 oases in southern Algeria to identify all cultivars with medicinal interest. Local people were interviewed with open questions. A questionnaire and personal interviews for data collection were designed to record important cultivars, parts used and preparations. To determine the active constituents of date palm pollen used in traditional medicine, a phytochemical screening was performed. The effects of oral administration of date palm pollen suspension on male adult rats were investigated on body and testicle weights, serum testosterone level. -

Qualitative Traits Variation in Barley Landraces (Hordeum Vulgare L.) from Algeria Using Shannon-Weaver Diversity Index
Растениевъдни науки, 2020, 57(6) Bulgarian Journal of Crop Science, 2020, 57(6) Qualitative traits variation in barley landraces (Hordeum vulgare L.) from Algeria using Shannon-Weaver diversity index Hafida Rahal-Bouziane* 1, Samia Yahiaoui1, Samira Merdas1, Saliha Berkani1, Souad Nait-Merzoug1, Aissa Abdelguerfi2 1Algerian National Institute of Agricultural Research (INRAA) - Plant Genetic Resources - Baraki, Algiers, Algeria 2National High School of Agronomy - El Harrach (ENSA) *E-mail: [email protected] Citation Rahal-Bouziane, H., Yahiaoui, S., Merdas, S., Berkani, S., Nait-Merzoug, S., & Abdelguerfi, A. (2020). Qualitative traits variation in barley landraces (Hordeum vulgare L.) from Algeria using Shannon-Weaver diversity index. Rastenievadni nauki, 57(6) 41-47 Abstract Variations in useful barley botanical traits are very important among others for improvement and food secu- rity. This study was done on 29 Algerian barley landraces from Sahara in presence of four controls and aimed to evaluate the variability among these barley genotypes through nine descriptive traits using Shannon-Weaver diversity index (H’). Results showed a great variation existing within the landraces for the majority of the traits studied. Indeed, high values of Shannon-Weaver diversity index were obtained for the curvature of first rachis segment (0.99), the pigmentation of awn tips (0.95), length of rachilla hair in grain (0.88), the disposition of lodicules in the fertile grain (0.85), lemma awn barbs (0.76) and spike density (0.61). H’ was intermediate for lemma type in grain (0.55) and was low for the glume length compared to grain and for the spike shape (0.33 and 0.44 respectively). -

Water in Algerian Sahara: Environmental and Health Impact
Chapter 10 Water in Algerian Sahara: Environmental and Health impact Khaled Sekkoum, Mohamed Fouzi Talhi, Abdelkrim Cheriti, Younes Bourmita, Nasser Belboukhari, Nouredine Boulenouar and Safia Taleb Additional information is available at the end of the chapter http://dx.doi.org/10.5772/50319 1. Introduction The supply of drinking water has become difficult in many countries, thus, access to safe drink‐ ing water, is expected to become in the the world as fundamental economic and social rights and unfortunately this is not currently the case. Whether its origin, superfecial or groundwa‐ ter [Cheriti et al, 2011; Cheriti et al, 2009; Talhi et al, 2010], water used for human consump‐ tion are rarely consumables unchanged. It is often necessary to treat them more or less sophisticaly, or simply by disinfection in the case of groundwater. The reserves of groundwa‐ ter in Algeria are estimated to 6.8 billion m3. However, these groundwater are at significant depths and are characterized more by a strong mineralization, on the other hand, due to the particularity and specific climate of Algeria, the rivers dry frequently [ABHS, 2009]. As a rule, waters are subdivided into categories depending on a level of their mineralization or their ri‐ gidity. There are also other approaches to classification of water of various sources, for exam‐ ple, taking into account simultaneously its mineralization, rigidity and the contents of organic impurity. The boundary values for division of water into categories are sufficiently conven‐ tional and they differ in various sources of information [Djidel et al, 2010]. Better quality of water described by its physical, chemical and biological characteristics [Manjare et al, 2010]. -

Généralité De Zone De Travail (Zelfana
République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l’Enseignement Supérieur et La Recherche Scientifique Université de Ghardaïa Faculté des Sciences et Technologie Département Hydraulique et Génie civil Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de MASTER Domaine : Sciences et Technologie Filière : Hydraulique Spécialité : Hydraulique Urbaine Thème Etude De Tarissement Du Forage Albien Profond De Gouiflat El-Oued (Zelfana), Diagnostique Du Problème Et Solutions Palliatives Présenté par : • BEKOUIDER Souhila • KHATOUI Mebarka Devant le jury : Mr. BOULMAIZ Tayeb MCB Univ. Ghardaïa Président Mr. MECHRI Bachir MAA Univ. Ghardaïa Examinateur Mr. ACHOUR Mansour Doctorant ANRH Ghardaïa Encadreur Année universitaire 2019/2020 Remerciement Tout d'abord, merci Notre Dieu qui nous a donné force et courage. En conséquence, nous voudrions remercier M. ACHOUR Mansour, d’avoir encadre ce travail Avec beaucoup de compétence, des efforts énormes Des conseils et encouragements. Et sacrifié Son temps Pour nous Nous remercions également Toutes les institutions qui ont contribué à nous faciliter la Recherche et la collecte d’informations Dédicace Je dédie ce mémoire e A ma chère Mère qui a éclairé mon chemin qui M’a encouragée et soutenue tout au long de mes études mes Mots Elle ne suffiront pas à ses efforts avec moi. A mon cher Père pour son affection, ses encouragements et ses conseils. A ma chère binôme Mebarka pour son soutien moral, et sa patience. A mes chère frère Djalel et Yassine qui m'aider et m’encouragé. À mes chère amis Ouidad et Douniazed, Messouda Pour leur collaboration et leur aide. Bekouider Souhila Dédicace Je dédie ce mémoire À mon cher père Hadj Aouak pour le gout à l'effort qu'il a suscité en moi, de par sa rigueur et son amour et m'encourager. -

IO Brachenreport Algerien Tourismusinfrastruktur
AUSSEN WIRTSCHAFT BRANCHENREPORT ALGERIEN TOURISM SECTOR IN ALGERIA: HISTORY AND INVESTMENT OPPORTUNITIES TOURISM INVESTMENT IN ALGERIA (INVESTMENT POLICY AND PROMOTION) TOURIST POLES OF EXCELLENCE IN ALGERIA SAHARIAN TOURISM ALGERIAN GASTRONOMY TOURISM INVESTMENT POTENTIALS FOR AUSTRIAN COMPANIES AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER ALGIER APRIL 2021 2 Unser vollständiges Angebot zum Thema Tourismusinfrastruktur (Veranstaltungen, Publikationen, Schlagzeilen etc.) finden Sie unter wko.at/aussenwirtschaft/tourismus-know-how-infrastruktur Der vorliegende Branchenreport wurde von Wassym AMARA, Managing Director Studies and Training Firma AOM INVEST 03, Rue Agadir, Oran, Algérie T +213 41 46 49 91 E [email protected] W www.aom-invest.com für das AußenwirtschaftsCenter Algier T +213 23 47 28 21/23 F +213 23 47 28 25 E [email protected] W wko.at/aussenwirtschaft/dz fb.com/aussenwirtschaft twitter.com/wko_aw linkedIn.com/company/aussenwirtschaft-austria youtube.com/aussenwirtschaft flickr.com/aussenwirtschaftaustria www.austria-ist-ueberall.at erstellt; ergänzende Beiträge der Studie verfassten auch Marketing Officer Mohamed Aidat und der Wirtschaftsdelegierte Mag. Franz Bachleitner Dieser Branchenreport wurde im Rahmen der Internationalisierungsoffensive go-international, einer Förderinitiative des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und der Wirtschafts- kammer Österreich erstellt. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die Rechte der Verbreitung, der Vervielfälti- gung, der Übersetzung, des Nachdrucks -

Les Parcours Sahariens Entre Usage Et Enjeu! Cas De La Région De Ghardaïa
ISSN- 2170-1318 SENOUSSI Abdelhakim et BENSEMAOUNE Youcef Les parcours sahariens entre usage et enjeu! Cas de la région de Ghardaïa Senoussi Abdelhakim et Bensemaoune Youcef Laboratoire Bioressources Sahariennes; Préservation et Valorisation. Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et Sciences de la Terre et de l’Univers Université Kasdi Merbah-Ouargla (Algérie) [email protected] Résumé- La présente étude montre que les espaces pastoraux sahariens, estimés à 28 millions d’hectares sont sous l’emprise de multiples contraintes notamment d’ordre anthropique, où dans la région de Ghardaïa, le système d’élevage extensif a régressé à cause de l’évolution du mode de vie des éleveurs. Les investigations de terrain révèlent respectivement 25% des éleveurs sont de véritables nomades, 15% seulement sont des sédentaires et majoritairement (60%) sont des semi-nomades. Par ailleurs, le mode d’exploitation des espaces de parcours montre que 60% des éleveurs les surexploitent, corollaire d’un surpâturage causé par une surcharge et de là leur dégradation. Alors que l’extension des superficies agricoles a engendré une soustraction des espaces de parcours. Autrement dit, un système de culture vient se plaquer sur l’espace pastoral. Ce dernier est passé de 21742 ha en 2006 à 26436 ha en 2007, soit une diminution de l’ordre de 4694 ha. Devant cette situation alarmante et devant la fragilité du milieu saharien, nous admettons que l’espace pastoral saharien nous interpelle à travers un aménagement adéquat et une gestion rationnelle dans une perspective de durabilité. Pour se faire, un Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Espace (S.A.G.E.) pratique et faisable serait fortement recommandé. -

La Couverture Sanitaire De La Wilaya De Ghardaïa
La couverture sanitaire de la wilaya de Ghardaïa Pr. Larbi ABID La wilaya de Ghardaïa est située dans la vallée du Mzab, au nord du Sahara. Elle est limitée au Nord par la wilaya de Laghouat (200 Km) ; au Nord Est par la wilaya de Djelfa (300 Km) ; à l’Est par la wilaya de Ouargla (200 Km) ; au Sud par la wilaya de Tamanrasset (1470 Km) ; au Sud- Ouest par la wilaya d’Adrar (400 Km) ; à l’Ouest par la wilaya d’El Bayadh (350 Km). Elle couvre une superficie de 84660 km2. Cette wilaya se caractérise par trois principales zones géographiques : • le Grand Erg Oriental dont les dunes peuvent atteindre une hauteur de 200 m ; • la Hamada, un plateau caillouteux ; • la vallée du Mzab, c’est dans le creux de l’Oued Mzab que sont construites les cinq cités du Mzab. Les Escarpements rocheux et les oasis déterminent le paysage dans lequel sont localisées les villes de la pentapole du M’Zab et autour duquel gravitent d’autres oasis (Berriane, Guerrara, Zelfana, Metlili et beaucoup plus éloignée au Sud El Menea). L’ensemble géomorphologique dans lequel s’inscrit le M’Zab est un plateau rocheux, la Hamada, dont l’altitude varie entre 300 et 800 mètres. Le paysage est caractérisé par une vaste étendue pierreuse où affleure une roche nue de couleur brune et noirâtre. Ce plateau a été masqué par la forte érosion fluviale du début du quaternaire qui a découpé dans sa partie Sud des buttes à sommets plats et a façonné des vallées. L’ensemble se nomme la chebka «Filet» à cause de l’enchevêtrement de ses vallées.