Plan Local D'urbanisme
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
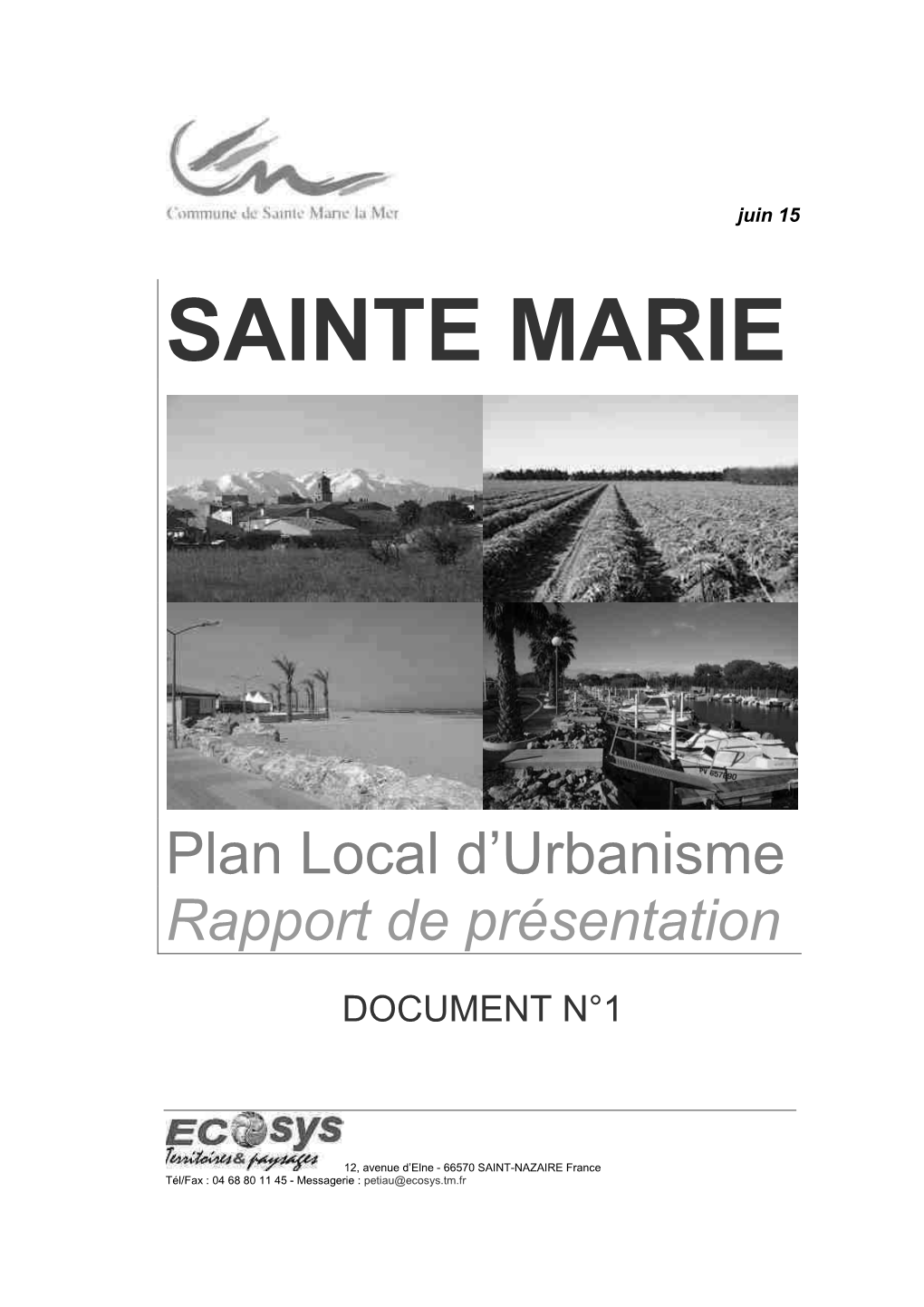
Load more
Recommended publications
-

Rendez-Vous Rendez-Vous
Les marchés des Pyrénées-Orientales Les marchés des Pyrénées-Orientales Terroir en pays catalan Terroir en pays catalan Terroir en pays catalan ALENYA BAIXAS CERBÈRE FONT-ROMEU Mardi, vendredi et dimanche Mercredi Mardi et vendredi Mercredi et vendredi LE BOULOU ODEILLO-VIA • A l’année - Parc Ecoiffier • A l’année Jeudi et dimanche Mercredi • A l’année - Front de mer et • Saison estivale et hivernale A l’année Saison estivale Parc du château les Pins Place de la République Rue Maillol • • AMÉLIE-LES-BAINS Rambla Rue Arago Place de la République Rendez-vououss Tous les jours BANYULS-SUR-MER CÉRET FORMIGUÈRES LE SOLER OLETTE-EVOL • A l’année Jeudi et dimanche Samedi Samedi Rendez-vououss terroir en pays catalan Place de la République • A l’année Lundi, mardi et samedi Jeudi • A l’année • A l’année - Centre du village • A l’année • A l’année - Place de la Victoire Place du marché Rues du centre ville en pays catalan Jeudi ILLE-SUR-TÊT Place de la République terroir • A l’année - Place de la Sardane BOLQUÈRE/PYRÉNÉES 2000 OPOUL-PERILLOS Petits instants de bonheur CLAIRA Mercredi et vendredi Mardi et vendredi Lundi Vendredi • A l’année LES ANGLES dans les Pyrénées-Orientales… ARGELÈS-SUR-MER • Saison estivale et hivernale Mardi • A l’année - Place de la Tour • A l’année Place de la République A l’année Mercredi et samedi Avenue Serrat de l’ours Place de la Liberté • Les marchés catalans, • A l’année - Village Avenue de Mont-Louis OSSÉJA LA CABANASSE Jeudi Rue de la République BOMpaS COLLIOURE Vendredi toutes les couleurs du terroir ! Jeudi -

Le Bulletin Municipal De La Ville De Pia Infos Utiles
N°11 PRINTEMPS 2018 ensembleLE BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE PIA INFOS UTILES MAIRIE DE PIA 18, avenue Maréchal Joffre, Pia Tél. 04 68 63 28 07 Mail : [email protected] www.pia.fr Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 / Le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h POLICE MUNICIPALE 18, avenue Maréchal Joffre, Pia Tél. 04 68 63 77 33 - 04 68 63 77 37 06 07 28 73 12 Mail : [email protected] Bureau ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 Le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h AFFAIRES SCOLAIRES Mairie - 18, avenue Maréchal Joffre, Pia Tél. 04 68 63 75 77 Mail : [email protected] Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h - fermé au public le mardi et vendredi après-midi / nouveauté à partir du 3 mai bureau ouvert au public le mercredi jusqu’a 18h30 BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE 18, avenue Maréchal Joffre, Pia Tél. 04 68 63 77 36 Mail : [email protected] Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h (sauf le vendredi à 17h) DÉCHÈTERIE Chemin de Claira, Pia Tél. 04 68 52 72 66 Du lundi au vendredi de 9h à 17h Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h Bulletin d’information municipale de la ville de Pia - n°11 Trimestriel - Avril, Mai, Juin 2018 Prochaine parution : Juillet 2018 Textes à transmettre avant le 1er juin à [email protected] Siège de la publication : Mairie de Pia Directeur de la publication : Michel Maffre Comité de rédaction : Marie-José Ruiz, Renée Garci-Nuno, Nathalie Ferrer Conception graphique et rédaction : Laurent Banyols, Sandrine Salvi Imprimerie : Imprimerie des Pyrénnées Crédits photographiques : © Ville de Pia, Freepik, Adobe Stock, Fest in Pia. -

Parcours Route
PARCOURS ROUTE KM PARCOURS 53 StEsteve-Baho-Pezilla-LaDone-Estagel-LaBataille-Corneilla-Pezilla-Villeneuve-StEsteve 53 StEsteve-Baho-Villeneuve-Pezilla-LaDone-Calces-Baixas-Espira-DirectionMontpins-Rivesaltes-Peyrestortes-Llabanere 54 Villeneuve-LeSoler-Thuir-Castelnou-Auxineill-Corbere-Millas-Corneilla-Pezilla-Villeneuve 54 Villeneuve-Pezilla-StFeliu-Thuir-Castelnou-Auxineill-Corbère-StFeliu-Pezilla-Villeneuve 55 Pia-Rivesaltes-Salses-StHyppolyte-StLaurent-Torreilles-SteMarie-Canet-JardinStJacques 55 StEsteve-Baixas-Calces-LaDone-Estagel-LaBataille-Corneilla-Pezilla-Direction 4chemin-D616-StEsteve 57 Villeneuve-Pezilla-LaDone-Estagel-Latour-LaBataille-Corneilla-Pezilla-Villeneuve-StEsteve 57 StEsteve-Baho-Villeneuve-LeSoler-StFeliu-Millas-Corneilla-Pezilla-4Chemins-Baixas-Espira-Rivesaltes-Pia 58 Villeneuve-LeSoler-Thuir-Terrats-Fourques-Villemolaque-StJean-Brouilla-Ortaffa-Bages-VilleneuveLaRaho 59 Pia-Rivesaltes-Salses-StHyppolyte-StLaurent-Torreilles-TorreillesPlage-SteMarie-Canet-JardinStJacques 59 Villeneuve-Pezilla-Corneilla-Millas-Ille-Corbere-Thuir-LeSoler-Villeneuve-StEsteve Toulouges-LeSoler-StFeliuD’Avall-StFeliuD’Amont-Millas-Nefiach-Ille-Corbere-L’Auxineil-Castelnou-Thuir-Llupia-PisteCyclable-Canohes- 59 Toulouges 59 Cabestany-Saleilles-VilleneuveDeLaRaho-Montescot-Brouilla-StJean-Villemolaque-Trouillas-Thuir-LeSoler-Villeneuve-Baho-StEsteve 60 StEsteve-Baixas-Calces-LaDone-Estagel-MasCamps-LaTour-LaBataille-Corneilla-Pezilla-Villeneuve-StEsteve 60 StEsteve-Baho-Pezilla-Corneilla-LaBataille-Estagel-LaDone-Pezilla-4Chemins-Baixas-Peyrestortes-Llabanere -

Plan De Prévention Des Risques Naturels Estagel
X PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES Plan de prévention des risques naturels Livret 1 Rapport de Présentation P.P.R. Estagel (N° INSEE : 66 071 ) prescrit le : 10 janvier 2000 élaboration : décembre 2002 approuvé le : P.P.R. approuvé et annexé à l'arrêté préfectoral 2004-3281 du 25 août 2004 Direction Départementale de Service Départemental de l’Agriculture et de la Forêt des restauration des terrains en montagne Pyrénées-Orientales des Pyrénées-Orientales PRÉAMBULE rès d’une commune française sur deux est susceptible d’être affectée par des risques naturels. La fréquence des catastrophes survenues depuis les P inondations de l’été 1992 et le constat d’un accroissement de la vulnérabilité en dépit de la mise en place de dispositifs réglementaires successifs ont conduit le gouvernement à renforcer la politique de prévention des risques naturels. Il a été décidé, lors du Comité interministériel du 24 janvier 1994, d’initier un programme décennal de prévention des risques naturels dont l’un des points essentiels est de limiter strictement le développement dans les zones exposées. Cette politique s’appuie sur la modernisation des procédures spécifiques et sur l’augmentation des moyens financiers nécessaires pour leur mise en application. Elle s’est traduite, dans la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, par la création des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.), qui visent à limiter, dans une perspective de développement durable, les conséquences humaines et économiques des catastrophes naturelles. » Philippe VESSERON Directeur de la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques, Délégué aux Risques Majeurs au Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable « La Montagne s’apprécie au naturel, belle et capricieuse… Vouloir y vivre ou la fréquenter, c’est accepter de la respecter et de s’adapter. -

Sommaire Edito 2 Inaugurations 3 Cérémonies 5 Urbanisme 6 Qualité De Vie 7 Culture 8 Vie Des Écoles 9 Jeunesse 12 Nos Seniors 14
p1 2009 LALA CANTARANACANTARANAHiver Bulletin Municipal de Pollestres - Hiver 2009 2009 Hiver Sommaire Edito 2 Inaugurations 3 Cérémonies 5 Urbanisme 6 Qualité de vie 7 Culture 8 Vie des écoles 9 Jeunesse 12 Nos seniors 14 Informations Municipales - Revue de la Municipalité. Imprimée en 2000 exemplaires. Responsable rédaction : Daniel Mach, Député Maire Commerce et Artisanat 15 Vie associative 16 Sports 17 Agenda 19 p2 Mesdames, Messieurs, Chers Amis, pour faire de l’évolution de notre commune une évolution réfléchie, mesurée qui nous conduira à accueillir et non à Permettez-moi, avant tout, de vous subir de nouveaux habitants. présenter en mon nom et en celui du Conseil Municipal, mes vœux de Pollestres est elle aussi soumise à la règle obligatoire des santé, bonheur et prospérité pour 20% de logements locatifs et j’ai la volonté d’organiser vous et tous ceux qui vous sont chers. cette nouvelle urbanisation pour que les règles de vie Que cette année 2010 vous apporte propres à vous toutes et vous tous, que nous respectons tout ce que 2009 a oublié de bon! et apprécions, s’immiscent dans les comportements des personnes qui auront le privilège de venir habiter notre Les traditionnelles fêtes de fin d’année viennent commune. J’aimerais que le mot «privilège» ne soit pas de s’achever et les membres du Conseil Municipal s’attellent pris à la lettre mais qu’il reflète tout simplement l’état déjà à réfléchir sur les futurs équipements qui embelliront notre d’esprit que nous avons tous ensemble insufflé à notre commune qui, je dois l’avouer, représente une grande fierté que commune: respect de l’histoire de Pollestres, respect j’espère partagée par tous. -

Département Des Pyrénées-Orientales Découpage
CC Agly Fenouillèdes CC Roussillon Conflent Fitou Département des Pyrénées-Orientales Opoul-Perillos Découpage des arrondissements Vingrau CC Salanque Méditerranée Périmètre des intercommunalités Salses le Château er Prugnanes 1 janvier 2017 Caudiès de Saint-Paul Fenouillèdes de Fenouillet Maury Tautavel Le St Espira de Hippolyte St Barcarès Lesquerde Rasiguères l’Agly Laurent St Martin Cases de la CC Conflent – Canigó Fenouillet Fosse de Fenouillet St Arnac Latour de Pène Rivesaltes Claira Salanque Estagel Le Lansac Planèzes de Vira Vivier Felluns France CC Capcir Haut Conflent Ansignan Baixas Torreilles Prats Calce CU Perpignan Méditerranée Pézilla Peyrestortes de Cassagnes Montner Pia Sournia de Trilla Caramany Rabouillet Conflent VillelongueSte Marie Bompas de la Sal. Bélesta Corneilla St Villeneuve la Mer Trévillach la Sournia Montalba Pézilla la Estève le Rivière la Rivière Perpignan Canet en Campoussy Château NéfiachMillas Rivière Baho Tarerach St Roussillon Ille sur Têt Feliu St Le Soler Cabestany Mosset Feliu Molitg d’Amont Arboussols Corbère d’Avall Toulouges les Bains St Nazaire Rodès les Puyvalador Eus Canohès Saleilles St Michel Cabanes Fontrabiouse Urbanya Thuir Villeneuve Campôme Vinça Bouleternère de Corbère de la Théza Alénya Réal Catllar Marquixanes Llotes Ponteilla Pollestres Camélas Raho Corneilla St Nohèdes Ria- Espira Rigarda Llupia Formiguères Conat Prades del Vercol Cyprien CC Sud Roussillon Sansa Sirach Los de Casefabre Conflent Ste Colombe Masos Joch Bages Latour Castelnou Trouillas Montescot Villefranche Codalet -

Association Syndicale Autorisee Du Canal D'arrosage De Pezilla La
LISTES DES PROPRIETAIRES AVANT EXTENSION ABDICHE FARID ARIES EVA ABET NEE VERITE NATHALIE /INDIVISION VERITE ARIES GEORGES PHILIPPE ARISO DAVID ACHON OLIVIER ARMENGOL GENEVIEVE ADUA LOUIS ARMENGOL PASCAL AFFRE DIDIER ARNAL FABIENNE AGOSTINI JEAN FRANCOIS ARNAUD ANNE MARIE EP OLLIER AGOSTINI PAUL ARNAUD BERNARD AGUILA MAS MARIA ARNAUD CEDRIC AGUILAR PHILIPPE ARNAUD PAUL AGUILERA BRUNO ARREDONDO MARIE AGUILERA EMMANUEL ARTERRISL ART DE LA TERRE - CENTRALE AGUILERA EPOUSE PI DOROTHEE ARTIGUES JACQUES AGUILERA SANDRINE ASA ASSAINISSEMENT ET IRRIGATI AGUILERA SYLVIE / CORDEL FRANCK ASA CANAL VERNET ET PIA AIMAR JEAN LUC ASENCI EP ROMAN FRANCOISE ALBALAT ARLETTE ASSOC LES RESIDENCES CATALANES ALCARAZ MICHEL ASSOC SYND LIBRE AL RIBERAL ALEMANY ANNE MARIE ASSOCIATION DIOCESAINE DE PERPIGNAN ALIBERT ALAIN ASSOCIATION THUIR SOLIDARITE ALIBERT AUDREY ASTOR - ZUNDEL FAUSTINE ALIN ERIC / BILLES MARIELLE INDIVISION ASTOR LOUIS ALLIER GREGORY / JAKOBONA SANDRINE ASTOR SYLVAIN ALLION BROCH JACQUELINE ASTOR YVES ALLOU KHALID ASTOR YVETTE ALQUIER CATHERINE ATGE MERCEDES ALQUIER CEDRIC ATGE MONTSERRAT ALQUIER PIERRE ATGE RAYMOND AMADO CHRISTINE ATGE SYLVIE AMALRIC CAROLE / FIGUERES DIDIER ATMANI SOUFIANE AMBROSINO BRIGITTE AUBERTHIE THIERRY AMIEL PAULETTE AUDEMARD LAETITIA AMIEL THOMAS AUSSEIL LOUIS ANARELLI BRICE AUSSEIL SYLVIE ANASTASI THIERRY AUTIE ANDRE ANDRE JULIEN MARIE CECILE MICHEL AUZOLLE CHRISTIAN ANDRILLO ALEXIS AYATS SIMONE ANGLAS OLIVIER AYAX ROGER ANGLES JOSETTE AYMERICH JOEL ANGLI ALAIN BADOSA ANDRE ANOLS VIDAL MARTA BADOSA CLEMENT ANTOINE -

Recueil Des Actes Administratifs
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS Recueil spécial 2 février 2021 SOMMAIRE PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES DIRECTION DES SECURITES . Arrêté PREF/DIRSEC/2021033-0001 du 2 février 2021 portant hommage public pour l’appellation Caserne Général Francis Hubert de la caserne de gendarmerie de Pollestres DIRECTION CITOYENNETE ET MIGRATION BRGE . Arrêté PREF/DCM/BRGE/2021028-0003 du 28 janvier 2021 portant nomination des membres des commissions de contrôle chargés de la régularité des listes électorales dans les communes du département des Pyrénées-Orientales DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DELEGATION MER ET LITTORAL . Arrêté DDTM/DML2021033-0001 du 2 février 2021 portant approbation de l’avenant n° 1 de la concession de plage de la commune de Banyuls sur Mer DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES . Décision du 1er janvier 2021 de délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire DIVERS IDEA (Institut Départemental de l’Enfance et de l’Adolescence) . Avis de concours Annexe n°1 - communes + 1 000 habitants avec plusieurs listes Conseillers municipaux 2ème liste Conseillers municipaux 3ème liste Conseillers municipaux- liste ayant COMMUNES + 1000 habitants ARR. CANTON DE Suppléants CM ayant eu le + grand nombre de Suppléants CM ayant eu le + grand nombre de Suppléants CM eu le + grand nombre de sièges sièges sièges AMÉLIE LES BAINS/ PALALDA CÉRET Canton 2 – Le Canigou CREMIEUX-BOUQUET Andrée GASTAL Christine ANDRE François BONASTRE Martine BONET Jacques TOKATLIAN Marc -

Mairie-De-Sainte-Marie-La-Mer-66470
BULLETIN mUNICIPAL N°53 e ienen p.04/05 Le nouveau Conseil Municipal de Sainte-Marie-la-Mer 2020-2026 p.06/07 Spécial Covid-19 p.13 Sécurité vacances juillet / août 2020 Éditorial SOMMAIRE «Traverser n Éditorial ......................................................... page 3 n Proximité ...................................................... pages 12 / 13 De nombreux messages nous proposant de l’aide nous sont la tempête parvenus de la part de Sainte-Marinois. Je remercie à ce propos n Trombinoscope... n Action sociale .......................................... page 15 tous les bénévoles qui ont été de précieux coéquipiers. du nouveau Conseil Municipal .. pages 4 / 5 et reprendre n Primavera .................................................... page 16 Enfin, la sortie du confinement n’a pas été sans son lot de n Spécial Covid - 19 ................................... pages 6 / 7 le cap.» complexité mais là encore je veux rendre hommage à la grande n Cadre de vie .............................................. page 17 réactivité et à l’efficacité de nos services. Les écoles ont été n Tempête Gloria 2019 ............................ page 8 rouvertes en un temps record, dans le respect des consignes n Associations .............................................. page 18 de sécurité. Le Préfet nous a accordé de son côté la réouverture Système d’alerte Si j’étais un capitaine au long des plages grâce à la présentation d’un dossier de qualité. à la population ........................................ page 9 n État-civil ........................................................ page 19 cours je dirais que les mois de confinement que nous venons de traverser ont été une tempête Toutefois ne nous méprenons pas. Si la tempête est passée, n Les orgues de l’église n durant laquelle il a fallu tenir bon, être à chaque instant attentifs la mer n’est pas pour autant redevenue calme. -
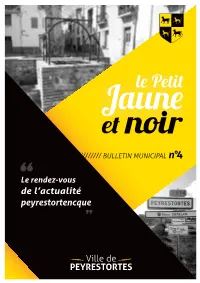
Le Petit Jaune
le Petit Jaune 4 Ville de PEYRESTORTES Edito ///////////////////////////////////////////////////// Etat Civil ///////////////////////////////////////////////////// Ce bulletin n°4 reste en cohérence Ils nous ont quittés avec les précédents, simple, direct et surtout informatif. Votre équipe municipale travaille • Jean POTHET 11/03 dans la continuité pour le bien de tous et cela depuis 5 ans maintenant. Je suis fier • Pierre FAUVART 20/03 du travail effectué, fier de retrouver enfin un village apaisé. Merci à vous tous, habitants, • Guy PASTORET 21/05 associations, enseignants, bénévoles en tout • Thérèse VIDAL 23/05 genre, pour votre contribution à ce mieux vivre ensemble. Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été en espérant vous rencontrer à l’occasion L’équipe municipale présente ses sincères de la fête du village le 29 juin. condoléances aux familles. Alain DARIO Maire de Peyrestortes Sommaire ///////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// p2 Etat Civil p7 Projets Naissances de votre commune p3 Actus • Livio CARMONA 16/05 p8 Solidarité - Citoyenneté p3 Éducation-Scolaire • Jade SIRVEN 25/05 p9 Bon à savoir p4 Environnement Développement durable p10 Festivités Félicitations aux parents et bienvenue aux nouveaux peyrestortencs. Animations p5 Réalisations dans votre commune p12 Ressources humaines 1 2 Actus /////////////////////////////////////////////////////////////// Environnement /// Développement Durable Visite du Préfet Lutte contre le moustique tigre Le 12 mars dernier, Monsieur La totalité du département des Pyrénées-Orientales le Préfet a visité notre canton. est définie en zone de lutte contre le moustique tigre A cette occasion, les domaines (Aedes Albopictus). L’arrêté préfectoral DD-ARS/2019 Brunet et Galabert lui ont été 120-001 fixe les modalités relatives à la lutte contre présentés. -

Plan D'exposition Aux Bruits De L'aéroport De PERPIGNAN-RIVESALTES Enquête Publique : Septembre - Octobre 2020
Dossier n° E202000050 / 34 Communes de CABESTANY – ESPIRA-de-l’AGLY PERPIGNAN - PEYRESTORTES PIA - RIVESALTES relative à l’élaboration d’un PLAN D’EXPOSITION AUX BRUITS générés par les activités de l’Aéroport de PERPIGNAN – RIVESALTES (22 septembre 2020 – 22 octobre 2020) Projet présenté par M. la Direction Générale de l’Aviation Civile (DSAC-Sud) Décision de Mme le Président du Tribunal Administratif en date du 4 août 2020 Arrêté de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales en date du 17 août 2020 Henri ANGELATS Commissaire-enquêteur 12 novembre 2020 SOMMAIRE 1 - RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 4 Préambule Chapitre 1 : Le Plan d'Exposition au Bruit 6 1.1. La place du PEB dans le code de l'environnement 1.2. Présentation de l'aéroport de PERPIGNAN-RIVESALTES 7 1.3. Le PEB opposable 10 12 1.4. Le PEB soumis à l'enquête publique Chapitre 2 : Organisation de l'enquête publique 17 2.1. Procédure 18 2.2. le dossier d'enquête 19 2.2. Préparation de l'enquête publique Chapitre 3 : Les avis formulés avant l’enquête publique 3.1. L'avis de la commune de Cabestany 22 3.2. L'avis de la commune d'Espira-de-l'Agly 22 3.3. L'avis de la commune de Perpignan 23 3.4. L'avis de la commune de Peyrestortes 23 3.5. L'avis de la commune de Pia 24 3.6. L'avis de la commune de Rivesaltes 26 3.7. L'avis de la Commission Consultative de l'Environnement 27 Page 2 Plan d'exposition aux bruits de l'Aéroport de PERPIGNAN-RIVESALTES Enquête publique : septembre - octobre 2020 SOMMAIRE (SUITE) Chapitre 4 : L'enquête publique 29 4.1. -

Fiche ZNIEFF Languedoc-Roussillon
ZNIEFF de type I n° 0000-5099 Plaine viticole de Baixas Identifiant national : 910030492 Modernisation de l'inventaire ZNIEFF Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique Région Languedoc-Roussillon Edition 2008 - 2010 Département(s) : Pyrénées-Orientales Maîtrise d'ouvrage Secrétariat Scientifique et Coordination des données Technique et Coordination "Flore et Habitats Naturels" des données "Faune" avec le soutien financier de : et la collaboration des porteurs de données et du CSRPN Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération ZNIEFF de type I Plaine viticole de Baixas n° 0000-5099 Identifiant national : 910030492 *La projection utilisée pour le calcul des surfaces est le Lambert II étendu. 1. Localisation et description générale - Communes concernées par la ZNIEFF Département des Pyrénées Orientales Code INSEE Nom de la commune Surface absolue (ha) Surface relative (%) 66014 BAIXAS 745 ha 38 % 66140 PEZILLA-LA-RIVIERE 588 ha 30 % 66030 CALCE 317 ha 16 % 66228 VILLENEUVE-LA-RIVIERE 173 ha 9 % 66012 BAHO 116 ha 6 % La ZNIEFF « Plaine viticole de Baixas » est située dans la plaine du Roussillon, à l'est du département des Pyrénées- Orientales et à l'ouest de la ville de Perpignan. Elle englobe un peu plus de 1943 hectares de coteaux viticoles dans la vallée de la Têt, entre le village de Baixas au nord-est et celui de Pézilla-la-Rivière au sud. L'altitude varie entre 60 et 200 mètres. - Description du Paysage (Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon) La plaine