CR CP2 Furans Gland V Def
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
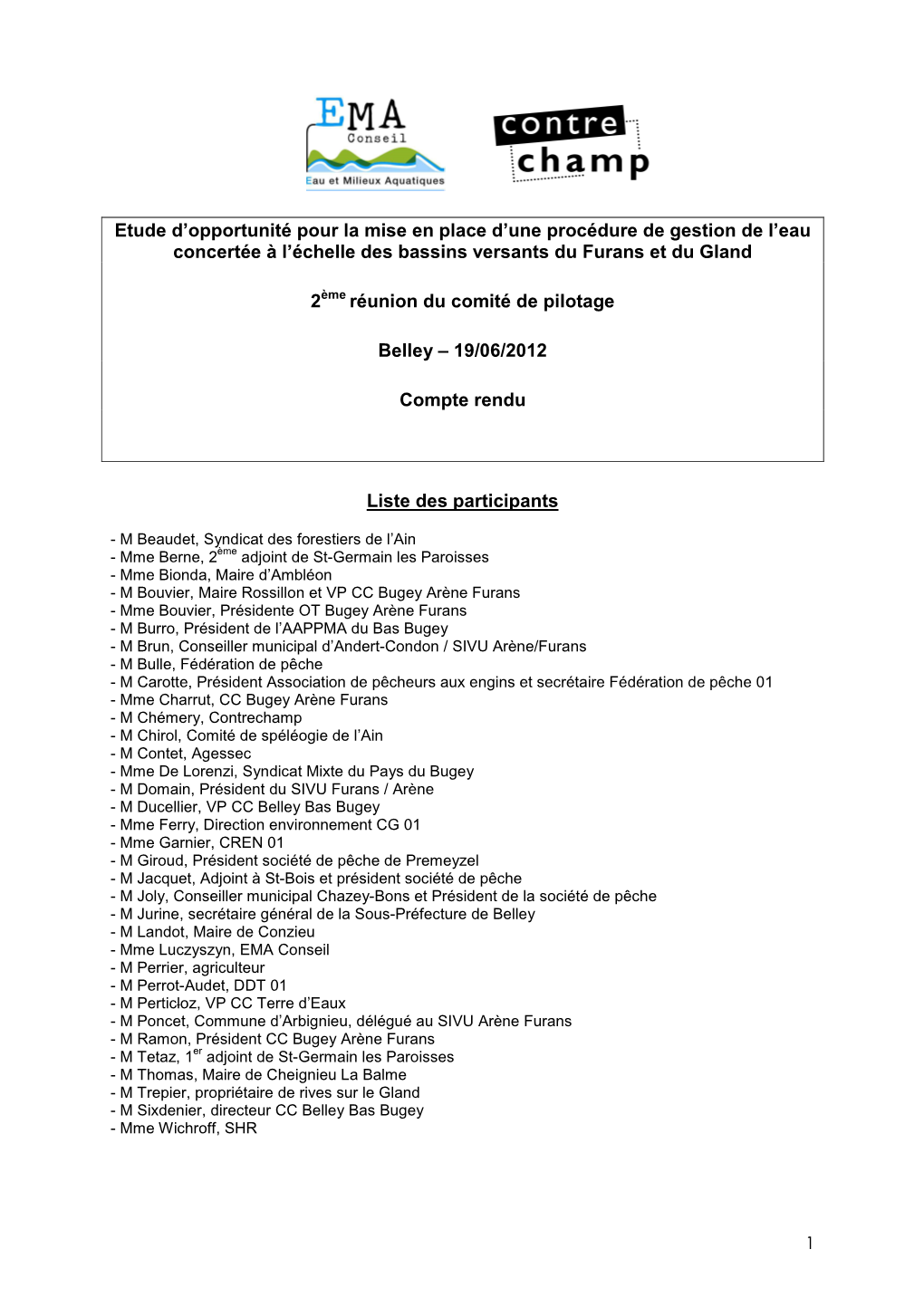
Load more
Recommended publications
-

Le Marais De Conzieu
Le marais de Conzieu Révision du plan de gestion Programme 2010 - 2015 en faveur de la biodiversité Intervenir sur le marais de Conzieu Le travail d’un conservatoire d’espaces naturels Origine du projet Culoz L’intérêt du marais de Conzieu a été découvert en 2000 lors de l’inventaire des tourbières de la région Rhône-Alpes coordonné par le CREN. Il faut savoir qu’en France, la moitié des zones humides a disparu au cours Belley des 30 dernières années et celles-ci ne représentent aujourd’hui plus que 3% du territoire métropolitain. La biodiversité constitue une ressource fondamentale Marais de Conzieu Ces milieux naturels, héritages de périodes très anciennes de notre histoire, pour la collectivité. Elle trouve sa place dans notre quotidien à travers Yenne probablement des dernières grandes glaciations, sont des espaces où des l’alimentation, la santé... Elle a toujours été une source de création conditions particulières (froid, sols gorgés d’eau) ont permis à des plantes artistique, de développement du tourisme… Sa préservation est une Morestel de survivre après la fin des glaciations, trouvant là leurs derniers refuges. préoccupation commune à tous. Ainsi, toutes les tourbières ou les marais comportant encore des espèces précieuses pour le maintien de la biodiversité ont été recensés dans cet Le marais de Conzieu est inventaire. situé sur la commune de Conzieu, au Sud du Bugey. Les conservatoires d’espaces naturels sont des partenaires techniques créés pour aider les collectivités et les usagers à préserver ce patrimoine. Leur statut associatif et leur neutralité leur donnent la possibilité de travailler avec les hommes et les femmes qui sont des acteurs des espaces naturels et de les associer à cette La richesse du marais de Conzieu démarche au travers des comités de pilotage. -

BULLETIN MUNICIPAL Janvier 2015 – N°14
www.saintgermainlesparoisses.fr BULLETIN MUNICIPAL Janvier 2015 – n°14 Lors du mois de mars dernier, les habitants de la commune de Saint- Germain-les-Paroisses ont accordé une majorité importante à la liste « Saint Germain pour demain » que j’ai eu l’honneur de conduire. Conscient des responsabilités et des enjeux futurs qui concernent notre commune, l’ensemble du nouveau conseil municipal s’est mis immédiatement au travail avec pour objectifs de servir au mieux les administrés et de les informer de nos actions. Les sujets qui avaient fait les grands thèmes de la campagne électorale, comme l’école, l’approvisionnement en eau, la mutualisation, sont au cœur de nos préoccupations et sont traités avec la plus grande attention. Il est important de souligner que les baisses de dotation de l’état annoncées à la fin du printemps dernier et qui rentreront en vigueur en 2015, vont nous obliger à être extrêmement vigilant sur les futures dépenses d’investissement et de fonctionnement de la commune. Tenant compte de ce contexte budgétaire contraint, nous serons tout au long de ce nouveau mandat en recherche de solutions et d’actions pour avancer rapidement et pour maintenir des projets structurants qui sont essentiels à la vie du village. Nous avons également la légitimité et le devoir de nous interroger sur l’avenir des petites communes comme Saint-Germain-les-Paroisses au milieu d’intercommunalités de plus en plus grandes ? Comment préserver notre identité et les moyens nécessaires pour bien vivre dans notre paysage rural ? Nous apporterons des propositions pour répondre à ces questions dans le but de construire un véritable projet de territoire dans lequel l’avenir de la commune serait conforté. -

Lac D'armaille
CONZIEU SAINT-GERMAIN-LES-PAROISSES À LA DÉCOUVERTE DU Lac d’Armaille Un espace naturel remarquable Un lac naturel au coeur du Bugey ... Il y a 15 000 ans, les glaciers recouvraient la région. En se retirant, ils ont laissé des «boues» imperméables au fond des dépressions, à l’origine des lacs. Le lac est situé sur Le Bugey sud compte quinze lacs. la commune de Saint-Germain-les- Parmi eux, le lac d’Armaille, d’une surface de Paroisses, au sud-est Bourg-en-Bresse 21ha, présente un paysage exceptionnel et un du département de fonctionnement atypique : son niveau d’eau varie de l’Ain. AIN plusieurs mètres au fil des saisons... Lac d’Armaille 2005 Le lac en hautes eaux 2009 Le lac en basses eaux Du lac à la source d’Armaille Source qui alimente Le lac est en partie alimenté par le ruisseau de le lac. Marchand mais aussi par des eaux souterraines. En effet, l’eau qui circule en sous-sol, ressort parfois sous la forme de sources ou de résurgences. Mais comme l’eau arrive, elle peut aussi repartir ! Ainsi des pertes sont présentes au fond du lac et permettent, à leur tour, d’alimenter d’autres sources. Le lac d’Armaille alimente la source du même nom, la source d’Armaille, à plusieurs centaines de mètres en aval. Elle constitue d’ailleurs un point de captage 2 en eau potable. Le lac, en tant que réservoir d’eau, joue donc un rôle important pour la population. Une biodiversité exceptionnelle La nature sait s’adapter! La nature nous offre ici un bel exemple de ses formidables capacités d’adaptation. -

DDE Ain : Permis De Construire, 1979-1990
DIRECTION DEPARTEMENTALE N° du versement DES TERRITOIRES DE L'AIN 547W VERSEMENT DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT DE L’AIN Service: SUBDIVISION Bureau: BELLEY-CULOZ Sommaire Art 1-35 : Permis de construire. Métrage linéaire: 1979-1990 Nombre d’articles : 35 Dates extrêmes : 3.50 Lieu de conservation: Archives départementales de l’Ain Communicabilité: libre Mission archives 13/03/2014 page 1/7 N° Analyse Début Fin article 1 Permis de construire : Andert-Condon : 79c88179 Barbe jacqueline. 1979 1979 Arbignieu : 79c87028 Aucourt alain. Armix : 79c87184 Union Rénoise des Centres de Vacances. Cheignieu-la-Balme : 79c87021 Anselmet marcel. 79c87020 Lyet suzanne. 79c88712 Miraillet clément. 79c85322 Bayle jean- louis. Colomieu : 79c87031 Codex marius. 79c88538 Develay roger. Conzieu : 79c87024 Brun christian. 79c87155 Martin michel. 79c86039 Champier jean. La-Burbanche : 79c92568 Thomas georges. 79c88349 Pommerol lucien. 79c91378 France jean-françois. Massignieu-de-Rives : 79c89987 Dujourdy édouard. 79c88970 Compagnie nationale du Rhône. 2 Permis de construire : Magnieu : 79c90804 Poncet fernand. 79c89986 Favre 1979 1979 jean. Peyrieu : 79c91083 commune de peyrieu . Pugieu : 79c89315 Collier pierre. 79c89224 Ruat jacques. 79c89531 Michaud bernard. Rossillon : 79c87202 Carrara jean. 79c92331 Bodin jacques. 3 Permis de construire : Arbignieu : 80c03020 Ortel roger. Brens : 80c03171 1980 1980 Coopérative agricole laitière Bugey. 80c03211 Serra laurent. Cheignieu-la- Balme : 80c03116 Lemoine michel. 80c03152 Revert julien. Colomieu : 80c03206 Quinet m-j. 80c03181 Naudin Elysé. Contrevoz : 80c03121 Jullien christian. Conzieu : 80c03180 Brun christian. Cuzieu : 80c03255 Cellard serge. Marignieu : 80c03218 Lothammer rené. Nattages : 80c03133 Paste alain. Parves : 80c03117 Gasquez joseph. Rossillon : 80c03224 Bouvier marcel. SAINT-Champ-Chatonod : 80c03238 Buillas robert. Virieu-le-grand : 80c90477 Vernay paul. Virignin : 80c23016 ADAPEI. -

Cahier Des Charges De L'indication Géographique Eau-De-Vie De Vin
Publié au BO AGRI du 19 février 2015 Cahier des charges de l’indication géographique « Eau-de-vie de vin originaire du Bugey » ou « Fine du Bugey » homologué par l ' arrêté du 7 janvier 2015 relatif à l'indication géographique « Fine du Bugey », JORF du 15 janvier 2015, modifié par l’arrêté du 12 février 2015 modifiant l’arrêté du 7 janvier 2015 relatif à l'indication géographique « Fine du Bugey », JORF du 18 février 2015 CAHIER DES CHARGES DE L’INDICATION GEOGRAPHIQUE « Eau-de-vie de vin originaire du Bugey » ou « Fine du Bugey » Partie I Fiche technique 1. Nom et catégorie de la boisson spiritueuse portant l’indication géographique L’indication géographique « Eau-de-vie de vin originaire du Bugey » ou « Fine du Bugey » est enregistrée à l’Annexe III du règlement (CE) n°110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 dans la catégorie de boissons spiritueuses « eau-de-vie de vin », Annexe II, point 4. 2. Description de la boisson spiritueuse comprenant les caractéristiques physiques, chimiques et/ou organoleptiques du produit L'indication géographique « Eau-de-vie de vin originaire du Bugey » ou « Fine du Bugey » désigne des eaux-de-vie ayant été vieillies sous bois au minimum 3 ans. 2.1 Caractéristiques organoleptiques L’« Eau-de-vie de vin originaire du Bugey » ou « Fine du Bugey » se caractérise par une robe limpide et ambrée. Au nez, les principaux arômes de la large palette aromatique sont la vanille, le tabac blond et la brioche grillée. La bouche est ronde et ample avec des arômes dominants de vanille et pruneau. -

Le Journal D'information De Votre Commune
Le Journal d’information de votre commune Bulletin municipal – Janvier 2013 2 |Chazey-Bons – Janvier 2013 Mot du maire Le mot du maire Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2013 à vous, votre famille et vos proches. L’année 2012 a été riche en dossiers importants pour la commune. La livraison et la mise en opération de la nouvelle station d’épuration de Cressieu, la validation du projet final du groupe scolaire avec le lancement de la procédure d’appel d’offre, le renouvellement du contrat d’affermage pour la production et la distribution de l’eau auquel nous avons décidé d’ajouter la gestion de l’assainissement collectif. Ces infrastructures et ces contrats vont dessiner l’organisation de nos services communaux pour de nombreuses années. En cette année 2013 qui sera la dernière année pleine dans le cadre du mandat de ce conseil municipal notre objectif sera de mener à bien les projets en cours. Il s’agit essentiellement du suivi des travaux de construction du groupe scolaire de la commune dont un premier bâtiment sera livré au printemps, de l’aménagement de la placette de Rothonod et de la rénovation de la salle des fêtes. Des travaux de renforcement du réseau électrique seront aussi conduits en coopération avec le Syndicat d’Electricité afin de faire face à la demande générée par les habitations nouvelles. Nous continuerons notre politique d’entretien et d’amélioration des voiries communales avec comme priorité la sécurité des usagers. C’est un point constamment soulevé lors des réunions de quartiers. -

La Rétrospective De La Communauté De Communes Bugey Sud De L'année
Ambléon • Andert-et-Condon • Arboys-en-Bugey • Armix • Artemare • Arvière-en-Valromey • Belley • Béon • Brégnier-Cordon • Brens • Ceyzérieu • Champagne-en-Valromey • Chazey-Bons • Cheignieu-la-Balme • Colomieu • Contrevoz • Conzieu • Cressin- Rochefort • Culoz Cuzieu • Flaxieu • Groslée-Saint-Benoît • Haut-Valromey • Izieu • La Burbanche • Lavours • Magnieu • Marignieu • Massignieu-de-Rives • Murs-et-Gélignieux • Parves-et-Nattages • Peyrieu • Pollieu • Prémeyzel • RossillonLa lettre • Ruffieu • Saint-Germain-les-Paroisses • Saint-Martin-de-Bavel • Talissieu Valromey-sur-Séran • Virieu-le-Grandde BUGEYSUD • Virignin • Vongnes • Ambléon • Andert-et-Condon • Arboys-en-Bugey • Armix • Artemare • Arvière-en-Valromey • Belley • Béon • Brégnier-Cordon • Brens • Ceyzérieu • Champagne-en-Valromey • Chazey-Bons • Cheignieu-la-Balme • Colomieu • Contrevoz# Janvier • Conzieu 2019 • Cressin- Rochefort • Culoz Cuzieu • Flaxieu • Groslée-Saint-Benoît • Haut-Valromey • Izieu • La Burbanche • Lavours • Magnieu • Marignieu • Massignieu-de-Rives • Murs-et-Gélignieux • Parves-et-Nattages • Peyrieu • Pollieu • Prémeyzel • Rossillon • Ruffieu • Saint-Germain-les-Paroisses • Saint-Martin-de-Bavel • Talissieu Valromey-sur-Séran • Virieu-le-Grand • Virignin • Vongnes • Ambléon • Andert-et-Condon • Arboys-en-Bugey • Armix • Artemare • Arvière-en-Valromey • Belley • Béon • Brégnier-Cordon • Brens • Ceyzérieu • Champagne-en-Valromey • Chazey-Bons • Cheignieu-la-Balme • Colomieu • Contrevoz • Conzieu • Cressin- Rochefort • Culoz Cuzieu • Flaxieu • Groslée-Saint-Benoît -

Communiqué De Presse
PRESS RELEASE Paris, 21 September 2018 FIXED AND MOBILE HIGH-SPEED BROADBAND JULY - AUGUST 2018 SFR, THE HIGH-SPEED BROADBAND LEADER, CONTINUES ITS ROLL-OUT THROUGHOUT THE COUNTRY AND LAUNCHES 4G+ OF UP TO 500 MBPS • 97% of the population has 4G coverage with 567 new towns now covered, plus 803 towns get 4G+ • 11 new cities now covered by 4G+ of up to 300 Mbps • SFR launches 4G+ of up to 500 Mbps in Lyon, Saint-Etienne and Marseille • France's first fiber optical(1) infrastructure provider with 11.8 million eligible FTTx connections, in July and August SFR added 234,000 new fiber connections across 308 towns 97% of the population has 4G coverage with 567 new towns now covered, plus 803 towns get 4G+ In July and August 2018, SFR continued to expand its 4G/4G+ network and remains - according to the French National Frequencies Agency (ANFR)(2) - the provider with the most working 4G antennas in France (33,365 antennas as at end of August). With 97% of the population covered by 4G, in July and August SFR opened up 4G coverage to 567 additional towns, 540 of which have fewer than 3,500 inhabitants, and 4G+ to 803 towns. For example, Menton (06), Annonay (07), Bonnieux (84) and Beaujeu (69) will now enjoy 4G coverage, while Besançon (25), Troyes (10) and Concarneau (29) will benefit from 4G+ (see lists below). 11 new cities now covered by 4G+ of up to 300 Mbps SFR continues to invest in order to provide its customers with 4G+ of up to 300 Mbps, offering them a theoretical maximum speed three times greater than that offered by 4G. -

Approche Spéléologique Et Karstologique
Approche spéléologique et hydrogéologique du karst du Bas-Bugey Communes de Lompnaz – Ordonnaz - Innimond – Marchamp – Ambléon – Conzieu – La Burbanche - Torcieu Mercredi 2 janvier 2008 Sous la conduite d’Yvan ROBIN Compte-rendu de Jean Philippe GRANDCOLAS & les nombreux compléments d’Yvan ROBIN Le Bas-Bugey Participants : GUS (Groupe Ulysse Spéléo - 69) : Anne Martelat – Yvan Robin Clan des Tritons - 69 : Laurent Cadilhac – Fabien Darne – Jean Philippe Grandcolas Suite à notre rencontre avec Yvan à l’exercice-secours début décembre 2007 au gouffre de la Morgne, nous décidons d’une excursion autour du massif du Bas-Bugey. L’objectif de notre promenade « karstique » est d’avoir un aperçu des différents systèmes en cours d’étude et d’exploration dans ce coin du Bas-Bugey. Restent à établir une cartographie avec les différents bassins et les réseaux connus + un inventaire spéléo complet du massif. Approche spéléologique et hydrogéologique du karst du Bas-Bugey- page 1 Notre circuit débute par Villebois vers 9H30. Station 1 : secteur La Rivoire en bordure D32 en direction d’Ordonnaz. Station 2 : Trou des Mongols, dans la plaine du Bief, entre Ordonnaz et Innimond. Station 3 : Grotte Moilda – Trous du Serpent – Trou Niquet, dans la plaine de Chanaux. Station 4 : Gouffre du Biolet – Lompnas, secteur la Gravelière. Exploration en cours du GUS (-100). Station 5 : Exsurgence du Perthuis à Marchamp. Trou des Copines en falaise - domine le Perthuis. Carrière paléontologique de Cerin-Marchamp (non visitée). Station 6 : Lac d’Ambléon (pique-nique). Station 7 : panorama dans la descente vers Ambléon. Station 8 : source du Setrin à Ambléon (captage). Station 9 : sources du Gland à Conzieu (captage). -

Liste Électorale - CDG 01 - COLLÈGE REPRESENTANTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
Liste électorale - CDG 01 - COLLÈGE REPRESENTANTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS SCRUTIN du MERCREDI 21 OCTOBRE 2020, 09 : 00 AU MERCREDI 28 OCTOBRE 2020, 16 : 00 Nombre de Etablissements publics Président (Nom) Président (Prénom) voix Agence Départementale d'Ingénierie de l'Ain DEGUERRY Jean 8 CAISSE DES ECOLES de ST VULBAS JACQUIN Marcel 4 CCAS de Belley LAHUERTA Dimitri 33 CCAS de BEYNOST TERRIER Caroline 3 CCAS DE DIVONNE SCATTOLIN Vincent 3 CCAS DE MARBOZ MOIRAUD Christelle 1 CCAS DE MEXIMIEUX RAMEL Jean-Luc 29 CCAS DE ST TRIVIER DE COURTES BRUNET Michel 1 CCAS VILLARS LES DOMBES LARRIEU Pierre 1 CCAS DE VONNAS GIVORD Alain 1 CDG01 REY Bernard 24 COMMUNAUTE DE COMMUNES BRESSE ET BILLOUDET Guy 39 SAONE Communauté de Com. Bugey Sud GODET Pauline 42 Communauté de Communes de la Côtière GUILLOT-VIGNOT Philippe 42 Communauté de Communes de la Dombes DUBOIS Isabelle 41 Communauté de Communes de la Plaine de GUYADER Jean-Louis 65 l’Ain Communauté de Communes de la Veyle GREFFET Christophe 40 Communauté de Communes de Miribel et du TERRIER Caroline 53 plateau Communauté de Com. Dombes Saône Vallée PECHOUX Marc 39 Communauté de Communes du Pays PERREARD Patrick 30 Bellegardien Communauté de Communes Rives de l'Ain Pays DUPUIS Thierry 26 du Cerdon Communauté de Communes Val de Saône DESCHIZEAUX Jean-Claude 52 Centre DYNACITE Office Public de l'Habitat 15 Haut Bugey Agglomération DEGUERRY Jean 146 OPH BOURG HABITAT 17 Elle pourra faire l’objet d’une réactualisation jusqu’au mercredi 14 octobre 2020 au plus tard. Liste électorale - CDG 01 - COLLÈGE REPRESENTANTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS SCRUTIN du MERCREDI 21 OCTOBRE 2020, 09 : 00 AU MERCREDI 28 OCTOBRE 2020, 16 : 00 PAYS DE GEX AGGLOMERATION DUNAND Patrice 135 SDIS de l'Ain BILLOUDET Guy 90 SI Aménag. -

Press Release
PRESS RELEASE Paris, July 8, 2021 In accordance with the agreement signed on December 18, 2020 between Free and the Syndicat Intercommunal d'Énergie et de Communication de l'Ain (SIEA), Free Fiber is now available to homes in the Ain region covered by the Li@in Public Initiative Network. Free’s arrival on this new network further demonstrates its commitment to the rollout of fiber throughout France in line with its aim of having a presence on the networks deployed in local communities. Through the SIEA’s Li@in network, Free is now offering its Fiber services to 25,000 homes (both in apartments and houses) in the following 60 municipalities: Divonne-les-Bains Feillens Trévoux Bellegarde-sur-Valserine Nievroz Balan Collonges Injoux-Genissiat Ambutrix Saint-Jean-de-Gonville Manziat Saint-Maurice-de-Remens Péron Val-Revermont Saint-Jean-sur-Reyssouze Challex Echallon Torcieu Saint-Cyr-sur-Menthon Belmont-Luthézieu Chanay Meillonnas Sault-Brenaz Saint-Jean-de-Thurigneux Saint-Bernard Arboys en Bugey Farges Château-Gaillard Villebois Saint-Nizier-le-Désert Béligneux Pougny Courmangoux 1/3 Bâgé-Dommartin Thil Conzieu Billiat Talissieu Prémeyzel Grilly Druillat Dagneux Belleydoux Confort Ambléon Priay Sainte-Euphémie Plagne Apremont Giron La Burbanche Villes Saint-Sorlin-en-Bugey Reyrieux Samognat Virieu-le-Petit Souclin Saint-Germain-les-Paroisses Saint-Genis-sur-Menthon Asnières-sur-Saône In three months’ time, Free Fiber will be available to over 60,000 homes already covered by the Li@in network. In addition to its presence on this network, Free’s Fiber offerings are already available to all the homes covered by fiber in the medium-populated areas (AMII1) of the Ain region, i.e. -

Carte Des Bassins De Risques Septembre 2015
CARTE DE SITUATION DES BASSINS DE RISQUES septembre 2015 SERMOYER CURCIAT-DONGALON VERNOUX ARBIGNY VESCOURS SAINT-TRIVIER-DE-COURTESCOURTES SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX SAINT-BENIGNE CORMOZ PONT-DE-VAUX CHAVANNES-SUR-REYSSOUZE SERVIGNAT MANTENAY-MONTLIN BEAUPONT REYSSOUZE DOMSURE GORREVOD LESCHEROUX BOZ DIVONNE-LES-BAINS SAINT-ETIENNE-SUR-REYSSOUZE SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE COLIGNY SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE PIRAJOUX VESANCY MIJOUX ASNIERES-SUR-SAONEOZAN FOISSIAT CHEVROUX GEX BOISSEY BEREZIAT JAYAT SALAVRE MANZIAT GRILLY VESINES VERJON MARBOZ VILLEMOTIER ECHENEVEX ETREZ CESSY SAUVERNY MARSONNAS FEILLENS DOMMARTIN POUILLAT DORTAN MALAFRETAZ COURMANGOUX MONTREVEL-EN-BRESSE PRESSIAT VERSONNEX BAGE-LA-VILLE BENY SEGNY SAINT-SULPICE CRAS-SUR-REYSSOUZE GERMAGNAT CROZET CHEVRY LELEX SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT ORNEX BAGE-LE-CHATEL REPLONGES SAINT-LAURENT-SUR-SAONE ARBENT SAINT-ANDRE-DE-BAGE SAINT-MARTIN-LE-CHATEL ATTIGNAT CHAVANNES-SUR-SURAN SAMOGNAT SERGY PREVESSIN-MOENS SAINT-ETIENNE-DU-BOIS TREFFORT-CUISIAT SAINT-GENIS-POUILLY FERNEY-VOLTAIRE CROTTET SAINT-GENIS-SUR-MENTHON CURTAFOND OYONNAX SAINT-CYR-SUR-MENTHON CONFRANCON BELLEYDOUX THOIRY SAINT-JEAN-SUR-VEYLE GEOVREISSET MATAFELON-GRANGES GRIEGES PONT-DE-VEYLE CORVEISSIAT VIRIAT BELLIGNAT POLLIAT MEILLONNAS ECHALLON CHAMPFROMIER CHEZERY-FORENS PERREX SIMANDRE-SUR-SURAN SAINT-JEAN-DE-GONVILLE CORMORANCHE-SUR-SAONE LAIZ MEZERIAT GROISSIAT GIRON SONTHONNAX-LA-MONTAGNE LEGENDE DROM IZERNORE JASSERON BIZIAT MONTCET CRUZILLES-LES-MEPILLAT GRAND-CORENT APREMONT VANDEINS MARTIGNAT PERON BUELLAS BEY SAINT-ANDRE-D'HUIRIAT