Projet ZOMAD
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
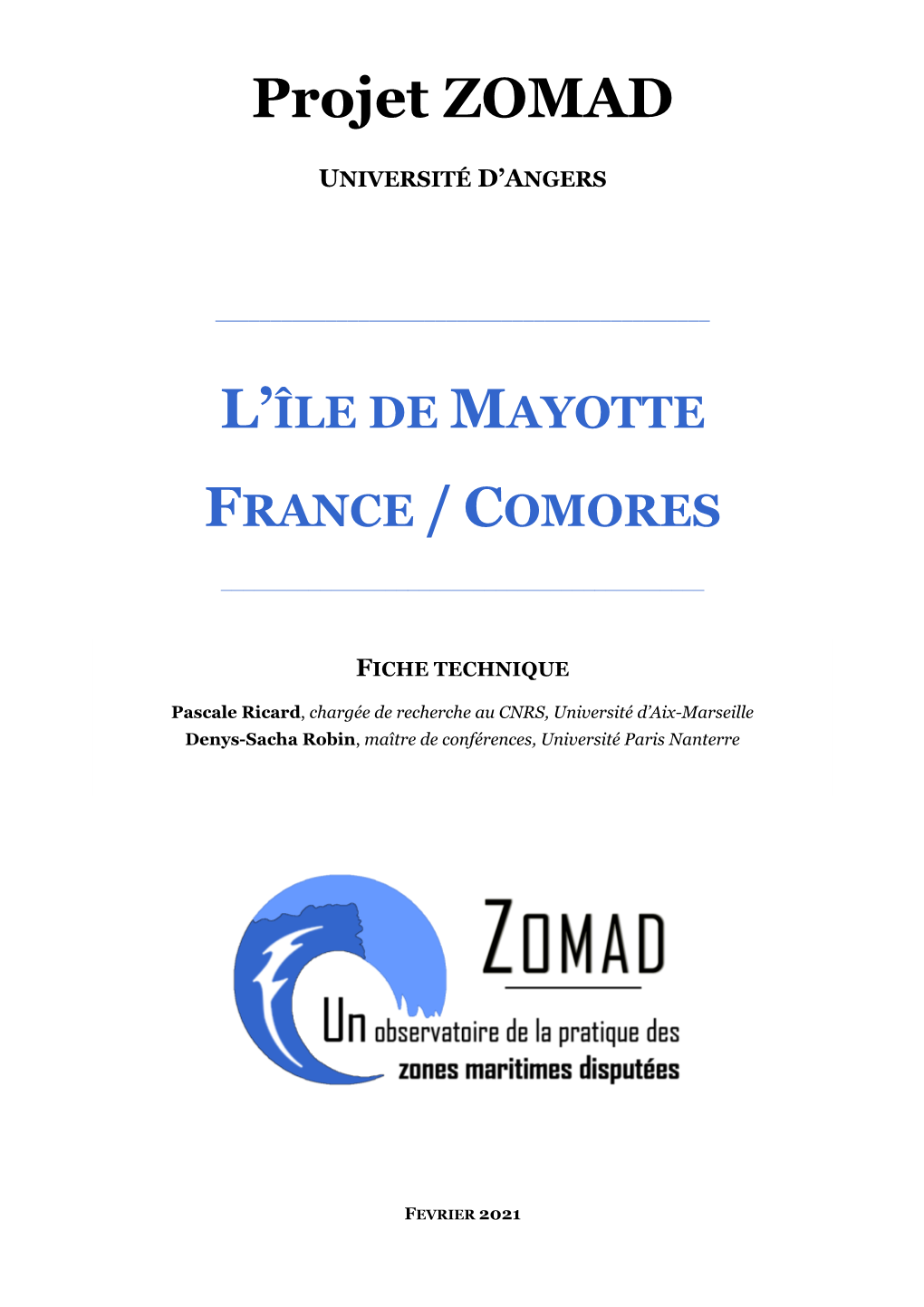
Load more
Recommended publications
-

Formal Name: Union of the Comoros Short Name: Comoros Adjective: Comoran Capital: Moroni Government: Republic LAS Member Since: November 20Th, 1993
Formal Name: Union of the Comoros Short Name: Comoros Adjective: Comoran Capital: Moroni Government: Republic LAS Member since: November 20th, 1993 DEMOGRAPHICS Ethnicity Groups: Antalote, Cafre, Makoa, Independence Day: Oimatsaha, Sakalava July 6, 1975 Religions: Muslim 98%, Roman Catholic 2% Total Area: Languages: Arabic (official), French (official), 2,235 km² Shikomoro Population: Life Expectancy: 63.48 years 766,865 Median Age: 19.2 years Sex Ratio: 0.94 male/female Gross Domestic Product: Literacy Rate: 75.5% $911 million Military Spending: ECONOMY NA% of GDP Labor Force: 233,500 Unemployment Rate: 20% Poverty Rate: 60% Inflation: 2.5% Exports: $19.7 million (vanilla, ylang -ylang, cloves, copra) Imports: $208.8 million (rice and other foodstuffs, consumer goods, petroleum products, cement, transport equipment) 1912 Comoros becomes a French colony 1947 Comoros given representation in the French parliament 1961 Comoros given autonomy from France 1974 3 islands vote for independence; Mayotte votes to stay with France 1975 Comoros unilaterally declares independence, with Ahmed Abdallah as President Abdallah replaced by Prince Sai Mohammed Jaffar through coup 1976 Ali Soilih takes power, pushing for a secular, socialist republic 1978 Soilih toppled, Abdallah is restored to power 1990 Said Mohamed Djohar elected President 1996 Mohamed Abdulkarim Taki elected President; drafts a constitution establishing Islam as the basis of law 1997 The islands of Anjouan and Moheli declare independence from the Comoros 1998 Tadjidine Ben Said Massounde -
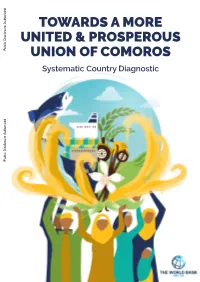
Towards a More United & Prosperous Union of Comoros
TOWARDS A MORE UNITED & PROSPEROUS Public Disclosure Authorized UNION OF COMOROS Systematic Country Diagnostic Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ABBREVIATIONS & ACRONYMS i CPIA Country Policy and Institutional Assessment CSOs Civil Society Organizations DeMPA Debt Management Performance Assessment DPO Development Policy Operation ECP Economic Citizenship Program EEZ Exclusive Economic Zone EU European Union FDI Foreign Direct Investment GDP Gross Domestic Product GNI Gross National Income HCI Human Capital Index HDI Human Development Index ICT Information and Communication Technologies IDA International Development Association IFC International Finance Corporation IMF International Monetary Fund INRAPE National Institute for Research on Agriculture, Fisheries, and the Environment LICs Low-income Countries MDGs Millennium Development Goals MIDA Migration for Development in Africa MSME Micro, Small, and Medium Enterprises NGOs Non-profit Organizations PEFA Public Expenditure and Financial Accountability PPP Public/Private Partnerships R&D Research and Development SADC Southern African Development Community SDGs Sustainable Development Goals SOEs State-Owned Enterprises SSA Sub-Saharan Africa TFP Total Factor Productivity WDI World Development Indicators WTTC World Travel & Tourism Council ii ACKNOWLEDGEMENTS We would like to thank members of the Comoros Country Team from all Global Practices of the World Bank and the International Finance Corporation, as well as the many stakeholders in Comoros (government authorities, think tanks, academia, and civil society organizations, other development partners), who have contributed to the preparation of this document in a strong collaborative process (see Annex 1). We are grateful for their inputs, knowledge and advice. This report has been prepared by a team led by Carolin Geginat (Program Leader EFI, AFSC2) and Jose Luis Diaz Sanchez (Country Economist, GMTA4). -

Situation Linguistique Et Évolution Du Français Contemporain Dans L’Archipel Des Comores
UNIVERSITÉ PALACKÝ D‘OLOMOUC Faculté des Lettres Département d’Études Romanes Situation linguistique et évolution du français contemporain dans l’archipel des Comores Linguistic situation and evolution of contemporary French on the Comoro Islands Mémoire de Licence Auteur : Lucia Hricová Directeur de recherche : Doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Dr. Olomouc 2015 Déclaration Je déclare que le présent mémoire de Licence de thème « Situation linguistique et évolution du français contemporain dans l’archipel des Comores » est le résultat de mon propre travail et que toutes les sources bibliographiques utilisées sont citées. Olomouc, le 5 mai 2015 La signature Remerciement Le présent mémoire de Licence est le résultat d´une collaboration internationale. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à sa réalisation. J´aimerais bien remercier Monsieur Jaromír Kadlec de m´avoir encouragée tout au long de mon travail et d´avoir ensuite surveillé soigneusement la rédaction de la présente étude. Table des matières Introduction ................................................................................................................................... 6 I Généralités ............................................................................................................................ 8 I.1 Géographie .................................................................................................................... 8 I.2 Démographie .............................................................................................................. -

Les Comores À L'assemblée Générale Des Nations Unies
Les Comores à l’Assemblée générale des Nations unies Laurent Sermet To cite this version: Laurent Sermet. Les Comores à l’Assemblée générale des Nations unies : Le “ verbe comorien ” dans les relations internationales institutionnelles et son ambivalence. Carnets de Recherches de l’océan Indien, Université de La Réunion, 2018, Varia. hal-02474946 HAL Id: hal-02474946 https://hal.univ-reunion.fr/hal-02474946 Submitted on 11 Feb 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. 2018 Carnets de Recherches de l’océan Indien N°2 Les Comores à l’Assemblée générale des Nations unies. Le « verbe comorien » dans les relations internationales institutionnelles et son ambivalence* Comoros before the United Nations General Assembly. The “Comorian verb” in International Relations and its Ambivalence Résumé À la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies, le représentant de l’État comorien présente annuellement la situation contemporaine de son pays au reste du Monde. De quoi ses discours sont-ils faits ? Quel est le verbe comorien ? Comment les Comores expliquent-elles le différend qui les oppose à la France sur Mayotte ? Cette étude entend montrer tant la dénonciation de la juridiction française sur Mayotte que l’ambivalence de la diplomatie comorienne. -

Constitutional Reform: Decolonization in the Comoros Islads Nicholas A
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by World Learning SIT Graduate Institute/SIT Study Abroad SIT Digital Collections Capstone Collection SIT Graduate Institute Fall 12-15-2017 Constitutional Reform: Decolonization in the Comoros Islads Nicholas A. Daou SIT Graduate Institute Follow this and additional works at: https://digitalcollections.sit.edu/capstones Part of the African Studies Commons, International Relations Commons, Other International and Area Studies Commons, and the Other Psychology Commons Recommended Citation Daou, Nicholas A., "Constitutional Reform: Decolonization in the Comoros Islads" (2017). Capstone Collection. 3065. https://digitalcollections.sit.edu/capstones/3065 This Thesis (Open Access) is brought to you for free and open access by the SIT Graduate Institute at SIT Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Capstone Collection by an authorized administrator of SIT Digital Collections. For more information, please contact [email protected]. 1 Constitutional Reform: The Decolonization Process in the Comoros Islands By: Nicholas Daou PIM 74 A Course-linked Capstone paper submitted in partial fulfillment of the requirements for a Masters of Arts in Peacebuilding and Conflict Transformation, at SIT Graduate Institute, Brattleboro, Vermont, USA December 2017 Advisor: Tatsushi Arai 2 Consent to Use of Capstone: I hereby grant permission for World Learning to publish my Capstone on its websites and in any of its digital/electronic collections, and to reproduce and transmit my CAPSTONE ELECTRONICALLY. I understand that World Learning’s websites and digital collections are publicly available via the Internet. I agree that World Learning is NOT responsible for any unauthorized use of my capstone by any third party who might access it on the Internet or otherwise. -

Comoros Page 1 of 5
Comoros Page 1 of 5 Published on Freedom House (https://freedomhouse.org) Home > Comoros Comoros Country: Comoros Year: 2016 Freedom Status: Partly Free Political Rights: 3 Civil Liberties: 4 Aggregate Score: 55 Freedom Rating: 3.5 Overview: In January and February 2015, Comoros held competitive parliamentary elections on all three islands. The opposition criticized the election commission for inadequate preparations and alleged widespread use of state resources and state-run companies to support the campaign of President Ikililou Dhoinine’s party. The president’s party won the most seats and formed a parliamentary majority through alliances with smaller parties. The recently formed Juwa Party of former president Ahmed Abdallah Mohamed Sambi was the primary opposition faction. Sambi attempted to run in the presidential election set for early 2016 despite the country’s unique electoral system, which rotates the presidency among the islands. The next president was supposed to come from Grande Comore. At the end of 2015, the Constitutional Court ruled that Sambi, a native of Anjouan but a resident of Grand Comore, was ineligible to register as a candidate. Relations between Comoros and France remain fragile, as Comoros claims the island of Mayotte—a French overseas department—as part of its territory. Large numbers of Comorans illegally migrate to the island in order to seek entry into mainland France, and the Comoran economy, which is primarily agricultural, relies heavily on remittances from Comoran citizens in France. The government announced in June 2015 that members of the diaspora, who reside predominantly in France, would be able to vote in the 2016 https://freedomhouse.org/print/47994 8/29/2016 Comoros Page 2 of 5 presidential election. -

Parcours De Soins Des Patients Comoriens Insuffisants Rénaux Chroniques Terminaux Vers Mayotte
Migration sanitaire au sein de l’archipel des Comores : parcours de soins des patients comoriens insuffisants rénaux chroniques terminaux vers Mayotte Claire Dumont To cite this version: Claire Dumont. Migration sanitaire au sein de l’archipel des Comores : parcours de soins des patients comoriens insuffisants rénaux chroniques terminaux vers Mayotte. Médecine humaine et pathologie. 2016. dumas-01369580 HAL Id: dumas-01369580 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01369580 Submitted on 21 Sep 2016 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Université de Bordeaux 2 – Victor Ségalen U.F.R DES SCIENCES MÉDICALES Année 2015 – 2016 N° 94 Thèse pour l’obtention du DIPLÔME d’État de DOCTEUR EN MÉDECINE Présentée et soutenue publiquement le 28 juin 2016 Par Claire DUMONT Née le 21 octobre 1987 à Romilly-sur-Seine Migration sanitaire au sein de l’archipel des Comores Parcours de soins des patients comoriens insuffisants rénaux chroniques terminaux vers Mayotte Directeur de thèse : M. le Docteur Christophe CARALP Rapporteur de thèse : M. le Professeur Pierre AUBRY Membres du Jury M. le Professeur Denis MALVY Président M. le Professeur Pierre AUBRY Jury M. le Professeur Jean-Marc FRANCO Jury M. -

Press Release
AFRICAN UNION AFRICAN UNION Uniao AFRICANA Addis Ababa, Ethiopia, B. P. : 3243 Tel. : (251-11) 5513 822 Fax: (251-11) 5519 321 Email: [email protected] PRESS RELEASE THE AFRICAN UNION DISPATCHES A HIGH-LEVEL EMISSARY TO THE COMOROS Addis Ababa, 4 December 2015: At the request of the Chairperson of the Commission of the African Union (AU), Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, and as part of the AU’s support to the stabilization process of the Comoros, former President Jakaya Kikwete of Tanzania undertook a one day visit to Moroni on 30 November 2015. The mission took place against the backdrop of the elections scheduled to take place in February and April 2016, for the Governors of the Autonomous Islands and for the rotating presidency of the Union of the Comoros. The successful holding of these elections will go a long way to consolidating the remarkable gains recorded by the Comoros over the past decade, following the protracted separatist and institutional crisis that was resolved thanks to the efforts led by the AU with the support of the larger international community. The objective of the visit was to impress upon the Comorian stakeholders the imperative of demonstrating a high sense of responsibility and contributing to the holding of peaceful, regular and transparent elections in 2016, in line with the relevant provisions of the Comorian Constitution, including those relating to the rotating presidency of the Union of the Comoros. In this respect, it is worth recalling that, at its 545th meeting held on 21 September 2015, the AU Peace and Security Council (PSC) stressed the importance of the smooth holding of the February and April 2016 elections, as a crucial step in the process for deepening reconciliation and strengthening the Comorian institutions. -

Comoros#.Vff3y0zsbde.Cleanprint
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/comoros#.VfF3y0zsbDE.cleanprint Comoros freedomhouse.org In September 2014, President Ikililou Dhoinine abruptly postponed the scheduled November parliamentary elections until late December due to government unpreparedness. No elections had taken place at year’s end. Various international bodies and donors have pursued strategies to assist Comoros with its struggling economy and lacking infrastructure in recent years. In February 2014, the Saudi Fund for Development pledged $40 million toward Comoran infrastructure and health services. Large numbers of Comorans illegally immigrate to the French-administered island of Mayotte to settle or to seek entry into metropolitan France, and the Comoran economy depends heavily on remittances and foreign aid. Tensions remain with France regarding the restrictions on movement between Comoros and Mayotte, which Moroni claims as part of its territory. Political Rights and Civil Liberties: Political Rights: 25 / 40 [Key] A. Electoral Process: 9 / 12 Since 1990, Comorans have voted in several parliamentary and presidential elections, though a pattern of military coups persisted for many years, with the first peaceful transfer of power through elections occurring only in 2006. The unicameral Assembly of the Union consists of 33 members, with 9 selected by the assemblies of the three islands and 24 by direct popular vote; all members serve five-year terms. Each of the three islands is semi-autonomous, with directly elected assemblies and governors. A 2009 referendum approved constitutional reforms increasing the powers of the federal government at the expense of the individual island governments. The reforms instituted a rotation of the federal presidency among the islands every five years. -

Ficha País De Comoras
OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA FICHA PAÍS Unión de Comoras Unión de Comoras La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación pone a disposición de los profesionales de los medios de comunicación y del público en general la presente ficha país. La información contenida en esta ficha país es pública y se ha extraído de diversos medios, no defendiendo posición política alguna ni de este Ministerio ni del Gobierno de España respecto del país sobre el que versa. SEPTIEMBRE 2021 son el árabe; el francés; y el comorano (variación del swahili con numerosas Unión de incorporaciones del árabe, en torno al 33 %, que habla el 96,6% de la población). El comorano presente diversas variaciones dialectales, de fácil Comoras comprensión mutua. Religión: La gran mayoría de la población es musulmana, fundamentalmente suní. Los cristianos representan en torno el 1% de la población del país y la Mitsamiouli Mbéni minoría católica ronda el 0,5%. Moneda: Franco comorense (KMF). 1 euro equivale a 491,81 francos como- renses y 1 dólar americano a 431,65 francos comorenses. Forma de Estado: República presidencialista federal multipartidista. El po- der ejecutivo recae en el Presidente, mientras que el poder legislativo es MORONI Océano Índico compartido entre el Ejecutivo y el Legislativo. Cuenta con parlamento unica- Foumbouni meral, la Asam-blea Nacional, compuesta por 33 diputados elegidos por un Demdéni mandato de 5 años: 24 de sus miembros son elegidos por sufragio universal directo y 9, indirectamente, por los parlamentos locales. Bandera: De proporciones 3 por 2, tiene cuatro franjas horizontales de co- Ouani lores: amarilla, blanca, roja y azul, con un triángulo verde arriba y una luna Moutsamoudou creciente blanca, así como una hilera vertical de 4 estrellas blancas de 5 Domoni puntas. -

Country Report
UNION OF THE COMOROS Vice President in charge of the Ministry of Territory Development, of Infrastructures, Urbanization and Housing COUNTRY REPORT Partnership Municipality / State / non-State Said Ali Andjib National consultant 2015 HABITAT III COUNTRY-REPPORT : UNION OF COMOROS [Date] I Table of contents LIST OF ABREVIATIONS AND ACRONYMS .............................................. Error! Bookmark not defined. PART I : INTRODUCTION AND COUNTRY PRESENTATION .................................................................. VI I. GENERAL INTRODUCTION ........................................................................................................ 7 II. COUNTRY PRESENTATION ........................................................................................................ 8 1.1. GeographicaL LocaLisation ....................................................... Error! Bookmark not defined. 1.2. Area .......................................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.3. PopuLation ................................................................................ Error! Bookmark not defined. 1.4. Use of Lands ............................................................................. Error! Bookmark not defined. 1.5. Independance .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.6. Constitution ............................................................................. Error! Bookmark not defined. 1.7. President .................................................................................