Lexique De L'orgue
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
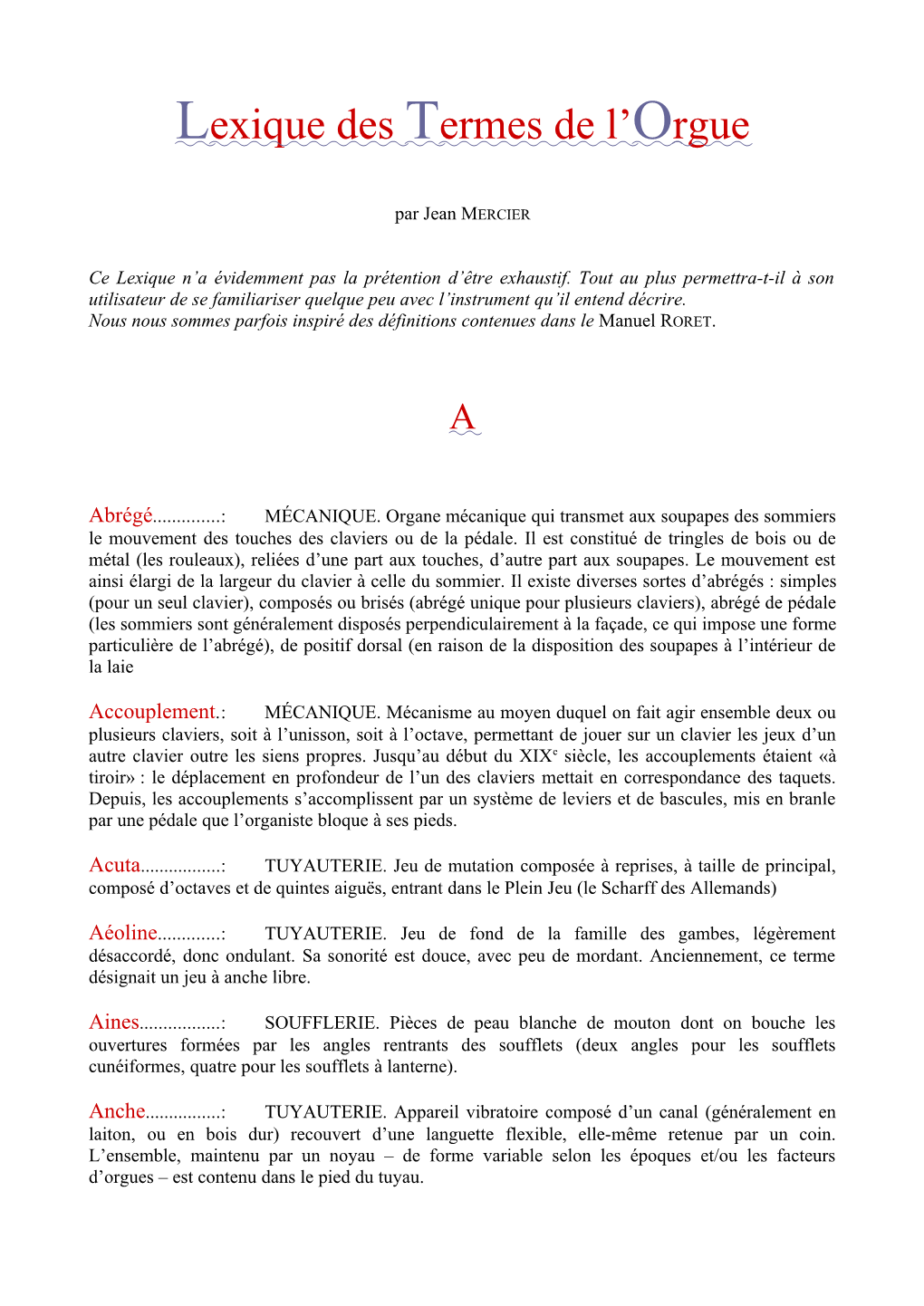
Load more
Recommended publications
-

The Berkshire Organist 2000
535353 2000 Patron : Gillian Weir DBE President 2000-2001 Graham Ireland MMus FRCO Firle Cottage, 5 Heath Road, Southend Bradfield, Reading, RG7 6HQ (0118) 974 4987 Hon Secretary Hon Treasurer Jim A Wooldridge FSCA Mark Jameson 9 Tazewell Court 92 The Hawthorns Bath Road, Reading Charvil, RG1 6HQ Reading, RG10 9TS (0118) 959 0122 (0118) 934 4212 Hon Programme Secretary Benevolent Fund Steward Christine Wells BMus Mrs Evelyn A Fisher FRCO LRAM 7 Beechwood Close Lynton Villa, Pheasants Hill Crays Pond, Goring Heath Hambleden Reading RG8 7SG Henley-on-Thames (01491) 681232 Oxfordshire, RG9 6SD (01491) 571588 Other Committee Members Philip Aspden Michael Humphries Philip Bowcock Gwen Martin Christopher Cipkin David Pether Derek Guy Michael Thomas Jonathan Holl Publicity Officer Donald Hickson 29 Langhams Way, Wargrave Reading, RG10 8AX (0118) 940 3209 Editorial Committee of The Berkshire Organist Philip Bowcock (Co-ordination and Production) Graham Ireland Jim Wooldridge Michael Humphries David Pether Neither the Editors nor the Association accept any responsibility for opinions expressed in this Journal THE BERKSHIRE ORGANISTS ASSOCIATION Registered Charity No 298088 The Berkshire Organists Association was founded at a meeting held on 19 April 1921, arranged by Mr. Percy Scrivener (Founder President) and Mr. Archibald Lusty, who subsequently served as Secretary for 46 years. The Association was affiliated to the National Union of Organists Associations: this body became the Incorporated Association of Organists in 1929, to which we are still affiliated. In 1988 we became a registered charity. Our aims as an Association are: - to promote the art of playing the organ - to encourage the public to appreciate organ music - to provide help and advice to church musicians - to enable organists to meet each other. -

Download the 2014 EROI Festival Program Book
Eastman Rochester Organ Initiative and the Film/Music Cluster of the University of Rochester present October 23–26, 2014 Eastman School of Music Rochester, New York The Eastman Rochester Organ Initiative (EROI) When the Eastman School of Music opened its doors in 1921, it housed the largest and most lavish organ collection in the nation, befitting the interests of its founder, George Eastman. Mr. Eastman provided the School with opulent facilities and stellar faculty, creating an expansive vision for organ art and education in the 20th century. Over the years, the Eastman School has built on this vision by offering one of the most distinguished organ programs in the world. In keeping with this tradition of excellence, the Eastman School of Music has embarked on a long-range plan, the Eastman Rochester Organ Initiative (EROI), which will extend George Eastman’s vision into the 21st century. With the aim of making Rochester a global center for organ performance, research, building, and preservation, the Eastman Rochester Organ Initiative of the Eastman School of Music is assembling a collection of new and historic organs unparalleled in North America. An incomparable teaching resource, this collection offers access to organs of diverse styles and traditions to talented young musicians from around the world. Tourists, scholars, and music lovers are drawn to Rochester to hear the varied sounds of these extraordinary instruments. In its short thirteen-year history, EROI has completed an initial phase that has included the placement of four magnificent instruments in downtown Rochester. A historic Italian Baroque organ was installed in the University of Rochester’s Memorial Art Gallery in 2005. -

CONSOLE ATOS Julaug 50-4 J 6/9/08 11:31 AM Page 1
ATOS JulAug 50-4 J 6/9/08 11:11 AM Page 1 JOURNAL OF THE AMERICAN THEATRE ORGAN SOCIETY JULY | AUGUST 2008 50THEATRE ORGAN YEARS ATTHE CONSOLE ATOS JulAug 50-4 J 6/9/08 11:31 AM Page 1 THEATRE ORGAN JULY | AUGUST 2008 Volume 50 | Number 4 FEATURES THEATRE ORGAN Bob Balfour Memorial 12 Wonder Morton Demystifying the 16 Diaphone Theatre Organ and Its 50 28 History of Innovation YEARS Discography Part 3 34 Richard W. “Dick” Leibert DEPARTMENTS 4 Vox Humana 5 Headquarters 6 Director’s Corner 7 Letters 8 News & Notes 10 Professional Perspectives 32 Vox Pops 50 For the Records 53 Ex Libris 54 Chapter News 65 From the Archives 66 Pipe Piper 71 Around the Circuit On the cover: Geoffrey Paterson concludes his fascinating Dick Leibert annotated discography with a careful examination of recordings made by the organist late in his career. 74 Meeting Minutes THEATRE ORGAN (ISSN 0040-5531) is published bimonthly by the American Theatre Organ Society, Inc., 5 Third Street, Suite 724, San Francisco, California 94103-3200. Periodicals Postage Paid at San 78 Obituaries Francisco, California and at additional mailing offices. Annual subscription of $33.00 paid from members’ dues. POSTMASTER: Send address changes to THEATRE ORGAN, c/o ATOS Membership Office, P.O. Box 5327, Fullerton, California 92838, [email protected]. JULY | AUGUST 2008 1 ATOS JulAug 50-4 J 6/9/08 11:32 AM Page 2 TWO SENSATIONAL NEW RECORDINGS BY JelaniJelani EddingEddingttonon phoenixphoenix renaissancerenaissance 55-manual-manual 106-rank Midmer--LoshLosh symphonic-theatre organ AdrianAdrian W. -

The American Guild of Organists Committee on Professional Education
The Eastman Rochester Organ Initiative extends special thanks to the following generous supporters of the 2011 EROI Festival, “Improvisation and Organ Pedagogy.” American Guild of Organists, Committee on Professional Education • Christ Church • Eastman School of Music • Encore Music Creations • EROI Working Committee • Mellon Foundation • Memorial Art Gallery • Rochester Chapter of the American Guild of Organists • Rochester Theater Organ Society • Sacred Heart Cathedral • Third Presbyterian Church • WXXI Public Broadcasting • Westfield Center The American Guild of Organists Committee on Professional Education The American Guild of Organists (AGO) is the national professional association serving the organ and choral music fields. Founded in 1896 as both an educational and service organization, it sets and maintains high musical standards and promotes the understanding and appreciation of all aspects of organ and choral music. The purpose of the AGO is to promote the organ in its historic and evolving roles, to encourage excellence in the performance of organ and choral music, and to provide a forum for mutual support, inspiration, education, and certification of Guild members. The Guild currently serves approximately 20,000 members in more than 300 local chapters throughout the United States and abroad. The American Organist magazine, the official journal of the AGO and the Associated Pipe Organ Builders of America, reaches an audience of more than 24,000 each month. The AGO’s Committee on Continuing Professional Education creates and promotes Guild programs as “education for a lifetime.” The primary responsibility of this committee is the planning of the biennial National Conference on Organ Pedagogy. In addition, the Committee works through the AGO’s Councillors for the Regions to encourage and promote the Guild’s professional certification program in sacred music. -

The Westfield Center
The Westfield Center The Westfield Center was founded in 1979 by Lynn Edwards and Edward Pepe to fill a need for information about keyboard performance practice and instrument building in historical styles. In pursuing its mission to promote the study and appreciation of the organ and other keyboard instruments, the Westfield Center has become a vital public advocate for keyboard instruments and music. By bringing together professionals and an increasingly diverse music audience, the Center has inspired collaborations among organizations nationally and internationally. In 1999 Roger Sherman became Executive Director and developed several new projects for the Westfield Center, including a radio program, The Organ Loft, which is heard by 30,000 listeners in the Pacific Northwest; and a Westfield Concert Scholar program that promotes young keyboard artists with awareness of historical keyboard performance practice through mentorship and concert opportunities. In addition to these programs, the Westfield Center sponsors an annual conference about significant topics in keyboard performance. Since 2007 Annette Richards, Professor and University Organist at Cornell University, has been the Executive Director of Westfield, and has overseen a new initiative, the publication of Keyboard Perspectives, the Center’s Yearbook, which aims to become a leading journal in the field of keyboard studies. Since 2004, the Westfield Center has partnered with the Eastman School of Music as a cosponsor of the EROI Festival. 1 The Eastman Rochester Organ Initiative (EROI) When the Eastman School of Music opened its doors in 1921, it housed the largest and most lavish organ collection in the nation, befitting the interests of its founder, George Eastman. -
The Berkshire Organist 2004
Patron : Gillian Weir DBE President 2004-2005 Jonathan Holl LRAM ARCO The Old Dairy Farm Winkfield Lane, Winkfield Windsor, Berks, SL4 4RU Hon Secretary Hon Treasurer Alan H Kent Mark Jameson 3 Sewell Avenue 92 The Hawthorns Wokingham, Berks Charvil, Reading, RG41 1NT RG10 9TS (0118) 978 5182 (0118) 934 4212 Hon Programme Secretary Benevolent Fund Steward Christine Wells BMus FRCO Anne Bolam LRAM 6 Hillview Close Lynton Villa, Pheasants Hill Tilehurst Road Hambleden Reading Henley-on-Thames RG31 6YX Oxfordshire, RG9 6SD (0118) 942 1020 (01491) 571588 Publicity Officer Editor, The Berkshire Organist Donald Hickson Philip Bowcock 29 Langhams Way 4 St Anne’s Road Wargrave Caversham, Reading, Reading, RG10 8AX RG4 7PA (0118) 940 3209 (0118) 954 3481 Other Committee Members Christopher Cipkin Graham Ireland Derek Guy Michael Thomas Jim Wooldridge Jill York Peter Chester Julian Greaves Editorial Committee of The Berkshire Organist Christopher Cipkin Graham Ireland Michael Humphries Michael Pickett Neither the Editors nor the Association accept any responsibility for opinions expressed in this Journal THE BERKSHIRE ORGANISTS’ ASSOCIATION Registered Charity No 298088 The Berkshire Organists’ Association was founded at a meeting held on 19 April 1921, arranged by Mr. Percy Scrivener (Founder President) and Mr. Archibald Lusty, who subsequently served as Secretary for 46 years. The Association was affiliated to the National Union of Organists Associations: which became the Incorporated Association of Organists in 1929, and to which we are still affiliated. In 1988 we became a registered charity. Our aims as an Association are: - to promote the art of playing the organ - to encourage the public to appreciate organ music - to provide help and advice to church musicians - to enable organists to meet each other. -
Organ Specifications
8' Chimney Flute 8' Bassoon 8' Flute Conique 8' Orchestral Oboe 8' Flute Celeste 8' Harmonic Trumpet (Swell) 8' Dulciana 4' Octave Tuba St. Matthew Lutheran Church 8' Unda Maris Harp Hanover, Pennsylvania 4' Principal Tremulant 4' Viola D’amour 1' Whistle 4' Waldflöte Solo To Solo 16 2 2/3' Nazard Solo Unison Off 2' Blockflöte Solo To Solo 4 1 3/5' Tierce String 1 1/3' Larigot 16' Double Viole II 1' Sifflöte 8' Violes D’orchestre I Plein Jeu IV 8' Violes D’orchestre II Zimbel III 8' Violins II 16' Baryton 8' Violas D’amour II 8' Clarinet 8’ Violes Sourdine II 8' Oboe D’amour 4' Octaves Violes II 8' Trompette 4' Viole D’amour 8' Regal Cornet De Violes III 8' Vox Humana 8' Vox Humana 4' Rohr Schalmei Zimbelstern Concert Harp On Solo 8' Orchestral Horn (Solo) On Swell 8' Trompette Royale (Solo) On Great Tremulant On Choir Choir To Choir 16 Antiphonal Choir Unison Off 16' Bourdon Choir To Choir 4 8' Principal Solo 8' Melodia 16' Bourdon 8' Gemshorn 8' Diapason 8' Gedeckt 8' Gross Flöte 8' Flauto Dolcissimo 8' Doppel Flöte 8' Flute Celeste 8' Orchestral Flute 8' Viola Da Gamba 8' Dulzflöte 8' Viole Aetheria 8' Gamba 8' Vox Angelica 8' Gamba Celeste 4' Octave 8' Violoncello 4' Fern Flute 8' Violoncello Celeste 4' Dulcet 4' Octave 4' Dulcet Celeste 4' Flute Ouverte 2' Fifteenth 4' Zauber Flöte Mixture IV 2 2/3' Harmonic Stopt 12th Mounted Cornet V 2' Piccolo 16' Double Trumpet Terzian II 16' Waldhorn Fourniture IV 8' Trumpet 16' Bass Trombone 8' Corno D’amore 16' Bass Clarinet 8' Voce Bassetto 8' Trompette Militaire Tremulant 8' Trompette Royale Zimbelstern 8' Tuba Sonora On Solo 8' Orchestral Trombone On Swell 8' Orchestral Horn On Great 8' French Horn On Choir 8' Cornetto Di Bassetto Acuta III-IV Midi On Great II St. -

The Grand Organ Smith 1697; Willis 1872, 1900, 1930, 1949; Mander 1977, 1994, 2008 (Stops with No Date Are from 1872) CHANCEL SECTION
The Grand Organ Smith 1697; Willis 1872, 1900, 1930, 1949; Mander 1977, 1994, 2008 (Stops with no date are from 1872) CHANCEL SECTION GREAT ORGAN (North case) NORTH CHOIR ORGAN (North case) Double Open Diapason 16 part 1697/1977 Chimney Flute 8 1977 Open Diapason I 8 Principal 4 1977 Open Diapason II 8 part 1697 Nason Flute 4 1977 Stopt Diapason 8 1977 Nazard 2⅔ 1977 Claribel Flute 8 1994 Fifteenth 2 1977 Quint 5⅓ Blockflute 2 1977 Principal 4 part 1697 Tierce 1⅗ 1977 Flute 4 1977 Larigot 1⅓ 1977 Twelfth 2⅔ Sharp Mixture 26.29.33.36 IV 1977 Fifteenth 2 part 1697 Trumpet 8 1977 Mixture 17.19.22 III Tremulant Mixture 24.26.29 (16’) III Fourniture 19.22.26.29 IV 1994 SOUTH CHOIR ORGAN (South Case) Trombone 16 Contra Viola 16 part 1977 Trumpet 8 Bourdon 16 1994 Clarion 4 Open Diapason 8 Swell to Great Violoncello 8 Choir to Great Dulciana 8 Solo to Great Claribel Flute 8 Vth to Great Lieblich Gedact 8 1872 moved 1994 Great Reeds on Solo Principal 4 1872 moved 1994 Great Reeds on Pedal Flûte Harmonique 4 1994 Flageolet 2 SWELL ORGAN (South case, enclosed) Sesquialtera 12.17 II 1949 Contra Gamba 16 Corno di Bassetto 8 1994 Open Diapason 8 Tremulant Lieblich Gedact 8 Swell to Choir Salicional 8 Solo to Choir Vox Angelica 8 Vth to Choir Principal 4 Great to Choir Fifteenth 2 Cornet 17.19.22 III SOLO ORGAN (North side, enclosed) Contra Posaune 16 Open Diapason 8 1900 Cornopean 8 Viola 8 1900 Hautboy 8 part 1977 Viola Celeste 8 1951 Vox Humana 8 1977 Flûte Harmonique 8 1900 Clarion 4 Concert Flute 4 Tremulant Piccolo 2 1900 Octave Corno di Bassetto -

Presentation - Organ New Hope Lutheran Church November 26, 2019 Great Falls, Montana Expression Tremulo Antiphonal Echo Great Choir
Presentation - Organ New Hope Lutheran Church November 26, 2019 Great Falls, Montana Expression Tremulo Antiphonal Echo Great Choir Console Set Swell Up Positiv Pedals Stadium Movie House Theater - Electrified Tracker Wurlitzer Action Hydraulis Pipe Calliope Principals Recorders Construction Types Electric Flutes Panpipes Development Chimes Size Pipes Reeds Piano vs Zimblestern Organ Discussion Organ Strings Electric vs Unusuals Pipe Great Falls Baldwin Mozart Piano Color Moeller Allen Harpsichord Borrowings Holtcamp Clavichord Rogers Hammond Mixtures Rogers- Amafi Presentation: Pipe Organ November 26, 2019 New Hope Lutheran Church, Great Falls, MT Organ C. Console Set Up I. Development 1. Great A. Panpipes 2. Swell B. Recorders 3. Pedals II. Unusuals 4. Expression A. Color 5. Tremulo B. Borrowings 6. Antiphonal C. Mixtures 7. Positiv III. Great Falls 8. Choir A. Holtcamp 9. Echo B. Moeller VI. Pipes C. Rogers A. Size D. Rogers-Amafi B. Principals E. Allen C. Flutes F. Baldwin D. Reeds G. Hammond E. Strings IV. Discussion F. Chimes A. Piano vs Organ G. Zimblestern B. Electric vs Pipe VII. Types C. Mozart Piano A. Hydraulis D. Harpsichord B. Pipe E. Clavichord C. Electric V. Construction D. Calliope A. Electrified Action E. Theater - Wurlitzer B. Tracker F. Stadium G. Movie House Organ (music) From Wikipedia, the free encyclopedia In music, the organ (from Greek ὄργανον organon, "organ, instrument, tool") is a keyboard instrument of one or more pipe divisions or other means for producing tones, each played with its own keyboard, played either with the hands on a keyboard or with the feet using pedals. The organ is a relatively old musical instrument, dating from the time of Ctesibius of Alexandria (285–222 BC), who invented the water organ. -
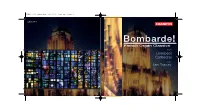
CHAN 9716 Front.Qxd 25/7/07 1:53 Pm Page 1
CHAN 9716 front.qxd 25/7/07 1:53 pm Page 1 CHAN 9716 CHANDOS Bombarde! French Organ Classics from Liverpool Cathedral with Ian Tracey CHAN 9716 BOOK.qxd 25/7/07 1:54 pm Page 2 Eugène Gigout (1844–1925) 1 Grand chœur dialogué 5:18 Léon Boëllmann (1862–1897) Suite gothique, Op. 25 12:23 AKG 2 I Introduction – Choral: Maestoso – 1:55 3 II Menuet gothique: Allegro – 2:08 4 III Prière à Notre-Dame: Très lent 4:17 5 IV Toccata: Allegro 3:59 Gabriel Pierné (1863–1937) Trois pièces 10:10 6 Prélude 2:47 7 Cantilène 3:14 8 Scherzando 4:05 Joseph Bonnet (1884–1944) Charles-Marie Widor Variations de concert, Op. 1 7:07 9 [Theme] – 1:40 10 Variation 1 – 0:25 11 Variation 2 – 0:40 12 Variation 3 – 1:17 13 Variation 4 3:04 3 CHAN 9716 BOOK.qxd 25/7/07 1:54 pm Page 4 Théodore Dubois (1837–1924) from Douze pièces nouvelles Bombarde! 14 9 In paradisum 3:39 Eugène Gigout Trompette Militaire stop, operated by its own Grand chœur dialogué separate blower motor and regulated to fifty- Charles-Marie Widor (1844–1937) Gigout wrote nearly 500 pieces of organ inches pressure. The sixty-one pipes of rolled music during his long career, although only a brass are arrayed 175 feet above the Symphony No. 6 in G, Op. 42 No. 2 32:13 handful, including this Grand chœur dialogué, Cathedral’s vast undertower central space, 15 I Allegro 9:07 are widely played today. -

PHOENIX ORGANS . . . the Ultimate Designed and Developed by Organists
PHOENIX ORGANS . the ultimate Designed and developed by organists ... … for organists Introduction Most, if not all, pipe organ builders will endeavour to provide a bespoke organ. They have no such thing as a "standard range". Nor do we, because we believe that every installation is totally different, and requires the right instrument for the surroundings. The electronic organ industry has been trying for over thirty years to emulate as closely as possible the might and majesty of the "King of Instruments". The pipe organ gets this in part by being designed and adjusted tonally for the room in which it is to be installed. We feel the one thing that a lot of manufacturers have missed is that no two instruments of similar size, even from the same builder, can ever sound the same, and for a manufacturer to come along with Organ Model “A” or “B” or “C”, take it out of its box, plug it in, switch it on and say to the customer “There you are sir, your organ is installed” is not really good enough. Any organ requires detailed setting up, and the chances are that the factory setting is not correct for that particular acoustic. Equally, there is a very good chance that none of the standard models are totally suitable in any case. Old-world craftsmanship and the highest standards of excellence characterise the design and construction of our consoles, using traditional pipe organ components. Everything about a Phoenix Organ makes it authentic to its pipe organ counterpart. The sounds emanating from the instrument, along with the look and feel of the console, will convince you that you are playing a truly fine pipe organ, one that you will enjoy playing over and over again. -

JULY 2018 Summerall Chapel at the Citadel Charleston, South Carolina Cover Feature on Pages 22–23
THE DIAPASON JULY 2018 Summerall Chapel at The Citadel Charleston, South Carolina Cover feature on pages 22–23 www.concertartists.com 860-560-7800 [email protected] PO Box 6507, Detroit, MI 48206-6507 ,Z>^D/>>Z͕WƌĞƐŝĚĞŶƚĐŚĂƌůĞƐŵŝůůĞƌΛĐŽŶĐĞƌƚĂƌƟƐƚƐ͘ĐŽŵ W,/>>/WdZh<EZK͕&ŽƵŶĚĞƌƉŚŝůΛĐŽŶĐĞƌƚĂƌƟƐƚƐ͘ĐŽŵ ANTHONY & BEARD ADAM BRAKEL THE CHENAULTS JAMES DAVID CHRISTIE PETER RICHARD CONTE LYNNE DAVIS ISABELLE DEMERS CLIVE DRISKILL-SMITH DUO MUSART BARCELONA JEREMY FILSELL MICHAEL HEY CHRISTOPHER HOULIHAN DAVID HURD SIMON THOMAS JACOBS MARTIN JEAN HUW LEWIS RENÉE ANNE LOUPRETTE ROBERT MCCORMICK BRUCE NESWICK ORGANIZED RHYTHM RAÚL PRIETO RAMÍREZ JEAN-BAPTISTE ROBIN BENJAMIN SHEEN HERNDON SPILLMAN CAROLE TERRY JOHANN VEXO BRADLEY HUNTER WELCH JOSHUA STAFFORD THOMAS GAYNOR 2016 2017 LONGWOOD GARDENS ST. ALBANS WINNER WINNER 50th Anniversary Season THE DIAPASON Editor’s Notebook Scranton Gillette Communications One Hundred Ninth Year: No. 7, In this issue, we are pleased to present a wide range of short Whole No. 1304 features for your reading pleasure and edifi cation. Yves Rech- JULY 2018 steiner, artistic director of France’s Festival Toulouse les Orgues, Established in 1909 provides us with a historical overview of transcribing music for Stephen Schnurr ISSN 0012-2378 the organ. André Lash gives us a fascinating glimpse into the 847/954-7989; [email protected] culture of the pipe organ in China. You will be amazed to learn of www.TheDiapason.com An International Monthly Devoted to the Organ, the organ’s growing presence in that part of the world! And Brian the Harpsichord, Carillon, and Church Music Gurley reports on the recent gathering of the Conference of church building and the Schuelke organ at Trinity Evangelical Roman Catholic Cathedral Musicians in Michigan and Indiana.