Les Centrales Hydroélectriques Dans Le Morbihan
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
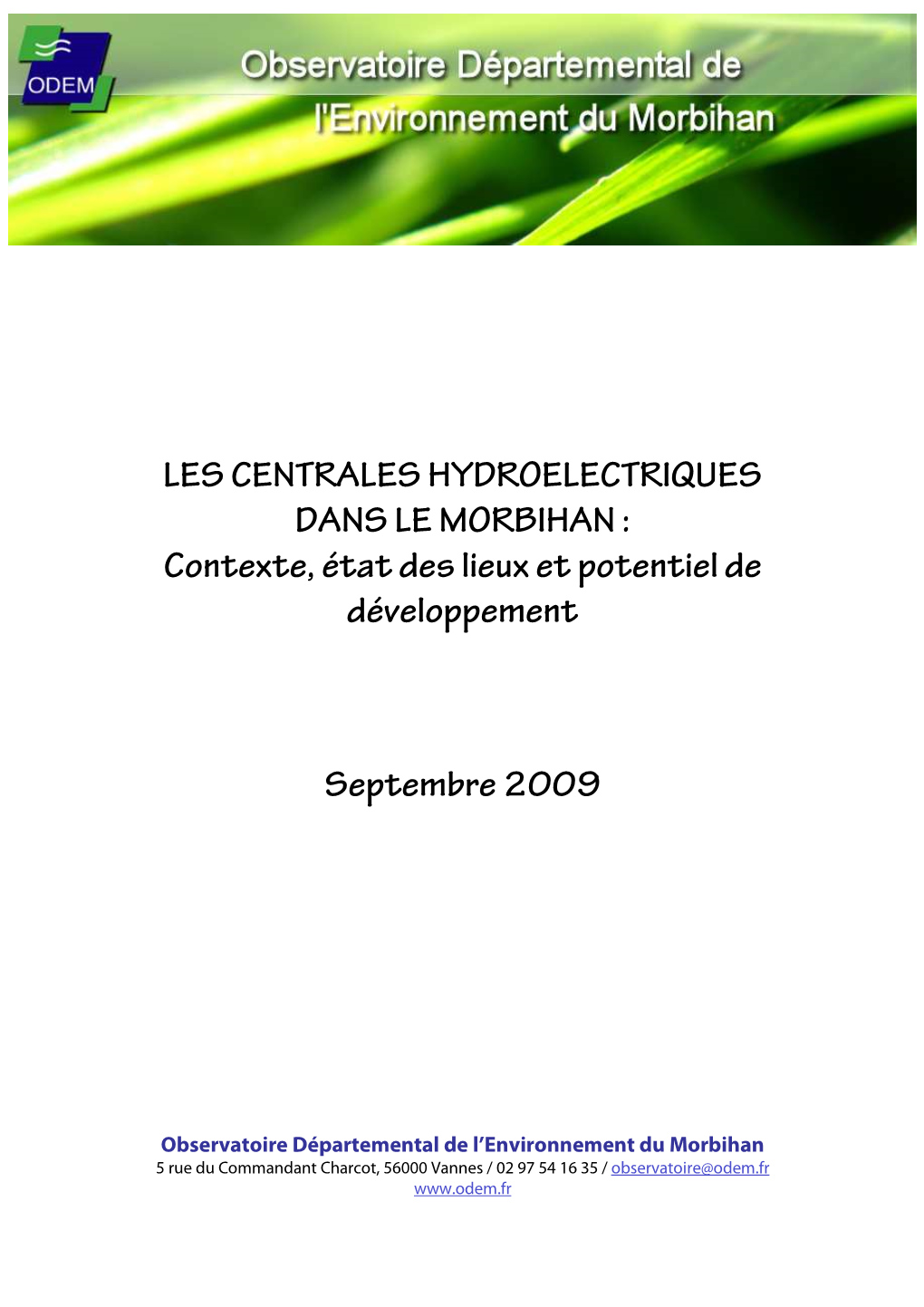
Load more
Recommended publications
-

Les Chiffres Cles Du Tourisme En
LES CHIFFRES CLES DU TOURISME EN 1 5ème département touristique français (clientèles françaises) 13 000 1 MILLIARD D’ EUROS DE EMPLOIS CONSOMMATION 32,4 MILLIONS DE NUITEES 555 000 LITS TOURISTIQUES 2 PORTRAIT LE MORBIHAN EN CHIFFRES 716 182 habitants (RGP INSEE au 1er janvier 2012) 6 823 km², soit ¼ de la superficie de la Bretagne 261 communes dont 65 communes littorales LES COMMUNES LABELLISEES 5 « Petites Cités de Caractère » (homologuées) : Josselin, La Roche Bernard, Rochefort en Terre, Guémené-sur-Scorff et Malestroit 1 commune labellisée « plus beaux villages de France » : Rochefort-en-Terre 2 « Villes d'Art et d'Histoire » : Lorient et Vannes 1 « Ville et Métier d’Art » : Pont-Scorff 9 « Communes du Patrimoine Rural » : Concoret, Cruguel, Guéhenno, Le Guerno, Noyal-Muzillac, Peillac, Ploërdut, Séglien et Tréhorenteuc 1 commune labellisée « plus beau détour de France » : Pontivy 10 « Stations Vertes de Vacances » : Carentoir, Cléguerec, La Gacilly, Rohan, Silfiac, Saint-Aignan, Priziac, Réguiny, La basse vallée de l’Oust (Peillac/St Martin sur Oust), Questembert 2 « Villages Etapes » : Elven et Josselin 12 « Escales d’une Rive à l’autre » : Peillac, Malestroit, Josselin, Rohan, Pontivy, Pluméliau, Baud - Pont-Augan, Inzinzac-Lochrist, La Roche-Bernard, Saint-Aignan, Saint-Nicolas des Eaux 39 communes labellisées « Villes et Villages fleuris » dont 5 communes labellisées « 4 fleurs » et 2 communes « Grand Prix National » (La Vraie-Croix et Vannes) 3 PORTRAIT LES SITES ET EQUIPEMENTS PHARES DU TOURISME SITES CULTURELS ET DE LOISIRS -

Lejournal GUÉMENÉ SUR SCORFF
Octobre 2019 lejournal GUÉMENÉ SUR SCORFF LE JARDIN INTERGÉNÉRATIONNEL MAISON DE SERVICES AU PUBLIC BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE 2 L’édito . p . 2 Permanences des élus . p . 2 Conseil Municipal . p . 3 Élections Européennes . .. p . 3 État civil . p . 3 Gendarmerie . p . 4 Expositions . p . 4 Circuit de l'eau . p . 4 Travaux . p . 5 L édito Maison de Services Au Public . p . 6-7 En cette période de rentrée et nouvelles offres ont été présen- Inauguration de la Maison Limbour . p . 8 de reprise d’activités pour nos tées. Je souhaite la bienvenue à La Croix Rouge . p . 8 établissements scolaires et nos l’association Assoleil qui œuvre ADIL . p . 9 associations, je voudrais tout dans trois disciplines le jonglage, L’Épicerie Centrale . p . 9 d’abord souhaiter une année de les percussions et les bulles Sommaire Saison estivale . .. p . 10-11 réussite pour tous. de savon géantes et à Estelle Coté scolaire, nos collèges et D. qui présente aussi tout un EstelleD . p . 12 écoles ont pu démarrer l’année panel d’activités (ateliers de cui- Katell pour vous . p . 12 dans de bonnes conditions. Au- sines, culture du safran, et bien Résidence Clair Logis. p . 13 cune fermeture de classe et les d’autres) au Café Pointu. CCAS . p . 13 équipes pédagogiques au com- Je vous encourage à aller à la La rentrée des classes . p . 14 plet ont contribué à ce constat. rencontre de ce monde associatif École publique Louis Hubert . p . 14 Coté associations, nous avons riche et varié et je ne doute pas vécu un très beau forum et je que vous trouviez l’activité qui École Saint-Jean-Baptiste . -

Commissions Administratives Paritaires
C.A.P. liste des membres Désignation des représentants des élus : 8 juillet 201, 11 décembre 2018 et 4 juin 2020 Election des représentants du personnel : 6 décembre 2018 et désignation de deux suppléants du groupe 6 : 18 décembre 2018 Mise à jour : 1er octobre 2020 Commissions administratives paritaires Catégorie A Représentants des élus Titulaires Joseph BROHAN Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du MORBIHAN Martine LOHÉZIC Maire de LOCMARIA GRAND CHAMP Gaëlle BERTHEVAS Maire de SAINT ABRAHAM Jean-Charles LOHÉ Maire de LOCMALO Jacques MIKUSINSKI Adjoint au Maire de PLOERMEL Jean-Michel BONHOMME Maire de RIANTEC Suppléants Jean-Pierre LE FUR Conseiller municipal de BERNÉ Dominique LE NINIVEN Maire de PRIZIAC Nathalie LE MAGUERESSE Conseillère municipale de LOCMIQUELIC Marc ROPERS Maire de CLÉGUÉREC Marie-Odile JARLIGANT Conseillère municipale d’ARZAL Diane HINGRAY Maire de PLUVIGNER 1/8 C.A.P. liste des membres Désignation des représentants des élus : 8 juillet 201, 11 décembre 2018 et 4 juin 2020 Election des représentants du personnel : 6 décembre 2018 et désignation de deux suppléants du groupe 6 : 18 décembre 2018 Mise à jour : 1er octobre 2020 Représentants du personnel Groupe hiérarchique 5 CFDT Titulaires Christelle LE ROUZIC Commune de QUÉVEN Catherine VELLY N’DIAYE LORIENT HABITAT Isabelle PASCO Commune de SAINT GUYOMARD Suppléants Thierry BAUDOUIN BRETAGNE SUD HABITAT Maryvonne LE ROY MINIER C.C.A.S. de PLOUAY En attente d’autorisation pour figurer sur le site Internet CFE-CGC / FA-FPT / SNDGCT Titulaire Yann RICHARD Commune de PLOUHARNEL Suppléant Xavier ROBERT Centre de gestion de la fonction publique territoriale du MORBIHAN Groupe hiérarchique 6 CFE-CGC / FA-FPT / SNDGCT Titulaires Franck HILLION Commune de LARMOR PLAGE Françoise JÉHANNO EAU du MORBIHAN Suppléants Membre ne souhaite pas que son nom figure sur Internet Philippe CRUARD Centre de gestion de la fonction publique territoriale du MORBIHAN 2/8 C.A.P. -

Monuments Historiques : Travaux Récents Effectués Dans Le Département Du Morbihan
Monuments Historiques : travaux récents effectués dans le département du Morbihan Maj janvier 2015 – copyright Ministère de la Culture – DRAC Bretagne – 02.99.29.67.11 La loi n°78-753 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs stipule ( art.10° l'exercice du droit de communication institué par le présent titre exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers la possibilité de reproduire, diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents communiqués".) Commune Édifice Nature des travaux Date (opération terminée) AMBON Eglise Restauration de la nef 2004 ARZON Tumulus du Petit Mont Restauration et consolidation du tumulus 1997 AURAY Chapelle des Frères du Saint-Esprit Restauration de la chapelle 1997 AURAY Mausolée Cadoudal Restauration du Mausolée 1997 BERRIC Chapelle Notre Dame des Vertus Restauration des voûtes et mise en valeur BREC'H Chapelle du Champ des Martyrs Restauration de la toiture 2010 CALAN Eglise Restauration des maçonneries charpentes et couvertures TF + TC et tranche unique pour 1998 poursuite restauration CALAN Eglise Mise en valeur intérieure 2004 CARNAC Eglise Saint Cornely Restauration des toitures 2010 GUEHENNO Manoir de Le May Travaux intérieurs et finition de l'extérieur 2ème phase 2005 GUEHENNO Calvaire Restauration du calvaire 2007 GUENIN Chapelle Notre Dame de Manéguen Restauration de l'édifice 2010 GUERN Chapelle Nte Dame de Quelven Restauration du clocher prog 92/93 et restauration maçonneries extérieures et intérieures 2002 versant Nord de la nef et transept JOSSELIN Château Restauration -

L'aër À Pont Tournant
L'Aër à Pont Tournant Dépositaires de cartes de pêche EHE: Dépositaires de cartes de pêche Guémené: Priziac / Le Croisty LIBRAIRIE HUARD MILIN RUCHEC LAKE 7 rue du Soleil Milin Ruchec 56320 LE FAOUET 56540 SAINT-CARADEC TREGOMEL Tél : 02 97 23 08 37 Tél : 02 97 51 63 62 Dépositaire d'assortiments migrateurs BAR TABAC PRESSE LA SOURCE BAR RESTAURANT "LA CROIX DES 7 et 9 Rue des Ecoles NATIONS" 56540 LE CROISTY Ce parcours est non La Croix des Nations Tél : 02 97 51 69 72 labellisé par la Fédération Poisson recherché : Truite Fario. 1ère catégorie : Ouverture du 2ème samedi de Mars au nationale de la pêche en 56240 BERNE 3ème dimanche de Septembre. Taille légale de capture: Truite fario : 23cm et 6 France. Tél : 02 97 34 27 11 AAPPMA GUEMENE SUR SCORFF truites/jour/pêcheur. Longueur du Parcours: 4km. Aménagement disponible : Grand Parking "SOCIETE DE PECHE A LA LIGNE DE à Pont Tournant. Largeur moyenne : 8 m. Profondeur moyenne : 70 cm. AAPPMA DU FAOUET "L'ENTENTE DU GUEMENE SUR SCORFF" HAUT ELLE" M. Rémi LE PROVOST - Président M. Benoit BOGARD - Président 9 place Corentin Le Floc'h 2 rue du Midi 56160 LIGNOL 56770 PLOURAY tél : 02 97 27 05 66 tél : 02 97 34 81 12 E-mail : [email protected] L'Aër est un affluent de la rive gauche de la rivière Site Internet : Site Internet : Ellé. Il est également appelé "rivière du Pont-Rouge" http://ehe-lefaouet-plouray.clubeo.com http://peche56.wix.com/aappmaguemene (du nom du pont qui franchit le cours d'eau entre les bourgs de Priziac et Le Croisty). -

Fiches Horaires Scolaires 2021-2020.Xlsx
Vers les Etablissements de PONTIVY MATIN LMMeJV 1422 7H10 LMMeJV 1421 7H07 LMMeJV 1402 7H09 0 Boduic Chapelle 7h10 0 Bann er Lann entrée ZA 7h07 0 Le Golut 7h09 1 Gendarmerie 7h16 1 Bann er Lann - Quélenesse 7h08 1 Kerdréan 7h10 2 Rue Le Gal 7h17 2 Loin du Bruit 7h10 2 rue du Breuil 7h12 3 Cléguérec Centre 7h18 3 Kéranroué 7h12 3 Clandy 7h13 4 Maison asso 7h19 4 Kerlierno 7h15 4 Guernaud 7H14 5 Bellevue 7h20 5 Lenvos 7h16 5 Cosquer 7h15 6 St Jean 7h22 6 Stival Guernal 7h18 6 Kermenaven 7h18 7 Croix du Grain 7h24 7 Rosaire 7h20 7 Cléguérec Centre 7h21 8 Kerault 7h25 8 Porhors 7h21 8 Foyer Logement 7h22 9 Lintever 7h27 9 Porhors 2 7h24 9 Belle Fontaine 7h25 10 Trevelin 7h28 10 Rosaire 2 7h25 10 Trevanec 7h26 11 Cléguérec Porhors 7h30 11 Stival centre 7h27 11 Le Château 7h28 12 Pontivy Stival 7h32 12 Pontivy Plaine 7h32 12 Le reste 7h29 13 Pontivy Plaine 7h36 13 Pontivy Plaine 7h40 LMMeJV 1400 6h39 0 St Caradec Trégomel 6h39 1 Kermascléden( abribus sur place) 6h46 2 Lande de Kergario 6h51 3Lignol 6h53 4Cravial 6h57 5Longueville 6h59 6 Guémené mairie 7h05 7 Guéméné Hopital 7h07 8 Lann-Cozien 7h10 9Lann-Sarre 7h12 10 Pont du Logeo 7h16 11 Pontivy Av Napoléon 1er 7h31 * arrêt exclusivement voyageurs Vers les Etablissements de PONTIVY MATIN Lundis matin 1425 6h15 MMeJV 1416 7H39 Lundis matin 1416 6h20 0 Inguiniel 6h15 0 Toulbahado 6h39 0 Gourin 6h20 1 Plouay cimetière 6h25 1 Ploërdut Eglise 6h45 1 Croas Loas 6h29 2 Le Faouët 6h45 2 la croix de Lanvoc'h 6h48 2 Plouray bascule 6h38 3 Priziac 6h55 3Merzer 6h52 3 Toulbahado 6h47 4 Le Croisty 6h59 4 Langoëlan église 6h55 4 la croix de Lanvoc'h 6h49 5 St Tugdual 7h07 5St Houarno 6h59 5 Merzer 6h53 6 Ploërdut église 7h13 6 Locmalo Eglise 7h06 6 Langoëlan église 6h56 7 Pontivy La plaine 7h40 7 Croix de Carach 7h08 7 St Houarno 7h00 8 Pontivy Av. -

Direction Des Services Départementaux De L'éducation
Ste-Brigitte St-Aignan Gourin Langonnet Plouray Roudouallec Silfiac Kergrist Cléguérec Croixanvec Le Saint Langoëlan St-Gonnery St-Tugdual Ploerdut Séglien Neuillac St-Gérand Ménéac Le Gueltas Brignac Faouët Le Croisty Guémené/Scorff Rohan Guiscriff Priziac Pontivy La Trinité Porhoët Locmalo Evriguet St-Brieuc St-Caradec Malguénac Noyal-Pontivy de Mauron St-Léry Trégomel Lignol Bréhan Guern Le Sourn Kerfourn Mohon Mauron Lanvénégen Kernascléden Persquen Crédin Guilliers Concoret Meslan St Thuriau Les Forges Bieuzy Berné St-Malo des Les Eaux Naizin Trois Fontaines Néant/Yvel Bubry Moustoir Pleugriffet La Grée Melrand Réguiny St-Laurent Inguiniel Remungol Lannoué Tréhorenteuc Pluméliau Loyat La Croix Hélléan Plouay Radenac Hélléan Lantillac Taupont St-Barthélèmy Josselin Campénéac Beignon Moréac St-Malo de Beignon Lanvaudan Quistinic Remungol Guégon Buléon Guillac Gourhel Calan Guénin St-Allouestre St-Servant Cléguer Baud Plumelin Guéhenno Ploërmel Augan Porcaro Pont- sur Oust Locminé Bignan Montertelot Guer Scorff Inzinzac Quily La Chapelle Neuve Billio Cruguel Monterrein Languidic Le Roc La Chapelle Lizio St-AndréCaro Monteneuf Caudan Camors Moustoir-Ac Caro Gestel Hennebont St-Jean Réminiac Guidel St-Abraham Brandérion Brévelay Quéven Colpo Plumelec Sérent St-Marcel Missiriac Ruffiac Tréal Quelneuc Lanester Brandivy Malestroit Carentoir Kervignac Pluvigner Lorient Nostang Landévant GrandchampLocqueltas St-Laurent Plaudren Trédion Bohal sur Oust St-Nicolas Ploëmeur Merlevenez St-Guyomard St-Congard du Tertre La Chapelle Locmiquélic Landaul -

Service Hydraulique an II-1953
Service archives Service hydraulique an II-1953 Répertoire numérique détaillé 7 S 1-1820 par Danielle Pellerin ; sous la direction de Florent Lenègre Vannes 2013 7 S Service hydraulique 2 Identification Référence de l'inventaire FRAD056_00000007S Référence service d'archives Archives départementales du Morbihan Intitulé Service hydraulique Cotes extrêmes 7 S 1-1820 Dates extrêmes an II-1953 Niveau de description Fonds Nombre d'éléments 1 820 articles Métrage 27,7 m.l. Resp. accès intellectuel Archives départementales du Morbihan Contexte Nom du producteur Préfecture du Morbihan Ponts et Chaussées Catégorie producteur administration Présentation du producteur La sous-série 7 S regroupe les dossiers concernant la gestion des eaux non navigables, non flottables. Les archives rassemblées dans cette sous-série sont issues pour partie des services de la préfecture et pour partie du service hydraulique créé en 1848, agissant pour le compte du ministère de l'Agriculture et placé sous l'autorité des services des Ponts et Chaussées. PRÉFECTURE Le rôle du service hydraulique est essentiellement administratif : suivi et contrôle des dossiers d'aménagements et de travaux, vérification des budgets, comptes administratifs et comptes de gestion des associations syndicales. Le rôle du préfet est en effet de vérifier et d'approuver les différents projets soumis par l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées ou par les différents directeurs des associations syndicales autorisées. Après la Révolution, des particuliers érigent de nouveaux moulins et réclament des droits sur l'eau. Le principe retenu est que l'eau n'appartient à personne mais est d'usage commun. Les lois de 1790 et 1791 donnent pouvoir à l'administration de régler les problèmes. -

PAYS DU ROI MORVAN TRANSPORTS TAILLARD - 02 97 38 04 16 � LIGNE BREIZHGO (EX TIM) N°15 : CTM - 02 97 01 22 01
RMCom À LA EN SAVOIR PLUS Le réseau de transport DEMANDE devient de la Région Bretagne Sur le réseau BreizhGo (ex Tim) Pour tout connaitre sur les horaires, arrêts, tarifs : 0 800 01 01 56 (Gratuit depuis un poste fi xe ou un mobile) Du lundi au samedi 7 h 30 à 19 h RMCom www.breizhgo.bzh À LA DEMANDE Pour une information en situation perturbée (retards, incidents, grèves, intempéries…) contactez directement le transporteur : � LIGNE BREIZHGO (EX TIM) n°14 : PAYS DU ROI MORVAN TRANSPORTS TAILLARD - 02 97 38 04 16 � LIGNE BREIZHGO (EX TIM) n°15 : CTM - 02 97 01 22 01 Le Conseil régional de Bretagne, aujourd’hui responsable de l’organisation des transports interurbains, scolaires (hors agglomérations), ferroviaire (TER) et des liaisons maritimes avec les îles a fait le choix de rassembler ÉTÉ 2019 l’ensemble de ce grand réseau de transport sous un nom unique : Horaires valables du 06/07/2019 au 01/09/2019 BreizhGo. Le réseau de cars interurbains TIM change donc de nom pour BreizhGo. RMC_a_la_demande_Ete2019.indd 12-1 12/06/2019 10:14 RMCom RMCom À LA À CHACUN SON TARIF À LA PRATIQUE DEMANDE DEMANDE BILLETS Billet • Billet vendu à bord des cars, avec Carte de • Pour tous (Carte non nominative). unitaire correspondance gratuite avec une autre 10 voyages • 10 voyages sur une même ligne sur une TRANSPORTS À LA DEMANDE ligne BreizhGo (ex Tim), dans les 2h période de 6 mois, avec correspondance € maximum suivant le voyage initial (heure € gratuite avec une autre ligne BreizhGo Pour les services signalés par ce symbole, 2 de référence = heure de validation de la 15 (ex Tim), dans les 2h maximum suivant réservation obligatoire au : montée dans le car). -

Circuit Rond De Saint-Vincent Persquen
PERSQUEN Le Rond de St-Vincent 5,6 km Variante : b - - - - - Balisage jaune Les sentiers sont aménagés sur do- maines public et privé. Respectons la nature et les aménagements, les propriétés privées (clôtures…) et les activités agricoles (animaux…). Pont et fontaine à Saint-Vincent Edition janvier 2013 Crédit photo Syndicat du Scorff Départ : Pas à Pas : D Chapelle Notre-Dame de Penety. Chapelle Notre-Dame de Penety Accès du bourg par la D130, direction Lignol, tourner à ç Ruisseau de Manerbec la cinquième à gauche et continuer tout droit jusqu’au village (chapelle à gauche en contrebas). é Beg an Ale (château de Penvern) èèè “Pont Romain” Sentier des Sources à l’Océan êêê Saint-Vincent Portion entre le Château de Penvern et le Saint-Vincent Balisage bleu clair 1,5 km PERSQUEN Le Rond de St-Vincent A découvrir en chemin Tout en parcourant le rond de Saint-Vincent, vous découvrirez la diversité des paysages de Persquen, chemins en sous-bois et le long des ruisseaux, prairies, zones humides et bocage. La richesse de son patrimoine historique vous surprendra, les villages de Saint-Vincent et de Penety avec leurs maisons rurales construites autour de leurs chapelles, le patrimoine lié à l’eau, fontaines, gués et pont... La chapelle St-Vincent et son enclos Gué sur le Saint-Vincent Chapelle Notre-Dame de Penety Stèle funéraire de l’âge du fer christianisée Pas à pas D1 Au départ de la chapelle de culture pour aboutir à la route à au lieu-dit « Pont romain » pour Notre-Dame de Penety, dos à l’édifice, Beg an Ale (littéralement “bouche bifurquer à droite et rejoindre le prenez à droite pour sortir du lieu-dit ou pointe de l’allée”, c’est-à-dire pont du Stum et Saint-Yves à Li- en direction du château de Penvern. -

« Un Peu De Trèfle, Ce N'est Pas Gênant »
TERRE POLLUTION Peu à peu les communes se tournent vers le zéro phyto pour l’entretien de leurs espaces verts. Exemples avec celles du bassin versant du Scorff. Hervé Cohonner Hervé « Un peu de trèfle, ce n’est pas gênant » / n°43 novembre-décembre 2018 / n°43 novembre-décembre epuis maintenant une dizaine d’années, les cimetières sans usage de promenade par exemple. Depuis 2017, collectivités et intercommunalités bretonnes « La Bretagne veut se montrer particulièrement ver- les collectivités se sont engagées sur la voie d’un entretien tueuse dans ce domaine, car la Région recèle de ont banni de D leurs usages plus naturel de leurs espaces verts. L'objectif est de nombreuses eaux de surfaces qui sont plus sujettes les désherbants diminuer l’utilisation de pesticides, notamment les à la pollution que les eaux souterraines », explique chimiques. produits phytosanitaires, afin d’éviter la contami- Stéphane Gourmaud, chargé de mission politique nation des eaux souterraines et de surfaces (ruis- de l’eau à la Région, qui a créé en 2009 le label « zéro seaux, rivières, lacs, étangs…) par ces derniers. phyto » pour récompenser les meilleurs élèves. Dix Promues par la Région, ces nouvelles pratiques ans plus tard, elles sont 300, représentant 25 % de vont au-delà de la loi qui, si elle prévoit l’interdiction la population bretonne, à avoir obtenu ce label. de produits chimiques, autorise encore quelques Sur le bassin versant du Scorff, qui couvre trente Les Nouvelles de Lorient Agglomération Les Nouvelles I exceptions, dans les espaces sportifs clos ou les communes et plus de 770 kilomètres de cours 20 ENVIRONNEMENT d’eau en comptant les affluents, elles sont plu- adhèrent à ce type de gestion plus subtile. -

Permis Exclusif De Recherches « Silfiac » (Départements Des Côtes D’Armor Et Du Morbihan) Société Variscan Mines
Permis Exclusif de Recherches « Silfiac » (départements des Côtes d’Armor et du Morbihan) Société Variscan Mines 1. - Contexte et objectif du projet La société Variscan Mines a déposé le 22 février 2013 une demande de permis exclusif de recherches de mines de zinc, plomb, étain, or, argent, tungstène, germanium et substances connexes dit « Permis de Silfiac » pour une durée de 5 ans. Cette demande couvre une superficie de 173 km² et concerne les communes de Gouarec, Lescouët- Gouarec, Perret, Plélauff, Plouguernevel (département des Côtes d’Armor) et de Bubry, Cléguérec, Guern, Locmalo, Malguénac, Melrand, Sainte-Brigitte, Séglien et Silfiac (département du Morbihan). Ce permis est sollicité par Variscan Mines pour des métaux de base et des métaux précieux. Le choix du périmètre a été guidé par les stratégies d'exploration et d'exploitation de la société, ainsi que par les travaux préalables d'analyse des connaissances synthétisées sur le périmètre qui renferme le gisement connu de "Plélauff". Ce gisement est un filon de plomb-zinc avec des teneurs économiques en métaux critiques (germanium, gallium…). La reconnaissance effectuée en 1963 a conclu à une dimension modeste mais ce type de gisement est souvent accompagné par un essaim de gisements similaires dans un environnement proche. Par ailleurs ce type de minéralisation peut être associé à des coupoles de granites spécialisés pouvant renfermer des minéralisations à tungstène et étain. Les nouvelles techniques de forage permettront d'explorer le gisement de Plélauff en profondeur pour découvrir de nouvelles ressources. Une campagne de géophysique aéro ou héliportée est également prévue sur toute la surface du PER afin de localiser les filons et filonnets en liaison spatiale avec apex granitiques ainsi que les minéralisations de sulfures (filons de plomb-zinc et coupoles granitiques à tungstène-étain).