Etat Des Lieux
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
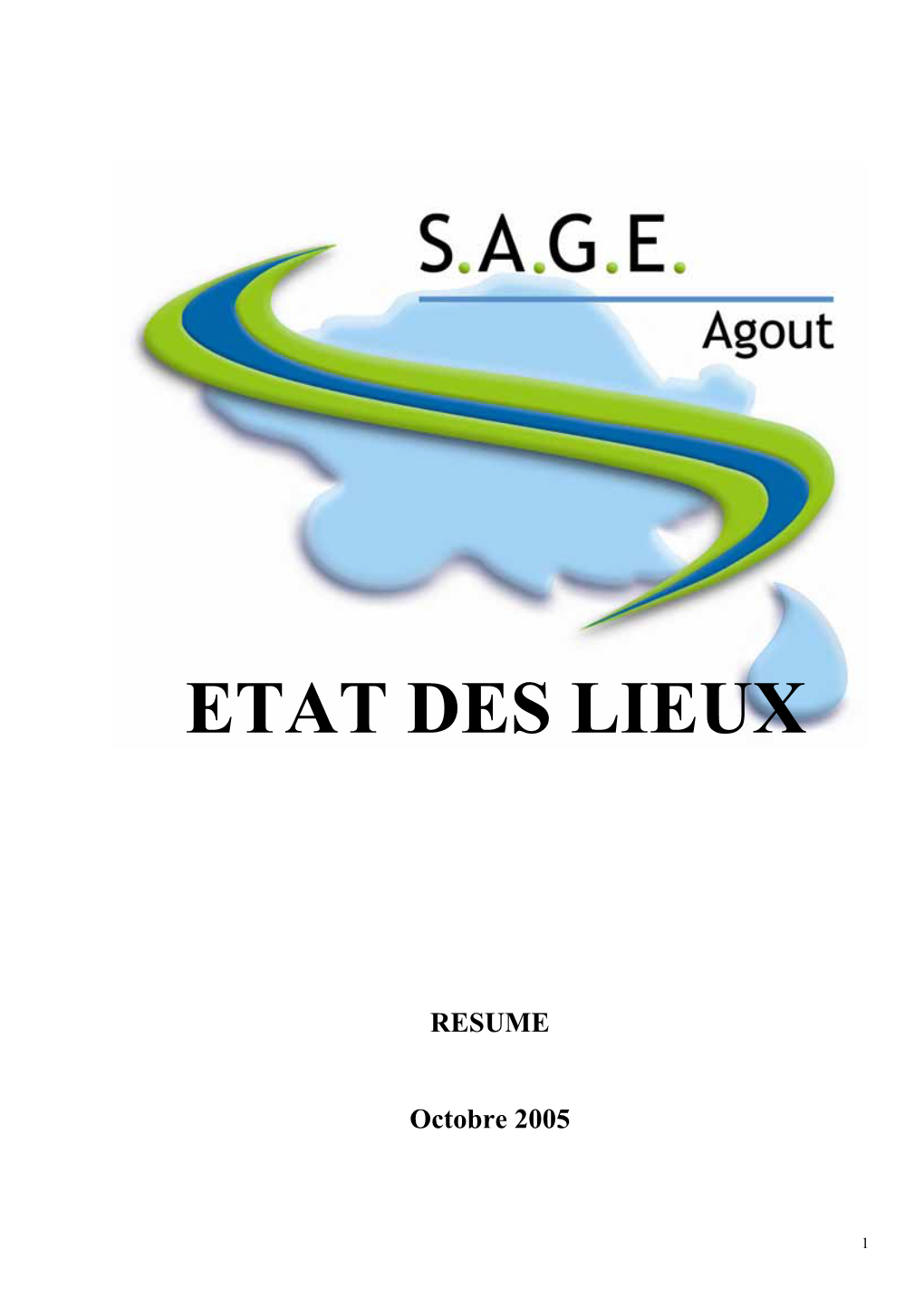
Load more
Recommended publications
-

Document Bach
Bach Chercher dans les matricules requete : Amiel Paul Hector Résultats 9141 à 9180 sur 9182 lancer la requête Matricule Nom Prénoms Année de Lieu de Classe Lieu d'en Cote naissance naissance registreme nt 2 Aussaresse Elie Jean 1899 Lavaur 1919 Saint-Paul- 1R2_246 s (Tarn, Cap-de- France) Joux (Tarn, France ; canton) 21 Jouet Félix 1900 Aguts 1920 Saint-Paul- 1R2_255 Emilien (Tarn, Cap-de- Gaston France) Joux (Tarn, France ; canton) 32 Papaix Emile 1899 Viterbe 1919 Saint-Paul- 1R2_246 Louis (Tarn, Cap-de- Ernest France) Joux (Tarn, France ; canton) 158 Truquet Léon 1900 Lavaur 1920 Lavaur 1R2_255 Gentil (Tarn, (Tarn, Marius France) France ; canton) 34 Navar Albert 1900 Puylaurens 1920 Saint-Paul- 1R2_255 Léon (Tarn, Cap-de- France) Joux (Tarn, France ; canton) 7 Bonhomm Henri 1899 Réalmont 1919 Saint-Paul- 1R2_246 e Parfait (Tarn, Cap-de- France) Joux (Tarn, France ; canton) 20 Garrabe Marceau 1899 Castres 1919 Saint-Paul- 1R2_246 Ernest (Tarn, Cap-de- France) Joux (Tarn, France ; canton) 1/6 2021-09-26 06:43:29 Bach Matricule Nom Prénoms Année de Lieu de Classe Lieu d'en Cote naissance naissance registreme nt 14 Daures Albin 1899 Viterbe 1919 Saint-Paul- 1R2_246 Ernest (Tarn, Cap-de- Ferdinand France) Joux (Tarn, France ; canton) 36 Papaix Paulin 1899 Damiatte 1920 Saint-Paul- 1R2_255 Jules (Tarn, Cap-de- Sylvestre France) Joux (Tarn, France ; canton) 37 Regis Jules 1899 Palleville 1919 Saint-Paul- 1R2_246 Armand (Tarn, Cap-de- France) Joux (Tarn, France ; canton) 13 Ducel Albert 1900 Lacroisille 1920 Saint-Paul- 1R2_255 Achille (Tarn, -

The Dragonfly Fauna of the Aude Department (France): Contribution of the ECOO 2014 Post-Congress Field Trip
Tome 32, fascicule 1, juin 2016 9 The dragonfly fauna of the Aude department (France): contribution of the ECOO 2014 post-congress field trip Par Jean ICHTER 1, Régis KRIEG-JACQUIER 2 & Geert DE KNIJF 3 1 11, rue Michelet, F-94200 Ivry-sur-Seine, France; [email protected] 2 18, rue de la Maconne, F-73000 Barberaz, France; [email protected] 3 Research Institute for Nature and Forest, Rue de Clinique 25, B-1070 Brussels, Belgium; [email protected] Received 8 October 2015 / Revised and accepted 10 mai 2016 Keywords: ATLAS ,AUDE DEPARTMENT ,ECOO 2014, EUROPEAN CONGRESS ON ODONATOLOGY ,FRANCE ,LANGUEDOC -R OUSSILLON ,ODONATA , COENAGRION MERCURIALE ,GOMPHUS FLAVIPES ,GOMPHUS GRASLINII , GOMPHUS SIMILLIMUS ,ONYCHOGOMPHUS UNCATUS , CORDULEGASTER BIDENTATA ,MACROMIA SPLENDENS ,OXYGASTRA CURTISII ,TRITHEMIS ANNULATA . Mots-clés : A TLAS ,AUDE (11), CONGRÈS EUROPÉEN D 'ODONATOLOGIE ,ECOO 2014, FRANCE , L ANGUEDOC -R OUSSILLON ,ODONATES , COENAGRION MERCURIALE ,GOMPHUS FLAVIPES ,GOMPHUS GRASLINII ,GOMPHUS SIMILLIMUS , ONYCHOGOMPHUS UNCATUS ,CORDULEGASTER BIDENTATA ,M ACROMIA SPLENDENS ,OXYGASTRA CURTISII ,TRITHEMIS ANNULATA . Summary – After the third European Congress of Odonatology (ECOO) which took place from 11 to 17 July in Montpellier (France), 21 odonatologists from six countries participated in the week-long field trip that was organised in the Aude department. This area was chosen as it is under- surveyed and offered the participants the possibility to discover the Languedoc-Roussillon region and the dragonfly fauna of southern France. In summary, 43 sites were investigated involving 385 records and 45 dragonfly species. These records could be added to the regional database. No less than five species mentioned in the Habitats Directive ( Coenagrion mercuriale , Gomphus flavipes , G. -

Cheeses Part 2
Ref. Ares(2013)3642812 - 05/12/2013 VI/1551/95T Rev. 1 (PMON\EN\0054,wpd\l) Regulation (EEC) No 2081/92 APPLICATION FOR REGISTRATION: Art. 5 ( ) Art. 17 (X) PDO(X) PGI ( ) National application No 1. Responsible department in the Member State: I.N.D.O. - FOOD POLICY DIRECTORATE - FOOD SECRETARIAT OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD Address/ Dulcinea, 4, 28020 Madrid, Spain Tel. 347.19.67 Fax. 534.76.98 2. Applicant group: (a) Name: Consejo Regulador de la D.O. "IDIAZÁBAL" [Designation of Origin Regulating Body] (b) Address: Granja Modelo Arkaute - Apartado 46 - 01192 Arkaute (Álava), Spain (c) Composition: producer/processor ( X ) other ( ) 3. Name of product: "Queso Idiazábaľ [Idiazábal Cheese] 4. Type of product: (see list) Cheese - Class 1.3 5. Specification: (summary of Article 4) (a) Name: (see 3) "Idiazábal" Designation of Origin (b) Description: Full-fat, matured cheese, cured to half-cured; cylindrical with noticeably flat faces; hard rind and compact paste; weight 1-3 kg. (c) Geographical area: The production and processing areas consist of the Autonomous Community of the Basque Country and part of the Autonomous Community of Navarre. (d) Evidence: Milk with the characteristics described in Articles 5 and 6 from farms registered with the Regulating Body and situated in the production area; the raw material,processing and production are carried out in registered factories under Regulating Body control; the product goes on the market certified and guaranteed by the Regulating Body. (e) Method of production: Milk from "Lacha" and "Carranzana" ewes. Coagulation with rennet at a temperature of 28-32 °C; brine or dry salting; matured for at least 60 days. -

Décembre 2019 35
numéro DÉCEMBRE 2019 35 • Comment aider ceux qui n’ont pas • Comment dans ces grands ensembles Edito accès au merveilleux univers d’inter- régionaux, ces nouvelles collectivités Il ne vous a pas échappé que le renou- net, par lequel toutes les démarches, XXL, conserver la seule valeur qui vellement des conseillers municipaux dites de dématérialisation, sont cen- compte, l’humain ? était programmé pour le mois de mars sées faciliter le quotidien de chacun C’est de conforter et de renforcer par prochain (voir l’article sur ces pro- d’entre nous, quand on sait que 20% une participation massive, le rôle et les chaines échéances). de la population française ne peuvent missions des conseils municipaux qui ou ne savent pas y accéder ? C’est un moment important et straté- sont et doivent rester vos interlocuteurs gique pour les communes qui sont et • Comment faire face à la disparition des attentifs et actifs, en étant plus que ja- doivent rester un facteur de proximité services et des commerces de proxi- mais à votre service dans ce monde de dans un monde en perpétuelle évolution. mité pour les administrés, qu’ils soient plus en plus déshumanisé. Car, c’est bien là l’enjeu essentiel de âgés, travailleurs ou précaires ? cette élection. Le Maire, Alain GLADE • Comment trouver un interlocuteur « Les valeurs humaines sont des richesses • Comment accompagner nos conci- qu’aucunes grandes fortunes monétaires ne pour exposer ses difficultés autrement peuvent acquérir par le pouvoir de l’argent ». toyens dans cette complexité de lois, qu’à travers un répondeur téléphonique Souleymane Boel de directives, de règlements de plus en en appuyant sur la touche 1 ou sur la plus complexes ? Mairie de Briatexte / Journaltouche municipal 2 ? n°32 1 Infos communales > TRAVAUX Voirie Les travaux de voirie prévus au programme 2019 ont été réali- sés, il s’agit de la VC N° 5 (Route de Cabanes) sur la partie la Sommaire plus endommagée et du CR N° 18 (Combets hauts). -

Liste Des Communes
Agel (Hérault) Hérépian (Hérault) Rosis (Hérault) Aiguefonde (Tarn) Joncels (Hérault) Rouairoux (Tarn) Aigues-Vives (Hérault) La Caunette (Hérault) Saint-Amancet (Tarn) Albine (Tarn) La Livinière (Hérault) Saint-Amans-Soult (Tarn) Anglès (Tarn) La Salvetat-sur-Agout Saint-Amans-Valtoret (Tarn) Arfons (Tarn) (Hérault) Saint-Etienne-d'Albagnan Aussillon (Tarn) La Tour-sur-Orb (Hérault) (Hérault) Avène (Hérault) Labastide-Rouairoux (Tarn) Saint-Etienne-d'Estrechoux Azillanet (Hérault) Labruguière (Tarn) (Hérault) Barre (Tarn) Lacabarède (Tarn) Saint-Geniès-de-Varensal Bédarieux (Hérault) Lacaune-les-Bains (Tarn) (Hérault) Berlats (Tarn) Lacaze (Tarn) Saint-Gervais-sur-Mare Berlou (Hérault) Lacrouzette (Tarn) (Hérault) Boisset (Hérault) Lamalou-les-Bains (Hérault) Saint-Jean-de-Minervois Boissezon (Tarn) Lamontélarié (Tarn) (Hérault) Bout-du-Pont-de-l'Arn (Tarn) Lasfaillades (Tarn) Saint-Julien (Hérault) Brassac-sur-Agout (Tarn) Le Bez (Tarn) Saint-Martin-de-L'Arçon Burlats (Tarn) Le Bousquet-d'Orb (Hérault) (Hérault) Cabrerolles (Hérault) Le Masnau-Massuguiès (Tarn) Saint-Nazaire-de-Ladarez Cambon-et-Salvergues Le Poujol-sur-Orb (Hérault) (Hérault) (Hérault) Le Pradal (Hérault) Saint-Pierre-de-Trivisy (Tarn) Cambounès (Tarn) Le Rialet (Tarn) Saint-Pons-de-Thomières Camplong (Hérault) Le Soulié (Hérault) (Hérault) Cassagnoles (Hérault) Le Vintrou (Tarn) Saint-Salvi-de-Carcavès (Tarn) Castanet-le-Haut (Hérault) Les Aires (Hérault) Saint-Salvy-de-La-Balme Caucalières (Tarn) Les -

FICHE R V LAURAGAIS REVEL SOREZ 030919.Indd
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LAURAGAIS REVEL SORÈZOIS 28 communes • 21 360 habitants • 4 zones d’activités PRÉSIDENT : ANDRÉ REY www.revel-lauragais.com VERS TOULOUSE TARN AÉROPORT LEMPAUT VERS CASTRES TOULOUSE/BLAGNAC POUDIS ZA PUECHOURSI BLAN MONTGEY PALLEVILLE SAINT-JULIA GARREVAQUES NOGARET BELLESERRE FALGA CAHUZAC MONTÉGUT-LAURAGAIS ZA MAURENS SAINT-AMANCET ROUMENS VAUX REVEL ZA ZA JUZES BÉLESTA-EN-LAURAGAIS SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS SOREZE DUFORT MOURVILLES-HAUTES ARFONS VAUDREUILLE LES CAMMAZES LES BRUNELS AUDE VERS CARCASSONNE AÉROPORT ZI DE LA POMME 29 % 23 % employés ouvriers Revel Surface disponible : 10 ha Surface totale : 110 ha 23 % 8 149 agriculteurs ACTIFS 13 % autres Service de transports interurbain et interdépartemental : dont Ligne de bus Réseaux routiers et ferrés : 24 % 11 % Autoroute et voie rapide professions cadres et professions 77 % Route intermédiaires intellectuelles supérieures artisans, commerçants Voie ferrée et gare des ZA 2015, IGN 2016 Atlas Occitanie, Région : Cd31-Transports, Sources et chefs d’entreprises Source : données INSEE 2015 2 619 121 1 hypermarché 188 66 15 2 collèges établissements commerces 4 supermarchés km de routes arrêts réseau écoles 2 lycées actifs départementales Arc-en-Ciel UNE QUALITÉ DE VIE PRIVILÉGIÉE Au cœur du triangle Toulouse-Albi-Carcassonne, la Communauté de communes Lauragais Revel Sorèzois rassemble 28 communes réparties sur trois départements (Aude, Haute-Garonne, Tarn). Le territoire s’organise autour du bassin de vie de Revel, avec des accès autoroutiers et aéroports à proximité. -

Programme LEADER Pays De Cocagne 2014 - 2020
Programme LEADER Pays de Cocagne 2014 - 2020 Partenaire de vos projets ! crédit photo : vue sur puylaurens/y. chevojon Le mot du Président Le LEADER, « Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale » est un programme européen de développement des territoires ruraux, accompagnant des projets innovants. En Pays de Cocagne, nous aidons les acteurs publics et privés dans leurs projets touristiques et de loisirs, la valorisation des zones d’activités, la qualification des entrées et des cœurs de bourg, le développement des infrastructures et services pour l’enfance-jeunesse et la santé, la transition énergétique et l’économie de proximité, à l’instar des circuits courts agricoles. Une enveloppe de 2 670 000 € de FEADER (Fonds Européen Agricole pour le DEveloppement Rural) a été attribuée - par la Région Occitanie (Autorité de Gestion des crédits européens) - au Pays de Cocagne pour la période 2014-2020. Elle permet d’accompagner financièrement les porteurs de projet du territoire et complète les moyens propres du « Pays ». Bienvenue au Pays de Cocagne ! Bernard Carayon Maire de Lavaur Conseiller régional d’Occitanie Président du GAL Cocagne Les thèmes du programme en Mener des opérations de valorisation IMPULSER UNE DÉMARCHE TERRITORIALE Qui peut demander une aide ? des entrées et des cœurs de bourg, en AUTOUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU Pays de Cocagne lien avec l’identité pastel MAINTIEN DE L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ Exemples : embellissement des revêtements, UNE DEMANDE DE SUBVENTION PEUT ÊTRE mobilier urbain, traitement -

Téléchargez Le Guide Cocagnol
LE GUIDE DES ENFANTS à partir de 7 ans COCAGNOL Voyage au Pays de Cocagne Des Jeux Des histoires Des idées Tout pour s’amuser ! www.tourisme-tarn.com 2 L'or bleu 4 Paysages Colle ici ta photo 6 La vallée de l'Agout 8 Les pigeonniers 10 La Montagne Noire Je m'appelle .................... 12 Jeux J'ai .... ans et je pars en voyage 14 avec .......................................... SOMMAIRE Découvertes 16 Lieux d'histoire(s) 18 Cités fortifiées 20 Au pied de la montagne 22 Jeux 24 Savoir-faire 26 Artisanat 28 Produits du terroir 30 Jeux Tu trouveras une carte du Pays et un glossaire à la fin du guide Photographie de couverture : pigeonnier à Viterbe. MINI - JEU Bonjour ! Es-tu observateur ? Combien y a-t-il de tournesols Je m'appelle Cocagnol. Je suis un pigeon. sur cette image ? Au dessus des champs de tournesols, je vole et j'admire les paysages de mon Pays de Cocagne. ? pigeonnier le derrière caché est qui Solution : 26 tournesols / Avais-tu vu celui celui vu Avais-tu / tournesols 26 : Solution L'or bleu L'or bleu Une poudre précieuse Autrefois, on cultivait dans le Tarn une plante aux Aux 15e et 16e siècles, le pastel était ! fleurs jaunes : le pastel. À partir de ses feuilles, on l’unique teinture bleue connue À faire élaborait une poudre de teinture bleue. Elle est à en Europe. On l’appelait « l’or l’origine du nom de mon pays. bleu » car c’était un produit pré- À proximité de Saint-Paul-Cap- château de Magrin cieux. -

Dépliant PPN (Carto Rando)
D152E5 St-Félix St-Jean D130 Commune de de-l'Héras D152 de-Buèges D151 D152E1 D33 Laval Roquecezière Lergue D9 Romiguières Belmont Camarès 02 Rocozels D142E2 D142E4 Pas de l’Escalette Commune de D142E2 D25 Pégairolles Masnau sur-Rance 2 Orb Grotte de Labeil Église St-Jacques Temple bouddhiste de-Buèges Massuguiès D902 D82 Fayet Pégairolles D9 Rance Église St-Jean-Baptiste l’Engayresque St-Pierre D130 la Claparède de-l'Escalette la Vacquerie St-Salvi 1 D152 Ceilhes-et-Rocozels 51 de-la-Fage et-St-Martin de-Carcavès D12 D902 A75 de-Castries St-Paul Plan d’eau D138 Roqueredonde Cirque du Bout du Monde de-Massuguiès St-Sever D149 du Bouloc D122 du-Moustier La Méridienne D4 Lac d’Avène D151 Panorama depuis le Caroux © G. Souche G. © Caroux le depuis Panorama Tauriac de-Camarès D89 D142 D151E4 D25 D607 Lauroux D138E2 D32 Brusque D8 D138 Soubès N D902 St-Étienne Secteur GRAND ORB Poujols de-Gourgas D89 52 les Moulières D149 les Salces Senaux D151 Avène Joncelets les Plans D9 D9E1D 3 D138E5 Église Orthodoxe D138 D149 St-Privat D163 Fozières D54 Vinas 5 Mont 4 D153 St-Michel de D153E1Mourcairol © CDRP34St-Baudille la Rouquette D4 Lacaze Joncels D142 Cathédrale (847m) Balisage des randonnéesViane Escroux Prieuré St-Michel St-Guilhem D81 le Coural St-Fulcran D144 Cloître le-Désert Les itinéraires de randonnée pédestre Arnac Chapelle Truscas de Grandmont Gijou sur-Dourdou D163 D153E Soumont sont jalonnés de marques conformes au St-André D35 Lodève D153E5 Usclas modèle en vigueur reproduit ci-dessous. de Rieussec D8 53 6 7 D153E4 Secteur grand orb -

Bulletin Bulletin Municipal N°59
DAMIATTE BULLETIN MUNICIPAL N°59 DECEMBRE 2016 7, avenue de Graulhet - 81 220 DAMIATTE Téléphone: 05.63.70.62.60 Fax: 05.63.70.53.05 E-mail: [email protected] Site internet: http://www.mairie-damiatte.fr Directrice de la publication: Madame FADDI Evelyne, Maire Rédaction du journal, photos et mise en page: La commission communale d’information et de communication - Mlle PALMA Déborah Tirage: 450 exemplaires Je tiens à commencer ce mot du maire en manifestant mon incompréhension devant l’incivilité de certaines personnes qui déposent matelas, téléviseur, canapé et autres encombrants au pied des conteneurs à ordures ménagères. Il serait plus judicieux de se rendre directement à la déchetterie de Guitalens l’Albarède ou de Puylaurens. Le dépôt y est gratuit pour les particuliers alors qu’il est payant pour la commune. A ce tarif s’ajoute le temps passé par le personnel communal pour net- toyer les emplacements et transporter les encombrants jusqu’à la déchetterie. La communauté de communes Lautrécois Pays d’Agout a décidé l’élaboration d’un PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal). Vous trouverez une information détaillée dans les pages de ce bulletin. Un registre est à votre disposition à la mairie pour que vous puissiez y déposer vos re- quêtes ou observations. Certainement avez-vous entendu parler de la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République). Quelles soient obligatoires ou optionnelles, la communauté de communes gère de plus en plus de compétences. Au 1er janvier 2017, les zones d’activités artisanales et industriel- les seront transférées des communes à l’intercommunalité. -

Sectorisation Collèges Par Commune-R2016
Sectorisations des collèges tarnais à la rentrée 2016 Commune de résidence collège de secteur DOURGNE DOURGNE DURFORT DOURGNE ESCOUSSENS LABRUGUIERE ESCROUX LACAUNE ESPERAUSSES BRASSAC FAUCH REALMONT FAUSSERGUES VALENCE-D'ALBIGEOIS FAYSSAC GAILLAC-CAMUS Date: 25/03/2016 FENOLS ALBI-BELLEVUE Commune de résidence Collège de secteur FIAC LAVAUR AGUTS PUYLAURENS FLORENTIN ALBI-BELLEVUE AIGUEFONDE MAZAMET-PAGNOL FRAISSINES ALBAN ALBAN ALBAN FONTRIEU BRASSAC ALBI FRAUSSEILLES CORDES-SUR-CIEL ALBINE LABASTIDE-ROUAIROUX FREJAIROLLES ALBI-BELLEVUE ALGANS-LASTENS LAVAUR FREJEVILLE VIELMUR-SUR-AGOUT ALMAYRAC BLAYE-A.MALROUX GAILLAC ALOS CORDES-SUR-CIEL GARREVAQUES PUYLAURENS AMARENS CORDES-SUR-CIEL GARRIGUES LAVAUR AMBIALET ALBAN GIJOUNET LACAUNE AMBRES LAVAUR GIROUSSENS ST-SULPICE ANDILLAC GAILLAC-CAMUS GRAULHET GRAULHET ANDOUQUE VALENCE-D'ALBIGEOIS GRAZAC RABASTENS ANGLES BRASSAC GUITALENS-LALBAREDE VIELMUR-SUR-AGOUT APPELLE PUYLAURENS ITZAC CORDES-SUR-CIEL ARFONS DOURGNE JONQUIERES LAUTREC ARIFAT REALMONT JOUQUEVIEL BLAYE-A.MALROUX ARTHES ST-JUERY LABARTHE-BLEYS CORDES-SUR-CIEL ASSAC VALENCE-D'ALBIGEOIS LABASTIDE-DE-LEVIS GAILLAC-CAMUS AUSSAC ALBI-BELLEVUE LABASTIDE-DENAT ALBI BALZAC AUSSILLON LABASTIDE-GABAUSSE BLAYE-A.MALROUX BANNIERES LAVAUR LABASTIDE-ROUAIROUX LABASTIDE-ROUAIROUX BARRE LACAUNE LABASTIDE-ST-GEORGES LAVAUR BEAUVAIS-SUR-TESCOU RABASTENS LABESSIERE-CANDEIL GRAULHET BELCASTEL LAVAUR LABOULBENE CASTRES-JAURES BELLEGARDE MARSAL SAINT JUERY LABOUTARIE REALMONT BELLESERRE DOURGNE LABRUGUIERE LABRUGUIERE BERLATS BRASSAC LACABAREDE -

Les Oiseaux Rares Dans Le Tarn Et L'aveyron Deuxième Rapport Du
Les oiseaux rares dans le Tarn et l’Aveyron Deuxième rapport du Comité d'Homologation Tarn-Aveyron Année 2013 Amaury Calvet, Samuel Talhoët et le CHTA. Introduction Ce 2ème rapport du Comité d’Homologation Tarn-Aveyron (CHTA) couvre l’année 2013. 70 fiches, concernant 137 observations, ont été examinées (35 tarnaises et 35 aveyronnaises) et le taux d’acceptation global est de 83 %. Le Comité d’homologation est composé de 8 membres : Timothée Bonnet (LPO Tarn), Pascal Bouet (LPO Aveyron), Amaury Calvet (LPO Tarn), Gilles Cartier (LPO Aveyron), Pierre Chavanon (LPO Tarn), Alain Hardy (LPO Aveyron), Michel Malaterre (Secrétaire - LPO Tarn) et Samuel Talhoet (LPO Aveyron). Le fonctionnement du comité et la liste des espèces soumises à homologation sont consultables sur http://www.faune-tarn-aveyron.org/index.php?m_id=20025 Révision de la liste des espèces soumises à homologation dans le Tarn et l’Aveyron La liste des espèces soumises à homologation dans le Tarn et l’Aveyron reste inchangée à partir du 1er janvier 2014. Validation des fiches Chaque fiche qui parvient au comité est examinée par les huit membres. Une fiche peut être validée ou acceptée par un membre (vote A) ou bien refusée (vote R). Un membre peut aussi demander que la fiche soit discutée en réunion plénière (vote D) ou bien se déclarer non compétent pour donner un avis sur telle ou telle espèce ou pour statuer sur tel ou tel problème d’identification (NC). Si plus de 2 membres se déclarent incompétents, l’avis d’un expert extérieur peut être sollicité. La fiche est acceptée ou refusée par l’avis unanime des membres se déclarant compétents.