Communauté De Communes Du Val D'essonne
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
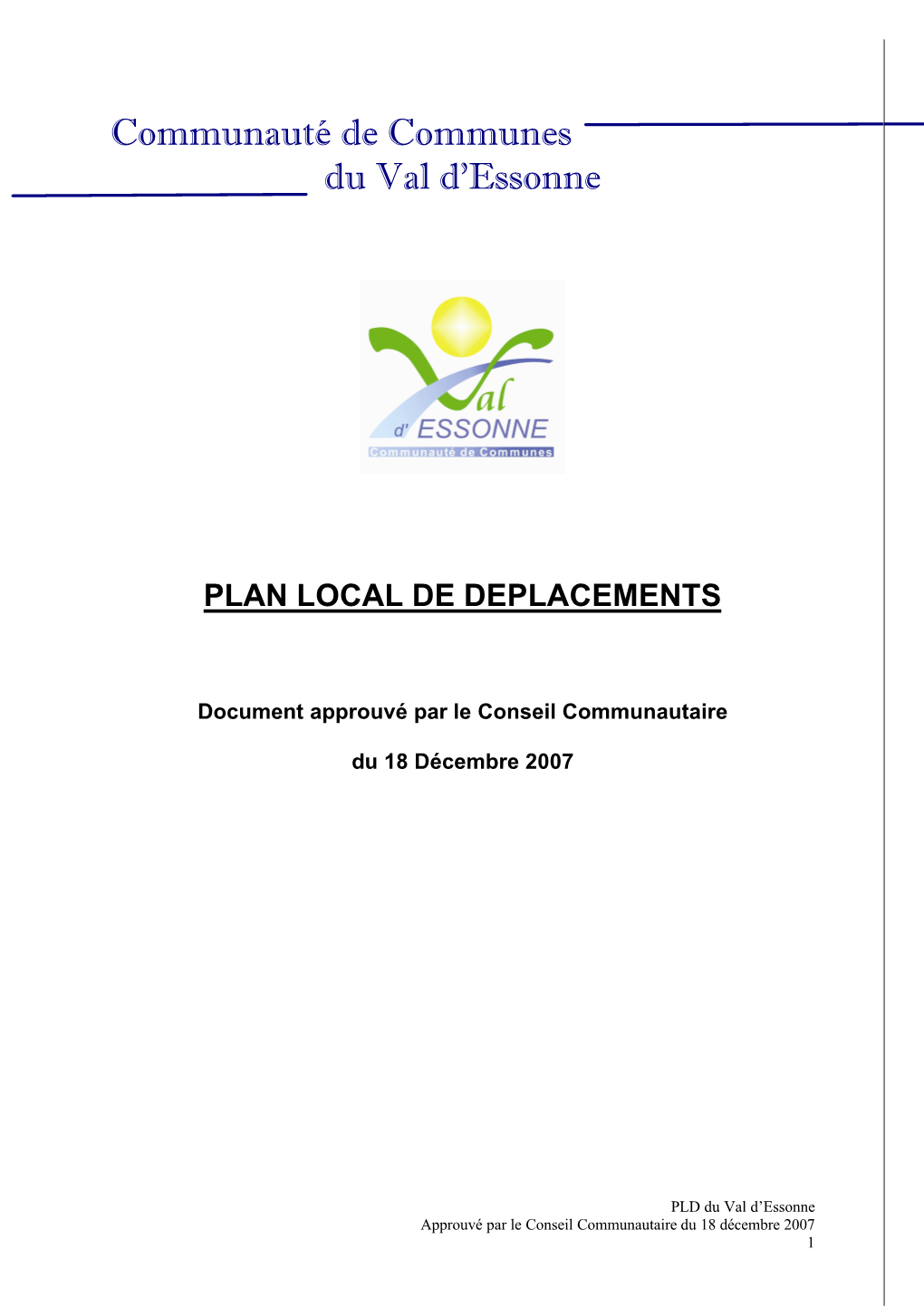
Load more
Recommended publications
-
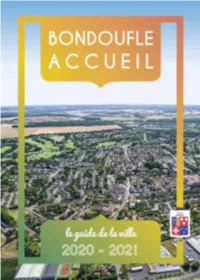
La Mairie À Votre Service - P 18 • Cadre De Vie - P 22
Éditorial Madame, Monsieur, Cher Bondouflois, chère Bondoufloise, Comme chaque année, j’ai le plaisir de vous adresser la nouvelle édition du guide pratique de notre ville. Il recense et vous présente toutes les associations municipales, les services mu- nicipaux et les commerces à votre disposition. La crise de la Covid19, du moins la 1re vague, nous impose, pour une durée indéterminée, un changement dans nos comportements du quotidien et dans la pratique de nos activités, notamment de loisirs. Les élections municipales se sont déroulées dans ce climat anxiogène, mais vous nous avez tout de même renouvelé votre confiance et je vous en remercie. Bondoufle poursuivra donc son développement conformément à nos obligations, mais aussi et surtout en conservant l’initiative de la mise en œuvre. Ainsi, nous poursuivrons l’implantation et l’extension des zones boisées et des îlots de biodi- versité, le prolongement du parc dans la ZAC et le début de construction de la nouvelle école. Si la Covid19 fera prendre du retard aux différents investissements et en augmentera leurs coûts, nous devrions mener à bien tous nos projets. Plusieurs entreprises devraient commencer leurs implantations, augmentant l’offre d’emploi de manière très significative tout en améliorant nos ressources fiscales. Notre cadre de vie fait partie de l’attractivité de notre ville, il appartient à tout un chacun de le respecter, voire de l’améliorer*. Le dynamisme des nombreuses associations et leurs diversités d’activités participent gran- dement au développement de notre commune. Le bénévolat nous permet d’offrir à tout un chacun un large panel d’occupations ludiques et culturelles et je remercie toutes celles et tous ceux qui permettent cela, grâce à un engagement qui ne se dément pas. -

Où Se Mettre À L'eau Et Au Vert À Grand Paris Sud
Où se mettre à l’eau et au vert à Grand Paris Sud... 3 82 88 51 Soisy- 85 61 Grigny 19 sur-Seine 2 55 Combs-la-Ville 36 20 47 92 63 84 62 75 29 32 60 38 40 79 95 Tigery Ris-Orangis 28 Étiolles 16 Évry 11 87 76 43 10 57 9 71 34 97 Se mettre à l’eau 70 72 35 67 77 83 37 12 69 48 Saint-Germain- Les balades autour de plans d’eau* 86 65 Lieusaint Moissy-Cramayel 68 49 50 lès-Corbeil 98 8 66 7 Courcouronnes 4 21 15 Les piscines et les cercles nautiques Corbeil- 64 99 Bondoufle 44 73 37 Essonnes 5 Les restaurants au bord de l’eau 33 22 96 1 94 6 46 Savigny- Réau 14 le-Temple Se mettre au vert 90 45 24 27 Saint-Pierre- 91 26 Lisses du-Perray Les forêts, les parcs et les espaces naturels Saintry- 39 78 80 sur-Seine Les lieux à découvrir dans des écrins de verdure 17 Villabé 23 Nandy 18 Les golfs 30 Morsang- 54 74 89 sur-Seine Vert 25 Saint-Denis 41 53 31 52 13 42 100 81 Cesson Le Coudray- 93 59 56 Montceaux 58 * Attention la baignade est interdite Où naviguer, pique-niquer, se rafraîchir, s’émerveiller, se reposer ?... I Se mettre à l’eau I Se mettre au vert Les balades autour de plans d’eau* Les forêts 1. Parc des Trois Parts - Bondoufle 54. Forêt de Rougeau - Morsang-sur-Orge, Nandy, 2. Parc Arthur Chaussy - Combs-la-Ville Saint-Pierre-du-Perray 3. -

Communes Au Zéro Phyto Total Et Labeliisées "Trophée Fleur Verte" Et "Terre Saine" ±
Communes au zéro phyto total et labeliisées "Trophée Fleur Verte" et "Terre Saine" ± BIEVRES VERRIERES-LE-BUISSON SACLAY IGNY VAUHALLAN WISSOUS VILLIERS-LE-BACLE MASSY PARAY-VIEILLE-POSTE CROSNE YERRES SAINT-AUBIN PALAISEAU ATHIS-MONS CHAMPLAN CHILLY-MAZARIN MORANGIS VIGNEUX-SUR-SEINE MONTGERON GIF-SUR-YVETTE ORSAY BRUNOY VILLEBON-SUR-YVETTE BURES-SUR-YVETTE JUVISY-SUR-ORGE BOUSSY-SAINT-ANTOINE LONGJUMEAU EPINAY-SOUS-SENART SAULX-LES-CHARTREUX SAVIGNY-SUR-ORGE VARENNES-JARCY LES ULIS VILLEJUST BOULLAY-LES-TROUX GOMETZ-LE-CHATEL DRAVEIL GOMETZ-LA-VILLE EPINAY-SUR-ORGE BALLAINVILLIERS VIRY-CHATILLON QUINCY-SOUS-SENART LES MOLIERES SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD VILLEMOISSON-SUR-ORGE NOZAYLA VILLE-DU-BOIS VILLIERS-SUR-ORGE SOISY-SUR-SEINE MORSANG-SUR-ORGE GRIGNY PECQUEUSE ETIOLLES RIS-ORANGIS LIMOURS JANVRY MARCOUSSIS TIGERY MONTLHERY SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS LONGPONT-SUR-ORGE FLEURY-MEROGIS SAINT-MICHEL-SUR-ORGE EVRY BRIIS-SOUS-FORGES LINAS SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL FORGES-LES-BAINS COURCOURONNES LEUVILLE-SUR-ORGE BONDOUFLE FONTENAY-LES-BRIIS LE PLESSIS-PATE CORBEIL-ESSONNES SAINT-PIERRE-DU-PERRAY BRETIGNY-SUR-ORGE VAUGRIGNEUSE BRUYERES-LE-CHATEL SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON COURSON-MONTELOUP OLLAINVILLE LISSES SAINTRY-SUR-SEINE ANGERVILLIERS ARPAJON VILLABE VERT-LE-GRAND SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE EGLY LA NORVILLE ECHARCON MORSANG-SUR-SEINE ORMOY BREUILLET LEUDEVILLE LE VAL-SAINT-GERMAIN GUIBEVILLE SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN MAROLLES-EN-HUREPOIX SAINT-YON BREUX-JOUY AVRAINVILLE MENNECY LE COUDRAY-MONTCEAUX VERT-LE-PETIT BOISSY-SOUS-SAINT-YON CHEPTAINVILLE -

XPR Evry/Conseil G N Ral-Q (Page 1)
. va R M G rd é R Rue A. au p e . B Renoir gu 4 u Co . i (B) urt R C n s Rue Depuis N7 on A Depuis stan g ORLY t ua x Imp. do ORLY e R Desaix op u BO Viry- Rue E. ur e UL l'E EVA D R. e H RD e E Branly d d e la Châtillon r r c . All. des va a ro le c ix nts Courts PLACE DE ou Tour le D B All. d'Alsace s U Depuis L'EUROPE Malte Lorraine . : 01 41 38 PARIS e M ÉL Tour hé A N445 ROP B t R E O Lorraine e E e ONSEIL ÉNÉRAL DE L SSONNE R U m C g C G ’E o H lla u L r i E P A V e Hôtel de V L du Hôtel du Département A R. Police R e Parc Henri (A) D Ru VRY CEDEX Depuis e L Boulevard de France - 91012 E ll Fabre E Tribunal au C PARIS d D L G E E Tél. : 01 60 91 91 91 - Fax : 01 60 91 91 77 e R s C Palais de de email : [email protected] Hôtel du F P PLANFAX © • T PLANFAX Rue E. Justice R a r . A l é N7 - h Département e fe Thomas M C N d c C ue tu a . Bâtiment E n r Grigny z ll ve e l iè A Administratif A a re sc s N448 B Pa Préfecture D D91 Terr. -

À Bondoufle Résidence Magnétic
Choisissez le style de vie qui vous ressemble entre ville et nature À BONDOUFLE RÉSIDENCE MAGNÉTIC 18454-COGEDIM Bondoufle PLAQUETTE-3volets-A4I talienne.indd 3 27/11/2017 12:01 Bondoufle se définit par un bel art de vivre, hérité de son passé de village rural. Située à moins BONDOUFLE de 30 km(1) de Paris et à proximité des pôles d’activités d’Orly et de Rungis, elle est intégrée à S’ÉPANOUIR ENTRE l’agglomération d’Évry et profite de son formidable dynamisme. Attirant chaque année de plus en VILLE ET NATURE plus d’habitants, la ville abrite de grands espaces verts dans un cadre de vie résolument privilégié. AU CŒUR DE L’ESSONNE En témoigne son nouveau quartier « Grand Parc » où ville et nature se mêlent en toute harmonie. Hôtel de Ville de Bondoufle VOTRE QUOTIDIEN EN TOUTE SIMPLICITÉ Ce qu’il faut savoir À 20 km(1) de l’aéroport d’Orly 2 lignes de bus Parcs et espaces verts Supermarché et marché Des lignes de bus Établissements scolaires généreux de 10 ha(2) à proximité, desservent les gares facilement accessibles à pied pour rejoindre les gares RER C et D entourant la résidence Infrastructures sportives du RER D (Bois de l’Épine – (complexe, parcours de santé et golf), Ris-Orangis) et du RER C et Espaces culturels (conservatoire, (Brétigny-sur-Orge) pour bibliothèque…) à quelques pas rejoindre Paris en moins 25,9 km de 40 min(1) de sentiers pédestres, répartis en 3 circuits de (3) (1) Source : Mappy. (2) Source : bondouflelegrandparc.fr (3) Source : ville-bondoufle.fr randonnées Tout le charme d’une ville champêtre Vivre au cœur d’un grand parc et résidentielle • Ce vaste nouveau quartier de près de 48 hectares(2), dont 10 hectares dédiés aux espaces verts, accueille • Bondoufle a su préserver son esprit village, mêlant petits depuis 2015 de nombreuses familles bondoufloises commerces et habitats à taille humaine pour offrir un cadre dans un environnement calme et serein. -

Les Communes De L'essonne Par Le Cercle Généalogique De L'essonne
Les communes de l’Essonne par le Cercle Généalogique de l’Essonne Commune Code Code Canton Nom_révolutionnaire Nom pré- Commune disparue Insee postal révolutionnaire Abbéville-la-Rivière 91001 91150 Méréville Angerville 91016 91670 Méréville Dommerville Angervilliers 91017 91470 Saint-Chéron Arpajon 91021 91290 Arpajon Franc-Val Arrancourt 91022 91690 Méréville Athis-Mons 91027 91200 Athis-Mons Mons Authon-la-Plaine 91035 91410 Dourdan Auvernaux 91037 91830 Mennecy Auvers-Saint-Georges 91038 91580 Etréchy Avrainville 91041 91630 Arpajon Ballainvilliers 91044 91160 Villebon-sur-Yvette Ballancourt-sur-Essonne 91045 91610 Mennecy Baulne 91047 91590 LaFerté-Alais Bièvres 91064 91570 Bièvres Bièvre, Bièvre-la- Bièvres-le-Châtel Montagne Blandy 91067 91150 Méréville Boigneville 91069 91720 Milly-la-Forêt Bois-Herpin 91075 91150 Méréville Boissy-la-Rivière 91079 91690 Méréville Boissy-le-Cutté 91080 91590 LaFerté-Alais Boissy-le-Sec 91081 91870 Etampes Boissy-sous-Saint-Yon 91085 91790 Saint-Chéron Bondoufle 91086 91070 Evry-Sud Boullay-les-Troux 91093 91470 Limours Bouray-sur-Juine 91095 91850 Etréchy Le Mesnil-Voisin Boussy-Saint-Antoine 91097 91800 Epinay-sous-Sénart Boussy-sous-Sénart Boutervilliers 91098 91150 Etampes Boutigny-sur-Essonne 91099 91820 LaFerté-Alais Bouville 91100 91880 Etampes Brétigny-sur-Orge 91103 91220 Brétigny-sur-Orge Breuillet 91105 91650 Saint-Chéron Breux-Jouy 91106 91650 Saint-Chéron Brières-les-Scellés 91109 91150 Etampes Briis-sous-Forges 91111 91640 Limours Brouy 91112 91150 Méréville Brunoy 91114 91800 Brunoy -

Evry-Courcouronnes, Bondoufle Et Lisses : Voyagez Dans Le Temps Au Cœur De Ces Anciens Villages Boucle Facile De 17 Km, Faisable Avec De Jeunes Enfants
Evry-Courcouronnes, Bondoufle et Lisses : voyagez dans le temps au cœur de ces anciens villages Boucle facile de 17 km, faisable avec de jeunes enfants, • Point de départ / arrivée : gare d’Evry-Courcouronnes Niveau de difficulté : facile bien suivre les indications du tracé centre sur Géovélo ou avec la trace gpx, car ce parcours n’est pas balisé. • Tout public Attention : les vélos avec remorques d’enfants, les tandems ou les • Dénivelé du parcours : 40 m D + tricycles ne peuvent pas franchir la barrière anti-intrusion d’accès à la voie verte du Bois des folies à Bondoufle. Cela oblige à faire le détour par la rue Noël Marteau 17 km Type de revêtement : 90% enrobé et 10% en grave Entre 2h et 3h en profitant du paysage et des stabilisée lieux de patrimoine. Parcours proposé par Provélo91 téléchargeable en format gpx sur le site https://www.geovelo.fr/france/rides 1. La gare d’Evry-Courcouronnes centre 2. La place des Terrasses : un lieu de rencontre en pleine transformation 3. Le parc de la Préfecture, du Palais de Justice et de l’hôtel du Département 4. Le parc des Coquibus Ce parc de 20 hectares tient son nom de la Grange « coq qui but », lieu de stockage des récoltes sur le bois. Véritable enclave verte, le parc forestier aux grandes allées relie le centre-ville aux quartiers des Aunettes et des Epinettes. 5. Le parc de la Dame du lac : symbole incontournable d’Evry-Courcouronnes 6. Le mail Jean Zay : un petit air de Provence 7. L’église nouvelle de Saint-Guénault 8. -

Images Et Sons Toutes Périodes IMAGES
Images et sons Toutes périodes IMAGES Avec plus 120 000 gravures, affiches, photographies, diapositives et cartes postales, les Archives départementales de l'Essonne offrent une véritable banque d'images, en cours de numérisation. Les documents couvrent une période très large, allant des gravures du XVIe siècle aux affiches contemporaines. Cette banque est à compléter par des documents issus des différentes séries (ex : plans d'intendance en série C, maquettes en série W etc.). Sous-série Fi : Documents figurés 10Fi. Photographies du pré-inventaire (format (images fixes) supérieur à 50 x 60 cm). 102 articles. 11Fi. Photographies du pré-inventaire (format Les documents se présentent sous plusieurs inférieur à 40 x 50 cm). 214 articles. formes : dessins, gravures, cartes et plans, photographies ou diapositives, cartes posta- 12Fi. Photographies du Comité départemental du les … pré-inventaire (format inférieur à 30 x 40 cm). 1970-1996. 165 articles. 1Fi. Cartes et plans. 1521-2002. 654 articles. En partie numérisés, disponibles sur écran en 13Fi. Photographies du Comité départemental du salle de lecture. pré-inventaire (format inférieur ou égal à 18 X 24 cm). 1970. 225 articles. 2Fi. Photographies entrées par voies extraordi- Montées sur bois ou sous verre. naires. 1819-2006. 1667 articles. 14Fi. Fonds Maréchal. 1910-1983. 584 articles. 2Fi/ n° de commune. Cartes postales. Plans d'architecte. 3Fi. Gravures et dessins (format supérieur à 24 15Fi. Corps expéditionnaire américain basé à x 30 cm). 1590-1996. 118 articles. ORLY. 1918-1919. 62 articles. 4Fi. Gravures et dessins (format inférieur à 24 x 17Fi. Aquarelles Capaul. 1882-1902. 112 articles. 30 cm). -

Une Année Scolaire Riche En Projets /// Pages 4 Et 5 >
Nov. 2012 - Fév. 2013 n° 35 HorizonLe journal des Grandvertois édito P 2-3 Soutenir les initiatives Retour en images P 4-5 à l’école Les projets d’écoles La période de rentrée scolaire le lieu de l’éducation, de toutes P 6-7 s’impose toujours à nous comme les découvertes, de toutes Vous avez dit RAM ? un temps d’encouragement pour les aventures et de toutes les équipes enseignantes, les ouvertures de l’enfance… P 8-9 Bruno Nicolas les personnels encadrants, au monde. Elle est le complément Rénovation des vitraux Maire adjoint chargé les parents et bien entendu, incontournable à l’éducation de la Vie Scolaire les enfants. Consacrer une double que les parents donnent à page à tous les projets qui ont leurs enfants. P 10-11 vu le jour dans nos deux écoles Le Mobi’Val d’Essonne maternelle et élémentaire durant La municipalité finance et la saison dernière, reflète notre soutiendra ces initiatives comme P 12-13 volonté de féliciter toutes les le concert produit par l’ensemble Une pépinière de talents initiatives prises par l’ensemble des enfants de l’école primaire des acteurs du milieu éducatif. (juin 2012) et dont vous P 14-15 trouverez une belle illustration Que l’école soit le lieu du sur cette couverture. Autant 30 ans de judo « savoir, de l’apprentissage de rendez-vous qui enrichissent et de la vie en communauté » et façonnent l’univers de l’enfant. P 16 est une certitude. C’est aussi Très bonne année scolaire à tous. Infos pratiques Écoles maternelle et élémentaire Une année scolaire riche en projets /// Pages 4 et 5 > Retour en images > 13-14/10/2012 > L’excellence était au rendez-vous ! La salle Henri Boissière a hébergé des artisans connus, mais aussi de nouveaux visages, et surtout de nouvelles activités pour le Salon de la Création Artisanale, 12e du nom. -

Votre Avenir, Notre Priorité
Votre avenir, notre priorité 2017 SOMMAIRE Votre avenir, notre priorité 5 Interview de la Présidente 8 Interview du directeur 9 Organigramme 11 Faits marquants 13 Budget et financement 21 Chiffres clés et réalisations 23 Partenariats entreprises et collectivités 43 On parle de nous 48 Perspectives 2018 53 Nos soutiens 55 Glossaire 56 QUI SOMMES-NOUS ? Dynamique Emploi véritable moteur de la politique de l’emploi et de l’insertion professionnelle sur le territoire de l’Essonne depuis 40 ans regroupe notamment une Mission locale et un PLIE. L’association Composée d’une équipe de développe son expertise en matière 40 professionnels, d’un maillage d’emploi et de responsabilité sociétale territorial fort avec 3 antennes et 12 construite avec les entreprises permanences et une présence globale du territoire et les collectivités sur 40 communes, Dynamique Emploi territoriales. développe son action au coeur des quartiers pour être plus proche des 1700 professionnels sont publics concernés. recrutés par an grâce à un savoir- faire unique qui repose sur la mise en Les conseillers et coach place d’un partenariat privilégié avec professionnels de la structure offrent les employeurs du territoire pour leur un accompagnement individuel et/ apporter les meilleurs talents lors de ou collectif aux demandeurs d’emploi leurs recrutements. grâce à de nombreux outils pour faciliter l’accès à l’emploi et à la formation. NOS TERRITOIRES D’INTERVENTION Dynamique Emploi intervient sur 40 communes ... en assurant le même service de qualité sur l’ensemble de son territoire. Ainsi, l’association développe son action au plus près des besoins des publics, via des équipements de proximité. -

Communauté D'agglomération Évry Centre Essonne - 91
Communauté d'agglomération Évry Centre Essonne - 91 Statuts en date du 22/11/2013, rapport d'activités de 2011 Mise à jour : Mars 2015 www.iau-idf.fr Le groupement Sommaire La communauté d’agglomération Evry – Courcouronnes – Bondoufle – Le groupement 1 Lisses, qui est créée le 31/12/2000, élargit son périmètre à la commune de Composition 2 Ris-Orangis et prend le nom d’ "Evry – Centre Essonne" au 31/12/2003. Représentation des communes 2 Compétences et réalisations 2 Villabé rejoint la communauté d’agglomération à compter du 01/07/2010. La population intercommunale atteint 114518 habitants (population municipale Atlas 19 au recensement de 2012). La commune la plus peuplée est Evry (52349 Population 19 habitants, soit 46% du total intercommunal). Taux de logements sociaux 19 Zones d'activités économiques 20 La communauté est membre de Paris Métropole depuis le 30/04/2009. Potentiel financier 20 L’agglomération, fortement urbanisée, est issue d’un processus de Revenu des ménages 21 constitution engagé à la fin des années 60. L’établissement public Politique de la ville 21 d’aménagement de la ville nouvelle d’Evry (EPEVRY) est institué en 1969, en application du principe de création des villes nouvelles (premier schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région parisienne en 1965), puis, en 1973, le syndicat communautaire d’aménagement (SCA) chargé de la gestion administrative. Cette structure préfigure le syndicat d’agglomération nouvelle (SAN), créé en 1985. Jugeant les opérations d’intérêt national (OIN) achevées, le gouvernement recherchant par ailleurs Fiche d'identité Syndicat d'agglomération nouvelle un compromis face à la crise financière des villes nouvelles (durant les créé le 13/07/1983, transformé en années 1990) engage le processus de retour au droit commun en 1998. -

Plan De Prévention Du Bruit Dans L'environnement (PPBE)
Elaboration du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de l’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart Projet de PPBE 13 avril 2021 Préparé pour : Par : Bertrand MASSON Identification Références fichier : Références client, n° de Cde : 11DE07 – EN 11897 Marché n° 19M153 Diffusion Noms Société ou organisme Bérengère MAINFROID Évolution Date Version Modifications Rédaction Vérification 06/11/2020 01 Edition initiale provisoire 09/12/2020 02 . 06/01/2021 03b . Mises à jour Bertrand MASSON Gaëtan POTTIER 07/01/2021 04 . 14/01/2021 05 . 16/02/2021 06 . 13/04/2021 07 . Grand Paris Sud 11DE07 – EN 11897 Projet de PPBE 2 13/04/2021 Sommaire A CONTEXTES REGLEMENTAIRE ET LOCAL ............................................. 6 A.1 Réglementation ............................................................................................. 6 A.2 Contexte local................................................................................................ 7 A.3 Définition d’un PPBE .................................................................................... 8 A.4 Valeurs des dépassements de seuil de bruit .............................................. 9 B DIAGNOSTIC ACOUSTIQUE TERRITORIAL ........................................... 10 B.1 Collecte des données ................................................................................. 10 B.2 Bilan de la CBS ............................................................................................ 11 B.2.1 Données CBS, lacunes et bonus ........................................................................11