LE DEPARTEMENT DU VAR 1790 1990 Métamorphoses D'un Territoire
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
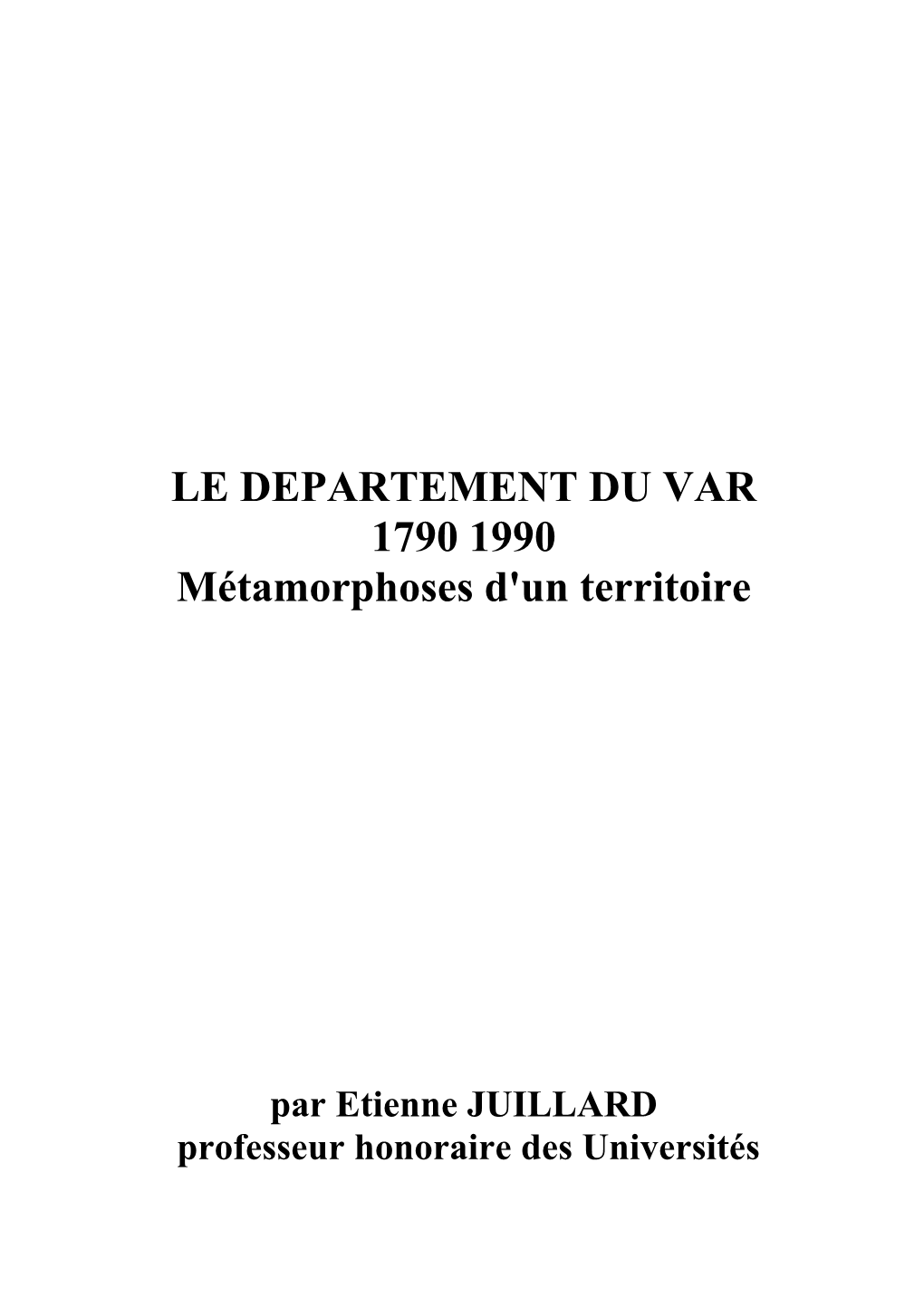
Load more
Recommended publications
-

LES VŒUX DE REGROUPEMENT DE COMMUNES Vœux
LES VŒUX DE REGROUPEMENT DE COMMUNES Vœux de regroupement : porte sur un support de poste choisi dans l’ensemble des communes comprises dans le regroupement. Les regroupements de communes correspondent généralement aux circonscriptions des inspecteurs. Regroupement de BRIGNOLES Regroupement de DRAGUIGNAN COTIGNAC BRIGNOLES CABASSE AIGUINES AMPUS SILLANS LA CASCADE LA CELLE CORRENS TOURVES DRAGUIGNAN TRANS EN PROVENCE BAUDUEN SALERNES LES SALLES/VERDON LORGUES MONTFORT S/ARGENS CARCES VILLECROZE AUPS LE THORONET ENTRECASTEAUX REGUSSE ARTIGNOSC/VERDON CAMPS LA SOURCE CABASSE TOURTOUR FLAYOSC ST-ANTONIN DU VAR LE VAL BRAS VINS SUR CARAMY Regroupement de ST RAPHAEL – FREJUS (écoles ventilées sur deux circonscriptions) FREJUS SAINT RAPHAEL Regroupement de CUERS BELGENTIER COLLOBRIERES MEOUNES Regroupement de HYERES LA FARLEDE PIERREFEU du VAR BORMES-LES-MIMOSAS HYERES SOLLIES VILLE CUERS LA LONDE DES MAURES SOLLIES TOUCAS SOLLIES PONT Regroupement de LA SEYNE Regroupement de LA GARDE ( écoles ventilées sur deux circonscriptions ) CARQUEIRANNE LA GARDE LE PRADET LA CRAU LA SEYNE SAINT MANDRIER Regroupement de SIX FOURS SIX-FOURS-LES PLAGES OLLIOULES Regroupement de GAREOULT Regroupement LE MUY BESSE/ISSOLE CARNOULES FLASSANS/ISSOLE LES ARCS LE MUY GAREOULT FORCALQUEIRET LA ROQUEBRUSSANE LES MAYONS LE LUC GONFARON MAZAUGUES SAINTE ANASTASIE TARADEAU VIDAUBAN NEOULES NANS LES PINS SAINT ZACHARIE LE CANNET DES MAURE PIGNANS PLAN D’AUPS ROCBARON PUGET VILLE Regroupement de STE MAXIME Regroupement de ST MAXIMIN CAVALAIRE/MER COGOLIN LA CROIX VALMER -

Côtes De Provence (135)
Côtes de Provence (135) - A – Domaine de l'Amaurigue - Le Luc Château des Anglades - Hyères Château L'Arnaude - Lorgues Château d'Arsac - Lorgues Domaine de l'Artaude - Le Pradet Domaine des Aspras - Correns Chateau d'Astros - Vidauban Château de l'Aumérade – Pierrefeu - B - Château Barbanau - Roquefort Domaine de la Bastide Blanche - Ramatuelle Bastide des Bertrands - Le Cannet Domaine de la Bastide Neuve - Le Cannet Château de Beaupré - Saint-Cannat Château de la Bégude - Rousset Château de Berne - Lorgues Domaine Bertaud-Belieu - Gassin Domaine La Blaque - Pierrevert Domaine Bouisse-Matteri - Hyères Domaine du Bourrian - Gassin Domaine de la Bouverie - Roquebrunne Château de Brégançon - Bornes les Mimosas - C - Cave La Carçoise - Carcès Domaine Castel des Maures - Hyères Cellier des Archers - Arcs sur Argens Cercle des Vignerons de Provence - Brignoles Domaine du Château Vert - La Londe Clos Cassivet - Trans en Provence Clos Cibonne - Le Pradet Clos de la Procure - La Garde La Commanderie de Peyrassol - Flassans Coste Brulade - Puget-Ville Domaine de La Courtade - Porquerolles Château Coussin Ste Victoire – Trets, Partenaire de l’ASNCAP Domaines de la Cressonnière - Pignan Domaine de la Croix - Ramatuelle Domaine de la Croix Rousse - Le Suvé du Vent Château Les Crostes - Lorgues Domaine de Curebéasse – Fréjus - D - Château Deffends - Carnoules Domaine du Dragon - Draguignan Dupéré-Barrera - La Garde - E - Domaine des Escaravatiers - Puget Château d'Esclans - La Motte Domaine de l'Estello – Lorgues - F - Domaines Fabre - Pierrefeu Cave -

During Your Stay, You Can Visit Different Places in the Surrounds of Aiguines
During your stay, you can visit different places in the surrounds of Aiguines: The Gorges du Verdon tour From Aiguines, drive down to the Sainte-Croix lake and Moustiers Sainte-Marie (faïence town). Just before arriving to Moustiers, drive towards La Palud-sur-Verdon on the Verdon right bank where you can appreciate Galetas panorama and Mayreste viewpoint. Once in La Palud, follow the route des Crêtes (D23), especially made-up to access easily the viewpoints on the Verdon and its cliffs (climbers’ paradise) . The road goes by the chalet de la Maline (Martel hike departure) and loops back to La Palud. Beware, the route des Crêtes is a one-way road. Then drive to Rougon where you can stop at the Point Sublime viewpoint, admire the entrance of Couloir Samson and perceive some vultures. Next, y ou follow the road via Castellane and Trigance, medieval village. You arrive then at the other side of the Verdon, the left bank: the Corniche Sublime towards Aiguines. All along the emerald green river, you will appreciate successive viewpoints: the Mescla (where Artuby river flows into the Verdon), the Artuby bridge, the Cavaliers cliffs, the Vaumal e cirque, the Col d'Illoire, before arriving in Aiguines. You will drive approximately 5 hours for this 100 kilometers road trip. The Valensole plateau Valensole is well-known for its huge lavender fields, mirrors of the blue sky of Pr ovence. Lavender offers bees’ excellent nectar. This latter is transformed into honey in numerous hives of bee-keepers of the surroundings. Situated 40 kilometers far from Aiguines. -

Le Midi De La France À Vélo Électrique Les Points Forts
Le Midi de la France à vélo électrique Circuit sportif rendu accessible grâce aux vélos électriques de qualité. Traversées du Verdon et du plateau de Valensole, la côte d'Azur et la Méditerranée... 9 jours - 8 nuits - 7 étapes VAE/VTC Départ garanti à 2 Séjour itinérant Sans portage Liberté Code voyage : FR9DINI Les points forts • Digne, capitale de la Haute Provence • Le Verdon, le plateau de Valensole • Saint Raphaël, Nice, le massif des Maures • Beauté des paysages et confort du vélo électrique • Plus bel itinéraire cyclotouriste du Midi de la France Avant votre départ, pensez à vérifier la validité de la fiche technique sur notre site web. https://www.labalaguere.com/le_midi_de_la_france_velo_electrique.html FR9DINI Dernière mise à jour 09/11/2020 1 / 13 C'est la plus belle traversée cyclotouriste du Sud de la France. Elle part de Digne, la capitale de la Haute Provence, et musarde d'abord à travers le plateau de Valensole, haut-pays des blés et de la lavande, l'un des plus beaux endroits de Haute Provence. Le Rubicon à franchir ensuite s'appelle le Verdon. Difficile à traverser non seulement parce que son Grand Canyon est l'un des plus profonds et des plus spectaculaires d'Europe, mais aussi parce que ses hauts plateaux y dépassent les 1000m d'altitude! C'est ici que l'on appréciera vraiment l'assistance électrique de nos vélos! Cet itinéraire magnifique, nous avons voulu le rendre le plus accessible possible. Les étapes sont de difficulté moyenne: une soixantaine de kilomètres par jour environ et un dénivelé maximum de 760 mètres dans la même journée. -

SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE ET DE L' ENREGISTREMENT DE DRAGUIGNAN 2 Ses Coordonnées 43 CHEMIN DE SAINTE BARBE CS 30407 83008 DRAGUIGNAN CEDEX
SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE ET DE L' ENREGISTREMENT DE DRAGUIGNAN 2 Ses coordonnées 43 CHEMIN DE SAINTE BARBE CS 30407 83008 DRAGUIGNAN CEDEX 04 83 08 70 99 [email protected] Ses horaires d'accueil Le ressort territorial de sa compétence LES ADRETS DE L ESTEREL COTIGNAC LE THORONET SAINT ANTONIN DU VAR AIGUINES DRAGUIGNAN LE VAL SAINT JULIEN AMPUS ENTRECASTEAUX LES ARCS SUR ARGENS SAINT MARTIN DE PALLIERES ARTIGNOSC SUR VERDON ESPARRON LES MAYONS SAINT PAUL EN FORET ARTIGUES FAYENCE LES SALLES SUR VERDON SAINT RAPHAEL AUPS FIGANIERES LORGUES SAINT TROPEZ BAGNOLS EN FORET FLASSANS SUR ISSOLE MAZAUGUES SAINT ZACHARIE BARGEME FLAYOSC MEOUNES LES MONTRIEUX SAINTE MAXIME BARGEMON FORCALQUEIRET MOISSAC BELLEVUE SALERNES BARJOLS FOX AMPHOUX MONS SEILLANS BAUDINARD SUR VERDON FREJUS MONTAUROUX SEILLONS SOURCE D ARGENS BAUDUEN GAREOULT MONTFERRAT SILLANS LA CASCADE BESSE SUR ISSOLE GASSIN MONTFORT SUR ARGENS ST MAXIMIN STE BAUME BRAS GINASSERVIS MONTMEYAN STE ANASTASIE SUR ISSOLE BRENON GONFARON NANS LES PINS TANNERON BRIGNOLES GRIMAUD NEOULES TARADEAU BRUE AURIAC LA BASTIDE OLLIERES TAVERNES CABASSE LA CELLE PIGNANS TOURRETTES CALLAS LA CROIX VALMER PLAN D AUPS TOURTOUR CALLIAN LA GARDE FREINET PONTEVES TOURVES CAMPS LA SOURCE LA MARTRE POURCIEUX TRANS EN PROVENCE CARCES LA MOLE POURRIERES TRIGANCE CAVALAIRE SUR MER LA MOTTE PUGET SUR ARGENS VARAGES CHATEAUDOUBLE LA ROQUE ESCLAPON RAMATUELLE VERIGNON CHATEAUVERT LA ROQUEBRUSSANNE RAYOL CANADEL VIDAUBAN CHATEAUVIEUX LA VERDIERE REGUSSE VILLECROZE CLAVIERS LE BOURGUET RIANS -

Plan De Canjuers
FICHES DE CARACTERISATION DES RESERVOIRS ET DES CORRIDORS DE LA TVB PROVENCE ALPES COTE D'AZUR PPllaann ddee CCaannjjuueerrss CONTINUITES ECOLOGIQUES Plan de Canjuers GENERALITES Grand ensemble écologique : Préalpes du sud Hydro-écorégions : Collines de Basse Provence ; Plateaux calcaires de Provence NOMBRE DE RESERVOIRS DE BIODIVERSITE : - Forêt : 2 - Milieux semi-ouverts : 10 - Milieux ouverts : 2 - Eaux courantes : non dénombrés - Zones humides : non dénombrés NOMBRE DE CORRIDORS : - Forêt : 7 - Milieux semi-ouverts : 19 - Milieux ouverts : 1 CONTINUITES / SURFACE TOTALE DE LA PETITE REGION NATURELLE : 87,2 % Dont 12,4 % sont des espaces protégés et 78,3 % sont des zonages spécifiques PACA. COMPOSANTE VERTE COMPOSANTE BLEUE Vastes continuités écologiques recouvrant la quasi-totalité Principaux réservoirs concernant les eaux courantes : Partie aval de l’Artuby avec quelques affluents. Linéaire total peu important. Etat de la fonctionnalité dégradé pour l’Artuby et non dégradé pour ses de la petite région naturelle. Milieux semi-ouverts affluents. principalement (Camp de Canjuers) et secondairement Milieux rivulaires et zones humides peu représentés globalement sauf au niveau du Vallon de Leruy, affluent de l’Artuby avec une zone humide d'environ 1,7 km² issue des Inventaires départementaux. La milieux forestiers. surface totale occupée par les zones humides est d'environ 2,6 km² ce qui représente environ 0,7 % de la surface totale de la région Plan de Canjuers. Peu de pressions anthropiques. CONTINUITES ECOLOGIQUES Plan de Canjuers -

Alpes De Haute-Provence
Alpes de Haute-Provence Here your desires take over! www.alpes-haute-provence.com 1 Contents A unique and contrasted place Page 3 Three major destinations Page 4 to 6 Haute Provence Luberon Verdon Alpes Mercantour The AHP are natural page 7 The AHP are sensory, fragrance maker pages 8 to 12 The scents and flavours complex The AHP are tasty, full-flavoured pages 13 to 14 The AHP are recreational (loisirs), athletic (sportives) pages 15 to 23 Outdoor activities Winter activities The AHP are rich of their cultural heritage pages 24 to 30 Excursions and Discovery Culture and heritage Festivities page 31 Festivals page 33 8 European « bests » page 35 Practical information & contacts page 36 2 A unique and contrasted Place The Alpes de Haute-Provence are located in the heart of the Provence Alpes Côte d’Azur region, on the Italian border and in the middle of the Marseille-Nice-Grenoble triangle. The « 04 » as it is called, between the Alps and Provence, is rich in spectacular and contrasting landscapes. A splendid light-filled natural environment blessed with an exceptional Provencal climate, three typical touristic areas each with their own features and traditions. It is one of the vastest French departments (6925 Km²) with quite small population density: 160 000 inhabitants. Most important towns are Digne- les-Bains, Manosque, Forcalquier, Sisteron, Barcelonnette, Gréoux-les- Bains, Oraison, Castellane, Moustiers-Sainte-Marie, Saint-André-les-Alpes, or Banon 146 mountain lakes Among them, the well-known Lac d’Allos, the biggest lake in Europe at this altitude (2226 m) as well as a fisherman’s paradise. -

ANNEXE 1 AP CCLE 2020 -1000 OU +1000 1Liste
ANNEXE 1 : membres de la commission de contrôle des listes électorales dans les communes de moins de 1000 habitants Ou de plus de 1000 habitants dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement Conseiller municipal suppléant Suppléant délégué Suppléant délégué du tribunal Commune Conseiller municipal Délégué de l’administration Délégué du tribunal judiciaire * De l’administration * judiciaire Aiguines Monsieur Pierre MORDELET Madame Valérie HEBRARD Madame Yvonne GRESSINO Madame Sylvie RASCLE Madame ROUCHON Henriette Monsieur Alain CHAUVIN Ampus Monsieur Michel MANISCALCO Monsieur Christian CHILLI Madame Christel EGINARD Monsieur Bernard GIULI Artignosc sur Verdon Monsieur Sylvain GARRON Monsieur Max ROUVIER Madame Nadine AUTRAN Artigues Monsieur Hugo FERREIRA MARTINS MELO Monsieur Lionel MOUSSELIN Madame Marie-Pierre SARRAZIN Monsieur MATHIEU Michel Bargème Madame Liliane MONTALAND Monsieur Hugues LIBERATO Monsieur Claude NOEL La Bastide Monsieur Guy MAGNENAT Monsieur Jean-Pierre WOLFF Monsieur Henri MAGGINI Monsieur Charles FLOCCIA Monsieur Serge LAUGIER Baudinard sur Verdon Madame Noëlle CONTRUCCI Monsieur Gabriel LABONDE Monsieur Claude LIAUTAUD Madame Joëlle CARIOU Bauduen Madame Sabine LIONS Madame Françoise BAGARRE Monsieur Jean-Marc PELLOQUIN Belgentier Monsieur Guy FARCE Monsieur Daniel DESPICQ Monsieur Jacques REY Monsieur Jean-Marie LACANAL Monsieur Alain FENIS Le Bourguet Madame Danièle MAGRI Madame Chrystelle RICCA épouse JULIO Madame Corinne TEULADE épouse ROUX Brenon -

Mise En Page 1
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE o Adobre Stock - VOUS ATTENDEZ UN ENFANT Préparons ensemble sa venue La Protection Maternelle et Infantile est un service du Conseil départemental du Var Direction de la Communication du Conseil départemental Var : pôle création graphique IC ; imprimerie - 11-2019 Phot PARTOUT, POUR TOUS, LE VAR ACTEUR DE VOTRE QUOTIDIEN PARTOUT, POUR TOUS, LE VAR ACTEUR DE VOTRE QUOTIDIEN Vous attendez un enfant Pour bénéficier de la présence d’une sage-femme, prenez directement contact avec Nous avons eu connaissance de votre déclaration de grossesse par la Caisse le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) de votre commune de résidence. d’allocations familiales ou la Mutualité sociale agricole. Les sages-femmes de la Protection Maternelle et Infantile du Conseil départemental se tiennent à s LA SEYNE-SUR-MER - SAINT-MANDRIER LA SEYNE-SUR-MER : 04 83 95 49 00 la disposition des futurs parents pour des informations, une écoute, un soutien, un conseil, une consultation… s TOULON TOULON : 04 83 95 23 53 C’est avant la naissance qu’il est important de poser vos questions. s BANDOL - ÉVENOS - LA CADIÈRE - LE BEAUSSET - LE CASTELLET LITTORAL SUD SAINTE-BAUME : Vous pouvez faire appel à elles. OLLIOULES - RIBOUX - SAINT-CYR - SANARY - SIGNES - SIX-FOURS 04 83 95 27 60 s BELGENTIER - BORMES - CARQUEIRANNE - COLLOBRIÈRES - CUERS VAL GAPEAU ILES D’OR : HYÈRES - LA CRAU - LA FARLÈDE - LA GARDE - LA VALETTE - LA LONDE 04 83 95 39 50 LE LAVANDOU - LE PRADET - LE REVEST - PIERREFEU - SOLLIÈS-PONT Où rencontrer une sage-femme ? SOLLIÈS-TOUCAS - SOLLIÈS-VILLE La sage-femme peut vous recevoir lors d’une consultation au service de PMI de votre s BESSE - CABASSE - CARNOULES - FLASSANS - GONFARON - LE CANNET CŒUR DU VAR : 04 83 95 19 35 territoire ou se rendre à votre domicile pour répondre à toutes vos questions. -

Marine PERRONE Patrick CAVIGLIA Jean-Baptiste LE ROUX Linda
Marine PERRONE Patrick CAVIGLIA Jean-Baptiste LE ROUX [email protected] [email protected] [email protected] 04.94.93.62.19 – 06.75.33.60.12 04.94.22.76.42 – 06.76.11.39.90 04.94.22.40.22 – 06.75.33.61.14 Haut Var Verdon Provence Méditerranée Est Aire draçénoise Aiguines, Artignosc, Artigues, Aups Belgentier, Bormes-les-Mimosas, Carqueiranne, Collobrières, Cuers, Hyères, La Crau, Ampus, Bargème, Bargemon, Brenon, La Baudinard, Bauduen, Fox-Amphoux La Farlède, La Garde, La Londe-les-Maures, La Valette-du-Var, Le Lavandou, Le Pradet, Motte, Callas, Châteaudouble, Châteauvieux, Ginasservis, La Verdière, Les Salles-sur- Le Revest-les-Eaux, Pierrefeu-du-Var, Solliès-Pont, Solliès-Toucas, Solliès-Ville. Claviers, Comps-sur-Artuby, Draguignan, Verdon, Moissac-Bellevue Montmeyan, Figanières, Flayosc, Les Arcs, La Bastide, Le Régusse, Rians, Saint-Julien, Salernes, Golfe de Saint Tropez Bourguet, La Martre, Le Muy, La Roque Sillans-La-Cascade, Tourtour Vérignon, Cavalaire, Cogolin, Gassin, Grimaud, La Croix-Valmer, La Garde-Freinet, La Mole, Le Rayol- Esclapon, Lorgues, Montferrat, Taradeau, Villecroze, Vinon-sur-Verdon Canadel, Plan-de-La-Tour, Ramatuelle, Sainte-Maxime, Saint-Tropez Trans-en- Provence, Trigance, Vidauban. Provence verte Toulon est Fayence Barjols, Bras, Brignoles, Brue-Auriac, Callian, Fayence, Mons, Montauroux, Saint- Camps-la-Source, Carcès, Châteauvert, Paul-en-Forêt, Seillans, Tanneron, Tourrettes. Correns, Cotignac, Entrecasteaux, Esparron- de-Pallières, Forcalqueiret, Garéoult, La Var Esterel Celle, La Roquebrussanne, Bagnols en Forêt, Fréjus, Les Adrets de Le Val, Mazaugues, Méounes, Montfort, l’Estérel, Puget sur Argens, Roquebrune sur Nans-les-Pins, Néoules, Ollières, Plan Argens, Saint Raphaël d'Aups, Pontevès, Pourcieux, Pourrières, Rocbaron, Rougiers, Sainte-Anastasie, Cœur du Var Saint-Antonin, Saint-Martin-de-Pallières, Besse-sur-Issole, Cabasse, Carnoules, Saint-Maximin, Saint-Zacharie, Seillons- Flassans, Gonfaron, Les Mayons, Le Cannet- Source-d'Argens, Tavernes, Tourves, des-Maures, Varages, Vins sur Caramy. -

Boucle Magnan La Madeleine
Itinéraire 6 Durée : 3h30 Distance : 5 km Difficulté : moyenne Magnan - La Madeleine LE PALAIS DE FRONTONS 1 L’AGRICULTURE 3 DÉCORÉS Le bâtiment, dessiné par Paul Martin, Les frises sont apportées par les ingénieur des arts et métiers et ouvriers italiens appelés sur la secrétaire général de la Société Côte d’Azur à la fin du XVIII e siècle Centrale d’Agriculture, d’Horticul- pour aider à la construction des ture et d’Acclimatation de Nice et grandes demeures. Elles se présentent sous deux aspects : soit un des Alpes-Maritimes, est construit décor polychrome réalisé le plus souvent au pochoir, soit sous la forme sur un terrain concédé par la ville de Nice, et inauguré le 8 avril 1901 d’un camaïeu dans les tons ocres ou bruns appelé « sgraffito ». Elles se par le Président de la République, Émile Loubet. Le Palais est classé à répartissent le plus souvent sous les toits des villas ou immeubles, mais l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. peuvent aussi composer des « panneaux » entre deux fenêtres ou entre deux étages. Les thèmes utilisés pour cette ornementation sont très variés et peuvent être répartis comme suit : LE MUSÉE les fleurs : roses, glycines, iris, jonquilles, violettes, acanthes 2 DES BEAUX-ARTS et chardons sont parmi les plus utilisées ; JULES CHÉRET pour les plantes acclimatées : agaves, figuiers de Barbarie, palmiers et bananiers ; Construit en 1878 sur la colline les arbres sont le plus souvent représentés par les oliviers, chênes, des Baumettes pour la princesse marronniers, figuiers et lauriers ; ukrainienne Elisabeth Kotchoubey, le registre fruitier se compose surtout d’oranges, citrons, grenades, ce palais, inspiré de l’architecture raisins, figues, cerises… néoclassique de Saint Petersbourg, est devenu musée des Beaux-Arts Jules Chéret en 1928. -

Sables Bleutés Du
La controverse sur l’âge des “ Sables bleutés du Var ” (1966-1980) : Les paradoxes méthodologiques d’une polémique caractéristique de la fin du XXe siècle, entre un géologue amateur, Fernand Touraine, un paléomalacologiste, Roger Rey, et des spécialistes académiques de la paléontologie des mammifères et de la tectonique alpine Jean-Claude Plaziat To cite this version: Jean-Claude Plaziat. La controverse sur l’âge des “ Sables bleutés du Var ” (1966-1980) : Les para- doxes méthodologiques d’une polémique caractéristique de la fin du XXe siècle, entre un géologue amateur, Fernand Touraine, un paléomalacologiste, Roger Rey, et des spécialistes académiques de la paléontologie des mammifères et de la tectonique alpine. Travaux du Comité français d’Histoire de la Géologie, Comité français d’Histoire de la Géologie, 2013, 3ème série (tome 27, 1), pp.1-75. hal-01196534 HAL Id: hal-01196534 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01196534 Submitted on 10 Sep 2015 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. TRAVAUX DU COMITÉ FRANÇAIS D’HISTOIRE DE LA GÉOLOGIE (COFRHIGÉO) TROISIÈME SÉRIE, t. XXVII, 2013, n° 1 (séance du 13 mars 2013) Jean-Claude PLAZIAT La controverse sur l’âge des « Sables bleutés du Var » (1966-1980) : Les paradoxes méthodologiques d’une polémique caractéristique de la fin du e XX siècle, entre un géologue amateur, Fernand Touraine, un paléomalacologiste, Roger Rey, et des spécialistes académiques de la paléontologie des mammifères et de la tectonique alpine Résumé.