GARDOUCH Église Saint-Martin
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Terres Du Lauragais
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DU LAURAGAIS 58 communes • 38 545 habitants • A68011 zones d’activités PRÉSIDENT : CHRISTIAN PORTET www.terres-du-lauragais.fr A68 VERS ALBI ZA VAL DE SAUNE BOURG-SAINT-BERNARD Sainte-Foy-d’Aigrefeuille VALLESVILLES SAUSSENS VENDINE Surface disponible : 2,4 ha SAINT-PIERRE-DE-LAGES FRANCARVILLE ZA LOUBENS-LAURAGAIS Surface totale : 9,4 ha ZA PRUNET ZA LANTA LE FAGET MASCARVILLE ALBIAC SAINTE-FOY-D'AIGREFEUILLE TARN ZA LA SALVETAT-LAURAGAIS ZA ZA VILLENOUVELLE AURIN MAUREVILLE CARAMAN ZA Villenouvelle PRÉSERVILLE VERS CASTRES AURIAC-SUR-VENDINELLE Surface disponible : 3 ha TARABEL LE CABANIAL Surface totale : 4,6 ha A61 CARAGOUDES SÉGREVILLE MOURVILLES-BASSES CAMBIAC TOUTENS ZA VILLEFRANCHE- SAINT-GERMIER BEAUVILLE DE-LAURAGAIS ZA MAUREMONT CESSALES A61 TRÉBONS-SUR-LA-GRASSE ZA LE CABANIAL Villefranche-de-Lauragais VILLENOUVELLE SAINT-VINCENT VERS TOULOUSE MONTGAILLARD-LAURAGAIS Le Cabanial Surface totale : 72,4 ha LUX ZA VALLÈGUE Surface disponible : 2,2 ha RIEUMAJOU Surface totale : 7,6 ha MONTESQUIEU-LAURAGAIS SAINT-ROME VILLEFRANCHE- ZA LE TAMBOURET FOLCARDE SAINT-LÉON DE-LAURAGAIS VIEILLEVIGNE 20 ZA Nailloux GARDOUCH ZA RENNEVILLE Surface disponible : 3,8 ha 1 AVIGNONET-LAURAGAIS Surface totale : 10 ha NAILLOUX SEYRE MAUVAISIN MONTCLAR-LAURAGAIS LAGARDE BEAUTEVILLE MONTGEARD AIGNES A66 MONESTROL A61 14,88 % ouvriers CAIGNAC VERS CASTELNAUDARY 26,93 % employés GIBEL CALMONT A66 ZA VERS PAMIERS 19 574 19,77 % ACTIFS agriculteurs 9,27 % autres Service de transports interurbain dont et interdépartemental -

ANNEXE 12 Direction Académique De La Haute Garonne ZONES INFRA POUR VOEUX LARGES DPE 5 8 Zones - Par Zone Géographique
Rectorat de Toulouse MOUVEMENT 2021 ANNEXE 12 Direction académique de la Haute Garonne ZONES INFRA POUR VOEUX LARGES DPE 5 8 zones - Par zone géographique CIRCONSCRIPTIONS code ZONE INFRA SECTEURS COMMUNES RATTACHEES 2021 circo 1 - 2 - 3 - 31000 - 31100 - 31200 - 20211 - TOULOUSE TOULOUSE 4 - 5 - TOULOUSE 19 - 24 31300 - 31400 - 31500 Colomiers COLOMIERS AUSSONNE COLOMIERS 17 DAUX Aussonne MERVILLE MONDONVILLE FROUZINS PLAISANCE DU TOUCH 16 TOURNEFEUILLE Frouzins Seysses SEYSSES TOURNEFEUILLE BRAX LA SALVETAT ST GILLES LASSERRE-PRADERE Lévignac LEGUEVIN 20212 - Haute-Garonne LEVIGNAC OUEST MONTAIGUT SUR SAVE PIBRAC BRIGNEMONT BRETX LEGUEVIN 26 CADOURS COX LAUNAC LE BURGAUD Cadours LE CASTERA MENVILLE PELLEPORT ST CEZERT ST PAUL SUR SAVE THIL BEAUZELLE Blagnac BLAGNAC CORNEBARRIEU BLAGNAC 18 FENOUILLET GAGNAC SUR GARONNE Fenouillet LESPINASSE SEILH CEPET GRATENTOUR Gratentour LABASTIDE ST SERNIN ST SAUVEUR VACQUIERS AUCAMVILLE BRUGUIERES BRUGUIERES 6 CASTELGINEST FONBEAUZARD LAUNAGUET Pechbonnieu MONTBERON PECHBONNIEU 20213 - Haute-Garonne ST ALBAN ST GENIES BELLEVUE NORD ST LOUP CAMMAS BOULOC FRONTON Fronton ST RUSTICE VILLENEUVE LES BOULOC BESSIERES BUZET SUR TARN BONDIGOUX BESSIERES LA MAGDELAINE SUR TARN MIREPOIX SUR TARN GRENADE 23 MONTJOIRE CASTELNAU D ESTRETEFONDS GRENADE Ondes LARRA ONDES ST JORY LE BORN VILLAUDRIC VILLEMUR VILLEMATIER VILLEMUR SUR TARN Edition du 23/03/2021 Page 1/6 Rectorat de Toulouse MOUVEMENT 2021 ANNEXE 12 Direction académique de la Haute Garonne ZONES INFRA POUR VOEUX LARGES DPE 5 8 zones - Par zone géographique -

Les Artistes Emblématiques Du Lauragais
Ecole de Payra- Ecole sur-l’Hers de Montgeard Ecole Ecole d’Avignonet- de Lauragais Vallesvilles Ecole Ecole de Ecole Ecole Mauremont de Souilhe de de Vallègue Gardouch Ecole Ecole de Soupex de Gibel Ecole de Saint-Martin- Les artistes Ecole Lalande Jean Moulin emblématiques de Ecole Castelnaudary de Ecole du Lauragais Caignac de Cenne- 2013/2014 Monestiés Lauragais dans les arts 11e édition SYNDICAT MIXTE DU PAYS LAURAGAIS 3 chemin de l’Obélisque 11320 Montferrand 04.68.60.56.54 - [email protected] www.payslauragais.com ela fait maintenant 11 ans que le Syndicat mixte du Pays Lauragais propose avec le « Lauragais dans les arts » une action culturelle ambitieuse au sein des écoles de son territoire. Ce projet vise en effet à permettre la rencontre entre élèves et artistes dans le but d’enrichir leur culture personnelle Cet de développer leur pratique artistique. Après le succès de la précédente édition consacrée à la gastronomie, le programme a porté cette année sur les artistes emblématiques du Lauragais. Au-delà des grands anonymes du passé tel que le maître de Cabestany, le Lauragais a vu passer depuis le XIXe siècle des figures artistiques notables, tant sur la scène locale que nationale, qui sont autant d’ambassadeurs culturels de notre territoire. Cinq artistes ayant vécu et travaillé dans le Lauragais ont ainsi retenu l’attention des écoles : le poète de langue d’oc Auguste Fourès, les peintres Jean-Paul Laurens et Paul Sibra, le compositeur Déodat de Séverac, et le créateur de tapisserie Dom Robert. La vie et l’œuvre de ces artistes ont servi de point de départ aux enfants pour se réapproprier leur langage plastique ou l’atmosphère de leurs œuvres. -

Centres De Tests Psychotechniques
A jour au 01/05/2017 PRÉFET DE LA HAUTE GARONNE ORGANISMES AGRÉÉS EN HAUTE-GARONNE POUR FAIRE PASSER LES TESTS PSYCHOTECHNIQUES DÉNOMINATION TÉLÉPHONE LIEU DES TESTS Park and Suites- Chemin de Mandillet A.A.A.A.B.C 04.65.26.00.71 31700 CORNEBARRIEU Park and Suites Prestige Blagnac-10, place de la Révolution 31700 BLAGNAC Toulouse espace affaires Labège innopole AGENCE D’ACCOMPAGNEMENT ACTIF A 05.82.95.48.60 41 rue de la découverte L’EVALUATION PSYCHOTECHNIQUE 31676 LABEGE (A.A.A.E.P) Baya Axess 1 rue des pénitents blancs BP 71028 31010 TOULOUSE Buro club AAC 04 78 32 84 79 99 route d’Espagne Bat B 31100 TOULOUSE 33 rue Nicolas Bachelier 31000 TOULOUSE AACC 09.50.07.60.29 32 bis chemin de Raudelauzette 31140 FONBEAUZARD 9 ter avenue Lapeyrière 31240 SAINT JEAN …/… 1, Place Saint Etienne 31038 TOULOUSE CEDEX 9 – Tél. 05 34 45 34 45 http://www.haute-garonne.gouv.fr/ [email protected] DÉNOMINATION TÉLÉPHONE LIEU DES TESTS Chambre d’agriculture 28 route d’Eaunes A.C.C.A. 05 61 07 61 86 31600 MURET Maison des associations 51 rue du Pradet 31800 SAINT-GAUDENS 72 rue riquet 31000 TOULOUSE 478 rue de la découverte - MINI PARC 3 ACTIV POINTS 09.84.43.37.86 31676 LABEGE 07.82.74.74.07 4, rue du midi- ZA La Vache 31270 FROUZINS 06.08.57.34.98 Auto-école Ferrere AEFM 05.61.79.03.45 31440 CIERP GAUD 1 rue des pénitents blancs (4e étage) ALLIANCE PERMIS 06.66.41.31.10 31010 TOULOUSE 10 allée Aristide Maillol ALMEIDA MAIA 05 61 80 74 41 zac des ramassiers 06 50 06 63 85 31770 COLOMIERS AraPL 13 av jean Gonord 31506 TOULOUSE -

Schema Departemental De Gestion Cynegetique De
SCHEMA DEPARTEMENTA L DE GESTION CYNEGETIQUE DE HAUTE-GARONNE Bilan de réalisation du SDGC 2007-2012 Bilan des consultations partenariales Contextes cynégétiques 2013 3 Table des matières Le mot du Président ............................................................................................................................................................................... 5 Introduction ............................................................................................................................................................................................... 6 1-Contexte national et régional ........................................................................................................................................................ 7 2-Bilan du schéma départemental de gestion cynégétique de la Haute-Garonne de 2006 à 2012 .................. 12 3-Bilan des consultations des activités en relation avec les territoires cynégétiques ................................................... 21 4-Evolution de l’activité cynégétique en Haute-Garonne ....................................................................................................... 23 4.1-Evolutions relatives aux espèces ...................................................................................................................................... 23 4.2-Evolutions relatives aux chasseurs ................................................................................................................................. 30 4.3-Evolutions relatives -

Centres Spécifiques COVID
CENTRES DE CONSULTATIONS COVID-19 EN HAUTE-GARONNE COMMUNE (HORS TOULOUSE) CENTRE COVID-19 MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE - ASPET LOTISSEMENT DU PONT NEUF 31160 ASPET FRONTON MAISON DE SANTÉ DES TERRES D'AURIGNAC - ")VILLE MUR-SUR-TARN AURIGNAC ") CHEMIN DE LA FONTAINE VIELLE 31420 AURIGNAC GYMNASE DU COLLÈGE ANTONIN PERBOSC - 18 " AUTERIVE BORDEROUGE BIS AVENUE D'HERMANNSBURG 31190 AUTERIVE CASTE LNAU-D'E STRE TE FONDS") SALLE DU COMPAS - 4 RUE DES JARDINS BALMA 31130 BALMA " SAINT-JORY") ") SALLE MUNICIPALE LA COOPÉ - ALLÉE PAUL CADOURS LABASTIDE -SAINT-SE RNIN BAZIÈGE "MINIMES MARTY, 31450 BAZIÈGE ")CASTE LGINE ST GYMNASE - ROUTE DE LÉVIGNAC FENOUILLET") "SOUPETARD CADOURS PONTS JUMEAUX " 31480 CADOURS Ne pas se rendre "MATABIAU ")VE RFE IL ") ") SALLE DES FÊTES DE CARBONNE - 5 ROUTE DE directement au CORNE BARRIE U CARBONNE L'UNION LACAUGNE 31390 CARBONNE Centre, appelez ") COLOMIE RS BALMA") SALLE DU LAC - BOULEVARD DES " CASTANET-TOLOSAN votre médecin SAINT-CYPRIEN "GUILHEMERY CAMPANHOLS 31320 CASTANET-TOLOSAN TOURNEFEUILLE") traitant avant ! ")PLAISANCE -DU-TOUCH" "LES PRADETTES CASTELGINEST 21 RUE DE L'ÉGLISE 31780 CASTELGINEST ") "PONT DES DEMOISELLES ") " SAINT-ORE NS-DE -GAME VILLE FAOURETTE " FONSORBE S ") CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS SALLE MULTISPORT - AVENUE DE MONTAUBAN "EMPALOT 31620 CASTELNAU-D'ESTRÉTEFONDS VILLE NEUVE -TOLOSANE" RAMONVILLE")CASTANE T-TOLOSAN " ROQUES GYMNASE DU COLLÈGE DU PLANTAUREL - RUE ") ") CROIX DE PIERRE CAZÈRES PINS-JUSTARET LABARTHE -SUR-LE ZE RAOUL SERRES 31220 CAZÈRES SAINTE -FOY-DE -PE YROLIERE -

Calendrier Poule A
CALENDRIER DES RENCONTRES SAISON 2017 / 2018 PAGE 1 POULE A VETERANS SEMAINE DU 2 au 6 octobre 2017 CLUB CLUB TERRAIN ST.ORENS FOOTBALL CLUB AS LABARTHE SUR LEZE St Orens Synthé Vendredi 20H30 US PINS JUSTARET VILLATE AS MURET Pins Justaret Venderdi 20h30 ASIP POMPERTUZAT (INTER FC) TOULOUSE F.C Pompertuzat Vendredi 20H GARDOUCH O.C. AUTAN AYGUEVIVES Gardouch Vendredi 20H LABEGE - C.L.PECHABOU FOOT AMIS CLUB Labège Synthé Vendredi 21h00 FC DE L'AUTAN 2 CONFLUENT/LSP Montgiscard Vendredi 20h45 SEMAINE DU 9 au 13 octobre 2017 CLUB CLUB TERRAIN AS LABARTHE SUR LEZE US PINS JUSTARET VILLATE Labarthe sur Lèze Synt. Vend. 20h30 TOULOUSE F.C ST.ORENS FOOTBALL CLUB STADIUM Synt. Brice Taton Vend.20H AS MURET GARDOUCH O.C. Muret (Nelson Paillou) Vend. 21H FOOT AMIS CLUB ASIP POMPERTUZAT (INTER FC) Villefranche de Lauragais Vend. 21h00 AUTAN AYGUEVIVES FC DE L'AUTAN 2 Ayguesvives Vendredi 20h CONFLUENT/LSP LABEGE - C.L.PECHABOU Lacroix Falgarde Vend.20h30 SEMAINE DU 16 au 20 octobre 2017 CLUB CLUB TERRAIN AS LABARTHE SUR LEZE TOULOUSE F.C Labarthe sur Lèze Synt. Vend. 20h30 GARDOUCH O.C. US PINS JUSTARET VILLATE Gardouch Vendredi 20H ST.ORENS FOOTBALL CLUB FOOT AMIS CLUB St Orens Synthé Vendredi 20H30 FC DE L'AUTAN 2 AS MURET Montgiscard Vendredi 20h45 ASIP POMPERTUZAT (INTER FC) CONFLUENT/LSP Pompertuzat Vendredi 20H LABEGE - C.L.PECHABOU AUTAN AYGUEVIVES Labège Synthé Vendredi 21h00 SEMAINE DU 6 au 10 novembre 2017 CLUB CLUB TERRAIN GARDOUCH O.C. AS LABARTHE SUR LEZE Gardouch Vendredi 20H FOOT AMIS CLUB TOULOUSE F.C Villefranche de Lauragais Vend. -

Horaires Et Trajet De La Ligne 383 De Bus Sur Une Carte
Horaires et plan de la ligne 383 de bus 383 Salles-Sur-L'Hers / Toulouse Voir En Format Web La ligne 383 de bus (Salles-Sur-L'Hers / Toulouse) a 2 itinéraires. Pour les jours de la semaine, les heures de service sont: (1) Salles-Sur-L'Hers / Toulouse: 06:45 - 17:20 (2) Toulouse / Salles-Sur-L'Hers: 07:30 - 18:10 Utilisez l'application Moovit pour trouver la station de la ligne 383 de bus la plus proche et savoir quand la prochaine ligne 383 de bus arrive. Direction: Salles-Sur-L'Hers / Toulouse Horaires de la ligne 383 de bus 40 arrêts Horaires de l'Itinéraire Salles-Sur-L'Hers / Toulouse: VOIR LES HORAIRES DE LA LIGNE lundi 06:45 - 17:20 mardi 06:45 - 17:20 Salles-Sur-L'Hers - Place Marengo Rue Marengo, Salles-sur-l'Hers mercredi 06:45 - 17:20 Salles-Sur-L'Hers - Route De Toulouse jeudi 06:45 - 17:20 Saint-Michel-De-Lanes - Centre vendredi 06:45 - 17:20 Rue du Pont de l'Hers, Saint-Michel-De-Lanes samedi 07:00 Beauteville - Labarraque dimanche Pas opérationnel Montclar-Lauragais - Le Châtelet Montclar-Lauragais - Cassejus Informations de la ligne 383 de bus Renneville - Tirane Direction: Salles-Sur-L'Hers / Toulouse Arrêts: 40 Gardouch - Poids Public Durée du Trajet: 55 min Rue du Poids Public, Gardouch Récapitulatif de la ligne: Salles-Sur-L'Hers - Place Marengo, Salles-Sur-L'Hers - Route De Toulouse, Gardouch - La Vierge Saint-Michel-De-Lanes - Centre, Beauteville - Avenue Tolosane, Gardouch Labarraque, Montclar-Lauragais - Le Châtelet, Montclar-Lauragais - Cassejus, Renneville - Tirane, Gardouch - Laval Gardouch - Poids Public, Gardouch -

Occupation Des Installations Du 17/03/2018 Au 26/05/2018 17/03
DISTRICT HAUTE GARONNE Occupation des installations du 17/03/2018 au 26/05/2018 Heure Match Code Minitel Equipe recevant Equipe visiteur Compet Abr Poule 310360102 Stade Municipal 2 à AUZIELLE 17/03/2018 14H30 20381816 61456.1 529785 Auzielle Js 1 - 537942 Hersoise As 1 U11D2 A 14H30 20381817 61457.1 521351 St Jory Ese 1 - 524391 T.F.C. (Fém.) 3 U11D2 A 15H 20381818 61458.1 529785 Auzielle Js 1 - 524391 T.F.C. (Fém.) 3 U11D2 A 15H 20381819 61459.1 521351 St Jory Ese 1 - 537942 Hersoise As 1 U11D2 A 310690301 Stade Des Barradels 1 à BLAGNAC 07/04/2018 14H30 20381857 61481.1 529785 Auzielle Js 1 - 519585 Gardouch Oc 1 U11D2 A 14H30 20381856 61480.1 519456 Blagnac Fc 3 - 521351 St Jory Ese 1 U11D2 A 15H 20381864 61482.1 519456 Blagnac Fc 3 - 519585 Gardouch Oc 1 U11D2 A 15H 20381865 61483.1 529785 Auzielle Js 1 - 521351 St Jory Ese 1 U11D2 A 310880102 Stade Municipal 2 à BRAX 07/04/2018 14H30 20381852 61476.1 524782 Brax Js 1 - 524391 T.F.C. (Fém.) 3 U11D2 A 14H30 20381853 61477.1 563648 St Alban Aucamville 3 - 537942 Hersoise As 1 U11D2 A 15H 20381855 61479.1 563648 St Alban Aucamville 3 - 524391 T.F.C. (Fém.) 3 U11D2 A 15H 20381854 61478.1 524782 Brax Js 1 - 537942 Hersoise As 1 U11D2 A 311180103 Stade Municipal N°3 à CASTELNAU D ESTRETEFONDS 24/03/2018 14H30 20381845 61469.1 516782 L'Union As 1 - 521351 St Jory Ese 1 U11D2 A 14H30 20381844 61468.1 520607 Castelnau Est 1 - 529785 Auzielle Js 1 U11D2 A 15H 20381847 61471.1 516782 L'Union As 1 - 529785 Auzielle Js 1 U11D2 A 15H 20381846 61470.1 520607 Castelnau Est 1 - 521351 St Jory Ese -

Ecluse De Négra Montesquieu-Lauragais, FR 31450
Direction Locaboat Holidays 10 Rue de Villenouvelle – Ecluse de Négra Montesquieu-Lauragais, FR 31450 [email protected] T: + 33 (0) 5 61 81 36 40 F: + 33 (0) 5 61 81 36 43 G: N 43°25’04.53 E 01°38’28.39 Starting out formalities & boarding Starting out formalities: Boarding : departure days between 2 and 6 pm. As soon as the boat is ready. On site: WC and shower according to the opening hours of the base. How to get to the base Access: Parking: A61 – E80 exit 20 Villefranche-de-Lauragais. At the roundabout enclosed, not guarded: € 35/week. follow dir. Gardouch (D622). At Gardouch, turn right on D16 dir. Montesquieu Lauragais. After 5 km, turn right on D11 dir. ‘Ecluse en Négra’. The base is situated at the lock. train station Villefranche-Lauragais (8 km) TGV station Toulouse (40 km) airport Toulouse-Blagnac (47 km) airport Carcassonne-Salvaza (64 km) Car hire: Taxi : Avis (Toulouse, 40 km) tel.: 05 61 62 50 40 Bettinger, tel.: 06 19 55 29 97 (minibus) Europcar (Toulouse, 40 km) tel.: 05 61 73 30 50 Canal du Midi tel.: 06 61 76 45 48 Hertz (Toulouse, 40 km) tel.: 08 25 86 18 61 Sixt (Toulouse, 40 km) tel.: 08 20 00 74 98 Hotels, restaurants and shopping facilities on site Hotels : Restaurants : Du Lauragais (Villefranche-de-Lauragais, 8 km) le Vieux Four (Montesquieu-Lauragais, 1 km) tel.: 05 61 27 00 76 – Fax: 05 61 81 17 23 tel.: 05 61 27 52 92 De France (Villefranche-de-Lauragais, 8 km) La Pradelle (Villefranche-de-Lauragais, 8 km) tel.: 05 61 81 62 17 – Fax: 05 61 81 66 04 tel.: 05 61 81 60 72 – Fax : 05 61 81 92 39 La Pradelle (Villefranche-de-Lauragais, 8 km) L’Escarbille (at D813 between Montgiscard and Donneville), tel.: 05 61 81 60 72 – Fax: 05 61 81 92 39 tel.: 05 61 81 90 52 Le phoenix a Villenouvelle (2 km) tel.: +33 (0)5 61 80 37 67 La Pizza Gauloise (7 km, Gardouch) tel.: +33 (0)5 61 46 38 58 Shops : Markets : at Gardouch (4 km): closed on mondays at Gardouch (4 km): sale of vegetables and fruits at Villefranche (8 km): closed on Sunday afternoons. -

The Markets of Toulouse - an Art of Living
PUBLISHED BY THE CONSEIL DÉPARTEMENTAL OF HAUTE-GARONNE 02 SUMMER 2018 HERITAGE & discovery Lake Saint Ferréol DESTINATION HAUTE- GARONNE PUBLISHED BY THE CONSEIL DÉPARTEMENTAL OF HAUTE-GARONNE ÉDITORIAL 1, boulevard de la Marquette BY GEORGES MÉRIC 31090 Toulouse Cedex 9 PRESIDENT OF THE CONSEIL DÉPARTEMENTAL Tel. +33(05 34 33 32 31 OF HAUTE-GARONNE HEAD OF THE PUBLICATION There are many reasons why you should spend this summer in Haute-Garonne. Georges Méric From its pastures to the middle valley of the Garonne and the high Pyrenean COORDINATION mountains, the Haute-Garonne is both stunning and surprising - with its landscapes François Boursier and villages and the multitude of activities on offer. In the heart of Occitania, it passionately cultivates history and is known worldwide for CHIEF EDITOR Julie Pontonnier its modernity. and Aurélie Renne Since the famous Venus of Lespugne, sculpted at the beginning of humanity, to the latest leaders in the aeronautic and space industries, the Haute-Garonne is an CONTRIBUTED TO THIS EDITION admirable showcase for curiosity and inventiveness, art and technology, expertise Pascal Alquier, Émilie Gilmer, and skill. Nicolas Héry, Élodie Pagès, Set off to explore all of its wonders and you will experience surprising nature, unique Isabelle Prunier heritage, and an art of living based on interaction, sharing and exchange. and Axelle Szczygiel The surprises will just keep coming ! PHOTOS The great Saint-Bertrand-de-Comminges listed as a Unesco world heritage site ; Loïc Bel, Aurélien Ferreira, the -
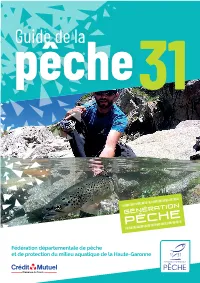
Guide-Peche-2021.Pdf
Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Haute-Garonne Plaisance du Touch SOMMAIRE RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE 4 Quelle carte pour 2021 6 Périodes d’ouverture et tailles légales 8 Comment mesurer un poisson 8 Limitation du nombre de captures 9 Nombre de cannes autorisées 9 Appâts 9 Classement piscicole 10 Heures légales de pêche 11 Modes de pêche prohibés 11 Procès verbaux 12 Réserves et pêches interdites 16 Les écrevisses PARCOURS SPÉCIAUX 18 Parcours spécifiques Μ22 Parcours animations pêche pour enfants 23 Parcours touristique et initiation 24 Parcours détente et initiation AGIR POUR LA PÊCHE 26 Calendriers des lâchers de truites 2021 28 Pêche en barque et float tube 28 Mises à l’eau 29 Pêche en embarcation en Haute-Garonne 30 Les associations de pêche 32 Les Ateliers Pêche Nature (APN) 33 Le pôle animation 31 34 Les dépositaires 38 Les pontons 40 Au service de la pêche 42 La garderie fédérale 44 Guide de pêche 44 Pêches spécialisées 46 Les hébergements pêche A L’INTÉRIEUR CARTE DÉTACHABLE > Réseau départemental > Lacs et plans d’eau > Lacs de montagne > Poster poissons LE MOT DU PRÉSIDENT L’année 2020 avait bien commencé et laissait présager une bonne année halieutique. La crise sanitaire et son train de mesures restrictives, est hélas venue perturber la pratique de notre loisir. Pour faire face à cette situation inédite, nous avons dû nous organiser pour assurer la continuité de gestion de la Fédération tout en respectant les consignes du confinement. Nous avons eu recours au télétravail pour le service administratif et à l’arrêt provisoire du service développement.